
C'est grâce au corps que le cerveau peut penser
Jean-Didier Vincent, Pascale-Marie Deschamps | 01 juin 2008
Entretien avec Jean-Didier Vincent, neurobiologiste, membre de l’Institut, membre du directoire de la Fondation pour l’innovation politique.
Jean-Didier Vincent : « C’est grâce au corps que le cerveau peut penser »
Enjeux-Les Echos – Grâce à l’imagerie, à la biophysique et à la génétique, on sait désormais décrire le cerveau et son fonctionnement dans leurs moindres détails moléculaires. Que reste-t-il à comprendre ?
Jean-Didier Vincent – Tout ! Le cerveau est un continent dont on vient tout juste de découvrir les complexités et les quelques principes de base qui l’organisent avec une véritable constance. Mais au fond, on ne sait rien de lui. Ainsi, on ne comprend toujours pas comment on passe de la perception réelle d’un être que l’on désire à l’envie de le connaître, de partager avec lui, de l’aimer. On connaît les zones qui vont être impliquées et on sait ce qui se passe chimiquement, mais ensuite… il se joue une opération par laquelle cette perception réelle devient une chose mentale qui n’est pas directement isomorphe à ce qui se passe dans le cerveau. Ce n’est plus de la chimie, mais ce n’est pas non plus un mystère de l’ordre de l’impalpable, ni l’effet d’un esprit qui agirait de l’extérieur.
Qu’est-ce qui change entre la perception réelle et la reconstitution de cette perception ?
J. -D. V. – Faites cette expérience. Vous connaissez le drapeau américain ? Imaginez-le maintenant. Combien a- t-il d’étoiles ? Si vous connaissez le nombre d’Etats américains, vous le savez. Mais si je vous demande combien il a de bandes, vous ne saurez pas les compter à partir de l’image reconstruite. Et pourtant, ce drapeau est bien là devant vous : vous le reconnaissez dans votre tête. Pour convoquer cette image, vous allez activer exactement les mêmes structures cérébrales qu’au moment où vous l’avez regardé pour la première fois. Mais vous n’arrivez pas à travailler sur cette image-souvenir comme sur l’image réelle : vous l’avez reconstruite, mais elle n’est plus là. En même temps, elle est présente à vous. On ne peut pas dire « à votre esprit », car votre cerveau l’a refabriquée avec les mêmes structures. On ne sait pas comment ça marche. Là s’arrête notre connaissance scientifique, là commencent les problèmes philosophiques.
Faute de mieux, c’est ce que vous appelez l’âme ?
J. -D. V. – En effet, mais ce n’est pas quelque chose qui flotte dans l’air, ni un fluide invisible. Ni cette chose que Descartes accrochait à l’épiphyse (glande pinéale) pour mieux s’en débarrasser. L’auteur des Passions de l’âme savait bien que les passions naissent dans le cerveau et que celui-ci est l’expression de la chair. Quand il était amoureux, c’était avec son corps. Je suis aussi de ceux qui pensent que le cerveau fonctionne essentiellement à partir d’affects : il est ému par le corps, le corps étant lui-même, par la manière dont il le perçoit, le reflet de ce qui se passe dans le monde où il s’exprime et agit. Cette perception va se manifester dans ce que j’appelle l’âme. Celle-ci étant simplement ce que dit le cerveau, « le cri de la chair », disait Epicure. Je commence à parler de mon âme quand je dis « je » : je suis celui qui voit ceci, qui veut faire cela, celui qui souffre, qui fait ce choix, qui reçoit ou qui émet cette information. Ce « je » est l’ego, le « self » comme disent les Américains, la conscience de soi. Bref, l’ego c’est l’âme. C’est aussi la définition qu’en donnait Sartre, un philosophe qui ne passe pas pour un grand déiste : l’âme est l’ego dans tous ses états, le moi et le je.
Neurobiologiste, pourquoi défendez-vous la psychanalyse face aux prétentions des pharmacologues et des cogniticiens de tout régler par des drogues et des réapprentissages ?
J. -D. V. – Ces professionnels rendent de grands services mais n’expliquent rien. Chez le psychanalyste, c’est un sujet qui parle. La psychanalyse fait au moins un effort de compréhension. Elle a été la porte ouverte sur l’inconscient, mais celui-ci n’a pas à être réifié ou déifié. Simplement, 95% du fonctionnement du cerveau ne parvient pas à la conscience. Un cerveau voit, pense, agit, décide, invente, crée, le plus souvent sans que les étapes intermédiaires soient conscientes. Ce qui ne veut pas dire que c’est l’inconscient qui s’exprime en soi. En revanche, le rêve est vraiment une fenêtre sur l’inconscient. Vous êtes endormi ou allez l’être mais de façon si soudaine que lors de votre éveil vous allez prendre conscience d’un rêve qui vient de se dérouler. C’est le témoignage que le cerveau continue d’associer des images, à travailler, à se raconter des histoires. Il n’est jamais au repos.
Nous sommes, dites-vous, des « bêtes » culturelles et sentimentales. Qu’est-ce qui au fond nous distingue des animaux ?
J. -D. V. – Tous les animaux ont un cerveau et un système nerveux. La méduse aussi, même si ce n’est pas grand-chose. Elle a cependant en puissance tout ce qui adviendra chez les autres espèces : des fibres sensibles, des ébauches de neurones, des yeux. Ils ne lui servent pas à regarder car il n’y a pas de nerfs pour les relier au cerveau. Mais, la vie présentant une grande uniformité, les yeux de la méduse, ceux de la grenouille et les nôtres sont fabriqués exactement par les mêmes gènes. Nous sommes, comme les animaux, le produit par essais/erreurs de l’évolution et de la sélection naturelle.
La première grande différence survient avec les vertébrés. Leur génome leur donne une certaine liberté de jeu dans l’appariement des gènes. C’est cette individuation qui fait leur singularité. Il n’y a pas d’individus chez les abeilles (à l’exception des reines), même si elles font preuve de performances cognitives exceptionnelles. Enfin, les vertébrés souffrent et ressentent du plaisir. C’est pourquoi je dis qu’il n’y a pas d’acte, de pensée, de représentation sans un substrat perceptif. Le cerveau doit être affecté pour penser, il lui faut un corps pour agir et pour sentir. Tout ce qui est dans la chair et le corps affecte le cerveau et modifie son fonctionnement – en patois on dit chez moi : « je joui, don je soui ». Mettez un cerveau sur la table, vous n’en ferez rien. Même les corps les plus désensibilisés par des amputations, des paralysies, des maladies laissent des souvenirs qui affectent le cerveau.
Seulement, à la différence des animaux, nous avons dans le cortex frontal des neurones miroirs qui nous permettent de reproduire dans notre corps ce que fait l’autre, et de le simuler. C’est ce qui nous permet de le comprendre. J’appelle compassion ce processus qui se produit dans le cortex frontal et qui est propre à l’homme. La compassion implique le partage et la compréhension des gestes, des actions, des passions et finalement des sentiments de l’autre. Enfin, ce cortex frontal très développé nous donne la connaissance du temps qui dure et par là une conscience de soi. Je n’ai conscience de m’appeler Vincent que parce que j’en connais l’histoire : je sais qu’il y a dix minutes j’étais déjà Vincent et que je le serai encore demain. De notre point de vue d’humain – nous sommes juge et partie, l’homme est le plus perfectionné des êtres vivants. Mais rien n’exclut que notre point de vue puisse être erroné.
Ame, compassion… vous utilisez un langage religieux surprenant chez un biologiste matérialiste, mécréant revendiqué…
J. -D. V. – Après les avoir oubliées, je retrouve mes racines protestantes. Mais on ne peut pas être biologiste et conserver la foi de son enfance. C’est impossible. Médecin on est confronté à la mort, à la matérialité du vivant. Il n’y aucun argument logique pour, par exemple, accepter la résurrection de la chair. C’est impossible pour un scientifique et c’est là-dessus que j’achoppe quand je discute avec les théologiens. J’essaie alors de renvoyer à la « communion des saints » qui n’a pas besoin de la résurrection de la chair pour se réaliser car elle a justement pour support la compassion. C’est une résurrection qui se fait dans le coeur des autres et qui permet à l’homme, en étant une partie infime d’une immense communion, de ne pas être seul et relégué en enfer. Car, voyez-vous, je vais jusqu’à accepter la notion d’enfer. L’enfer c’est le non-être, le néant. Pour Origène, c’était la mort, mais là, c’est la mort de la mort. Le néant n’est en effet supportable que dans la mesure où la mort peut être à l’origine d’une sorte de don de soi aux autres : vous léguez vos gènes, mais aussi ce que vous avez été et ce que vous avez apporté d’amour et de compassion aux autres. Ceux qui se coupent des autres et meurent loin d’eux peuvent perdre tout espoir. Ceux qui ont vandalisé ces capacités de l’amour de l’autre et qui n’auront pas été à la vraie table – celle qui rassasie car elle apporte l’amour et qui peut être douloureuse car les processus qui opposent le plaisir et la souffrance sont présents dans la chair même du cerveau, ceux-là sont voués à l’enfer du non-être.
Que vous inspirent ces « neurothéologiens » pour qui il y aurait dans le cerveau une aire dédiée à la foi ?
J. -D. V. – Leur idée est très simple : si Dieu a fait l’homme à son image, il a bien été obligé de créer une zone dans le cerveau qui permet de le reconnaître. IRM à l’appui, ils montrent que la prière et la méditation activent le cortex pariétal inférieur droit et en font le siège de la foi. C’est aussi absurde que la neuroéconomie qui prétend utiliser l’imagerie cérébrale pour expliquer, modéliser, voire prédire le comportement des agents économiques. La foi reste quelque chose de mystérieux par essence. Je choque beaucoup les prélats quand je leur dis que leur foi est ce qui guide le caneton de Konrad Lorenz quand il suit la boîte de conserve qu’à sa naissance on a substituée à sa mère cane. A mon sens, la foi résulte d’un phénomène d’empreinte similaire. On vous l’inculque quand vous êtes petit, elle s’imprime très tôt par l’éducation. Si les dispositifs neuronaux de l’humain le disposent au langage et à la culture, ils ne s’activent qu’au contact des autres, d’un père, d’une mère. Comme le dit Kant, on naît deux fois, la première fois du ventre de sa mère et, la seconde fois, de son éducation.
Aujourd’hui, on compare volontiers le cerveau à un superordinateur. Jusqu’où l’analogie est-elle exacte ?
J. -D. V. – L’informatique est en effet à l’origine des sciences cognitives. D’où l’idée que le cerveau est un gros ordinateur qui traite des algorithmes. Il suffirait donc de connaître ces algorithmes pour savoir comment le cerveau fonctionne. Mais c’est aller un peu vite en besogne car nos capacités en informatique et en algorithmes sont pour l’instant limitées. A ce jour, la vie telle qu’elle se présente n’est pas réductible à un ordinateur tel qu’on les connaît. Cela dit, ce mouvement philosophico-scientifique qu’on appelle transhumanisme nie ces limites et prétend que les cognisciences – la convergence des nanotechnonologies, des biotechnologies et des sciences de l’information – permettront de pénétrer au coeur même des algorithmes responsables de la pensée de type humain, c’est-à-dire avec un moi, une subjectivité, etc.
Il existe déjà des machines mixtes mêlant neurones et puces et des programmes cérébraux. Pour des fonctions simples, comme les fonctions motrices, on parvient déjà grâce à des électrodes placées au bon endroit dans le cerveau à faire déclencher des mouvements par la pensée. On pourra même envisager la communication intersubjective par transmission d’algorithmes à partir d’une psyché artificielle. Pourquoi pas ? Les transhumanistes pensent que la possibilité de penser l’impensable est la preuve même que l’on peut rendre possible l’impossible. Ils prennent au pied de la lettre la preuve de saint Anselme pour qui l’existence de l’inexplicable est la meilleure preuve que Dieu existe car s’il y a de l’inexplicable, il y a forcément une entité qui dépasse cet inexplicable.
En admettant que les transhumanistes parviennent à leurs fins, verra-t-on pour autant apparaître une nouvelle espèce humaine ?
J. -D. V. – C’est une question qui me taraude. Notre espèce est-elle le fin du fin en matière d’évolution ou y aura-t-il une spéciation ? La plupart des espèces disparaissent mais auparavant elles ont quelquefois donné des branches. Repartirons-nous du singe ? Ce n’est pas évident. Si l’espèce humaine venait à disparaître rien ne pourra immédiatement prendre le relais tant elle a exploité son biotope, au point qu’elle n’en a pas vraiment puisque nous allons sur la Lune en scaphandre. En revanche, elle est susceptible d’en former une autre. On fera des robots qui se reproduiront en faisant la synthèse de leur propre corps grâce à de nouvelles molécules qui s’auto-répliqueront. On trouvera des solutions pour accroître leurs performances. Ça marchera chez certains, chez d’autres non. Les transhumanistes adoptent le principe de l’imperfectibilité : plus il y a d’imperfections, plus les chances augmentent de tomber sur quelque chose qui marche. Ils reproduisent le processus de l’évolution mais en l’accélérant et en devenant non plus les maîtres et possesseurs de la nature, comme le voulait Descartes, mais en produisant une nouvelle nature. Celle que nous connaissons, créée en quelque 4 milliards d’années de manière tout à fait aléatoire et contingente, apparaîtra comme une vieille nature obsolète. Les nouveaux ingénieurs recréeront une vie différente qui n’utilisera pas l’ADN mais ces nouvelles molécules autoréplicantes qui se combineront et, par la pression du milieu et la sélection naturelle, survivront ou disparaîtront.
Qu’adviendra-t-il dans ce cas des humains d’aujourd’hui ?
J. -D. V. – Ce qui s’est déjà passé sur la Terre il y a quelque 3,5 milliards d’années, quand par la sélection naturelle, le jeu des possibles et la défaite de tous sauf un – un seul code génétique a survécu – l’ADN. Auparavant, en ces périodes prébiotique et abiotique, plusieurs codes autoréplicants ont dû cohabiter. Puis une seule cellule a gagné en se reproduisant aux dépens des autres. Avec l’apparition des premiers hominidés, tout est allé très vite. Homo sapiens a fini par l’emporter sur les autres. Neandertal, le dernier, a disparu par hybridation ou extinction. De la même façon, il se peut que la loi de la sélection naturelle amène soit la disparition, soit la régression de l’espèce. Jusqu’ici la spéciation se faisait par les barrières géographiques. Quand des individus au sein d’une espèce n’ont plus accès à la reproduction, ils se séparent et à partir de là deux espèces font leur chemin. Admettons qu’on commence à améliorer le cerveau par des hybridations avec des puces. Certains s’y refuseront ou n’en auront pas les moyens économiques. Si une partie des humains n’a plus accès à la reproduction ou se reproduisent entre eux sans avoir accès à l’hybridation avec les autres, deux espèces émergeront, l’une probablement plus puissante que l’autre. Toutes les barbaries sont alors imaginables.
Mais les transhumains pourraient-ils aussi être poètes ?
J. -D. V. – Je me le demande. La poésie est peut-être le mode de connaissance suprême qui est offert à l’individu, et elle se met difficilement du côté de la raison. La poésie est-elle comprise dans le programme ? Programmée, elle cesserait d’être de la poésie. La poésie, celle qui est une vision, est non réductible à des algorithmes mathématiques et ne peut pas fonctionner avec la théorie des jeux. Ça ne marche que lorsque l’autre est derrière. Un art qui ne s’adresse pas à l’autre a manqué sa fonction. Il y a toujours quelque chose de divin chez le poète. La transhumanité pourrait fort bien être dépourvue de cette transcendance.
Jean-Didier Vincent – Tout ! Le cerveau est un continent dont on vient tout juste de découvrir les complexités et les quelques principes de base qui l’organisent avec une véritable constance. Mais au fond, on ne sait rien de lui. Ainsi, on ne comprend toujours pas comment on passe de la perception réelle d’un être que l’on désire à l’envie de le connaître, de partager avec lui, de l’aimer. On connaît les zones qui vont être impliquées et on sait ce qui se passe chimiquement, mais ensuite… il se joue une opération par laquelle cette perception réelle devient une chose mentale qui n’est pas directement isomorphe à ce qui se passe dans le cerveau. Ce n’est plus de la chimie, mais ce n’est pas non plus un mystère de l’ordre de l’impalpable, ni l’effet d’un esprit qui agirait de l’extérieur.
Qu’est-ce qui change entre la perception réelle et la reconstitution de cette perception ?
J. -D. V. – Faites cette expérience. Vous connaissez le drapeau américain ? Imaginez-le maintenant. Combien a- t-il d’étoiles ? Si vous connaissez le nombre d’Etats américains, vous le savez. Mais si je vous demande combien il a de bandes, vous ne saurez pas les compter à partir de l’image reconstruite. Et pourtant, ce drapeau est bien là devant vous : vous le reconnaissez dans votre tête. Pour convoquer cette image, vous allez activer exactement les mêmes structures cérébrales qu’au moment où vous l’avez regardé pour la première fois. Mais vous n’arrivez pas à travailler sur cette image-souvenir comme sur l’image réelle : vous l’avez reconstruite, mais elle n’est plus là. En même temps, elle est présente à vous. On ne peut pas dire « à votre esprit », car votre cerveau l’a refabriquée avec les mêmes structures. On ne sait pas comment ça marche. Là s’arrête notre connaissance scientifique, là commencent les problèmes philosophiques.
Faute de mieux, c’est ce que vous appelez l’âme ?
J. -D. V. – En effet, mais ce n’est pas quelque chose qui flotte dans l’air, ni un fluide invisible. Ni cette chose que Descartes accrochait à l’épiphyse (glande pinéale) pour mieux s’en débarrasser. L’auteur des Passions de l’âme savait bien que les passions naissent dans le cerveau et que celui-ci est l’expression de la chair. Quand il était amoureux, c’était avec son corps. Je suis aussi de ceux qui pensent que le cerveau fonctionne essentiellement à partir d’affects : il est ému par le corps, le corps étant lui-même, par la manière dont il le perçoit, le reflet de ce qui se passe dans le monde où il s’exprime et agit. Cette perception va se manifester dans ce que j’appelle l’âme. Celle-ci étant simplement ce que dit le cerveau, « le cri de la chair », disait Epicure. Je commence à parler de mon âme quand je dis « je » : je suis celui qui voit ceci, qui veut faire cela, celui qui souffre, qui fait ce choix, qui reçoit ou qui émet cette information. Ce « je » est l’ego, le « self » comme disent les Américains, la conscience de soi. Bref, l’ego c’est l’âme. C’est aussi la définition qu’en donnait Sartre, un philosophe qui ne passe pas pour un grand déiste : l’âme est l’ego dans tous ses états, le moi et le je.
Neurobiologiste, pourquoi défendez-vous la psychanalyse face aux prétentions des pharmacologues et des cogniticiens de tout régler par des drogues et des réapprentissages ?
J. -D. V. – Ces professionnels rendent de grands services mais n’expliquent rien. Chez le psychanalyste, c’est un sujet qui parle. La psychanalyse fait au moins un effort de compréhension. Elle a été la porte ouverte sur l’inconscient, mais celui-ci n’a pas à être réifié ou déifié. Simplement, 95% du fonctionnement du cerveau ne parvient pas à la conscience. Un cerveau voit, pense, agit, décide, invente, crée, le plus souvent sans que les étapes intermédiaires soient conscientes. Ce qui ne veut pas dire que c’est l’inconscient qui s’exprime en soi. En revanche, le rêve est vraiment une fenêtre sur l’inconscient. Vous êtes endormi ou allez l’être mais de façon si soudaine que lors de votre éveil vous allez prendre conscience d’un rêve qui vient de se dérouler. C’est le témoignage que le cerveau continue d’associer des images, à travailler, à se raconter des histoires. Il n’est jamais au repos.
Nous sommes, dites-vous, des « bêtes » culturelles et sentimentales. Qu’est-ce qui au fond nous distingue des animaux ?
J. -D. V. – Tous les animaux ont un cerveau et un système nerveux. La méduse aussi, même si ce n’est pas grand-chose. Elle a cependant en puissance tout ce qui adviendra chez les autres espèces : des fibres sensibles, des ébauches de neurones, des yeux. Ils ne lui servent pas à regarder car il n’y a pas de nerfs pour les relier au cerveau. Mais, la vie présentant une grande uniformité, les yeux de la méduse, ceux de la grenouille et les nôtres sont fabriqués exactement par les mêmes gènes. Nous sommes, comme les animaux, le produit par essais/erreurs de l’évolution et de la sélection naturelle.
La première grande différence survient avec les vertébrés. Leur génome leur donne une certaine liberté de jeu dans l’appariement des gènes. C’est cette individuation qui fait leur singularité. Il n’y a pas d’individus chez les abeilles (à l’exception des reines), même si elles font preuve de performances cognitives exceptionnelles. Enfin, les vertébrés souffrent et ressentent du plaisir. C’est pourquoi je dis qu’il n’y a pas d’acte, de pensée, de représentation sans un substrat perceptif. Le cerveau doit être affecté pour penser, il lui faut un corps pour agir et pour sentir. Tout ce qui est dans la chair et le corps affecte le cerveau et modifie son fonctionnement – en patois on dit chez moi : « je joui, don je soui ». Mettez un cerveau sur la table, vous n’en ferez rien. Même les corps les plus désensibilisés par des amputations, des paralysies, des maladies laissent des souvenirs qui affectent le cerveau.
Seulement, à la différence des animaux, nous avons dans le cortex frontal des neurones miroirs qui nous permettent de reproduire dans notre corps ce que fait l’autre, et de le simuler. C’est ce qui nous permet de le comprendre. J’appelle compassion ce processus qui se produit dans le cortex frontal et qui est propre à l’homme. La compassion implique le partage et la compréhension des gestes, des actions, des passions et finalement des sentiments de l’autre. Enfin, ce cortex frontal très développé nous donne la connaissance du temps qui dure et par là une conscience de soi. Je n’ai conscience de m’appeler Vincent que parce que j’en connais l’histoire : je sais qu’il y a dix minutes j’étais déjà Vincent et que je le serai encore demain. De notre point de vue d’humain – nous sommes juge et partie, l’homme est le plus perfectionné des êtres vivants. Mais rien n’exclut que notre point de vue puisse être erroné.
Ame, compassion… vous utilisez un langage religieux surprenant chez un biologiste matérialiste, mécréant revendiqué…
J. -D. V. – Après les avoir oubliées, je retrouve mes racines protestantes. Mais on ne peut pas être biologiste et conserver la foi de son enfance. C’est impossible. Médecin on est confronté à la mort, à la matérialité du vivant. Il n’y aucun argument logique pour, par exemple, accepter la résurrection de la chair. C’est impossible pour un scientifique et c’est là-dessus que j’achoppe quand je discute avec les théologiens. J’essaie alors de renvoyer à la « communion des saints » qui n’a pas besoin de la résurrection de la chair pour se réaliser car elle a justement pour support la compassion. C’est une résurrection qui se fait dans le coeur des autres et qui permet à l’homme, en étant une partie infime d’une immense communion, de ne pas être seul et relégué en enfer. Car, voyez-vous, je vais jusqu’à accepter la notion d’enfer. L’enfer c’est le non-être, le néant. Pour Origène, c’était la mort, mais là, c’est la mort de la mort. Le néant n’est en effet supportable que dans la mesure où la mort peut être à l’origine d’une sorte de don de soi aux autres : vous léguez vos gènes, mais aussi ce que vous avez été et ce que vous avez apporté d’amour et de compassion aux autres. Ceux qui se coupent des autres et meurent loin d’eux peuvent perdre tout espoir. Ceux qui ont vandalisé ces capacités de l’amour de l’autre et qui n’auront pas été à la vraie table – celle qui rassasie car elle apporte l’amour et qui peut être douloureuse car les processus qui opposent le plaisir et la souffrance sont présents dans la chair même du cerveau, ceux-là sont voués à l’enfer du non-être.
Que vous inspirent ces « neurothéologiens » pour qui il y aurait dans le cerveau une aire dédiée à la foi ?
J. -D. V. – Leur idée est très simple : si Dieu a fait l’homme à son image, il a bien été obligé de créer une zone dans le cerveau qui permet de le reconnaître. IRM à l’appui, ils montrent que la prière et la méditation activent le cortex pariétal inférieur droit et en font le siège de la foi. C’est aussi absurde que la neuroéconomie qui prétend utiliser l’imagerie cérébrale pour expliquer, modéliser, voire prédire le comportement des agents économiques. La foi reste quelque chose de mystérieux par essence. Je choque beaucoup les prélats quand je leur dis que leur foi est ce qui guide le caneton de Konrad Lorenz quand il suit la boîte de conserve qu’à sa naissance on a substituée à sa mère cane. A mon sens, la foi résulte d’un phénomène d’empreinte similaire. On vous l’inculque quand vous êtes petit, elle s’imprime très tôt par l’éducation. Si les dispositifs neuronaux de l’humain le disposent au langage et à la culture, ils ne s’activent qu’au contact des autres, d’un père, d’une mère. Comme le dit Kant, on naît deux fois, la première fois du ventre de sa mère et, la seconde fois, de son éducation.
Aujourd’hui, on compare volontiers le cerveau à un superordinateur. Jusqu’où l’analogie est-elle exacte ?
J. -D. V. – L’informatique est en effet à l’origine des sciences cognitives. D’où l’idée que le cerveau est un gros ordinateur qui traite des algorithmes. Il suffirait donc de connaître ces algorithmes pour savoir comment le cerveau fonctionne. Mais c’est aller un peu vite en besogne car nos capacités en informatique et en algorithmes sont pour l’instant limitées. A ce jour, la vie telle qu’elle se présente n’est pas réductible à un ordinateur tel qu’on les connaît. Cela dit, ce mouvement philosophico-scientifique qu’on appelle transhumanisme nie ces limites et prétend que les cognisciences – la convergence des nanotechnonologies, des biotechnologies et des sciences de l’information – permettront de pénétrer au coeur même des algorithmes responsables de la pensée de type humain, c’est-à-dire avec un moi, une subjectivité, etc.
Il existe déjà des machines mixtes mêlant neurones et puces et des programmes cérébraux. Pour des fonctions simples, comme les fonctions motrices, on parvient déjà grâce à des électrodes placées au bon endroit dans le cerveau à faire déclencher des mouvements par la pensée. On pourra même envisager la communication intersubjective par transmission d’algorithmes à partir d’une psyché artificielle. Pourquoi pas ? Les transhumanistes pensent que la possibilité de penser l’impensable est la preuve même que l’on peut rendre possible l’impossible. Ils prennent au pied de la lettre la preuve de saint Anselme pour qui l’existence de l’inexplicable est la meilleure preuve que Dieu existe car s’il y a de l’inexplicable, il y a forcément une entité qui dépasse cet inexplicable.
En admettant que les transhumanistes parviennent à leurs fins, verra-t-on pour autant apparaître une nouvelle espèce humaine ?
J. -D. V. – C’est une question qui me taraude. Notre espèce est-elle le fin du fin en matière d’évolution ou y aura-t-il une spéciation ? La plupart des espèces disparaissent mais auparavant elles ont quelquefois donné des branches. Repartirons-nous du singe ? Ce n’est pas évident. Si l’espèce humaine venait à disparaître rien ne pourra immédiatement prendre le relais tant elle a exploité son biotope, au point qu’elle n’en a pas vraiment puisque nous allons sur la Lune en scaphandre. En revanche, elle est susceptible d’en former une autre. On fera des robots qui se reproduiront en faisant la synthèse de leur propre corps grâce à de nouvelles molécules qui s’auto-répliqueront. On trouvera des solutions pour accroître leurs performances. Ça marchera chez certains, chez d’autres non. Les transhumanistes adoptent le principe de l’imperfectibilité : plus il y a d’imperfections, plus les chances augmentent de tomber sur quelque chose qui marche. Ils reproduisent le processus de l’évolution mais en l’accélérant et en devenant non plus les maîtres et possesseurs de la nature, comme le voulait Descartes, mais en produisant une nouvelle nature. Celle que nous connaissons, créée en quelque 4 milliards d’années de manière tout à fait aléatoire et contingente, apparaîtra comme une vieille nature obsolète. Les nouveaux ingénieurs recréeront une vie différente qui n’utilisera pas l’ADN mais ces nouvelles molécules autoréplicantes qui se combineront et, par la pression du milieu et la sélection naturelle, survivront ou disparaîtront.
Qu’adviendra-t-il dans ce cas des humains d’aujourd’hui ?
J. -D. V. – Ce qui s’est déjà passé sur la Terre il y a quelque 3,5 milliards d’années, quand par la sélection naturelle, le jeu des possibles et la défaite de tous sauf un – un seul code génétique a survécu – l’ADN. Auparavant, en ces périodes prébiotique et abiotique, plusieurs codes autoréplicants ont dû cohabiter. Puis une seule cellule a gagné en se reproduisant aux dépens des autres. Avec l’apparition des premiers hominidés, tout est allé très vite. Homo sapiens a fini par l’emporter sur les autres. Neandertal, le dernier, a disparu par hybridation ou extinction. De la même façon, il se peut que la loi de la sélection naturelle amène soit la disparition, soit la régression de l’espèce. Jusqu’ici la spéciation se faisait par les barrières géographiques. Quand des individus au sein d’une espèce n’ont plus accès à la reproduction, ils se séparent et à partir de là deux espèces font leur chemin. Admettons qu’on commence à améliorer le cerveau par des hybridations avec des puces. Certains s’y refuseront ou n’en auront pas les moyens économiques. Si une partie des humains n’a plus accès à la reproduction ou se reproduisent entre eux sans avoir accès à l’hybridation avec les autres, deux espèces émergeront, l’une probablement plus puissante que l’autre. Toutes les barbaries sont alors imaginables.
Mais les transhumains pourraient-ils aussi être poètes ?
J. -D. V. – Je me le demande. La poésie est peut-être le mode de connaissance suprême qui est offert à l’individu, et elle se met difficilement du côté de la raison. La poésie est-elle comprise dans le programme ? Programmée, elle cesserait d’être de la poésie. La poésie, celle qui est une vision, est non réductible à des algorithmes mathématiques et ne peut pas fonctionner avec la théorie des jeux. Ça ne marche que lorsque l’autre est derrière. Un art qui ne s’adresse pas à l’autre a manqué sa fonction. Il y a toujours quelque chose de divin chez le poète. La transhumanité pourrait fort bien être dépourvue de cette transcendance.
Neurobiologiste né en 1935 en Dordogne, membre de l’Institut et du comité d’éthique des sciences du CNRS, Jean-Didier Vincent est professeur à l’Institut universitaire de France. Membre de la Fondation pour l’innovation politique, il y a mené un séminaire sur les technologies de l’homme. Il vient de publier Voyage extraordinaire au centre du cerveau (Odile Jacob).
Lisez l’article sur lesechos.fr.
Commentaires (0)
Commenter




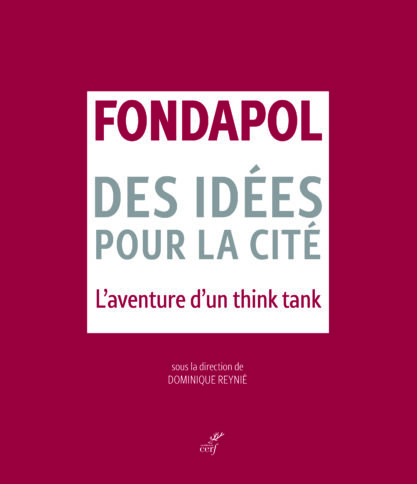



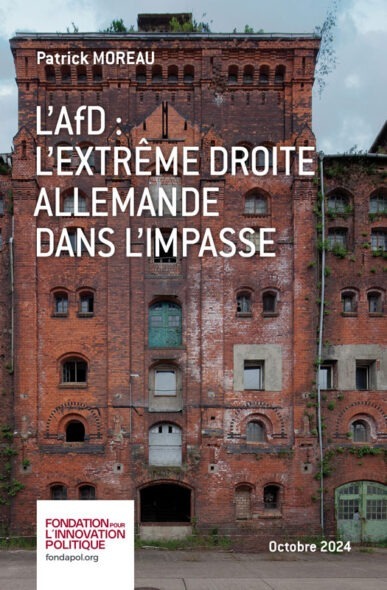



Aucun commentaire.