Combattre l’Europe. De Lénine à Marine Le Pen
16 avril 2018
Introduction
Depuis quelques années se développe un mouvement généralisé de critique et de rejet de l’Union européenne (UE). En témoignent le vote britannique en faveur du Brexit, la présence de huit candidats eurosceptiques sur onze au premier tour de l’élection présidentielle française en 2017 (qui ont totalisé 48% des voix), ou plus récemment encore les élections italiennes avec la percée de partis eurosceptiques comme le Mouvement 5 étoiles et la Ligue.
Est-ce dû à un changement d’époque ? s’interroge Bernard Bruneteau, professeur de science politique à l’université Rennes I et auteur de l’ouvrage Combattre l’Europe. De Lénine à Marine Le Pen. Les prémices de ces remises en cause sont souvent datées du début des années 1990, avec les effets de l’approfondissement institutionnel qui rendirent les politiques européennes plus intrusives. Cependant, en remontant l’historique des résistances au projet européen, on retrouve une certaine continuité conflictuelle. L’ouvrage de Bernard Bruneteau s’inscrit dans ce champ historiographique et analyse l’histoire de ces oppositions.
1900 – 1950 : les débuts de la critique européenne
Bernard Bruneteau commence par passer en revue les oppositions qui font suite à la proposition d’Aristide Briand de créer « un régime d’union fédérale européenne » en 1929. Il les classe en trois catégories, agissant de 1900 à 1950, contre une Europe unie.
La première est représentée par les partisans de l’Internationale communiste. L’idée européenne se développe depuis 1889 avec une vigueur nouvelle lorsqu’elle s’associe au pacifisme, ce qui lui vaut d’être condamnée par Engels puis par Marx. En effet la logique de lutte des classes rend caduque toute union des peuples d’Europe, et il est important de préserver l’intégrité nationale des ensembles où les possibilités d’affranchissement du prolétariat sont les plus fortes. Lénine fixe en 1915 la doctrine anti-européenne de la future URSS en critiquant le plan économique, puisqu’une mise en concurrence des nations les mettrait sur le chemin de la guerre. Si une entente était possible, elle aboutirait selon lui à une hégémonie de quelques pays et retarderait de plus les évolutions sociétales et politiques. Staline critiquera par la suite le projet Coudenhove-Kalergi et le plan Briand, en dénonçant l’encerclement de l’URSS par le capitalisme, ainsi que la volonté hégémonique de la France sur le continent. Si la position évolue en 1930 lorsque l’URSS demande à s’investir dans le projet européen, cela répond à la nécessité de maintenir les échanges économiques avec l’Europe en raison du lancement du plan de collectivisation et d’industrialisation.
La deuxième catégorie regroupe les adeptes du nationalisme intégral. Avec les Conférences de la Haye en 1889 et 1907 prospère l’idée d’une Europe cosmopolite. Les États sont néanmoins en concurrence car soumis à la Grande Dépression et les premières formes de mondialisation et de colonialisme apparaissent. La primauté européenne cède place à la prédominance de la nation. L’idée européenne renaît pendant l’entre-deux-guerres, mais se retrouve à nouveau concurrencée par le nationalisme récurrent des mentalités populaires, les idées coloniales évocatrices d’une autre idéologie de « grand espace » et les nouvelles alternatives politiques autoritaires. Le Parti national-socialiste se positionnera en 1925 sur l’idée européenne, en exprimant son regret de l’absence de conscience raciale. Hitler parlera ensuite de l’erreur, selon lui, de vouloir unifier des peuples racialement inégaux. Mussolini, dénonçant la conférence de paix ayant humilié l’Italie, mettra en place, à partir de ces présupposés révisionnistes, le fascisme italien, qui déniera toute légitimité à une unité européenne démocratique.
Enfin, la dernière catégorie rassemble les dévots de la mondialisation. Avant 1914 naît l’idéal d’un État mondial, dirigé par une élite éclairée, qui mettrait fin aux guerres et aux crises économiques. Ce mouvement est repris avec la création de la Société des Nations, puis avec l’ONU, mouvement porté par la « League of Free Nations Association » et par l’écrivain George Wells. Ceux-ci trouvent les limites de l’Europe trop étroites et Wells refuse de s’engager avec Coudenhove-Kalergi après l’échec du plan Briand. Les partisans de l’internationalisme économique libéral sont également très critiques à l’égard d’une fédération européenne qui serait anti-progressiste et porteuse d’affrontements.
1950 – 1992 : la structuration des oppositions
Le caractère de compromis qui marque les premières communautés européennes, ainsi que le non-dit sur leur objectif final, explique qu’un espace d’opposition se libère, ce qui montre bien que l’Europe construite avec le « consensus permissif » n’existe pas explique Bernard Bruneteau. Entre 1950 et 1992, cette opposition à la construction européenne se structure selon lui autour de trois points.
En premier lieu, ce sont les poids des cultures politiques nationales qui s’opposent. La thèse néo-réaliste considère l’Europe comme un moyen de redonner sa vigueur à l’État nation, ce qui entraîne quelques déceptions quand la construction européenne s’autonomise ou que les bénéfices nationaux ne sont pas au rendez-vous. Dès l’instauration de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA), on parle en France de souveraineté blessée, ce qui engendra l’échec de la Communauté européenne de défense (CED), puis de la constitution européenne. Cette interprétation se retrouve aujourd’hui dans les propos de Florian Philippot ou de François Asselineau. Au Royaume-Uni, les critiques s’organisent autour du souverainisme économique et de l’insuffisance démocratique des mécanismes communautaires. Il en est de même au Danemark, qui craint sa dilution dans un « super État » et pour lequel un transfert de souveraineté menacerait la pérennité de l’État.
Les groupes ont aussi été un des points centraux de l’opposition. Pour une fraction du monde patronal et agricole, il y eut un intérêt à résister à l’intégration économique européenne. Les patrons s’opposent à un pouvoir supranational d’organisation des secteurs (notamment contre la Haute Autorité de la CECA) et à une mise en concurrence trop rapide et brutale (due aux handicaps conjoncturels de l’économie française). La Politique agricole commune (PAC) génère elle aussi de multiples résistances et ce dès 1962, avec la critique de certains dispositifs considérés comme dirigistes et supranationaux. La lutte s’installe au cœur de la stratégie communiste à l’égard des agriculteurs, en condamnant une Europe libérale et concurrentielle. De même, le syndicalisme ouvrier se dresse contre une Europe qui ne serait pas sociale.
Enfin, il faut également noter la stratégie des partis politiques. Le Parti Social-Démocrate (SPD) en Allemagne combat ainsi fortement la CECA sous prétexte qu’elle serait au service de la France et accroitrait la division en Europe. De même, la vision du général de Gaulle, même suite à son départ, prévaut : il faut privilégier une confédération d’États pilotés par la France et écarter tout principe de supranationalité. Après la ratification de l’Acte Unique, il s’agit désormais de faire de l’Europe un outil de reconquête du pouvoir tout en se différenciant du Front National, en pleine ascension. Le Parti socialiste (PS) se définit également anti-européen afin de se distinguer de la Section française de l’Internationale ouvrière (SFIO) car il ne veut plus avoir à s’associer avec des partis de centre-droit bien qu’il soit lui-même extrêmement divisé. De même, au Royaume Uni, le Labour parti prend en compte la position des syndicats qui rejettent l’intégration : il refuse tout projet de développement institutionnel et montre sa volonté d’en finir avec la PAC. Les partis communistes, quant à eux, s’alignent sur la position soviétique et condamnent l’intégration.
De 1992 à aujourd’hui : la remise en cause de l’Union Européenne
Enfin, l’auteur se concentre sur la remise en cause même de l’Union Européenne après 1992, après la mise en place du marché commun, le lancement de l’euro ainsi que les élargissements. Malgré toutes ces avancées, l’UE reste un objet politique mal identifié car très complexe, ce qui instaure de nouvelles oppositions.
Tout d’abord, une légitimité « eurosceptique » apparaît dans ce contexte nouveau, marqué par de nouveaux clivages concernant la globalisation, l’obsolescence de l’État-Nation et le retour de l’Allemagne sur la scène internationale. L’UE se retrouve attaquée par la critique utilitariste (l’UE générerait plus de bénéfices que de coûts pour 26% des Français seulement), mais aussi politique (elle est considérée comme élitiste et peu accessible) et identitaire. En opposition à cette nouvelle situation, le souverainisme devient une thématique de plus en plus présente. En France, on remarque ainsi l’utilisation de l’identité nationale non seulement par le Front National, mais aussi par l’Alliance pour la souveraineté de la France, repris par Nicolas Dupont-Aignant, ainsi qu’à gauche par le Mouvement des Citoyens. Au Royaume-Uni, une multitude de partis antieuropéens se créent, adossés à une opinion publique rapidement hostile à l’UE, dont le United Kingdom Independance Party (UKIP). Ce dernier progressera rapidement, avec un discours sur le déclin national, face à une représentation mythifiée du Royaume-Uni avant son entrée dans l’UE. Enfin dans l’Allemagne réunifiée, où faire progresser l’intégration européenne était une forme d’obligation morale à la suite du traumatisme de 1945, la crise financière du début des années 2000 et la politique de solidarité à laquelle elle est soumise, redonnent vie au souverainisme avec la création de l’AfD.
Vient ensuite le printemps européen des populismes identitaires. Ces populismes en pleine ascension peuvent être divisés en différentes catégories. En France, la critique de l’UE par les populistes s’organise autour de deux discours. Le premier, produit par le Front National, est d’essence nationale. En effet l’UE représente pour eux un obstacle à la cause nationale car elle perd, avec la fin de la Guerre froide, sa fonction de protection contre le communisme, et ils s’opposent à une relance de l’intégration sous une domination allemande. Le deuxième discours est d’essence sociale, au sein de la gauche qui critique l’Europe néo-libérale. En Europe du Nord, où l’on observe la progression des votes populistes depuis des années, il s’agit d’une remise en cause de leur modèle, et donc d’un « welfare-nationalisme », à la suite des inquiétudes suscitées par l’immigration qui déstabilise ces sociétés homogènes. Enfin, en Europe centrale et orientale, on remarque un retour de l’ethno-nationalisme, avec les succès électoraux de partis similaires, incarnés par des leaders à forte personnalité. Cette réussite s’explique notamment par la dynamique sociologique des « perdants » de la mise aux normes libérales et capitalistes dans les années 1990 (puisqu’il s’agit d’anciens pays communistes qui bénéficiaient de systèmes sociaux protecteurs), ainsi par une certaine déception qui fait suite à leur adhésion.
Enfin, il s’agit du procès intellectuel de la gouvernance néolibérale. Tout d’abord, le procès du post-national : blâme de la mythification de Jean Monnet dû au déficit démocratique, comparaison de l’UE à un Empire par ceux qui ciblent l’hégémonie allemande, critique d’un projet européen post-politique qui a parié sur l’obsolescence de la nation. On assiste également au procès de la post-démocratie. En effet l’UE vit sur un héritage du modèle de la CECA qui a privilégié le technicien, de la pratique institutionnelle qui a établi le primat de l’exécutif, et enfin de la Cour de justice qui a montré la primauté du droit. Cet héritage nourrit l’accusation de déficit démocratique, qui se retrouve autour de deux discours : l’Europe méprise le politique (suite à l’accord de coalition entre les groupes Socialistes et Démocrates et Parti Populaire Européen, il n’existerait plus de débat donc plus de démocratie) et, surtout, oublie le peuple (abandon de la représentation sociale pour l’Europe néolibérale, de la représentation démocratique pour un fonctionnement technocratique, et de la représentation nationale avec la limitation de la souveraineté des Etats). Pourtant, le projet des Pères fondateurs était bien de créer une démocratie mixte, dans laquelle la souveraineté du peuple devait s’exercer dans des conditions qui protègeraient la liberté, et donc ne pas exercer son pouvoir directement. Par ailleurs, ces derniers avaient conscience du fait que la construction européenne devait avoir une continuité et donc ne pas être soumise trop tôt aux aléas du suffrage universel direct (il eut été compliqué de connaitre la volonté du peuple face à un phénomène aussi inédit). Enfin, il s’agit du procès du libéralisme, accusé par Bourdieu puis plus généralement en France, de dévaster le social et le lien politique en raison de l’interdiction par l’Union Economique et Monétaire de toute autre politique que celle de la concurrence libre. Il faut pourtant tempérer cette vision d’une UE ordolibérale, qui généraliserait une logique de marché afin de réguler l’État, puisque si l’intégration s’accélère à la fin des années 1980, ce n’est pas grâce à une victoire des libéraux mais grâce à la stratégie de la Commission d’utiliser le concept de marché comme point de ralliement.
Conclusion
Bernard Bruneteau termine son ouvrage en relativisant toutes ces oppositions, malgré l’hostilité déclarée de plus en plus radicale des mouvements souverainistes et populistes de droite comme de gauche. En effet, ces oppositions découlent de trois dynamiques : les cultures politiques nationales, les perspectives stratégiques permises par un positionnement anti UE, et des matrices idéologiques inscrites dans l’histoire contemporaines de l’Europe. Cependant celles-ci sont peu propices à former un front commun et sont donc condamnées à rester confinées dans des espaces nationaux.
Mathilde Tchounikine




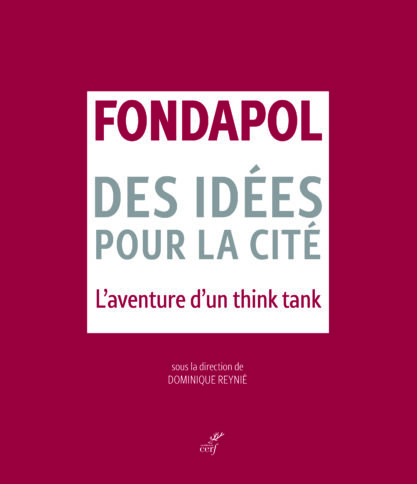



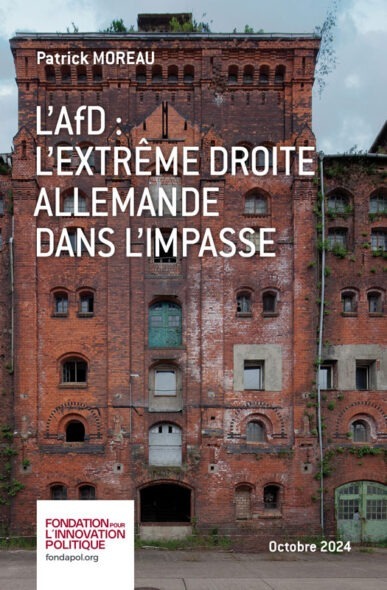



Aucun commentaire.