L’école remise en marche ?
25 février 2019
La loi sur « l’école de la confiance » récemment adoptée a suscité nombre de critiques, dont celle, sévère, de Claude Lelièvre, historien de l’éducation : « il manque à ce projet une colonne vertébrale ». De fait, elle ne paraît pas à la hauteur des défis posés par la formation de la jeunesse française et surtout elle semble abandonner le girondisme de l’ouvrage programme (1) du ministre au profit d’un jacobinisme dont l’efficacité est pourtant sujette à caution.
L’ampleur du défi
En 1870, disait-on, la France avait été vaincue par l’instituteur prussien. L’institution scolaire était effectivement restée un parent pauvre de l’action publique au XIX è siècle : peu d’enfants allaient à l’école malgré la loi Guizot (1833) qui prévoyait l’ouverture d’une école primaire de garçons dans chaque commune et exigeait des maîtres un brevet de capacité ou malgré les efforts de Victor Duruy qui invente le certificat d’étude sous le Second Empire. La République s’est donc mise à l’école allemande : l’instruction est devenue obligatoire et le système français s’est doté d’un corps d’enseignants compétents formés dans les écoles normales. Jules Ferry n’invente donc pas l’école mais il crée celle de la République et la dote de fonctionnaires aux qualifications et à l’autorité reconnues. Résultat : le « lire, écrire compter » devient une réalité ; un mythe national est né : celui d’un enseignement creuset de la République, porteur de ses valeurs de patriotisme, de laïcité et d’égalité des chances.
En 2019, une note de Patrick Artus, « France, nous nous désintéressons totalement de nos enfants » (2), relève qu’il y a 17% de NETTs dans le pays, c’est-à-dire de jeunes de 15 à 29 ans sans diplôme, ni formation ni emploi. Il rappelle le constat de l’enquête PISA : l’école française est peu performante pour les enfants des milieux modestes, elle accroît les inégalités sociales entre les générations, elle se contente enfin de comptabiliser les « décrocheurs » qui ne sont jamais récupérés pour être remis dans le système. Et Patrick Artus d’ajouter que ce chiffre n’inclut pas les bacheliers qui échouent au début de leur premier cycle universitaire. Le constat est accablant : sur 700 000 jeunes d’une classe d’âge, 200 000 sont en situation d’échec éducatif ! La France est en train de perdre la bataille de la formation. A l’heure de la compétition mondiale dans laquelle elle doit d’abord compter sur la qualification de sa population active, il y a là un scandale social, un non sens économique et une gabegie financière – l’éducation nationale représente le plus gros poste du budget de l’État -.
La faiblesse de la réponse politique
La récente discussion de la loi sur « l’école de la confiance », dans ce contexte, aurait dû être l’occasion pour l’Assemblée nationale de se saisir du sujet comme la République l’avait fait dans les années 1870, le ministre ayant présenté son projet comme « une nouvelle étape de cette épopée glorieuse de l’école depuis la fin du XIX è siècle ».
Las ! Les partis politiques ont plutôt montré en la circonstance que cette question ne les intéresse plus depuis longtemps. Ils ont alors saisi le prétexte pour faire un peu d’électoralisme, sans plus y croire vraiment eux-mêmes. Les Républicains ont fait adopter un amendement sur la présence des drapeaux tricolore et européen sans oublier les paroles de la Marseillaise dans les classes – suivez mon regard – et les socialistes ont misérablement tenté de rallumer la guerre scolaire en pointant les crédits supplémentaires alloués au privé en raison de la scolarisation obligatoire dès trois ans. Autant de réponses, on le voit, à la hauteur des enjeux de l’avenir de la jeunesse française. La République en marche n’a pas voulu non plus être en reste et a proposé avec succès de regrouper collèges et écoles primaires dans les zones de faible densité, sans doute en réponse aux angoisses légitimes de la « France périphérique » ( C.Guilluy).
Quant au projet de loi lui-même, difficile de le raccrocher à « l’épopée glorieuse de l’école depuis la fin du XIX è siècle » : il se contente de réaffirmer certaines mesures positives prises depuis un an : les CP/CE1 dédoublés dans les zones défavorisées et la réforme du baccalauréat, sans oublier d’introduire les inévitables changements de sigles qui sont l’une des raisons d’être de la technostructure de la rue de Grenelle – « il faut que tout change pour que rien ne change » disait le Guépard – : le CNESCO devient le conseil d’évaluation de l’école – aucune importance, aucun élève, aucun parent d’élève et même peu de professeurs savent de quoi il s’agit -, les ESPE, anciennement IUFM s’appelleront désormais INSPE mais quoi qu’il en soit, pour pallier la crise du recrutement, il est surtout prévu d’embaucher des contractuels et notamment des étudiants … qui iront se former directement sur le terrain. Dans le fond, il s’agit de supprimer la formation plutôt que de changer le statut, alors que ce dernier, certes défendu farouchement par les syndicats – mais que pèsent-ils ?-, est sans doute une des raisons de la crise des « vocations ». Une crise qui de toutes façons ne pourra être endiguée que si le politique mais également la nation dans son ensemble définissent clairement les missions de l’école, la « colonne vertébrale » évoquée par Claude Lelièvre. En son temps, Jules Ferry avait su le faire en répondant à ces cinq questions : que faut-il enseigner ? A qui ? Pourquoi ? Avec qui ? Comment ?
Confiance, autonomie et décentralisation
Pour relever les défis du nouveau siècle, la France a donc besoin de repenser la formation de sa jeunesse et on peut parier qu’elle ne la rendra efficace que si elle la décloisonne, c’est-à-dire si elle admet, en en tirant toutes les conséquences, que l’école n’en a pas le monopole. Un exemple : il manque aujourd’hui dit Patrick Artus une formation technique et professionnelle de qualité – au passage : où est –elle dans « l’école de la confiance » ? –. Or son existence et sa réussite ne supposent-elles pas la mise en synergie de différents acteurs agissant de concert et … en confiance : écoles, entreprises, associations ? Les « cités éducatives » prévues par le rapport Borloo il y a un an allaient dans ce sens : pourquoi ne pas en reprendre l’idée ? Leur gestion, indiquait-il, devra être décentralisée et basée sur le principe de l’autonomie. A charge pour les chefs de ces établissements de recruter et de motiver leurs équipes, notamment avec des primes et des avantages définis à l’échelle locale – ce qui suppose aussi une refonte du recrutement et de la formation des personnels de direction -. Décentralisation, autonomie, une révolution dans l’éducation et deux termes étrangement absents du projet de loi sur « l’école de la confiance » alors qu’ils lui étaient associés dans le livre programme de Jean-Michel Blanquer : la France n’en a donc pas fini avec le jacobinisme ?
Risquons alors une hypothèse : le projet de loi n’est que partiellement celui du ministre. On y retrouve de fait des éléments de continuité avec les mauvaises pratiques du passé. Ainsi pour pallier – déjà – les insuffisances du recrutement officiel, il y a une vingtaine d’années, l’éducation nationale prévoyait de dispenser les mères de trois enfants de la licence pour passer le concours de l’école normale !
Risquons encore une question assortie d’une autre hypothèse : Luc Ferry, racontant ses souvenirs de la rue de Grenelle (3), avouait s’être rapidement aperçu de la relativité de son pouvoir. Les choses se sont-elles tellement modifiées depuis ? Peut-être pas.
Risquons enfin une prévision en guise de conclusion : si rien ne change, on croit connaître les résultats de la future enquête PISA, Marseillaise ou pas, ainsi que le titre de la prochaine étude de Patrick Artus sur le sujet.
Vincent Feré
(1) Jean-Michel Blanquer, L’Ecole de demain Odile Jacob, 2016.
(2) Patrick Artus, « France, nous nous désintéressons totalement de nos enfants », Natixis, janvier 2019.
(3) Luc Ferry, Comment peut-on être ministre? , Plon, 2005.




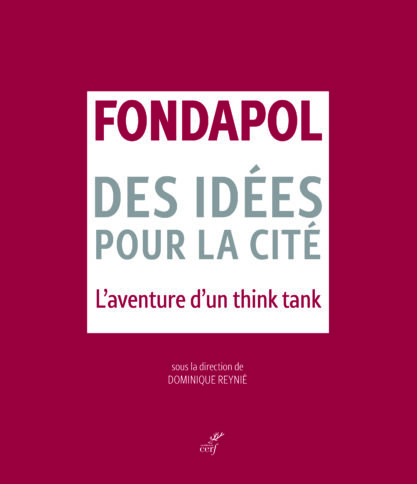



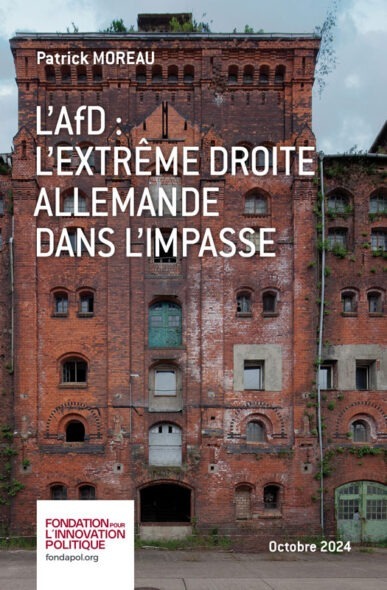



Aucun commentaire.