
La démocratie déconsolidée
Charles Jaigu | 29 mai 2019
CHRONIQUE – Deuxième volet d’une série sur les défis de la démocratie. Rencontre avec Dominique Reynié, qui publie un baromètre en demi-teinte du sentiment démocratique dans 42 pays.
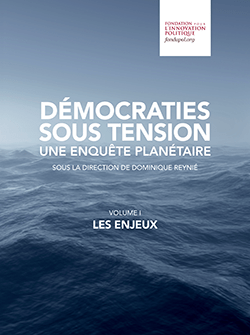
Habitué des débats et des plateaux télé, Dominique Reynié pratique le commentaire politique agrémenté d’une pointe d’accent de Rodez, sa ville natale. Il le fait notamment au nom de la Fondation pour l’innovation politique, l’un de ces think-tanks français qui font beaucoup avec peu – 1,3 million d’euros par an et cinq collaborateurs. C’est dérisoire et pourtant c’est le lot de la plupart des centres d’analyse «made in France». C’est sans doute aussi pour cette raison que la fondation s’est associée à l’International Republican Institute (IRI). Tous deux se revendiquent de la droite libérale, mais le partenaire américain dispose d’un budget de 130 millions de dollars et 400 collaborateurs dans le monde…
«Nous avons lancé il y a deux ans cette idée d’une enquête planétaire sur l’état de l’opinion dans 42 États démocratiques, et l’IRI a tout de suite dit oui», se réjouit Reynié, depuis les discrets bureaux de la Fondapol, rue de Grenelle, tout près de Sciences Po. Quelque 37.000 personnes ont donc été interviewées afin de mieux étalonner les transformations du sentiment démocratique en Europe et aux États-Unis, mais aussi au Brésil, en Israël, en Australie ou au Canada. Le résultat de cette enquête donne, comme toujours, des arguments aux optimistes et aux pessimistes. Mais le tableau est moins misérable et catastrophique qu’on aurait pu le redouter: nous ne sommes pas encore entrés dans les années 30. Certes, le mot «démocrature» est à la mode et il montre la tentation de glisser vers des régimes autoritaires ayant l’apparence de la démocratie. Mais dans les démocraties qui le sont à part entière, ce n’est pas la demande d’une démocrature qui l’emporte mais la critique d’un régime qui par définition est toujours perfectible. On observe au fond la généralisation d’un sentiment «démo-critique», pour utiliser un autre mot-valise, et qui ne remet pas en cause l’essentiel.
« Il ne s’agit plus aujourd’hui de consolider la démocratie là où elle est encore naissante, mais de protéger des démocraties installées» Dominique Reynié
Rien de surprenant, puisque la contradiction est le mode de fonctionnement d’une démocratie. Les démocraties sont, en effet, «sous tension». Elles le sont en quelque sorte par nature. Il importe de guetter si elles le sont plus aujourd’hui qu’hier. On observe en effet un reflux de la contagion démocratique depuis l’année 2005. Pourtant, ce coup d’arrêt vient après que leur nombre a été multiplié par deux entre 1970 et 2000. Cela veut dire, en effet, que les démocraties sont moins sûres d’elles: «Il ne s’agit plus aujourd’hui de consolider la démocratie là où elle est encore naissante, mais de protéger des démocraties installées», écrit Dominique Reynié. La première leçon, essentielle, est que les personnes interrogées sont souvent très critiques sur le fonctionnement mais ne remettent pas en cause la règle du jeu. Ainsi, 49 % des personnes interrogées considèrent que la démocratie fonctionne mal, mais ce jugement est aussitôt nuancé quand on leur demande si c’est le meilleur système possible, car elles sont 67 % à répondre par l’affirmative. Elles sont aussi 82 % à juger le modèle de la démocratie représentative le meilleur de tous, même si la démocratie directe ne vient pas loin derrière. Et elles défendent à 98 % «le droit de dire ce que l’on pense». Enfin, 70 % des personnes interrogées estiment que le vote est utile. La liste des reproches, toutefois, est longue: la transparence du scrutin, la faiblesse des élus, l’internationalisation des échanges, et à tout cela il faudrait ajouter le prix de l’énergie – car le droit de se déplacer est presque considéré comme un droit de l’homme par le citoyen en démocratie.
La critique des lobbys internationaux est très présente. Et les plus sceptiques à l’égard de la démocratie sont le plus souvent ceux qui se jugent victimes de la mondialisation. Cette variable recoupe les très nombreux diagnostics faits, par exemple en France, à l’occasion de mobilisations de «gilets jaunes». Mais elles remontent beaucoup plus loin, au moins à la crise de 2008. Car le compromis issu de l’après-guerre, et qui reposait sur les promesses de la démocratie sociale, est dans le coma. La démocratie fonctionne mais elle n’a plus d’argent pour se transformer en démocratie sociale effective, sauf si on considère que produire des déficits, c’est être un pays riche.
On juge le régime mal adapté à la nécessité de réformes à venir
L’un des enseignements de cette enquête est l’écart entre les opinions de l’Europe atlantique et celles de l’Europe postsoviétique. Les anciens pays de l’Est sont beaucoup plus ouverts à une autre voie. Ils répondent plus favorablement aux questions posées sur la nécessité d’un «homme fort», ou à l’idée d’une nouvelle «épistocratie» – autrement dit un gouvernement élu par un collège électoral composé seulement de «ceux qui savent». Cette intolérance au suffrage universel est d’ailleurs un des signaux nouveaux relevés par l’étude. L’autre enseignement est le pessimisme des pays d’Europe de l’Ouest à l’égard du régime dont ils ont toujours cru qu’il était la forme la mieux faite pour répondre aux aspirations de l’âme humaine. On le juge mal adapté à la nécessité de réformes à venir: soit pour piloter la transition écologique, soit pour piloter la transition vers un marché de travail refaçonné par l’intelligence artificielle et la robotisation.
La jeunesse reflète cette imprégnation pessimiste. L’enquête souligne «une crise de l’attachement à la démocratie dans la transmission générationnelle». C’est ce que l’étude décrit comme une forme de «déconsolidation démocratique». La classe d’âge des 18-30 ans oscille entre affirmation intransigeante de la liberté (civic tech, démocratie participative) et la volonté décomplexée d’ordre (il faut imposer la transition écologique). À titre d’exemple, l’idée d’une ingérence militaire dans la vie d’un pays, ou l’appel à un homme fort, séduit un tiers d’entre eux. Il est plus surprenant encore de constater qu’à l’âge d’Internet et de l’hyperdémocratie, deux tiers des jeunes interrogés souhaiteraient que les experts gouvernent le pays. Cette aspiration positiviste a de quoi surprendre après quarante ans d’esprit libertaire et en plein rejet, par exemple en France, du gouvernement des experts. Elle montre l’attractivité du modèle chinois. Cette autocratie high-tech, qui est aussi une épistocratie, offre la prospérité en échange d’une gouvernance conduite d’en haut par des ingénieurs. L’idée jupitérienne déclinée par «l’énarque» Emmanuel Macron au début de son mandat correspond à quelque chose. Mais ce n’est pas pour cette raison qu’elle est forcément acceptée telle quelle: là, comme ailleurs, il y a l’art et la manière. Car le privilège du citoyen démocrate pas encore sinisé est de critiquer ce qu’il défendait la veille et de louer ce qu’il critiquait. Bienvenue dans la «démo-crisis».
? @DominiqueReynie dans @Le_Figaro: « Il ne s’agit plus aujourd’hui de consolider la démocratie là où elle est encore naissante, mais de protéger des démocraties installées » cc @CJaigu
➡ Enquête planétaire @Fondapol|@IRIglobal #DémocratiesSousTension sur https://t.co/NefE5gDTTw pic.twitter.com/IvItLLg5dh— Fondapol (@Fondapol) May 30, 2019
Lisez l’article sur lefigaro.fr.












Aucun commentaire.