Pour un impôt "vraiment" démocratique
Fondapol | 03 juin 2012
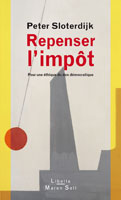 Peter Sloterdijk, Repenser l’impôt. Pour une éthique du don démocratique, Paris, Libella/Maren Sell, 2012
Peter Sloterdijk, Repenser l’impôt. Pour une éthique du don démocratique, Paris, Libella/Maren Sell, 2012
C’est bien connu : en France, le printemps s’achève avec l’envoi de la déclaration de revenus. Le contribuable rappelé à la fatalité fiscale pourra, au choix, trouver des motifs d’agacement ou de délectation en parcourant le dernier livre du philosophe allemand Peter Solterdijk. L’agacement, superficiel, tient au prix de l’ouvrage en question : pas moins de 22 euros, au format de poche ! Ajoutez à cela qu’il s’agit d’un livre d’entretiens… qui n’évite pas les écueils du genre -cohérence toute relative et qualité inégale du propos, notamment-.
Pour une dénaturalisation de l’Etat fiscal
L’originalité de la démarche de Peter Sloterdijk mérite pourtant qu’on ne s’arrête pas à ces considérations-là. Rares sont en effet les philosophes -même les philosophes du politique- à s’être intéressés à l’impôt, qu’ils abandonnent volontiers aux économistes et aux historiens. Au-delà d’un désintérêt coupable pour l’Etat dans sa réalité pratique, beaucoup refusent d’interroger la logique fiscale en elle-même : « on [les citoyens et les intellectuels] accepte depuis longtemps ce fardeau [l’impôt] comme une donnée naturelle[1] ». C’est donc un travail de dénaturalisation de l’Etat fiscal que Peter Sloterdijk propose.
Tout est parti en quelque sorte d’un essai publié dans un grand quotidien allemand en juin 2009, sous un titre particulièrement violent : « Capitalisme et cleptocratie. Sur l’activité de la main qui prend ». Solterdijk y dénonçait la « liaison dangereuse entre idéalisme et ressentiment[2] » qui anime à la fois les critiques contemporaines du capitalisme et les partisans d’une augmentation de la pression fiscale sur les « riches » au nom de l’égalité. Le philosophe allemand ne dédaignant pas la provocation, certains des quasi-aphorismes de cet article déclenchèrent une vive polémique en Allemagne. Qu’on en juge ! L’Europe baignerait selon lui dans un « semi-socialisme animé par les mass-médias, exerçant son emprise par le biais de l’Etat fiscal, sur la base d’une économie privée », où les ministres des Finances joueraient le rôle de « Robin des Bois qui [auraient] prêté serment sur la Constitution[3] ».
Sloterdijk développa ensuite cette intuition dans une série d’entretiens paru en 2009-2010[4]. L’avant-propos de Repenser l’impôt rassemble des arguments dispersés au fil des entretiens et les « noue en gerbe » avec une clarté si prodigieusement convaincante qu’on voudrait en citer chaque phrase.
« Nous ne sommes pas sortis du Moyen-Âge fiscal[5] »
Résumons : pour Peter Sloterdijk, le délitement du vivre ensemble dans les sociétés occidentales aurait, parmi d’autres, une cause fiscale. L’impôt continuerait en effet à y fonctionner sur des bases non démocratiques, suivant une logique qui amalgame une « tradition absolutiste et autoritaire » et le modèle de la « contre-expropriation[6] ». En clair, des logiques où le contribuable est considéré, soit comme un mineur, soit comme un voleur. Il en ressort que l’Etat contemporain se sent insuffisamment tenu de justifier la contribution financière qu’il exige des citoyens.
Ce défaut démocratique se trouve en aval, pour ce qui est de l’usage des recettes ainsi perçues ; et Peter Sloterdijk d’y voir une des causes de l’endettement massif que connaissent les pays européens : faute de devoir rendre des comptes, l’Etat se montrerait dispendieux, sacrifiant ainsi le futur au présent.
Des contribuables surtaxés… mais méprisés
L’urgence d’une refondation démocratique de l’impôt s’imposerait donc, pour des raisons qui relèvent à la fois de la cohésion sociale et de la bonne gestion des finances publiques.
Peter Sloterdijk observe en effet que l’effort fiscal pèse surtout, en Europe, sur une minorité de foyers : « les 10 % du palier supérieur des contribuables versent plus de 50% des impôts sur le revenu, et les 20% supérieurs environ 70%[7] ». Mais, attention ! Il ne s’agit pas pour le philosophe allemand de plaider, dans son livre, pour la proportionnalité contre la progressivité fiscale. Il déplore simplement que les citoyens les plus actifs fiscalement ne soient pas reconnus à la hauteur de leur contribution au bien commun, mais au contraire montrés du doigt, en Europe, comme des expropriateurs à punir. Ce manque de considération pèserait fortement sur l’esprit public, expliquant que « la société matériellement la plus riche de l’Histoire (…) [soit] en même temps la plus ronchonne, la plus insatisfaite et la plus méfiante qui ait jamais existé en temps de paix[8] ».
D’autant que la désinvolture, voire le mépris de l’Etat pour ses plus gros contributeurs n’est pas sans conséquences : elles ont pour noms exil fiscal ou réticence à entreprendre, par exemple.
Pour que l’impôt redevienne un don
Peter Sloterdijk propose donc de repenser l’impôt pour pallier ces travers, en redonnant à la contribution fiscale une nature de don. Concrètement, il s’agirait que les citoyens puissent disposer d’abord et libéralement d’une partie du montant de leur impôt, pour choisir de l’attribuer à la politique publique de leur choix. Des mécanismes de reconnaissance se mettraient alors très probablement en place pour saluer la contribution au bien public des citoyens concernés, cependant que les administrations bénéficiant des dons se sentiraient tenues de rendre des comptes sur leur gestion à leurs généreux donateurs. Peter Sloterdijk conçoit même cette pratique du « don organisé » comme une étape, l’Etat renonçant progressivement à encadrer cette recette et faisant confiance, à terme et pour partie, à la générosité des citoyens.
On entend d’ici les procès en angélisme, en irresponsabilité : une telle évolution ne conduirait-elle pas à la faillite pure et simple de l’Etat ? C’est postuler sur la médiocrité et la « méchanceté » de l’homme que de raisonner ainsi, quand Peter Sloterdijk imagine, lui, une véritable compétition entre donateurs. Et observe avec raison qu’ « en Suisse, cela fait longtemps que les citoyens votent sur le niveau de leurs impôts sans qu’on [y] ait jamais constaté de famine[9] », car les citoyens helvétiques comprennent « qu’il existe des formes de bien-être auxquelles on n’accède qu’en commun[10] ».
Du réenchantement démocratique de l’impôt… au réenchantement démocratique tout court
On peut juger exagérément optimiste l’analyse ultime de Peter Sloterdijk… Mais que sa proposition d’un réenchantement démocratique de l’impôt est séduisante !
L’idée de transformer une part de l’impôt en don organisé fait partie de ces propositions originales qui devraient nourrir le débat démocratique en Europe, dans les années à venir, à l’instar du recours au tirage au sort pour désigner une partie des élus locaux, par exemple. Aussi ne saurait-on trop conseiller le petit livre du philosophe allemand à ceux qui élaborent les projets des formations politiques en Europe : de gauche -Peter Sloterdijk se définit comme un fils de la social-démocratie- comme de droite, ils y trouveront matière à réflexion… et à propositions.
David Valence
[1] P. 18
[2] P. 177
[3] P. 183-184
[4] Notamment « Sur quoi repose notre Etat fiscal ? », entretien avec Marc Beise, Süddeutsche Zeitung, 5 janvier 2010, reproduit p. 246-257. « Les impôts sont le phénomène central de notre civilisation », entretien avec Stephan Maus, Stern, 7 janvier 2010, reproduit p. 258-266 et « Une lettre de remerciement du centre d’impôts », entretien avec Holger Fuss, Enorm. Wirtschaft für den Menschen, septembre-novembre 2010, reproduit p. 267-287.
[5] P. 33
[6] P. 31 et 33
[7] P. 251
[8] P. 72
[9] P. 249
[10] P. 135












Aucun commentaire.