Enseignement supérieur : la réforme ou le déclin
Fondapol | 23 juillet 2011
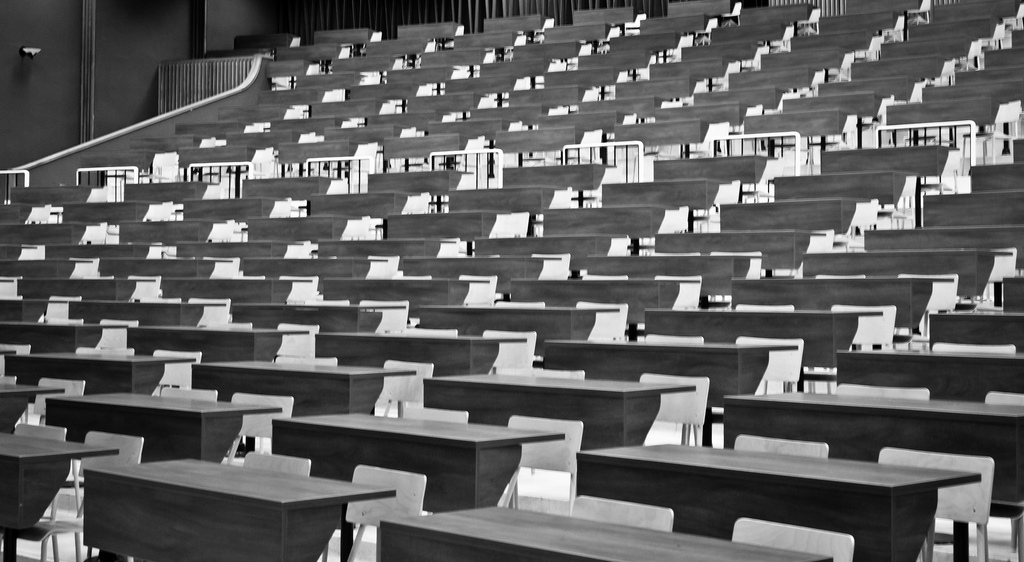 François Garçon, Enquête sur la formation des élites, Paris : Perrin, 2012
François Garçon, Enquête sur la formation des élites, Paris : Perrin, 2012
Depuis 1968, l’enseignement supérieur et la recherche sont dans une situation paradoxale en France.
Les paradoxes de l’Université française
Après une impulsion initiale sous la IVème République et la présidence gaullienne, notre pays a assuré l’ouverture de l’accès à l’Université et maintenu la présence de la France dans les avancées scientifiques et technologiques.
Mais dans le même temps, l’Université hexagonale a fait l’objet de nombreuses critiques.
En cause, pêle-mêle : son manque de moyens chronique, ses dysfonctionnements internes, sa difficulté à s’ouvrir au monde économique, la division entre grandes écoles et universités. Des lois successives (Loi Faure, Loi Savary, plan « Universités 2000 ») ont d’ailleurs abordé de front ces problèmes… sans faire complètement taire les critiques.
L’œuvre d’un universitaire libre… et atypique
L’auteur de ce livre est, de son propre aveu, un universitaire atypique. Historien de formation, il a fait l’essentiel de sa carrière dans le privé – un monde aussi méconnu que rejeté par de larges pans du supérieur – avant d’être élu à la Sorbonne.
Il propose ici un livre décapant, où la richesse de l’information le dispute au caractère clinique du constat : l’université française est, au plan international, sur la route d’un lent déclin.
Il existe désormais un véritable marché international des cerveaux
L’enseignement supérieur est le chaînon du système éducatif qui est entré le plus précocement dans la mondialisation du « capital humain ». Comme le souligne François Garçon –il s’agit d’un simple constat- il existe désormais un véritable marché international des cerveaux.
Or, cette réalité – déjà tangible pour une poignée d’établissements supérieurs d’élite- a connu une visibilité inédite dans les années 2000, avec la publication des classements internationaux d’universités : classement de Shangaï en 2003, Times Higher Education en 2004.
Le choc des classements internationaux pour les universités… et le système éducatif français
Pour nombre de pays européens, le réveil a été rude : si la Suisse et la Grande-Bretagne figuraient dans le peloton de tête, les autres pays (notablement la France et l’Allemagne) y étaient très mal classés.
On peut ajouter qu’au niveau de l’enseignement obligatoire, le classement PISA a entrainé sur le vieux continent des réveils tout aussi douloureux.
La tentation du déni
Comment les professionnels et les autres acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche ont-ils réagi à ces informations ?
C’est le déni qui a dominé en France, sous de multiples arguments: le classement de Shangaï serait asio-centré, les évaluations privilégieraient les sciences dures ou la taille des établissements, le nombre de publications, l’anglais…
Chiffres et classements à l’appui, François Garçon fait justice de ces explications, qui sont en réalité le paravent d’une certaine forme hexagonale de repli national et de refus de la mondialisation.
Description clinique du « mal universitaire français »
Le cœur de l’ouvrage propose une batterie d’informations et de statistiques particulièrement fournie. L’auteur définit les spécificités et les difficultés de notre enseignement supérieur en la comparant à d’autres pays développés[1] : Etats-Unis, mais surtout pays européens frontaliers (Suisse, Allemagne, Grande-Bretagne, Italie).
Il apparaît que l’Université française est le parent pauvre de l’enseignement supérieur français. Notre pays a en effet comme triste spécificité de créer une division entre enseignement (universitaire) et recherche (assurée pour une large part via le CNRS).
Les étudiants et maintenant les enseignants-chercheurs les plus sélectionnés sont aspirés par les grandes écoles, établissements de pouvoir et historiquement peu impliqués dans la recherche.
A l’Université française incombe par conséquent une charge écrasante de missions parfois contradictoires : assurer la démocratisation de l’enseignement supérieur, renforcer l’effort de recherche, participer au marché international de la connaissance, se soucier de justice sociale et territoriale, maintenir une égalité formelle entre les établissements universitaires…
Mais à trop charger la barque, celle-ci devient ingouvernable.
Les étudiants, premières victimes de la situation dégradée de l’Université française
Cette situation dégradée affecte tous les acteurs du système universitaire.
Elle affecte d’abord les étudiants.
La gratuité de l’enseignement supérieur est un leurre, tant elle revient à faire financer les études des classes moyennes et supérieures par l’ensemble de la population. Le taux d’abandon dans les universités françaises est élevé, le lien entre l’établissement et l’élève est faible, l’encadrement pédagogique et éducatif est souvent négligé et négligent.
La faiblesse du service aux consommateurs du système universitaire trouve sa contrepartie dans leur désinvestissement chronique et la récurrence des mobilisations sociales aux mots d’ordre parfois hasardeux.
L’environnement culturel, sportif ou artistique des sites universitaires reste en outre très en-deçà des autres systèmes universitaires occidentaux.
Opacité des recrutements, sécurité du statut, faiblesse des rémunérations : un cocktail délétère pour l’attractivité du métier d’enseignant-chercheur en France
Elle affecte ensuite les professionnels de l’enseignement supérieur eux-mêmes. Les modes de recrutement de l’université française favorisent dramatiquement les candidats locaux. Ils conduisent à l’absence d’un véritable marché – gage de qualité et de transparence partout ailleurs.
Comme le souligne avec ironie l’auteur, l’enseignement supérieur et la recherche en France, qui critiquent souvent le secteur privé pour l’immoralité supposée des pratiques qui y ont cours, abritent des pratiques en matière de ressources humaines ou de travail qui y seraient condamnées au nom de l’égalité des chances et de la transparence des procédures de recrutement!
La faiblesse des rémunérations, la spécificité française de « chercheurs purs » qui n’enseignent pas ou peu, le mode de gouvernance des universités (que la loi dite « LRU » commence à peine à transformer) forment un cocktail délétère pour le supérieur français.
Au total, les enseignants-chercheurs qui s’investissent (notamment dans l’enseignement en 1er cycle ou l’encadrement pédagogique) ne sont ni incités, ni récompensés.
Le modèle américain est-il transposable en Europe ?
Pour envisager une réforme de ce système universitaire, François Garçon propose une lecture attentive de modèles occidentaux d’enseignement supérieur qui monopolisent les classements internationaux.
Il commence par le système américain, volontiers érigé en modèle (attractif ou répulsif). Il en souligne les vertus, qui tiennent à sa capacité à allier la présence d’établissements d’excellence et un dense réseau de Colleges assurant une démocratisation universitaire bien supérieure à l’Europe.
François Garçon se garde cependant de préconiser une transposition de ce modèle en Europe. Il insiste en particulier sur le coût exorbitant et croissant des diplômes aux Etats-Unis, qui finit par inquiéter l’opinion publique américaine elle-même.
Un modèle helvético-britannique ?
En réalité, c’est vers des modèles proches de la France, mais finalement méconnus, que se tourne l’auteur, à savoir la Suisse et la Grande-Bretagne.
Ces deux pays sont en effet très proches en matière d’enseignement supérieur. Ayant jusqu’aux années 1980 un faible nombre d’étudiants, ils ont réformé profondément leur système universitaire.
Le résultat est spectaculaire : ils se sont durablement installés à la tête des classements internationaux -la Suisse jouant le tour de force d’y placer des établissements de création très récente, sans d’ailleurs être anglophone-.
Or, loin d’avoir vendu leur âme à un capitalisme réputé ne pas en avoir, ces deux pays ont mené de pair démocratisation sociale, attraction croissante des enseignants et étudiants étrangers, succès scientifiques, le tout quasi-totalement par financement public.
Ce remarquable succès, moins médiatisé que le gigantisme des campus américains ou les universités-champignons indiennes ou chinoises, est pourtant celui qui est le plus aisément transposable en France.
Une invite à la réforme
François Garçon souligne en conclusion de cet ouvrage passionnant que des pays comme l’Allemagne ont retenu les enseignements des classements et des évaluations… et les ont mis à profit pour réformer leur université. Il invite aussi à l’audace, puisqu’il propose notamment la suppression des grandes écoles et des classes préparatoires…
La France ne peut pas se laisser distancer si, précisément, elle veut préserver son héritage d’excellence éducative et scientifique.
Victor Haumonté
Crédit photo : Flickr, marcgelinas
[1] Voir également à cet égard les travaux de Christine Musselin et Judith Lazar.












Aucun commentaire.