
La grève, un délit devenu un droit
Stéphane Sirot | 01 septembre 2007
Citation de l’Etude Le service minimum garanti, enfin ? (F. Rouvillois, F. Wintrebert, juin 2007).
Depuis l’élection présidentielle, la question du service minimum dans les transports publics a resurgi à l’avant-scène de l’actualité. Ce sujet récurrent provoque un débat orchestré autour de trois concepts : le droit de grève, le droit au travail et la continuité du service public. Présentés comme concurrents, ces principes constitutionnels s’entrechoquent dans le discours politique. A tel point que leur contenu paraît fortement brouillé. Pourtant, chacun a un sens précis, fruit d’une longue construction historique.
La reconnaissance de la grève en tant que droit est l’aboutissement d’un cheminement d’un siècle et demi. La Révolution française, tout à sa volonté d’instaurer la liberté d’entreprise après avoir supprimé le système des corporations, établit avec la loi Le Chapelier (juin 1791) les cadres généraux du nouveau marché du travail. Elle interdit l’organisation et la revendication ouvrières. Napoléon Bonaparte parachève le dispositif : en 1803, la participation à une coalition – terme désignant l’arrêt du travail – est qualifiée de délit, infraction reprise en 1810 par le Code pénal qui prévoit des peines d’amende et de prison. Chaque année, des grévistes sont jugés et parfois punis.
Il faut attendre 1864 pour que la loi du 25 mai supprime ce délit, remplacé par celui d’« atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail ». La grève est dépénalisée, mais elle n’est pas encore un droit à part entière. Pourtant, les énergies revendicatives sont libérées et la grève devient un fait social banal. Un coup d’arrêt lui est cependant porté par le régime corporatiste de Vichy qui interdit tous les mouvements revendicatifs. Après la Libération, les réformes majeures sont orientées par le programme du Conseil national de la Résistance (mars 1944), déterminé à favoriser « la reconstitution, dans ses libertés traditionnelles, d’un syndicalisme indépendant, doté de larges pouvoirs dans l’organisation économique et sociale ». Et doté aussi de moyens d’action : après avoir énoncé que « tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale », le préambule de la Constitution de la IVe République (octobre 1946) affirme que « le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ». Alors que l’Europe du Nord-Ouest décide de privilégier la négociation, la loi fondamentale française manifester le choix de la régulation conflictuelle des rapports sociaux, validé de nouveau par la Constitution de la Ve République (octobre 1958) qui renvoie au préambule de 1946. Pour la première fois, la grève est reconnue comme un droit constitutionnel.
Mais même si la loi de février 1950 sur les conventions collectives apporte une précision inédite selon laquelle « la grève ne rompt pas le contrat de travail », la législation annoncée ne voit pas le jour. Les limites à l’exercice de ce droit ne sont donc pas fermement tracées : c’est la jurisprudence qui en réglemente pour l’essentiel l’usage. Le pouvoir judiciaire souligne d’ailleurs très tôt, dans une célèbre décision du Conseil d’Etat (7 juillet 1950), l’ambiguïté ouverte par le préambule de la Constitution : « En l’absence de cette réglementation, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d’exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre […] en l’état actuel de la législation, il appartient au gouvernement […] de fixer lui-même […] la nature et l’étendue desdites limitations » pour les services publics. Pourtant, à de rares exceptions près telle la loi du 31 juillet 1963 instituant un préavis de cinq jours pour les fonctionnaires, peu de textes législatifs ont été votés en matière de conflit du travail. Le texte fondamental des IVe et Ve Républiques fait ainsi de la grève une liberté individuelle aux contours fluctuants et susceptible d’entrer en collision avec d’autres droits essentiels.
Le préambule de la Constitution de 1946, juste avant d’évoquer le droit syndical et de grève, proclame le droit au travail : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. » Ce droit remonte à la Constitution de 1793 qui affirme pour la première fois que « la société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d’exister à ceux qui sont hors d’état de travailler ». Cette reconnaissance du droit de subsistance au moyen d’un emploi, ou à défaut de secours assumés par la collectivité, est reprise en 1848 dans le préambule de la Constitution de la IIe République. Conçu comme la possibilité pour chacun de vivre dignement de la rétribution de ses capacités, le droit au travail est érigé au rang d’essence du système républicain. L’un des ténors politiques de l’époque, Ledru-Rollin, l’exprime le 11 septembre 1848 à la tribune de l’Assemblée : « Quand un homme travaille, il s’anoblit […] On a dit, le droit au travail, c’est le socialisme. Je réponds : non, le droit au travail, c’est la République appliquée. »
Les Constitutions de la IVe et de la Ve République reprendront ces principes. Si la jurisprudence édifie le droit au travail en obligation de moyens et non de résultats, la République est cependant garante de la protection du citoyen dans l’incapacité d’oeuvrer. Le droit au travail s’est ainsi inscrit dans la panoplie des droits sociaux et n’a jamais été un principe constitutionnel opposé au droit de grève.
La continuité du service public entre-t-elle davantage en contradiction avec le droit de grève ? A-t-elle une même valeur constitutionnelle ? Dès le début du xxe siècle, cette notion est utilisée pour faire obstacle à l’exercice de la grève par les fonctionnaires. Ainsi, en 1909, le Conseil d’Etat entérine-t-il la révocation de quelque 300 postiers coupables d’avoir cessé le travail. Car, comme le dit le commissaire du gouvernement Tardieu : « La continuité est de l’essence du service public. » Mais le régime de Vichy lui porte un coup en 1941 en édictant le premier statut général des fonctionnaires disposant que « tout acte des fonctionnaires portant atteinte à la continuité indispensable à la marche normale du service public qu’il a reçu d’assurer constitue le manquement le plus grave à ses devoirs essentiels ». Ce statut est abrogé en 1944.
Est-ce en partie l’influence de ce passé immédiat ? Toujours est-il que les Constitutions de la IVe et de la Ve République restent muettes sur la continuité du service public. C’est seulement en 1979 qu’une décision du Conseil constitutionnel avance que « la continuité du service public […], tout comme le droit de grève, a le caractère d’un principe de valeur constitutionnelle ».
Leurs légitimités respectives ne sont donc pas tout à fait identiques. Ce décalage est parfois reconnu et regretté par les défenseurs du service minimum. Ainsi une récente étude de la Fondation pour l’innovation politique propose-t-elle d’inscrire dans la Constitution le principe de continuité du service public pour « renverser la présomption de légitimité dont bénéficie seulement actuellement le droit de grève »…
Droit de grève, droit au travail et principe de continuité du service public ont donc chacun leur histoire et leur degré de légitimité. Les mettre en concurrence ne correspond pas à la conception de l’édifice des textes fondamentaux qui depuis la Révolution jalonnent notre histoire. Depuis la dépénalisation de la grève, la principale limite imposée à sa pratique du xixe siècle à nos jours est le délit d’« entrave à la liberté du travail » qui consiste à empêcher par des moyens de contrainte la poursuite de la production. Ce qui est sans rapport avec la « liberté du travail » aujourd’hui souvent présentée comme le droit de gagner son entreprise au moyen des transports en commun.
* Chercheur au Centre d’histoire sociale du XXe siècle
(Paris-I) et auteur de La Grève en France (Odile Jacob).
Isaac Le Chapelier, inspirateur de la loi de 1791 sur la liberté d’entreprendre qui proscrit les arrêts de travail. A droite, usagers lors de la grève de la SNCF en 1955.
FRANÇOIS GAUDU* « LA CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC EST DÉJÀ ASSURÉE »
« Rappelons d’abord qu’il y a très peu de grèves aujourd’hui dans le secteur privé contrairement aux années 70. Cette quasi-disparition a créé un effet de loupe sur celles qui se poursuivent dans le secteur public. Ensuite, contrairement aux Etats-Unis ou à la Grande-Bretagne, la grève a très peu contribué à la production du droit du travail, sauf dans le cadre de très grandes crises nationales (1936, 1946, 1968). En Grande-Bretagne, la chute du pouvoir syndical a entraîné le détricotage du droit de travail, ce qui n’est pas le cas en France où l’Etat est vécu comme rempart et protecteur quand il représentait un ennemi de classe outre-Manche. Ceci posé, la question du service minimum peut s’analyser en termes juridiques et d’opportunité. Etat et syndicats auraient dû s’acheminer vers un accord négocié plutôt que d’en passer par la loi car ils avaient conscience de part et d’autre qu’aucun texte n’empêchera jamais la grève, que des dispositifs, bien que méconnus, existent déjà pour assurer la continuité du service public, et que rien n’est pire que des textes qu’on n’applique pas. Il y a trop de précédents de textes ignorés pour prendre le risque d’aggraver encore l’écart entre la norme et la réalité. On pourrait déjà appliquer le non-paiement des jours de grève. Ce qui n’est pas le cas dans l’Education nationale qui interprète largement la notion de jours de service.
Juridiquement, les fonctionnaires sont déjà censés déposer un préavis mais cette loi votée avant 1971 n’a pas été déférée devant le Conseil constitutionnel. On ne sait donc pas ce qu’il en serait s’il devait se prononcer aujourd’hui. Ainsi le projet d’en passer par le vote à bulletin secret après une semaine de grève souffre d’une ambiguïté juridique. Le droit de grève est un droit individuel qui ne peut pas être tributaire d’une décision de groupe. Cependant, les préavis sont déposés par des syndicats ce qui restreint le droit individuel en amont. Une solution serait de soumettre le préavis et la fin de la grève au fait majoritaire. Autrement dit d’en laisser l’initiative aux syndicats majoritaires dans les élections professionnelles comme celle des comités d’entreprise ou assimilés. La loi Fillon de 2004 permet déjà aux branches professionnelles de choisir de négocier sur ce principe. C’est une piste qui aurait mérité d’être approfondie. »
* Spécialiste du droit du travail, professeur de droit privé à l’université Paris-I et auteur de Le Droit du travail (Dalloz).
Lisez l’article sur lesechos.fr.




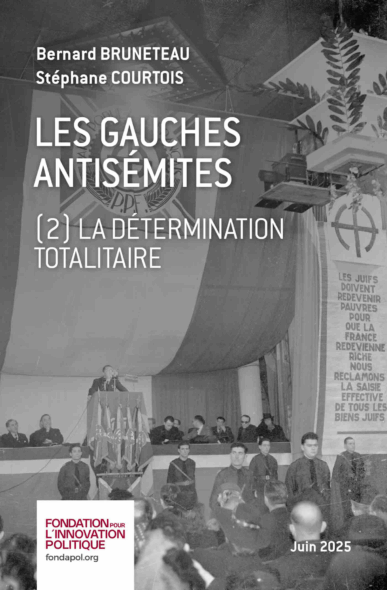
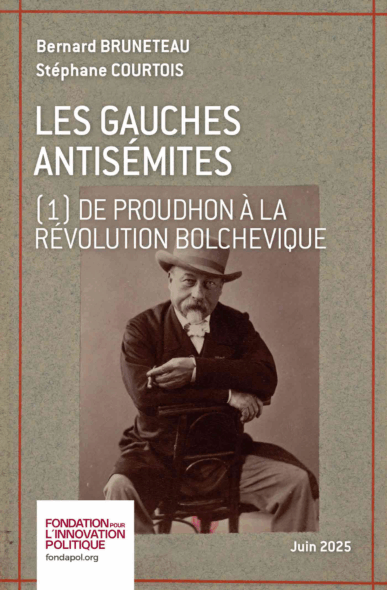


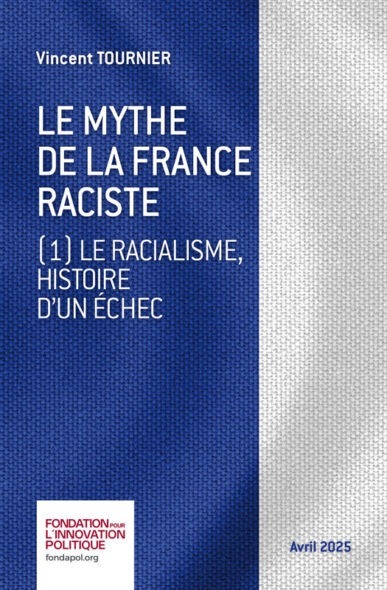



Aucun commentaire.