
Charles Jaigu: « Extension du domaine de l’Europe »
Charles Jaigu | 01 mars 2023
CHRONIQUE - La Fondation pour l’innovation politique fait le point sur l’opinion européenne, et Jacques Rupnik nous entretient des paradoxes de l’élargissement.
En l’an 2022, les Européens ont été proeuropéens, comme les années précédentes. La synthèse sur l’état de l’opinion européenne publiée par la Fondation pour l’innovation politique constate, d’année en année, par-delà les crises, un souhait toujours aussi net des opinions européennes en faveur de l’euro et d’une union plus étroite des pays membres. Ces dernières années, le soutien à l’UE a aussi été conforté par plusieurs défis relevés: le Brexit, le Covid, la Russie. Le Brexit n’a pas été la martingale promise par les souverainistes, la politique vaccinale et d’aide structurelle ont été jugées efficaces par les opinions après les premiers cafouillages, l’agression de Vladimir Poutine en Ukraine a soudé les États membres. Un point très surprenant est la plus grande confiance de l’opinion européenne à la Commission et au Parlement (47 %) qu’à leurs gouvernements et parlements nationaux, qui oscillent entre 41 % et 44 %. À l’est de l’Europe, cet écart est plus fort encore. Il apparaît que «l’Union européenne est perçue par une partie de l’opinion comme un moyen de protéger la démocratie face à la dérive autoritaire du gouvernement national», conclut la Fondapol. Les évolutions électorales récentes de plusieurs pays membres vers la droite ne modifient pas l’adhésion au projet européen, mais elles font évoluer les priorités de la politique européenne en faveur du contrôle des frontières, de la sécurité commune, de la responsabilité individuelle et contre l’assistanat.
Ce consensus impressionnant reste néanmoins ambigu. Comme le disait le politiste Stanley Hoffmann, l’Europe est, encore et toujours, «une divinité dont la signification varie pour chacun de ses croyants». La Pologne illustre à l’envie ces contradictions. Son opinion plébiscite l’appartenance à l’UE, mais son gouvernement conteste bruyamment la tutelle de Bruxelles. Le sentiment d’appartenance européen est fort, mais les modalités de cette appartenance sont hésitantes et contestées. Elles peuvent donner lieu à de fortes embardées. C’est vrai sur les questions d’approfondissement des institutions, et c’est vrai en matière d’élargissement.
Ce sujet délicat est revenu sous les projecteurs avec engagements solennels de la Commission et du Parlement d’accueillir à marche forcée l’Ukraine dans l’Europe. À marche forcée? Minute, papillon. Ce serait oublier que l’élargissement est devenu un mot tabou en Europe. Jacques Rupnik, directeur de recherche au Ceri de Science Po et spécialiste des confins orientaux du Vieux Continent, nous remet quelques événements en mémoire qui montrent que la mélodie de l’élargissement n’est pas un hymne à la joie. «L’entrée dans l’Union européenne des anciens protectorats soviétiques était la réponse à l’effondrement du mur en 1989, mais elle s’est faite quinze ans après, et les opinions européennes ne les ont pas comprises.» C’est le moins que l’on puisse dire: elles ont sanctionné ce choix par les référendums de 2005 (France, Pays-Bas) et par le référendum britannique qui a dit oui au Brexit, où le débat sur la migration interne des travailleurs venus de l’Est européen a pris des proportions catastrophiques. Il ne faut pas s’y tromper, les électeurs français et anglais ont largement voté contre la libre circulation du «plombier polonais» et contre l’élargissement du «club». Autre tabou: la Turquie. On sous-estime l’effet dévastateur de l’optimisme béat de l’après-guerre froide qui a débouché sur l’absurde statut de candidat accordé à la Turquie en 1999. Le processus est aujourd’hui gelé, mais pas officiellement annulé.
Il ne faut donc pas s’étonner que les six pays d’ex-Yougoslavie qui ont été déclarés éligibles à une candidature dès 2003 soient encore loin d’une entrée dans l’UE. «Le premier élargissement à l’est était la réponse à la fin de l’Union soviétique, le deuxième élargissement au sud-est était la réponse à dix ans de guerre dans les Balkans, et le troisième élargissement à l’est est à nouveau une réponse à la guerre», fait observer Jacques Rupnik. «Depuis un certain temps le statut de candidat ne se transforme plus en adhésion. Si on veut redonner une crédibilité aux espoirs d’adhésion, il faudrait déjà que les pays qui sont candidats depuis vingt ans maintenant rejoignent l’UE», relève Jacques Rupnik. Cette abondance de candidatures est un embarras pour l’Union européenne. Elle a tenté d’y remédier en proposant plusieurs fois des associations moins formelles: «En 2003, les Européens ont défini, sous l’impulsion de Javier Solana et Chris Patten, une nouvelle “politique de voisinage”: son but était d’éviter que l’élargissement soit le seul mode de relation avec un pays voisin de l’Union, nous rappelle Rupnik. La ligne était simple: vous pouvez tout avoir sauf les institutions.» Hélas, les voisins orientaux ne veulent pas d’un partenariat constructif et bienveillant. Ils veulent la carte VIP de membre du club. On peut les comprendre, car l’Europe, ça marche, contrairement au «monde russe» de monsieur Poutine. L’Ukraine et la Pologne avaient un produit intérieur brut comparable avant l’adhésion polonaise en 2004, et aujourd’hui celui de la Pologne a été multiplié par trois, quand celui de l’Ukraine a stagné. Son niveau de vie reste quatre fois inférieur à celui de la Roumanie, l’État membre le plus pauvre.
Le risque pour l’Union européenne est la fuite en avant. Or les Européens, notamment dans les vieux États membres, ont clairement dit, depuis vingt ans, qu’ils y étaient hostiles. Faire entrer l’Ukraine, la Moldavie, et six États balkaniques risque d’être très mal compris. «On ne peut pas mentir aux Européens et leur dire “c’était difficile à 27, mais ne vous inquiétez pas, tout sera beaucoup plus facile à 35!”», admet Rupnik. C’est pourquoi les promesses d’adhésion rapide faites à l’Ukraine laissent sceptique. «Il faut d’abord que la paix définitive soit revenue aux frontières. Il n’est pas question pour l’Europe d’importer un conflit territorial», rappelle Rupnik. Vous avez dit la paix? Vaste et improbable programme! «Cela supposerait un nouveau régime russe, qui accepte la coexistence pacifique avec le modèle européen», reconnaît Rupnik. Perspective plus que lointaine. Pour éviter le supplice de Tantale d’une adhésion indéfiniment reportée, Jacques Rupnik suggère que «les États candidats accèdent par étapes aux compétences européennes, ce qui permettrait de débloquer les fonds européens correspondants». Suggérons une autre solution: que l’Union européenne revienne à la politique de voisinage imaginée dans les années 2000: on vous donne tout, sauf les institutions.
Retrouvez l’article sur lefigaro.fr
Dominique Reynié (Dir.), L’opinion européenne 2020-2022, janvier 2023


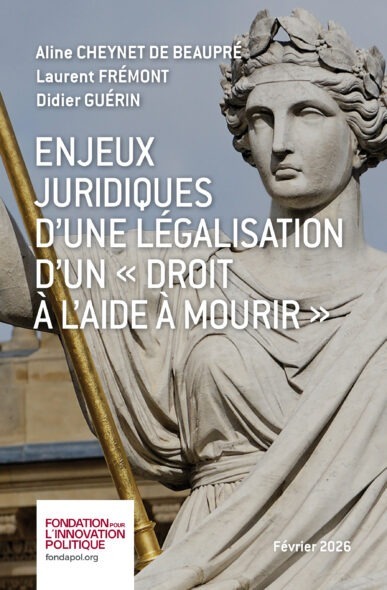
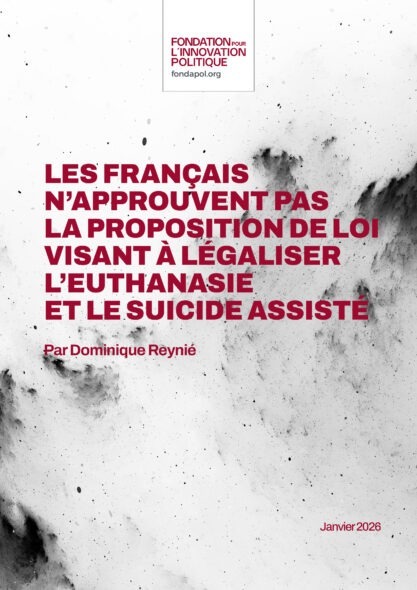









Aucun commentaire.