
Jean-Paul Bouttes: «L'État français a délaissé son rôle en confiant le nucléaire aux marchés»
Jean-Paul Bouttes, Ronan Planchon | 24 avril 2023
Ancien directeur de la stratégie d'EDF, Jean-Paul Bouttes vient de publier une note pour la Fondation pour l'innovation politique, intitulée « Souveraineté, maîtrise industrielle et transition énergétique », où il analyse les conditions de réussite du programme nucléaire français de 1945 à 1975.
LE FIGARO. – Comment la France est-elle devenue pionnière dans le domaine de l’énergie nucléaire, à partir de 1945 ? Quelles conditions ont permis cette réussite ?
Jean-Paul BOUTTES. – On parle souvent de la réussite du programme nucléaire français et de la construction des centrales entre 1975 et 1990, mais il ne faut pas oublier ce qui s’est passé avant. Le général de Gaulle a été à l’initiative de cette stratégie en 1945. Et avec lui, un certain nombre de politiques et de personnalités comme Félix Gaillard (NDLR, ancien ministre des Finances et président du Conseil des ministres sous René Coty) ont compris la nécessité de mettre en place une vraie stratégie énergétique, pour assurer la reconstruction du pays et sa prospérité. L’expérience des deux guerres mondiales va mettre en évidence la vulnérabilité énergétique de la France, beaucoup moins bien dotée en charbon que l’Allemagne ou le Royaume-Uni, et sans pétrole. La France a ainsi eu depuis le début du vingtième siècle le souci de sa souveraineté énergétique. L’hydraulique a été le premier moyen d’avoir de l’électricité, en dépendant peu d’autres puissances étrangères. Dans les années 1950-1960, on va progressivement utiliser l’ensemble des sites disponibles.
Dès 1945, la France a pris conscience du potentiel du nucléaire non seulement pour son utilisation militaire, mais aussi pour l’approvisionnement de la France en électricité et pour assurer la sécurité de cet approvisionnement. La force de notre pays a été de comprendre rapidement l’intérêt de maîtriser la dimension civile du nucléaire. Au total, il y a eu trois grandes périodes dans le nucléaire. De 1945 à 1970 : c’est le moment des prototypes, des essais des démonstrateurs industriels et du choix de développer massivement la filière industrielle via la filière à eau légère. Ensuite, de 1970 à 1990, il y a eu la construction des 60 réacteurs (ou «tranches»). Le parc des centrales nucléaires françaises présente la particularité d’être standardisé : elles sont techniquement proches et reposent toutes sur une même technologie, l’eau sous pression. La troisième grande réussite, c’est l’exploitation de notre parc, à partir des années 1980, qui nous a fourni les trois-quarts de notre électricité jusqu’à 2021. La capacité à maintenir un cap politique transpartisan sur toutes ces décennies a été le point décisif. C’est ce qui a permis aux pouvoirs publics de mobiliser les meilleures compétences scientifiques et industrielles. La fin des années 1990 marque une première inflexion, avec une perte de compétences liée à l’absence de nouveaux investissements depuis près d’une décennie, et la fragilisation du consensus politique sur l’intérêt du nucléaire.
Depuis quelques années, notre politique industrielle s’est étiolée, dites-vous. Nous avons misé presque exclusivement sur les marchés européens (concernant le gaz et l’électricité) ou internationaux (pour les équipements ou les matières premières). Quelles ont été les conséquences de ce choix ?
Le milieu des années 80 a été marqué par le contrechoc pétrolier et gazier. Dans le même temps, on met au point la technologie de la centrale à gaz à cycle combiné. En 1986, on entre dans une période de surabondance énergétique, qui va durer jusqu’en 2005, où les prix du gaz et du pétrole sont très faibles. Sur cette période, beaucoup ont pensé que les centrales à gaz étaient une technologie miracle, à tort.
À partir des années 90, apparaissent les premiers débats sur l’ouverture des réseaux électriques. La directive européenne de 1996 a introduit les marchés au cœur de l’électricité et du gaz. Certains politiques ont alors pensé que ce n’était plus à l’État de s’occuper de l’énergie, mais au marché. Avec la globalisation, les dirigeants ont aussi pensé que la géopolitique n’était plus un problème. La France, en particulier, a commencé à se désintéresser des problèmes de sécurité d’approvisionnement énergétique et de la compétitivité de son système électrique. Il faudra attendre de nombreuses années, et notamment la guerre en Ukraine, pour comprendre que ces choix ont été catastrophiques.
Peut-on revenir en arrière ? La France peut-elle reprendre la main dans ce domaine ?
Encore faut-il avoir une politique ambitieuse et transpartisane en la matière. L’État s’est apparemment retiré au profit des marchés européens. Mais la réalité est têtue, ces marchés ne peuvent fonctionner seuls. Cette démission de l’État s’est traduite ainsi dans un système électrique européen hyperréglementé, mais de façon largement incohérente. D’où sa grande fragilité et son inefficacité aujourd’hui. Il est temps de prendre à nouveau conscience de l’importance de maîtriser notre industrie et d’assurer la sécurité d’approvisionnement, ce qui fait une puissance économique dans la durée.
La question de fond, c’est celle de savoir si l’État doit à nouveau assumer son rôle de chef d’orchestre en s’appuyant sur des compétences scientifiques et industrielles de haut niveau. On voit aujourd’hui la nécessité pour l’État de reprendre la main dans ce domaine. C’est le grand enjeu de ces dix ou vingt prochaines années, si l’on veut assurer notre souveraineté et se développer sur le plan économique.
La France peut-elle faire cavalier seul ou notre souveraineté industrielle doit-elle passer par des coopérations internationales?
Il est nécessaire d’avoir des bonnes coopérations internationales qui soient profitables pour tout le monde. Il faut à la fois qu’on ait une électricité peu chère pour les ménages comme pour les entreprises, tout en gardant la maîtrise industrielle pour conserver notre souveraineté vis-à-vis des puissances étrangères. Atteindre ces objectifs suppose d’avoir une vraie maîtrise scientifique et industrielle. Si on est capable de faire nous-mêmes une bonne partie du travail, on peut ensuite choisir ce que l’on veut partager avec d’autres pays, que ce soit en termes de fabrication ou de recherche scientifique. Et puis, il faut que l’on ait une vision claire de ce que doit être notre politique étrangère. Il est impératif d’intégrer les enjeux géopolitiques avec les stratégies industrielles. C’est ce qui a été fait dans l’histoire de la filière nucléaire avec de nombreux partenariats, y compris sur le retraitement avec les Japonais. Le général de Gaulle autorise dès 1958 la construction de la première centrale à eau légère de technologie américaine Westinghouse pour la tester avec les Belges.
A-t-on toujours les compétences pour réformer en profondeur notre politique industrielle et préparer la décennie qui vient ?
Oui. La France est un acteur majeur dans la construction des nouvelles centrales nucléaires. En allant sur les chantiers de Flamanville en France, d’Hinkley Point au Royaume Uni, en participant à la mise en place de la centrale nucléaire d’Olkiluoto à l’ouest de la Finlande, ou en participant au chantier des EPR de Taïshan en Chine, notre pays a montré son savoir-faire et a su remonter un peu la pente. Il y a chez nous des ingénieurs et des personnes de grande qualité et qui seront, demain, les acteurs de notre puissance si on sait les mobiliser et les responsabiliser. Cela n’empêche pas d’établir un diagnostic sans complaisance sur nos lacunes actuelles, en particulier concernant nos capacités de pilotage d’un programme industriel ambitieux.
Plusieurs initiatives vont dans le bon sens. La création de la délégation interministérielle sur le nucléaire, pilotée par l’ancien directeur général de l’armement, est une bonne idée. Cela doit permettre de remettre l’État au cœur de notre politique industrielle. Il faudra, ensuite, fixer des objectifs clairs : remettre à des niveaux de disponibilité de 85% ou plus notre parc nucléaire, prolonger la durée de vie des centrales, en construire de nouvelles mais aussi déterminer quel sera notre mix électrique (la part du nucléaire, des photovoltaïques, des éoliennes, etc.) et anticiper nos besoins en énergie dans les prochaines années.
Retrouvez l’article sur lefigaro.fr
Jean-Paul Bouttes, Souveraineté, maîtrise industrielle et transition énergétique (1) Les conditions de réussite du programme nucléaire français de 1945 à 1975, Fondation pour l’innovation politique, mars 2023.
Jean-Paul Bouttes, Souveraineté, maîtrise industrielle et transition énergétique (2) Transition énergétique, géopolitique et industrie : quel rôle pour l’État, Fondation pour l’innovation politique, mars 2023.
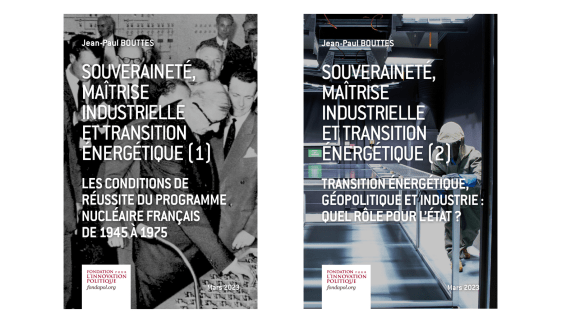












Aucun commentaire.