
« L’habitant des grandes villes, défouloir d’une société en crise »
Nelly Garnier | 08 juillet 2019
Pour Nelly Garnier, communicante proche du parti Les Républicains, le portrait-robot de l’habitant des métropoles, à l’aube des municipales de 2020, ne correspond que partiellement à l’image caricaturale du « bobo » gentrificateur.
Alors que, tout au long des XIXe et XXe siècles, la ville n’a cessé d’être décrite comme l’avant-poste des maux de la modernité, s’est développé, au cours des dernières décennies, un discours enfermant le métropolitain dans la caricature d’une élite heureuse. Dans les métropoles, une nouvelle bourgeoisie aurait élu domicile « dans une sorte d’altermonde en suspension », selon l’expression du politiste Jérôme Fourquet, privilégiant l’entre-soi, disposant de tous les capitaux, financiers, sociaux et culturels, pour se créer sa propre « citadelle invisible » – à en croire, cette fois, le géographe Christophe Guilluy.
Par quel processus l’habitant des grandes villes est-il devenu le défouloir collectif d’une société en crise ? Pour le comprendre, il faut d’abord revenir sur la grande mutation urbaine des cinquante dernières années qu’a été la gentrification. L’analyse de ce phénomène a été principalement portée par des écoles d’inspiration marxiste, qui ont installé les nouvelles populations urbaines dans la position de dominants imposant leur violence de classe à des catégories populaires reléguées en périphérie. Le concept de « bobo » est venu, par la suite, concentrer toutes les critiques sur l’habitant des métropoles.
En faisant le choix de la centralité, l’habitant des métropoles exprime ses priorités : l’accès à une offre abondante de services, une sociabilité alliant une forme d’entre-soi et un fort brassage culturel
Marqué du sceau de la critique sociale, le discours sociologique, politique et médiatique en est venu à occulter les nombreux signaux qui renvoyaient à la montée d’un malaise urbain. Pourtant, la ville ne fait plus rêver. Alors que le « gentrificateur » a souvent été décrit sous les traits d’un prédateur patrimonial, la part des personnes propriétaires de leur résidence principale est beaucoup plus faible dans les métropoles qu’à l’échelle nationale : quand 60,5 % des Français sont propriétaires de leur résidence principale, ils ne sont que 34 % à Paris, 36,8 % à Bordeaux, 40,8 % à Marseille, 36,7 % à Toulouse, 28,8 % à Strasbourg et 40,2 % à Grenoble (chiffres Insee 2015). À cela s’ajoute un statut des cadres dégradé et qui ne joue plus un rôle de distinction sociale, quand près de la moitié de la population active est composée de cadres et professions intellectuelles supérieures, comme à Paris.
Dans les quartiers en gentrification des centres urbains, la mixité est de plus en plus subie par des populations dont le choix résidentiel est avant tout dicté par des raisons économiques, et qui vivent avec la peur du déclassement pour leurs enfants. Enfin, la délinquance, le risque terroriste, la pollution, sont vécus comme autant de menaces qui dessinent un environnement anxiogène. Bien loin de constituer une élite qui se cloître derrière les murs que son capital culturel et économique lui permet de dresser, les habitants des métropoles font donc davantage figure de population désenchantée.
Positionnés au centre de l’espace social
En réalité, ce qui caractérise l’habitant des métropoles est moins sa position de « gagnant » dans la société mondialisée que la primauté qu’il accorde au capital culturel, et l’importance qu’il donne au fait de résider dans l’hypocentre comme mode d’expression de son capital culturel. En faisant le choix de la centralité, l’habitant des métropoles exprime ses priorités : l’accès à une offre abondante de services et d’équipements, une sociabilité alliant une forme d’entre-soi et un fort brassage culturel, ainsi qu’un positionnement symbolique au centre de l’espace social. Ce sont ces raisons, et non pas uniquement de simples raisons d’opportunités professionnelles, qui expliquent la part de population à fort capital culturel dans les villes. Les « cadres créatifs » représentent ainsi, en moyenne, près d’un tiers des cadres métropolitains. Toutefois, ce choix de la centralité urbaine n’est pas sans concession. Il est vécu avec beaucoup d’ambivalence, comme un combat difficile.
Politiquement, l’analyse du « malaise urbain » montre les limites de l’opposition entre des métropoles gagnantes et des territoires relégués, devenue un lieu commun du discours médiatique et qui sous-tend idéologiquement l’affrontement électoral entre La République en marche et le Rassemblement national. Si LRM et le RN se renforcent mutuellement par cette opposition sociale et géographique, les autres forces politiques, en premier lieu desquelles Les Républicains, ont créé les conditions de leur propre affaiblissement en reprenant les thèses vulgarisées notamment par Christophe Guilluy.
Toutefois, un espace politique pourrait s’ouvrir pour elles. Car bénéficiant du fort dynamisme économique des métropoles, les urbains n’en sont pas moins sujets à de nombreuses fragilités. Depuis 2001, la population métropolitaine a considérablement évolué. Son sentiment d’insécurité et son sentiment de déclassement sont allés croissants. À force de ne voir dans les métropoles que des territoires gagnants de la mondialisation, la sphère politique a trop vite considéré qu’elles ne méritaient pas d’action politique. Dès lors, tout l’enjeu des offres politiques qui voudront proposer une alternative de long terme à LRM et au RN lors des prochaines échéances électorales sera de savoir se défaire de la partition ville/périphérie et de répondre aux insécurités des urbains, notamment à l’occasion du prochain scrutin municipal.
Nelly Garnier est directrice associée chez Havas Paris et ancienne directrice des études pour Les Républicains (2017-2019). Elle a rédigé, sur le sujet des habitants des métropoles, une analyse qui doit être publiée le 8 juillet par le think tank Fondation pour l’innovation politique.
Lisez l’article sur lemonde.fr.

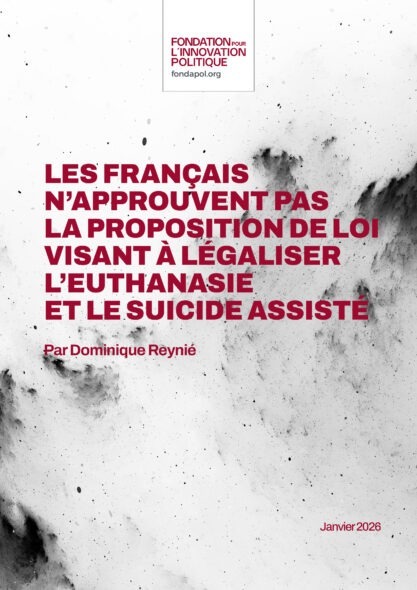










Aucun commentaire.