Apprendre avec les serious games ?
31 octobre 2017
« Si les serious games font l’objet de nombreuses expériences de terrain dans l’enseignement primaire et secondaire, ils restent suspects aux yeux d’une partie de la communauté éducative. Que penser de leur potentiel éducatif ? Qu’en dit la recherche ? Quels jeux choisir et comment les utiliser en classe pour favoriser l’apprentissage ? ». Julien Alvarez, Damien Djaouti et Olivier Rampnoux explorent les déclinaisons pratiques et pertinentes des serious games dans le domaine de l’éducation.
Qu’est-ce qu’un serious game et quelle est sa plus-value pour une classe ?
Il existe plusieurs définitions du serious game. Pour les auteurs, celle qui est proposée par les concepteurs de jeux vidéo Chen et Michael est à la fois synthétique et juste « tout jeu dont la finalité première est autre que le simple divertissement ». Les serious games peuvent ainsi se décliner au secteur de l’éducation, de la santé, de la politique ou de l’humanitaire. Les supports du jeu sont eux aussi multiples. Les premiers serious games sur support papier et concernant le domaine de l’éducation, remontent aux années 60 ; la version numérique est aujourd’hui largement popularisée, ouvrant davantage de perspectives en termes d’innovation, dans la manière de jouer, d’enseigner ou d’échanger de la donnée. Le serious game, est donc « le dispositif, numérique ou non, dont l’intention initiale est de combiner, avec cohérence, à la fois des aspects utilitaires ( « serious ») tels, de manière non exhaustive et non exclusive, l’enseignement, l’apprentissage la communication ou encore l’information, avec des ressorts ludiques issus du jeu, vidéoludique ou non (« game »). Une telle association vise une activité ou un marché s’écartant du seul divertissement ».
La plupart des logiciels « ludo-éducatifs » qui apparaissent dans les années 80, s’organisent autour d’une approche qui s’inspire des théories cognitives « behaviouriste » : le jeu est utilisé comme récompense suite à un travail de la part de l’apprenant. D’autres serious games s’appuient sur une approche différente, dite « intrinsèque » et inspirée des théories constructivistes. « Elle vise à mélanger les dimensions sérieuse et ludique, de manière à ce qu’il ne soit plus possible de les séparer ».
Processus et objectif : comment jouer aux serious games en classe ?
Dans les théories de l’apprentissage des serious games, différents courants structurent les travaux de recherche sur les théories de l’apprentissage. Le courant dit « fonctionnaliste » ou pragmatique conçoit l’apprentissage comme une activité de transformation au niveau de l’action et de la réflexion. Le second courant, béhaviorisme, fait la part belle à l’apprentissage par essais et erreurs. « L’apprenant va expérimenter plusieurs solutions, tester différentes options, jusqu’à ce qu’il trouve la bonne qui lui permette de franchir l’obstacle ou la difficulté imposée par le jeu ». Enfin, un troisième courant d’origine allemande, la « Gestalt psychologie », ou « psychologie de la forme », montre qu’un même stimulus n’engendre pas les mêmes réponses chez un individu. « Les réponses sont conditionnées par les représentations mentales des individus et l’interprétations que l’individu fait du stimulus ». En 2009, François Jarraudexpliquait sur le site « Café pédagogique » que « les jeux électroniques sont conformes à toutes les approches développées « comportementaliste, cognitivistes et constructivistes. Toutefois, alors que les anciens logiciels éducatifs mettaient l’accent sur les deux premières théories, les jeux plus récents encouragent, en raison de leur complexité et de leur nature ouverte et coopérative, une approche constructiviste de l’apprentissage ».
Créer des serious games sur mesure.
Certains enseignants font le choix de créer leurs propres serious games, à l’instar de Jean-Pierre Gallerand, professeur de SVT au collège Théophane-Vénard de Nantes. Les enseignants qui souhaitent se lancer dans la programmation de serious games sans être des spécialistes de la programmation informatique peuvent débuter avec des logiciels de présentations tels que PowerPoint ou Microsoft 1990-2016. Mais il est également possible d’élaborer des serious games à la structure et à la richesse proches de productions professionnelles grâce à une autre catégorie de logiciels, les « usines à jeux » : il faut donc faire appel à de création vidéoludique simples d’accès tels que RPG Maker ( Enterbrain / ASCII ) ou The Games Factory 2. La difficulté réside plutôt dans le choix d’une usine à jeux adaptée au niveau de maîtrise informatique de son utilisateur, mais aussi à la complexité du projet ou au temps dont l’utilisateur dispose.
Les étapes de création d’un jeu.
Plusieurs méthodologies de création de conception de serious games peuvent être envisagées, et comme tout acte créatif, la réalisation d’un jeu ne suit pas un schéma figé et normé. Les enseignants qui se lancent dans la mise en place d’un serious game optent le plus souvent pour l’approche dite « DICE » un modèle cyclique constitué de quatre étapes : « D » comme définir le contenu sérieux du jeu, « I » comme imaginer un concept de jeu, « C » comme créer un prototype afin de tester la pertinence du jeu, « E » pour évaluer la pertinence et l’efficacité du jeu après d’un public cible. En informatique, ce type de processus cyclique est qualifié de « processus itératif », chaque boucle représentant une « itération », ou une « version » du logiciel, comme le rappellent les auteurs.
Le savant équilibre entre le jeu et l’apprentissage.
La création de jeux en classe est une activité riche en matière d’apprentissage, du point de vue des connaissances (contenu sérieux du jeu), mais aussi du point de vue des compétences (travail de groupe et maîtrise du numérique). « Notons toutefois qu’on ne joue pas nécessairement quand on crée un jeu. Cette méthode s’apparente plutôt à la méthode Freinet : il s’agit de créer un jeu vidéo au lieu d’un journal de classe. Elle convoque la thématique du jeu, mais ne relève pas stricto sensu de la Ludo pédagogie ». Bien choisi et bien utilisé, le jeu sérieux serait donc un outil efficace pour faire progresser tous les élèves, s’adaptant au niveau de chacun, mettant l’accent sur des compétences parfois délaissées par l’école, tel que le savoir-être social et la capacité à travailler en autonomie.
Farid Gueham
Pour aller plus loin :
– « Enseigner les maths avec minecraft », vni- l’e-mag de l’éducation.
– « Qu’est-ce qu’un Serious Game ? », agilepartner.net
– Podcast « Des startups au secours des enseignants », France inter.

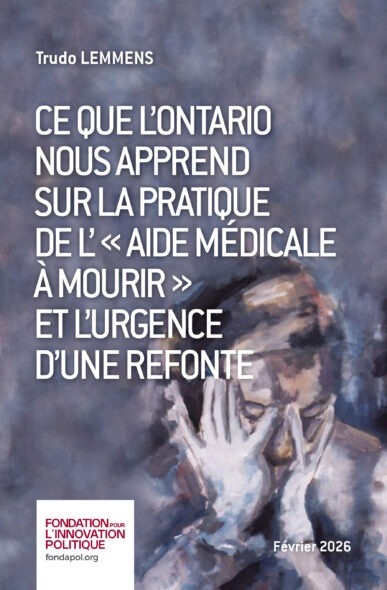
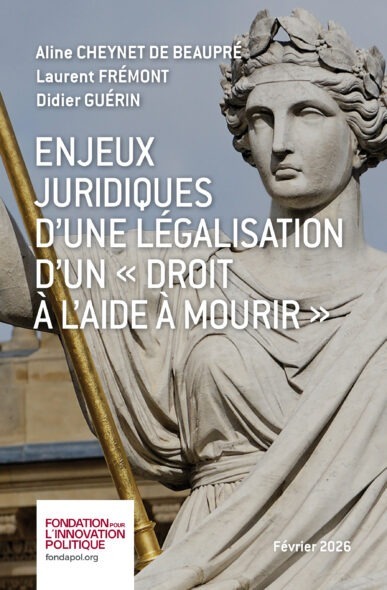
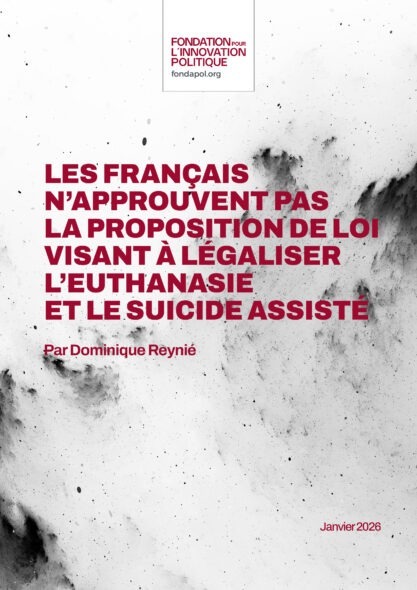








Aucun commentaire.