Au fait, c'est quoi la "justice sociale" ? (3)
Fondapol | 27 avril 2011
 « Pour nous, l’objet premier de la justice, c’est la structure de base de la société, ou plus exactement la façon dont les institutions sociales les plus importantes répartissent les droits et les devoirs fondamentaux et déterminent la répartition des avantages tirés de la coopération sociale ».
« Pour nous, l’objet premier de la justice, c’est la structure de base de la société, ou plus exactement la façon dont les institutions sociales les plus importantes répartissent les droits et les devoirs fondamentaux et déterminent la répartition des avantages tirés de la coopération sociale ».
(John Rawls, Théorie de la justice, trad. français, 1987, éditions du Seuil, collection Points, p. 33)
Décidément, le fait est établi : l’impératif de justice est bien le principe premier de toute société. Aussi bien le sens commun, pour qui « la justice est la première vertu des institutions sociales »[1], que la tradition philosophique depuis Aristote en sont d’accord. Car, pour parler comme Rawls, si les conceptions de la justice varient – ô combien ! –, le concept de justice est, lui, universellement reconnu, puisqu’il faut bien, partout et toujours, déterminer les règles de la « coopération sociale ». Et une justice, dont le domaine d’application doit être compris de façon large : non seulement les grands principes du droit civil et pénal, mais tout ce qui touche à la « structure de base » de la société. Autrement dit, la répartition des « biens premiers » que constituent aussi bien « les droits, les libertés et les possibilités offertes, les revenus et la richesse », que « le respect de soi »[2]…
Le juste contre l’utile
Jusqu’ici, John Rawls dit la même chose que John Stuart Mill ; et pourtant, l’un des objectifs essentiels de sa théorie de la justice est de fournir une solution alternative à la conception utilitariste, quelle que soit l’admiration qu’il voue au philosophe anglais, dont il a commenté sans relâche la doctrine[3].
Car, parmi les nombreux défauts qu’il présenterait, selon Rawls, l’utilitarisme commettrait une faute majeure : au nom de la maximisation de l’utilité globale de la société, il serait prêt à sacrifier les droits de certains[4]. Position qui, avant même de poser un problème moral, se heurte à une objection théorique : pourquoi une minorité, quelle qu’elle soit, souscrirait-elle à un ordre social qui la défavoriserait ? Autrement dit, l’utilitarisme ne permet pas de garantir les deux conditions premières d’une « société bien ordonnée » : la légitimité et la stabilité.
L’esprit de Kant
C’est à ce double enjeu fondamental que Rawls va consacrer sa propre démonstration, dans une problématique directement reprise de Kant, référence constante de la Théorie de la justice [5]: de même que le philosophe allemand s’interrogeait sur les conditions de possibilité du jugement moral, de même Rawls va se demander : à quelles conditions une société juste est-elle pensable?
Il n’est évidemment pas possible de rendre compte ici de la démarche suivie par Rawls, qui occupe une œuvre immense, complexe et évolutive : la seule Théorie de la justice ne compte pas moins de 629 pages ( notes non comprises) dans l’édition française !
Contentons-nous des éléments essentiels de la réponse qu’il apporte à la double question de la légitimité et de la stabilité de l’ordre social.
Les principes de la justice
Celle-ci réside dans la conception de « la justice comme équité » (justice as fairness), qui s’énonce dans les « deux principes de la justice », entre lesquels existe un ordre de priorité.
En effet, placés dans une « position originelle » où les déterminations sociales et psychologiques de toute nature seraient occultées derrière un « voile d’ignorance », les partenaires (parties) s’accorderaient, nous dit Rawls, sur les idées suivantes :
1. Chaque personne a un droit égal à un agencement (scheme) pleinement adéquat de libertés de base égales pour tous, qui soit compatible avec un même agencement de libertés pour tous ; et dans cet agencement, la pleine valeur (fair value) des libertés politiques, et de celles-là seulement, doit être garantie.
2. Les inégalités sociales et économiques doivent satisfaire à deux conditions :
-elles doivent être liées à des fonctions et à des positions ouvertes à tous, dans des conditions de véritable égalité des chances (fair equality of opportunities) et,
-elles doivent procurer le plus grand bénéfice aux membres les plus désavantagés de la société[6] (principe de différence).
On le voit, une approche largement inspirée de la théorie des jeux : liberté complète des joueurs puisqu’il ne saurait y avoir de fair play sous la contrainte ; égalité initiale et réelle des chances de gagner, arbitrage en faveur des plus défavorisés puisque chaque partenaire, ignorant sa situation réelle, pourrait être l’un d’entre eux.
Elle vise, par son caractère a priori, à faire l’économie de la situation réelle et de la « conceptions du bien », religieuse, philosophique mais aussi politique, particulière à chaque individu. Purement « procédurale », la justice comme équité, ne repose donc pas sur le partage de valeurs communes, mais sur l’acceptation de règles préalables sans lesquelles aucun partage (de biens comme de valeurs) n’est possible.
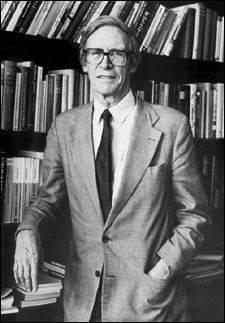 La synthèse rawlsienne
La synthèse rawlsienne
Dans la pratique et à travers les nombreux exemples qu’il étudie, cette approche permet d’intégrer des positions, souvent présentées comme inconciliables et relevant de cultures politiques différentes : garantie des « libertés de base », acceptation d’un certain niveau d’inégalité sociale, du marché libre et concurrentiel, mais aussi de la discrimination positive, de l’avortement ou encore de la progressivité de l’impôt. A noter également un souci particulier de Rawls : la nécessité de concevoir la justice également entre générations, d’où la nécessité d’une « épargne juste» à cette fin. On mesure l’actualité de la recommandation en ces temps de dette publique colossale, allègrement transmise à nos successeurs…
Fortunes d’une théorie
On comprend dès lors l’énorme influence de la théorie de Rawls : aux Etats-Unis, il a redonné une base théorique solide aux « liberals », les tenants du libéralisme progressiste, si contesté par les théories néo-libérales ou libertariennes, alors en pleine ascension. Quitte à revoir de fond en comble le fonctionnement de l’Etat-providence, dont les impasses socio-économiques sont pointées sans détour par Rawls.
En France, malgré une découverte tardive, sa théorie est entrée en résonance avec l’idéal républicain, dont elle partage la même et décisive référence kantienne[7]. Idéal républicain auquel Rawls insuffle une nouvelle jeunesse, grâce au « principe de différence » en faveur des plus défavorisés : de quoi donner, et Rawls le fait lui-même[8], un contenu concret à la notion aussi généreuse que vague de « fraternité », héritée du romantisme fusionnel de 1848. Quitte, là encore, à abandonner une vache sacrée du républicanisme français, en l’occurrence notre si chère « méritocratie », dont Rawls instruit un procès sans concession. Car ce qu’on l’appelle le mérite n’est qu’utilisation avisée de talents personnels et d’avantages sociaux initiaux dont nous ne sommes pas responsables : autrement dit, on ne mérite pas son mérite !
Partout enfin, la Théorie de la Justice a paru constituer la réponse si désespérément attendue à gauche, à l’antagonisme apparemment insurmontable entre liberté politique et égalité sociale, illustré par l’histoire de tant d’échecs tragiques, de Robespierre à Lénine. Cette fois, au prix de la « priorité » de la première sur la seconde et donc de l’abandon de tout maximalisme égalitaire…
Car, entre les différents principes de justice, s’instaure une hiérarchie des priorités dans l’ordre où ils sont énoncés (d’où l’expression d’ « ordre lexical » utilisée par Rawls) : non seulement le premier principe doit l’emporter sur le second, mais chaque élément de chaque principe l’emporte sur le suivant. Il ne saurait ainsi être question de limiter les libertés au nom de la juste répartition des revenus, ni l’égalité des chances au nom de la discrimination positive.
Une pierre philosophale ?
En somme, préservant, avec l’égalité des droits, l’héritage essentiel du libéralisme, Rawls y ajoute l’égalité réelle des chances, faisant ainsi droit à la critique marxiste des « libertés formelles ». C’est le double sens du mot fair qui signifie à la fois « équitable » et « honnête », « sans biais », « authentique » : autrement dit, une équité qui n’en reste pas aux bonnes intentions mais qui se traduit dans les politiques sociales elles-mêmes, par la priorité des priorités, selon Rawls : celle de la justice sur l’efficacité. Point de rupture décisif, dans son esprit, avec la perspective utilitariste.
Faut-il, pour autant le suivre sur ce point essentiel ? Et, tenons-nous enfin, avec la théorie de la justice, la pierre philosophale (c’est le cas de le dire) sur laquelle bâtir notre pacte social ? Rawls ou Mill ? Tel sera l’objet de notre prochaine « tradition revisitée »…
[expand title = « Notes »]
[1] TJ, p.29
[2] TJ, p.123
[3] Non seulement il y fait de fréquentes références dans ses écrits politiques majeurs mais il lui a consacré des leçons dans ses cours de philosophie morale et politique.
[4] Sur cette critique de l’utilitarisme, voir entre autres, TJ, p.53-59.
[5] Par exemple : « les principes de la justice sont analogues aux impératifs catégoriques kantiens », TJ, p.289.
[6] Nous prenons ici les principes de justice tels que Rawls les a reformulés dans son Libéralisme politique, (éditions française, PUF, 1995, p.29-30) pour tenir compte de objections qui lui ont été faites. La traduction est reprise de celle de Catherine Audard, sauf pour le mot « fair », qu’ « équitable » ne rend pas bien dans tous les cas. Ainsi, fair equality ne peut être traduit, sous peine de confusion, par « égalité équitable », mais par « véritable », « authentique » « égalité ».
[7] Voir l’influence décisive sur la constitution de la « morale républicaine » des œuvres de Jules Barni et de Charles Renouvier, tous deux philosophes, hommes politiques et spécialistes de Kant.
[8] TJ, p.135-136
[/expand]












Aucun commentaire.