Au fondement de la violence
Fondapol | 28 janvier 2012
 Marc Crépon, Le Consentement meurtrier, Paris, Cerf, coll. « Passages », 2012, 274 p. Prix 34 euros.
Marc Crépon, Le Consentement meurtrier, Paris, Cerf, coll. « Passages », 2012, 274 p. Prix 34 euros.
Où se situe la ligne au-delà de laquelle la violence devient intolérable ? Faut-il qu’elle touche sa famille, un proche, son pays, sa langue, sa civilisation pour que nous réagissions ? Existe-t-il une violence que nous condamnons tout en la tolérant ? Dans Le consentement meurtrier, le philosophe Marc Crépon s’intéresse à cet « en-deçà » où nous acceptons ce qui devrait nous révolter. Il nomme ainsi « nihilisme » cette passivité nourrie d’alibis faciles – « c’est terrible mais que puis-je y faire ? » ; « c’est loin, c’est compliqué », qui nous conduit à refuser le soin, la solidarité, l’impératif d’hospitalité que la mortalité de l’autre (soit le fait qu’il soit mortel, comme moi) nous impose. Selon l’auteur, l’absence de cette injonction éthique dans la politique et le droit interroge la nature même de notre rapport au monde. Ce « consentement meurtrier » est-il une donnée essentielle de la vie mondaine ou constitue-t-il une facilité, un penchant condamnable auquel nous succombons par commodité ?
« Ce que peut la littérature »
Le raisonnement de l’auteur s’appuie sur une méthode singulière, qui accorde une place centrale à la littérature. « Ce n’est pas seulement la philosophie qui est sollicitée dans les chapitres qui suivent, explique Crépon page 25, mais tout autant la littérature (romans, théâtre, poésie), dans un rapport où ce n’est pas la première qui vient expliquer ou interpréter le seconde, mais le texte littéraire qui seconde l’analyse conceptuelle ou qui lui supplée, lorsque celle-ci fait l’épreuve de ses propres limites ». Ainsi, les textes littéraires convoquées ne se contentent pas d’illustrer ou de prolonger la réflexion de l’auteur, mais par moments la dépassent en lui permettant de se « dégager » des apories.
Ce recours à la littérature s’expliquerait notamment par le fait qu’elle constitue en elle-même une réponse à la violence. L’auteur explique page 27 que « du simple fait de se donner en partage, (la littérature) atteste qu’elle ne peut ni ne veut faire de la violence le dernier mot ». Dans l’argumentation de Crépon, les œuvres d’Albert Camus, Stephan Zweig, Vassili Grossman, ou Kenzaburô Oé côtoieront ainsi les écrits de philosophes comme Freud, Emmanuel Levinas, Judith Butler ou Gunther Anders.
Fragilité de l’éthique
Marc Crépon considère l’objet complexe qu’est le consentement à la violence dans toutes ses nuances. Cette violence peut être active, passive, ou encore inconsciente. Qu’est-ce qui explique que nous la tolérions ? Trois idées fortes peuvent être dégagées de l’ouvrage.
1) Toute construction exclusive (de l’autre) est susceptible de générer un consentement à la violence. Tout « nous » qui ne prendrait pas en compte la fragilité des autres hommes s’expose à accepter, voire à justifier la violence. L’auteur établit ainsi une différence entre l’idéologie, qui tue ceux qui n’y adhère pas, et la révolte, qui refuse le monde tel qu’il est mais qui ne le contraindra pas à se plier à un hypothétique idéal. La réflexion que mène l’auteur sur la propagande nationaliste est à cet égard édifiante. Elle vise à déconstruire les discours patriotiques en revenant sur la technique de « nomination » (nommer la chose) et de narration (mise en forme du récit). La lecture de Karl Kraus éclaire crûment ce hiatus entre les faits et le discours tel qu’il établit le « récit national ». L’auteur prend ainsi position, implicitement, dans le débat sur l’identité nationale en mettant en garde contre tout discours établissant des cadres affectifs trop rigides. Ceux-ci nous inciteraient à pleurer les morts de notre pays mais feraient peu de cas des victimes des guerres lointaines. Il existe ainsi chez Marc Crépon une peur de tous les « nous » à l’exception de l’irréductible, selon lui, « nous les mortels ».
2) La seule communauté à laquelle nous devons nous identifier est selon lui cette humanité fragile qui doit faire l’objet de notre attention. Crépon appelle ainsi au développement d’une « éthicosmopolitique », soit une éthique à l’échelle du globe. Selon lui, à une époque où la mondialisation accélère les échanges mais aussi la propagation de menaces planétaires, comme en témoigne la prolifération des armes nucléaires, seule une éthique d’échelle mondiale pourrait apporter une réponse satisfaisante. La globalisation des périls appelle ainsi au dépassement des cadres de la souveraineté nationale toujours susceptibles d’engendrer la violence et impose « une communauté de honte ».
3) Dans dernier point, peut-être moins novateur, l’auteur porte son attention sur les origines de la violence. Celle-ci n’est pas selon lui un accident conjoncturel mais une potentialité toujours actualisable, comme l’a montré le XXe siècle, « siècle des excès ». L’ignorer revient à refuser de penser cette « part obscure » pointée par Georges Bataille.
En conclusion, l’auteur pose la question qui sous-tend l’ensemble de son argumentation, celle de l’existence d’une « communauté des êtres vivants ». S’il tâche d’y apporter une réponse, il reconnaît qu’elle est pour l’instant fragile et qu’elle appelle de plus amples développement.
Penser l’impensable
La réflexion vigoureuse de Marc Crépon invite à ne pas tenir pour acquis un certain nombre de faits (famine, guerre, violence politique, propagande, etc.) qui composent notre quotidien. Elle refuse de traiter le spectacle de la violence par cette réponse de pharisien : « que puis-je y faire ? ». L’ouvrage formule un devoir d’intransigeance à l’égard de la violence et appelle à la recherche d’une voie de « dégagement », d’une autre forme d’ « être-au-monde » où l’éthique ne demeure pas un vœu pieux mais apparaisse, au contraire, comme le fondement même de la politique.
Pour autant, le lecteur ne peut manquer de s’interroger sur le traitement de la souveraineté, présentée de manière éminemment péjorative. Est-elle uniquement source de violence ? Ne peut-elle être regardée comme attribut de liberté tant sur le plan extérieur qu’intérieur ? On pourra citer pour ouvrir la discussion qu’appelle forcément ce livre, les vifs débats qui perturbèrent la soutenance de thèse de Julien Freund, opposant son directeur Raymond Aron à Jean Hyppolite, membre du jury. Freund, dans son travail doctoral, liait indissociablement conflictualité et politique, reprenant à son compte les conceptions de Carl Schmitt. Lorsqu’Hyppolite s’insurgea contre de telles conceptions, Aron lui rétorqua : « Votre position est dramatique et typique de nombreux professeurs. Vous préférez vous anéantir plutôt que de reconnaître que la politique réelle obéit à des règles qui ne correspondent pas à vos normes idéales. » Irréductible conflictualité ou éthique cosmopolite ignorant les frontières ? Le débat reste ouvert.
Jean Senié


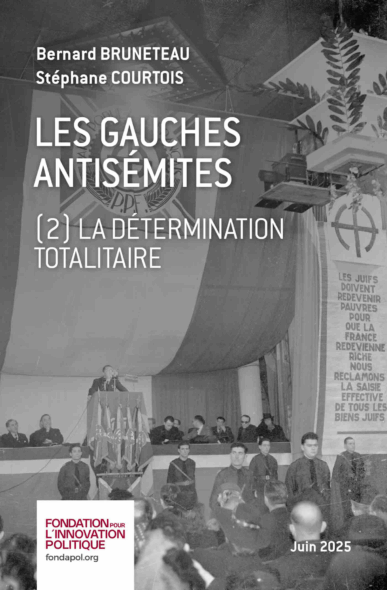
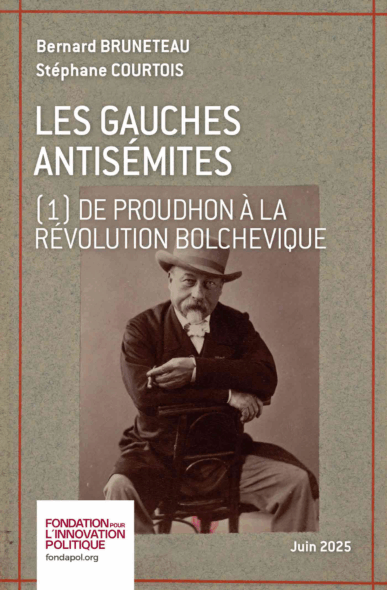


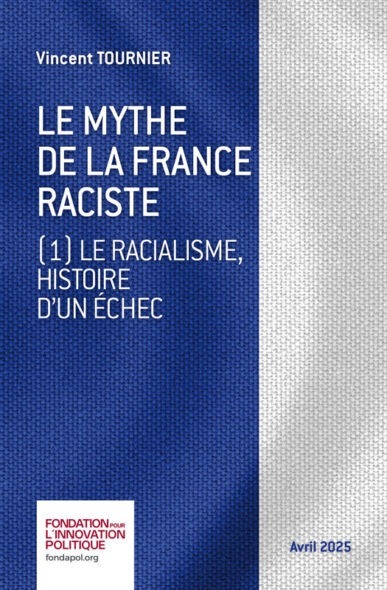





Aucun commentaire.