Châteaubriand, Gary, Rondeau : les écrivains-diplomates
Fondapol | 28 novembre 2012
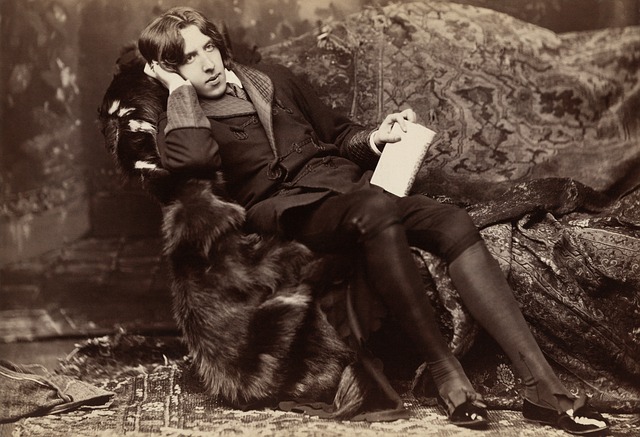 Ouvrage recensé : Écrivains et diplomates : L’invention d’une tradition XIXe-XXIe siècles, sous la direction de Laurence Badel, Gilles Ferragu, Stanislas Jeannesson et Renaud Meltz, Paris, Armand Colin, 2012, 414 p.
Ouvrage recensé : Écrivains et diplomates : L’invention d’une tradition XIXe-XXIe siècles, sous la direction de Laurence Badel, Gilles Ferragu, Stanislas Jeannesson et Renaud Meltz, Paris, Armand Colin, 2012, 414 p.
Cet ouvrage collectif est le fruit d’un colloque international qui s’est tenu du 12 au 14 mai 2011 sous le patronage du Ministère des Affaires Etrangères et qui a rassemblé aussi bien des universitaires que des écrivains diplomates comme Daniel Rondeau, Joëlle Bourgeois, Patrick Imhaus, Henri Lopes. Écrivains-diplomates et diplomates-écrivains : telles sont les deux faces complémentaires, et parfois contradictoires, des Janus qui partagent leur vie entre la littérature et les affaires internationales.
Les tiraillements d’une double carrière
À travers l’étude des différentes figures de l’écrivain-diplomate, dont la tradition remonte à Stendhal et Chateaubriand, cet ouvrage passionnant nous donne à voir le fonctionnement du Quai d’Orsay et les difficultés qu’il impose à l’écrivain-diplomate.
Celui-ci, en tant que haut fonctionnaire, est tenu au devoir de réserve. Peut-il dès lors écrire en toute liberté ? La liberté de parole et l’originalité ne sont-elles les exigences premières de l’écrivain ? Comment les concilier avec la norme, le protocole et le contrôle du langage, qui sont le propre du métier de diplomate ?
Au fil des exemples, se dessine le portrait d’un écrivain-diplomate tiraillé entre deux identités. Parfois, c’est le divorce des carrières : un Morand, trop anticonformiste, finira ainsi par quitter le Quai.
Les tensions propres au style d’écriture
Et pourtant, malgré ces contradictions, les figures illustres ne manquent pas, que cette double vie a enrichies.
L’ouvrage affirme que, loin de s’exclure, les deux métiers peuvent se nourrir l’un l’autre. Paul Claudel, Saint-John Perse, Romain Gary ont ainsi alimenté leurs écrits de leurs voyages et expériences dans les pays étrangers.
En fait, l’écriture est consubstantielle au métier de diplomate. Télégrammes, dépêches, notes sur la situation du pays où le diplomate est en poste, le texte est omniprésent. Par ailleurs, le style des diplomates est traditionnellement émaillé de citations savantes. Le diplomate est un « homme de lettres ». Il est également historien, soucieux de placer son action dans la continuité de la tradition diplomatique.
Cependant, les activités d’écriture et les propos historiques du diplomate, dès le XIXe siècle, sont strictement encadrés par des normes de rédaction définies par des manuels tels que le Cours de style diplomatique de Meisel, publié en 1826. Le diplomate est un tenu par la langue officielle et lié par l’intérêt national. Ces contraintes se resserrent à mesure que le métier de diplomate se professionnalise.
Aujourd’hui plus que jamais, le diplomate est un expert davantage qu’un « homme de lettres ». Ainsi, de nos jours, l’écriture doit être concise et claire, de manière à avoir des chances d’être lu par la hiérarchie quand celle-ci, à l’ère du numérique, est submergée par un flot sans précédent de télégrammes, de dépêches et de notes.
L’écrivain-diplomate entre anonymat et célébrité
Le diplomate écrit lorsque son métier lui en laisse le loisir ou lorsque les mondanités l’ennuient. Lors de la publication de ses textes, le devoir de réserve lié à sa fonction lui impose souvent d’utiliser un pseudonyme. Pour autant, ce subterfuge, purement formel, ne l’empêche pas de revendiquer son œuvre aux yeux du public, sous réserve de l’acceptation de publication du manuscrit par le service du personnel du Quai.
Le Quai ou la littérature
Il arrive cependant que l’écrivain-diplomate soit obligé de rompre avec son administration. Le rappel à l’ordre du fait d’un décalage par rapport aux normes établies l’amène dès lors à quitter le Quai pour suivre sa vocation et s’épanouir pleinement dans son identité d’écrivain.
En sens inverse, d’autres personnalités ont par elles-mêmes choisi de suspendre temporairement leur activité d’écriture dès lors qu’ils étaient en poste. Ce fut le cas de Stendhal en son temps et, plus récemment, de Daniel Rondeau, ambassadeur de France à l’Unesco depuis 2011.
Le diplomate-blogueur
Et si ce conflit était aujourd’hui dépassé ? Pour le diplomate Nicolas Chapuis, il est possible à l’ère du numérique de concilier le goût de l’écriture et le métier de diplomate en tenant des blogs relatant les expériences vécues à l’étranger. Le numérique offrirait une plus grande liberté au diplomate et lui donnerait plus de visibilité que les notes et dépêches que requiert son métier.
Mais comme le suggère l’entretien avec Christophe Farnaud, ambassadeur en Grèce, la création d’un blog s’inscrit davantage dans la fonction officielle de diplomate que dans l’activité d’écrivain. S’il n’est pas dénué d’intérêt, le blog sert à diffuser auprès d’un public plus large, aussi bien français qu’autochtone, la politique officielle.
Un talent reconnu d’écrivain au service de la diplomatie : le cas de Romain Gary
Né lituanien en 1914 avant d’être naturalisé, Roman Kacew est plus connu sous le pseudonyme de Romain Gary.
La contribution de Kerwin Spire nous dévoile que l’auteur des Racines du ciel a pris très au sérieux son métier et sa carrière au Quai, pour laquelle il était tenu en haute estime par sa hiérarchie. Comme Paul Claudel avant lui, Romain Gary est allé jusqu’à mettre sa célébrité et son talent littéraire au service de son métier de diplomate.
Gary, diplomate modèle
Après la Seconde Guerre mondiale, Roman Kacew était entré par la voie complémentaire au Quai et s’est de ce fait trouvé en concurrence avec ses pairs du Concours. Ce sont à la fois ses galons de résistant et ses talents d’écrivain qui lui ont finalement permis de faire carrière au Quai avec l’appui de ses supérieurs hiérarchiques, malgré des obstacles liés à la réorganisation de l’administration d’après-guerre. Il termina sa carrière comme représentant permanent de la France auprès de l’ONU à New York et Consul général de France à Los Angeles.
La renommée de l’écrivain au service de la diplomatie
Ses talents reconnus d’écrivain et sa célébrité favorisèrent les contacts avec les représentants étrangers dans le cadre de postes diplomatiques, au début de sa carrière en tant que deuxième secrétaire à Sofia, ou dans le cadre de missions comme celle qu’il mena en Bolivie en novembre 1956, l’année de son prix Goncourt. Fort de cette utile renommée, Romain Gary disposa durant sa carrière d’une relative liberté pour écrire et publier, bien qu’on lui imposât de prendre un pseudonyme.
Gary quitte le Quai
Malgré cette cohabitation harmonieuse entre ses deux métiers, l’écrivain l’emportera finalement sur le diplomate. Gary quittera le Quai pour que la liberté inhérente à son identité s’épanouisse dans l’écriture. Après avoir demandé sa disponibilité pour convenances personnelles, il laissa libre cours dans ses textes à des critiques vis-à-vis du Quai, longtemps contenues lorsqu’il était en poste.
Son exemple montre que le conformisme du Quai finit par devenir insupportable à l’écrivain qui souhaite exercer son métier pleinement.
Thi Minh-Hoang Ngo.
Crédit photo: pixaby












Aucun commentaire.