Conseil constitutionnel : comment un chien de garde de l’exécutif est devenu pilier de l’Etat de droit
Fondapol | 23 février 2011
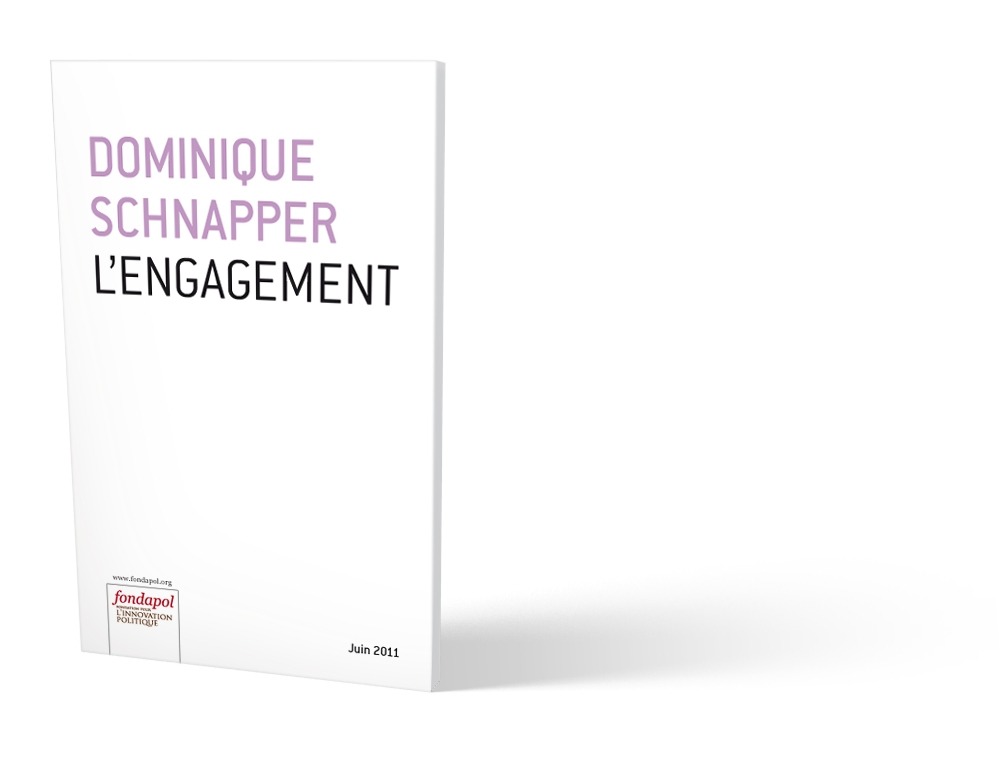 Dominique Schnapper, Une sociologue au Conseil constitutionnel, Paris, Gallimard, 2010.
Dominique Schnapper, Une sociologue au Conseil constitutionnel, Paris, Gallimard, 2010.
Plutôt la fiction de la volonté générale que la séparation et l’équilibre des pouvoirs, plutôt Rousseau que Montesquieu : c’est sur la base de cette préférence que les institutions républicaines se sont établies en France, du moins depuis la IIIe République. A l’origine, la constitution de 1958 ne dérogeait pas vraiment à ce principe. Il n’y est en effet jamais question de « pouvoir judiciaire ». A cette expression suggérant que la justice constituerait un « contre-pouvoir » au législatif et à l’exécutif, les auteurs de la loi fondamentale ont préféré celle d’ « autorité judiciaire » (titre VII, article 64 à 66-1). Encore était-ce un progrès par rapport aux constitutions antérieures !
Le texte adopté le 28 septembre 1958 par référendum innovait en outre en créant un Conseil constitutionnel. Les dispositions de la Constitution de la IVe République relatives au fonctionnement d’un Comité constitutionnel (titre XI, articles 91, 92, 93) n’avaient jamais été appliquées… Mais la nouvelle institution n’avait pas vocation à devenir une Cour constitutionnelle. Dominée dans les années 60 par des hommes dévoués au général de Gaulle, elle devait surtout borner les capacités d’action du Parlement en vérifiant que la loi n’empiétait pas sur le domaine de compétence du règlement (articles 34 et 37 de la Constitution). Certains la caricaturaient à l’époque en « chien de garde de l’exécutif ».
Pour autant, le Conseil constitutionnel sut s’émanciper dès le début des années 1970, jusqu’à jouer aujourd’hui un rôle essentiel dans le système politique français. C’est cette institution que la sociologue Dominique Schnapper étudie dans un livre dense et nuancé, très différent de celui qu’a publié récemment Pierre Joxe sur son expérience de membre du Conseil constitutionnel.
Un essai de participation sociologique
Nommée en 2001 par le président du Sénat Christian Poncelet, la sociologue Dominique Schnapper n’avait pas le meilleur des profils pour entrer au Conseil constitutionnel. A l’exception du politiste Alain Lancelot, les « Sages » sont volontiers choisis parmi les hommes politiques, les hauts fonctionnaires ou les professeurs de droit. Dominique Schnapper s’est certes intégrée assez vite au « petit groupe » du Palais-Royal, mais sans « toujours échappe[r] au sentiment d’[y] être une sorte de Bécassine ». Venant d’une éminente chercheuse en sciences sociales, le constat vaut pour son humour tout en modestie. L’ouvrage qu’elle signe se veut le résultat de neuf années de participation sociologique à une institution qui demeure assez mal connue du grand public, à la différence de ses équivalents allemand ou américain par exemple.
Une institution qui s’affirme
Cette méconnaissance a des raisons historiques. Jusqu’à la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, les citoyens ne pouvaient en appeler au Conseil pour faire respecter leurs droits. Seuls l’exécutif et les président des deux Chambres avaient la capacité de le saisir jusqu’en 1974. A cette date, le président Giscard d’Estaing transforma l’institution du Palais-Royal en étendant significativement sa saisine.
Aux yeux de l’opinion publique, le Conseil constitutionnel ressemble depuis lors à un mâtin endormi et ne sortant que rarement de sa léthargie, pour mordre le législatif et, plus encore, l’exécutif. Il se trouve toujours quelqu’un pour dénoncer dans ce cas le « gouvernement des juges ». Les socialistes n’y furent pas les moins enclins, après la censure de certains articles de la loi sur les nationalisations, le 16 janvier 1982… Autant que par les réformes de 1974 et de 2008, le Conseil constitutionnel a donc été « fait » par certaines de ses grandes décisions, de la liberté d’association (16 juillet 1971) à la taxe carbone (29 décembre 2009).
La sagesse des Sages
Dominique Schnapper invite à dépasser ces épisodes pour s’intéresser au travail quotidien d’une institution aujourd’hui en pleine révolution. Elle montre d’abord que les circonstances peu favorables qui ont présidé à la naissance du Conseil constitutionnel ne sont pas complètement oubliées. Les parlementaires, les membres du Conseil d’Etat ou de la Cour de Cassation, les professeurs de droit conservent des réticences à l’égard de la notion de juge, et plus encore de Cour constitutionnels. Au reste, la jurisprudence de l’institution montre que les Sages ont souvent intégré ces résistances ou ces procès en légitimité à leur réflexion. Ils évitèrent par exemple de se prononcer sur la loi légalisant l’interruption volontaire de grossesse au début du septennat de Valéry Giscard d’Estaing, de peur de relancer un débat public difficile, dont la solution avait été dégagée aux prix de maints efforts par la ministre Simone Veil.
Loin du fantasme d’un gouvernement des juges, le Conseil constitutionnel cherche d’abord à respecter sa propre jurisprudence plutôt qu’à s’opposer par nature aux pouvoirs exécutif et législatif. La prévisibilité de sa jurisprudence garantit de fait sa crédibilité. Elle lui permet de se poser en gardien d’une certaine sécurité juridique : quoi de plus libéral que ce beau principe ?
Sociologie d’un petit groupe
Le Conseil constitutionnel n’a jamais compté plus de onze membres (neuf membres nommés et deux membres de droit). Il s’agit d’un petit groupe, au sein duquel se nouent des alchimies subtiles. Dominique Schnapper fait donc œuvre de sociologue lorsqu’elle étudie la manière dont les Sages, qui se définissent plus volontiers par leur activité passée que par leur appartenance au Conseil, modifient ou pas leurs jugements et méthodes de travail après quelques mois d’expérience. Il est des politiques qui jouent le jeu, d’autres qui se désintéressent des activités de l’institution, des hauts fonctionnaires qui se montrent respectueux ou audacieux vis-à-vis du Conseil d’Etat ou de la Cour de Cassation, éternels rivaux du Conseil constitutionnel, …
Dominique Schnapper assume le risque de désenchantement que font courir à l’institution ces approches typologiques. Elles ne la conduisent pas au relativisme, puisqu’elle insiste à plusieurs reprises sur la part de hasard presque miraculeux qui a permis jusqu’ici à cette institution de s’affirmer, malgré des moyens limités.
Quelles réformes possibles ?
Les projets de réforme du Conseil constitutionnels sont légions. Mais n’est-il pas nécessaire de laisser aujourd’hui de laisser aux Sages le temps de s’adapter à la révolution opérée en 2008 ?
Quelques pistes sont cependant ouvertes, qui permettraient d’asseoir encore la crédibilité de l’institution. L’élection du président du Conseil par ses membres, au lieu qu’il soit nommé aujourd’hui par le président de la République, en fait par exemple partie. Les Sages doivent aussi avoir le temps de travailler : à ce titre, le délai d’un mois prévu entre la saisine et la décision du Conseil apparaît trop réduit.
Les libéraux ne peuvent, quoi qu’il en soit, que se réjouir de voir cette modeste « Cour suprême à la française » gagner en compétence et en respectabilité, comme c’est le cas depuis le début des années 70.












Aucun commentaire.