Crise économique, crise de la théorie ?
26 avril 2013
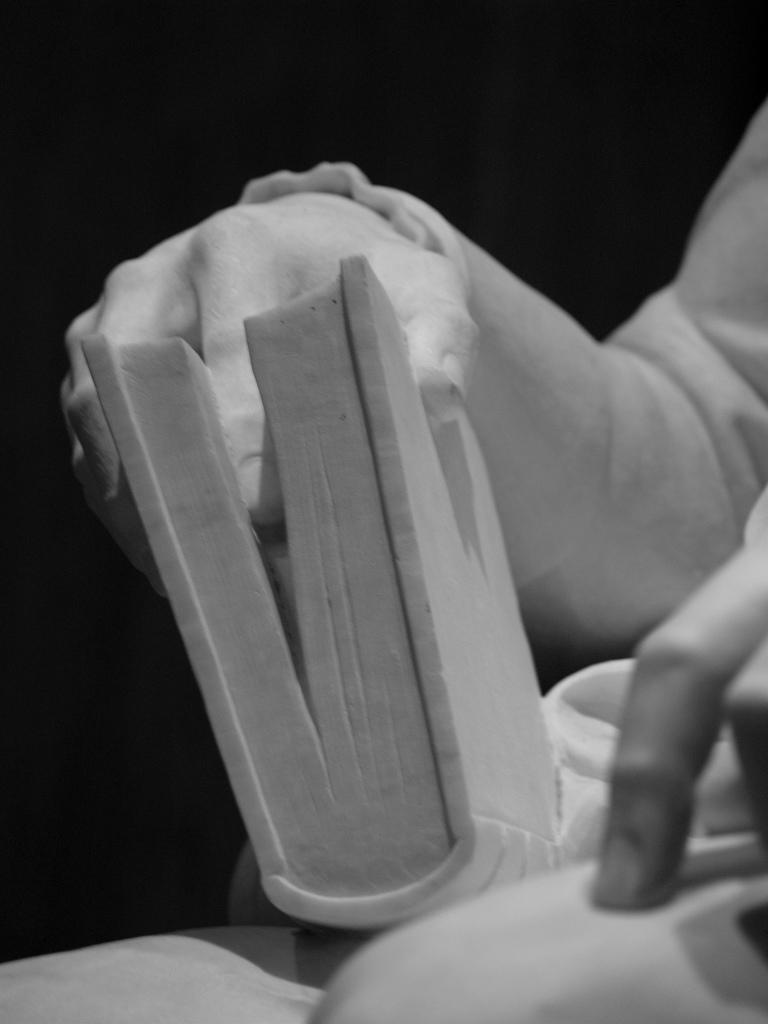 Crise économique, crise de la théorie ?
Crise économique, crise de la théorie ?
Bien que la crise ait remis en cause certains crédos et croyances des économistes, elle n’a pas entraîné de rupture dans la manière dont l’économie est pensée, et donc enseignée. Une situation que déplorent déjà, depuis 2000, différents mouvements d’étudiants en sciences économiques, qu’il s’agisse du mouvement des étudiants Contre l’Autisme en Economie [1] ou, plus récemment, du mouvement des étudiants Pour un Enseignement Pluraliste dans le Supérieur en Economie ou PEPS-Economie[2].
Pourtant, il est aisé de comprendre que l’aveuglement de la majorité des économistes quant à l’avènement de la crise n’est pas simplement dû à des erreurs de jugement, mais à une crise plus profonde de l’économie politique.
L’hégémonie de l’économie quantitative
Les approches dominantes de l’économie sont purement et simplement basées sur les mêmes postulats, qui risquent de devenir autant de croyances: individu rationnel (ou homo œconomicus), optimum de Pareto [3], théorie de l’équilibre général [4]. Ces postulats sont d’inspiration micro-économique ou néo-classique, c’est-à-dire tirés des travaux d’économistes tels que Léon Walras ou Vilfredo Pareto.
Keynésiens comme libéraux, voire néolibéraux, tous concourent à s’entendre sur cette base commune. Or, il est à signaler qu’une communauté scientifique est, comme toute communauté humaine, enserrée dans des luttes d’intérêts, des dynamiques sociales et politiques propres : il ne faut pas céder au scientisme et à une prétendue pureté de la profession scientifique.
Dans La structure des révolutions scientifiques, de Thomas Kuhn, la recherche scientifique est prise dans un contexte dit de « science normale », c’est-à-dire un paradigme [5] dominant (ici, la micro-économie ou approche quantitative). L’histoire scientifique ne saurait alors se résumer à un processus empirique et cumulatif, car la « concurrence entre des fractions du groupe scientifique est le seul processus historique qui amène jamais réellement le rejet d’une théorie précédemment acceptée et l’adoption d’une autre »[6], ce qui signifie aussi implicitement que des croyances, tant qu’elles font consensus, peuvent être considérées comme scientifiques. Car, comme le rappelle Karl Popper, si la critique est « le seul instrument de vérification d’une théorie économique. », il demeure alors tout à fait intriguant qu’une large majorité d’économistes adhère aux mêmes principes, postulats, théories sans jamais les questionner : en réalité, la critique ne touche jamais aux bases communes de leurs paradigmes respectifs.
Mais gare au contre-sens: il ne s’agit pas de prôner ici un relativisme mou où toutes les théories se valent comme autant d’opinions d’égale pertinence: il s’agit bel et bien d’un exercice rigoureux de l’esprit critique et donc de la recherche d’une adéquation toujours plus grande entre théorie et observation; autrement dit, d’une validité supérieure de la nouvelle théorie par rapport à la précédente, comme l’a montré Popper.
Un enseignement monolithique coupé du réel
Il est très difficile pour des enseignants de proposer des cours qui soient véritablement propédeutiques, alors que nous vivons dans un monde où l’information économique est omniprésente : ainsi, d’après Gilles Raveaud [7], « L’information économique n’a jamais été aussi disponible, contradictoire, passionnante. […] Mais c’est la peur qui continue à régner du côté des enseignants. Peur de ne pas savoir. Peur de passer pour un original auprès de ses collègues. »[8].
Ceci conduit forcément à un certain déni de réalité de la part des enseignants, toujours enfermés dans une approche strictement quantitative. Une situation que déplorent, comme signalé plus haut, différents mouvements d’étudiants très critiques à l’égard de la science économique. Cette dernière, « au lieu de se donner pour objet les phénomènes économiques et d’évaluer les méthodes permettant d’en évaluer la connaissance, […] les traite comme de simples exemples, illustrations de théories qui deviennent des fins en soi. »[9], un « enseignement cantonné aux « mondes imaginaires », c’est-à-dire flottant dans la pure théorie sans retour vers l’empirie »[10].
Pourtant, d’autres écoles de pensée pourraient être évoquées dans les cours d’économie, ne serait-ce que pour leur faculté à s’ancrer dans le réel et à éviter les abstractions mathématiques : l’école autrichienne ou « viennoise »[11], qui rejette le formalisme des néo-classiques, ou plus récemment Économie Politique Internationale (E.P.I.), de Susan Strange, qui tente de formuler une approche politique et économique de la mondialisation, etc. Des exemples d’écoles de pensée hétérodoxes qui prennent en compte la complexité du réel au lieu de le dissoudre dans des formulations abstraites.
L’économie est une science sociale
Quelles solutions apporter à l’enseignement de la science économique, pour qu’elle sorte des carcans que les paradigmes dominants lui imposent ?
Le mouvement des étudiants Pour un Enseignement Pluraliste dans le Supérieur en Economie apporte des réponses satisfaisantes à cet enjeu, de manière claire et synthétique, en partant d’un triple constat : « un manque de recul critique criant, un repli de l’enseignement sur une portion congrue de la discipline économique, et un isolement à l’égard des autres sciences sociales. »[12].
Il s’agit, tout d’abord, de redonner de la perspective, du recul aux étudiants sur leur discipline en dispensant des enseignements d’épistémologie (histoire de la pensée, des faits économiques, etc.) pour éviter de « favoriser la confusion entre science économique et économie néoclassique »[13].
Ensuite, de proposer un véritable pluralisme théorique en proposant des cours qui prennent en compte l’ensemble des théories et écoles de pensées existantes sur chacun des problèmes économiques contemporains.
Enfin, et c’est à souligner, il faut redonner de l’interdisciplinarité à la science économique qui est, aussi et surtout, une science sociale. A ce titre, Edgar Morin fait un diagnostic lucide : « L’économie, qui est la science mathématiquement la plus avancée, est la science socialement la plus arriérée, car elle s’est abstraite des conditions sociales, historiques, politiques, psychologiques, écologiques inséparables des activités économiques. ».
Un enjeu démocratique
Renouveler la pensée économique est une bataille essentielle. L’absence de véritable débat sur la manière dont est pensée l’économie est profondément néfaste pour l’avenir de nos sociétés démocratiques.
La montée des extrêmes et des populismes est directement liée aux difficultés économiques et sociales : en des temps difficiles, les prophètes de malheur trouvent un écho grandissant.
Surtout, il nous faut apprendre de nos erreurs et ne pas rester enfermés dans nos illusions, ce qu’un enseignement pluraliste, ouvert et donc préparatoire à l’exercice de la démocratie doit permettre : « la réforme de la connaissance et de la pensée est un préliminaire, nécessaire et non suffisant, à toute régénération et rénovation politiques, à toute nouvelle voie pour affronter les problèmes vitaux et mortels de notre époque. »[14]
Charles-Antoine Brossard
Crédit photo: Flickr, takomabibelot
Article connexe : Pour la concurrence des idées dans l’enseignement de l’économie, Le Monde, 02.05.2013
[1] Autisme-économie, http://www.autisme-economie.org/
[2] PEPS-Economie, http://pepseco.wordpress.com/
[3] L’optimum de Pareto se définit comme un état de la société dans lequel l’amélioration du bien-être d’un individu ne peut se réaliser sans détériorer celui d’un autre. Autrement dit, un équilibre économique optimal.
[4] La théorie de équilibre général est une première tentative de modélisation d’une économie par Léon Walras sous forme d’équations mathématiques, afin d’expliquer la formation des prix. Elle se décline en différents types (deux biens, plusieurs types de bien, production, croissance, monnaie …) et a été repris par différents économistes par la suite avec des modifications.
[5] Un paradigme (au sens scientifique du terme) est une représentation du monde cohérente qui repose sur un ensemble de postulats, théories, outils, observations, faits, méthodes, concepts, et va baser l’ensemble des travaux d’un scientifique.
[6] Thomas Kuhn, La structure des révolutions scientifiques, Paris, Flammarion, 1983, p. 26.
[7] Gilles Raveaud est maître de conférences en économie à l’Institut d’Etudes Européennes de l’université Paris 8 Saint-Denis et membre du comité de rédaction de la revue L’Economie Politique.
[8] IDIES, 10 ans après la lettre ouverte des étudiants et le rapport Fitoussi. Où en est l’enseignement de l’économie à l’université, http://www.assoeconomiepolitique.org/IMG/pdf/idies_note_de_travail_15_BAT.pdf, mars 2011.
[9] Alternatives économiques, Pour un pluralisme dans l’enseignement de l’économie, http://www.alternatives-economiques.fr/pour-un-pluralisme-dans-l-enseignement-de-l-economie_fr_art_1087_53938.html, avril 2011.
[10] PEPS-Economie, Pour un enseignement pluraliste dans le Supérieur en Economie, http://pepseco.wordpress.com/
[11] Pour aller plus loin : Louis Nayberg, L’originalité d’une école de pensée, http://www.trop-libre.fr/le-marche-aux-livres/l%E2%80%99originalit%C3%A9-d%E2%80%99une-%C3%A9cole-de-pens%C3%A9e#_edn1, 24 avril 2013.
[12] Le Monde, La crise économique est aussi une crise de l’enseignement de l’économie, http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/04/02/la-crise-economique-est-aussi-une-crise-de-l-enseignement-de-l-economie_3151936_3234.html, 2 avril 2013.
[13] Ibid.
[14] Le Monde, En 2013, il faudra plus encore se méfier de la docte ignorance des experts, http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/01/01/en-2013-il-faudra-plus-encore-se-mefier-de-la-docte-ignorance-des-experts_1811813_3232.html, 1er janvier 2013.












Aucun commentaire.