Focus sur l'économie circulaire : réduire, réutiliser, recycler
Marie-Éva Bernard Mercuri | 13 mars 2015
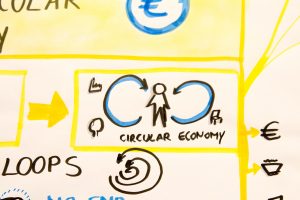 Focus sur l’économie circulaire : nouveau principe de gouvernance territoriale
Focus sur l’économie circulaire : nouveau principe de gouvernance territoriale
Par Marie-Éva Bernard Mercuri
Jean-Claude Lévy et Vincent Aurez, L’Économie circulaire : un désir ardent des territoires, Paris, Presses des Ponts, 2014, 30€
Jean-Claude Lévy est historien-géographe et rapporteur général d’une mission de réflexion sur l’économie circulaire qui lui a été confiée en 2013 par Pascal Canfin, alors ministre délégué chargé du Développement.
Vincent Aurez est rapporteur de cette même mission en tant que collaborateur scientifique, et effectue des recherches à Sciences po et à l’Université de Pékin.
Avant même que les mots d’ « économie circulaire » et de « recyclage » ne soient inventés, les déchets avaient souvent une seconde vie dans les zones rurales françaises[1]. L’économie circulaire conceptualise ces méthodes et permet leur transposition au XXIe siècle en milieu urbain. Elle désigne les initiatives qui visent à rendre à la Nature les flux de matière que nous lui empruntons pour les besoins du développement économique. Elle est donc une « gouvernance des flux », qui s’organise autour des « 3 R » (réduire, réutiliser, recycler) par opposition à l’économie linéaire qui répond à une logique « extraire-fabriquer-consommer-jeter ». Elle va de pair avec l’éco-conception à l’échelle des entreprises, l’écologie industrielle à l’échelle des zones industrielles, l’économie de fonctionnalité à l’échelle du marché, la green economy, et la valorisation des circuits courts.
Bien que ce livre présente de nombreuses failles, de forme d’abord (phrases mal construites, utilisation excessive et mal à propos des guillemets, fautes de frappe, voire paragraphes en double), de méthodologie (manque de structure et de définition des concepts), et de fond (thèses discutables[2], érudition artificielle), il a le mérite d’attirer l’attention sur un thème méconnu et passionnant.
L’Économie circulaire, une nécessité financière
Le premier pays à atteindre un développement durable gagnera en influence et en attractivité sur les plans écologique, économique et politique. En contribuant à l’innovation industrielle et en réduisant l’émission de gaz à effet de serre, il améliorera la sécurité de son approvisionnement énergétique et réduira sa dépendance vis-à-vis des pays étrangers. Cette approche pragmatique de l’écologie est intéressante, dans un contexte de raréfaction des ressources et de difficultés budgétaires (à titre d’exemple, la gestion des déchets représente un marché de 300 milliards de dollars, qui présente de belles opportunités pour les entreprises).
La « panacée verte »
L’émergence des politiques intégrées de développement, les parcs éco-industriels, les biocénoses industrielles, les formes nouvelles de partenariat, sont au cœur des stratégies de planification territoriale respectueuses de l’environnement.
Les méthodes de l’économie circulaire sont applicables en milieu urbain (à Valencienne, l’hôtel de ville est chauffé par les eaux usées de la ville) et en milieu rural (dans les zones du Yuxi et de Erhai, en Chine, une circularité des flux entre agriculture et élevage a été mise en place, en s’appuyant sur le biogaz comme principal composant du circuit d’énergie et de matière à l’intérieur de ces zones).
En France, on peut citer le cas de la région Champagne-Ardenne, où un Institut européen de la bio-raffinerie (IBE) a été implanté. Il regroupe des entreprises diverses mais toutes impliquées dans la filière agroalimentaire, où les produits ou coproduits de l’un sont les matières premières de l’autre. Jean-Paul Bachy, président du Conseil régional, déclarait en 2014 à propos de ce complexe : « Au-delà de la vocation alimentaire de l’agriculture, qui reste essentielle, ses coproduits sont systématiquement transformés dans une chaîne de valeur, où tout est utilisé et recyclé. Le principe de base « zéro déchet », « zéro pollution » permet la mise en œuvre d’un cycle industriel vertueux, qui entretient lui-même sa propre dynamique. »
Des pratiques difficilement exportables
Quatre grands pays (Japon, Allemagne, Pays-Bas, Chine) ont inscrit l’économie circulaire dans leurs lois. Mais ces appareils législatifs encadrent les politiques endogènes, internes aux États concernés, sans prévoir de lien avec leurs actions menées à l’international. Cette situation est en partie due au fait que les pratiques regroupées sous l’expression « économie circulaire » ne sont pas toujours exportables. Les expériences qui en relèvent sont en effet très liées aux spécificités culturelles locales : il existe par exemple une dizaine de poubelles de tri différentes en Scandinavie, tandis qu’il n’y en a que quatre en Allemagne et trois en France. C’est pourquoi, quand Howard Odum propose une méthode d’évaluation de la circularité des projets (le concept d’ « émergie », qui caractérise tous les produits et les services en équivalent énergie solaire et permet d’envisager une optimisation de l’efficience énergétique du système), il prend le risque d’imposer un indicateur en le considérant comme un argument objectif, alors qu’il n’est en fait qu’un jugement social et culturel sur le monde « tel qu’il devrait être ».
Entre les lignes de la planification urbaine : focus sur les agendas 21
En matière de protection de l’environnement, la France poursuit des objectifs ciblés, comme les « 3 fois 20 » (stratégie visant à une réduction de 17% des émissions de gaz à effet de serre, à la réalisation de 20% d’économie d’énergie en 2020, et à l’intégration de 23% d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale en 2020) et le « facteur 4 » (objectif de diviser par 4 les émissions de GES d’ici 2050). De multiples outils de planification existent, mais ils sont trop souvent sectoriels et peu coordonnés : plan climat énergie territorial (PCET), plan local d’urbanisme (PLU), schéma de cohérence territorial (SCOT), plan État-région sur le climat, l’air et l’énergie, ou encore stratégies de développement durable affichées dans les Agendas 21. Ces derniers sont nés après le Sommet de la Terre à Rio en 1992, où les collectivités territoriales furent reconnues comme un acteur majeur de la promotion du développement durable. Ils fonctionnent sans autorité régalienne, sans obéir à un plan national. Cela pourrait être une faiblesse, c’est aussi une force, car ils favorisent une gestion transversale et multiacteurs des questions écologiques .
Aujourd’hui, 900 Agendas 21 (ou assimilés) sont recensés en France, et les dépenses des collectivités en matière de préservation de l’environnement[3] correspondent à 20- 25% de leurs budgets, même si le volontarisme des élus se heurte parfois à un manque de ressources financières.
Éco-conception et écologie industrielle : des approches à dépasser
L’éco-conception et l’écologie industrielle sont des concepts intéressants dont l’application prépare la mise en place de l’économie circulaire, mais ils présentent plusieurs écueils.
Ainsi, dans son approche traditionnelle, l’éco-conception n’est pas directement liée au territoire (bien qu’elle puisse s’appliquer aux filières locales et aux produits impliqués dans des circuits courts). Elle se caractérise par une vision globale, qui prend en compte toutes les étapes du cycle de vie des produits, depuis l’extraction des matières premières jusqu’au traitement des produits en fin de vie, en passant par leur fabrication, leur transport et leur utilisation. Mais toute la recherche sur les impacts environnementaux est concentrée dans le seul produit. Une fois vendu, ce qu’il advient du produit dépend de comportements d’usagers, d’initiatives de différents acteurs et de processus qui échappent au contrôle du concepteur. L’entreprise va donc commercialiser un produit certes recyclable, mais sans contrôle sur le fait qu’il soit réellement recyclé. L’économie circulaire va plus loin, en posant la question du bouclage effectif, du couple produit-service, des comportements en aval de la vente et de la consommation.
Dans de nombreuses entreprises, l’écologie industrielle a précédé l’économie circulaire. Les solutions proposées par l’écologie industrielle sont centrées autour des synergies entre les acteurs et l’utilisation de ressources locales. Elles sont essentiellement de deux types : les mutualisations et les substitutions. Les substitutions visent à remplacer des flux de ressources non renouvelables et importées par des flux disponibles localement, et les mutualisations à mettre en place des achats et des livraisons groupés et des collectes uniques des déchets pour plusieurs entreprises, par exemple. L’objectif est d’apporter des solutions plus efficaces sur le plan écologique (économie de ressources non renouvelables) dans l’intérêt général, et sur le plan économique (économies logistiques) dans l’intérêt des entreprises.
Crédit photo : Julie Verlinden
[1] Dans une ferme, les points d’attache pour les chaînes des animaux pouvaient par exemple être fabriqués avec de vieux outils en fer dont les pointes étaient cassées.
[2] Les auteurs font par exemple de la crise de 2008 une crise aux implications écologiques très fortes, sans vraiment justifier ce parti pris.
[3] Agrégat des dépenses concernant la fourniture d’eau potable, l’assainissement, les déchets, l’air, les espaces verts, l’énergie, le bruit, les risques naturels et technologiques.












Aucun commentaire.