France-Corée : un rendez-vous manqué ?
04 juin 2012
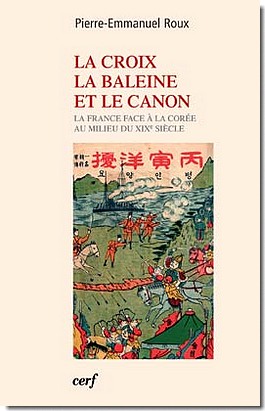 Pierre-Emmanuel Roux, La Croix, la baleine et le canon : La France face à la Corée au milieu du XIXe siècle, Paris, éditions du Cerf, 2012, 460 p.
Pierre-Emmanuel Roux, La Croix, la baleine et le canon : La France face à la Corée au milieu du XIXe siècle, Paris, éditions du Cerf, 2012, 460 p.
Jeune chercheur spécialiste du catholicisme en Asie, Pierre-Emmanuel Roux vient de publier une histoire passionnante et originale des relations franco-coréennes et, plus largement, des relations internationales en Asie orientale, au milieu du XIXe siècle. Cette période est charnière dans l’histoire des relations internationales, car elle voit la « connexion » des histoires de l’Occident, de la Chine, du Vietnam, du Japon et de la Corée.
A partir de la première « guerre de l’opium » (1839-1840), qui marqua la fin de la prédominance chinoise et le début de la pénétration occidentale en Asie, la Corée s’ouvre « par le canon », plus de force que de gré, aux intérêts français. Ceux-ci sont en grande partie guidés par des considérations géostratégiques et les rivalités entre les puissances européennes dans la région. Il aura fallu cependant du temps pour qu’à la suite des Britanniques, les diplomates français s’intéressent à la Corée. Auparavant, les récits de voyage décrivant un pays inhospitalier les en dissuadaient. Ce n’est donc qu’à partir du milieu du XIXe siècle que les Français redécouvrent la Corée et s’y aventurent. Ce livre est le récit tumultueux de leurs périples, où se côtoient navigateurs, savants, diplomates, missionnaires.
Pas de choc de civilisations ?
Selon l’auteur, il faut d’abord nuancer l’idée de « choc de civilisations » entre l’Occident chrétien et la Corée confucéenne. Avant les « guerres de l’opium », les persécutions des missionnaires ont été entrecoupées de période de calme et de tolérance tacite de la population à l’égard de la religion chrétienne. Pierre-Emmanuel Roux met bien en parallèle la réception du christianisme en Chine et en Corée ; il en tire des arguments pour esquisser une histoire plus complexe de la proscription du catholicisme et des réactions populaires que ne le suggère l’historiographie existante.
Après les « guerres de l’opium », le changement de contexte en Asie orientale fait craindre à la Corée une invasion occidentale. La connexion avec les événements en Chine s’établit néanmoins avec un temps de décalage, la nouvelle de la première « guerre de l’opium » ne parvenant qu’assez tardivement en Corée. Les savoirs circulent alors entre les deux pays. Ainsi, l’ouvrage majeur de l’historien et géographe Wei Yuan, le Mémoire illustré sur les pays d’outre-mer, publié en Chine en 1842 et introduit en Corée en 1845, qui doit son succès à ses recommandations stratégiques pour parer à la menace d’une invasion par les « barbares occidentaux ».
Côté français, la primauté des considérations géostratégiques
La perception négative de l’Occident par la Corée est renforcée, à partir du milieu du XIXe siècle, par des expéditions maritimes qui répondent à des intérêts géostratégique. En ce sens, les expéditions du contre-amiral Cécille, puis de Roze en Corée ne peuvent se comprendre que dans le cadre de la stratégie élaborée par la France à la suite des « guerres de l’opium » pour faire contrepoids à l’influence britannique et contenir l’avancée de la Russie en Asie orientale.
Or, la mesure exacte des « intérêts géostratégiques » de la France en Asie orientale relève à la fois de mythes et de réalités. La pêche à la baleine en mer du Japon est, par exemple, une réalité, et reflète la collusion entre les cercles économiques et politiques. Le premier consul français de Shanghai, Montigny, saisit ainsi « l’opportunité » que créa en Corée le naufrage du baleinier le Narval pour décider l’intervention et mettre en place un lobby baleinier. En revanche, bien qu’elle soit avérée, la présence de ressources minérales au Japon et en Corée était exagérée, donnant lieu à un véritable mythe aurifère.
Outre les intérêts géostratégiques, les expéditions maritimes étaient motivées à partir des années 1860 par des intérêts commerciaux. La France ambitionnait en effet d’ouvrir une route commerciale vers le Pacifique.
La Corée restait cependant mal connue des diplomates français. Un exemple ? Le contre-amiral Cécille avait proposé de soustraire la Corée aux dominations chinoise et japonaise… Projet séduisant sur le papier, mais qui méconnaissait le jeu des influences réciproques dans l’aire asiatique : le contexte de l’impérialisme et des « guerres de l’opium » durcissait en effet l’opposition entre les pays d’Asie orientale, d’une part, et l’Occident, d’autre part. Les malentendus entre les milieux diplomatiques français et les Coréens expliquent l’échec des expéditions maritimes comme celle du contre-amiral Roze en 1866, dont l’auteur montre qu’elle fut vécue par les Coréens comme la première véritable guerre d’invasion occidentale.
Missionnaires… et diplomates
Le canon n’était pas cependant la seule voie d’ouverture de la Corée aux intérêts français. Il s’accompagnait de démarches diplomatiques. A cette fin, les missionnaires qui ont joué un rôle crucial et ont été les pionniers de l’ouverture de la Corée à la France, ont été mis au service des intérêts géostratégiques et politiques du Quai d’Orsay, ce dont ils n’étaient pas tout à fait dupes. Mais eux-mêmes recherchaient la protection diplomatique face aux persécutions dont ils étaient l’objet, dans le but d’ouvrir la Corée à la religion catholique. Il est ainsi remarquable de découvrir le rôle diplomatique que des missionnaires ont pu jouer pour faire intervenir le régime impérial chinois en Corée, aux côtés des Français… même si ces tentatives n’ont pas abouti. L’histoire des missionnaires français en Corée est en effet étroitement liée à celle de la Chine.
En conclusion, cet ouvrage est un bel exemple d’une histoire connectée de l’Asie orientale, où s’entrecroisent et se confrontent les perceptions et les intérêts des différentes parties. L’auteur montre bien que les « guerres de l’opium » constituent une période charnière, avec des répercussions sur les voisins de la Chine, dont la Corée.
Ce récit se double d’une analyse critique de sources inédites françaises et coréennes, qui permet d’insister sur les arrière-pensées géostratégiques et politiques à l’œuvre dans les expéditions maritimes françaises. Si l’auteur récuse l’idée de choc de civilisations, il insiste sur les difficultés qu’éprouvent les Français pour comprendre la Corée… ce qui explique probablement l’échec de leur implantation au mal nommé « pays du matin calme », au milieu du XIXe siècle.
Thi Minh-Hoang NGO












Aucun commentaire.