Jacques Rueff, « prophète en son pays »
Jean Sénié | 04 mars 2016
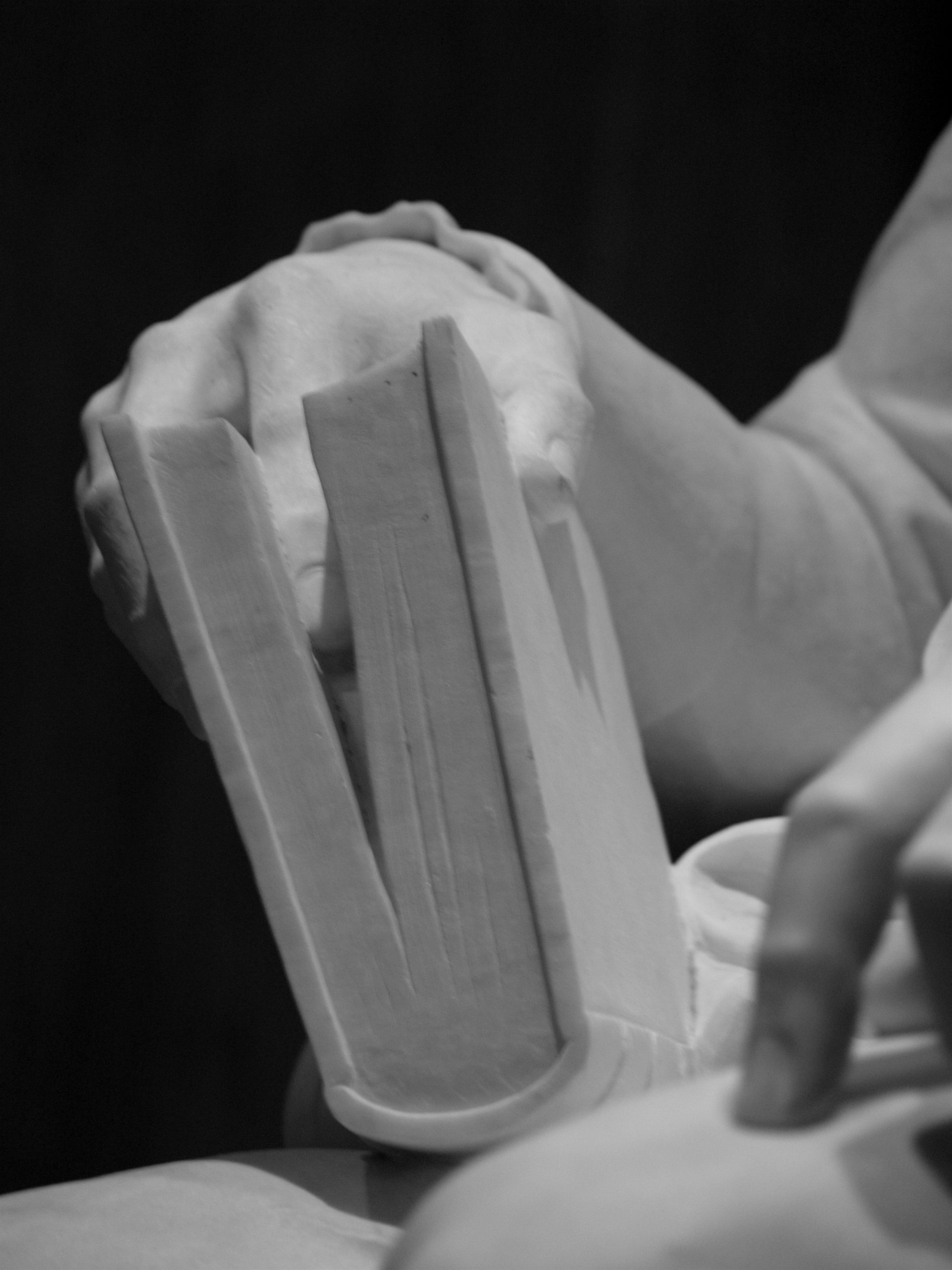 Jacques Rueff, « prophète en son pays »
Jacques Rueff, « prophète en son pays »
Par Jean Senié
Jacques Rueff un libéral francais, de Gérard Minart, Éditions Odile Jacob, 2016, 368 pages, 25.90€
Le choix du titre pourrait, a priori, surprendre, tant Jacques Rueff paraît aujourd’hui oublié, si ce n’est de quelques spécialistes de l’histoire de la pensée économique ou d’historiens de la Vème République. Selon cette vision qui, indéniablement, comporte une part de vérité, Jacques Rueff serait un des derniers hérauts du libéralisme français et, surtout, à la française.
Or, la biographie que lui a récemment consacrée Gérard Minart permet de revenir sur cette vision. La lecture de ce riche ouvrage invite ainsi dès les premières pages à prendre la mesure de la pensée, de l’action de Rueff, mais surtout de sa position cruciale dans les reformulations du libéralisme au XXème siècle. En venant combler un manque évident, l’historien du libéralisme a pour but de réparer un tort et, en même temps, de mettre en lumière une tradition bien française de vouer aux gémonies ses trop rares figures libérales.
Un penseur tombé dans l’oubli
Sans nous appesantir sur ce qui constitue le contexte de l’œuvre, il est frappant que depuis sa mort en 1978, Jacques Rueff soit sorti de la mémoire collective. Peu d’ouvrages lui sont aujourd’hui consacrés, et ce, toujours de manière indirecte. L’ouvrage de Gérard Minart est ainsi la première biographie en bonne et due forme dédié à une figure que les anglo-saxons continuent d’étudier et à laquelle ils font encore référence.
Il convient, dès à présent, de saluer le travail de Gérard Minart. Il est tout à l’honneur de cet ancien rédacteur en chef du quotidien régional La Voix du Nord d’écrire une histoire, par certains aspects, méconnue, celle du libéralisme français. La biographie de Jacques Rueff fait suite à des ouvrages sur Pierre Daunou[1], Frédéric Bastiat[2] ou sur le belge Gustave de Molinari, disciple de Frédéric Bastiat[3]. Sans aller trop avant dans le lamento sur la méconnaissance de la tradition libérale francophone, on peut se féliciter du sillon que continue de tracer inlassablement Gérard Minart ainsi que de la persévérance avec laquelle il entend reconstituer les différentes branches du libéralisme français, lequel ne se résume pas, en dépit de tous ses mérites, à l’unique personne de Raymond Aron.
Jacques Rueff, un libéralisme français
Parmi les différents traits qui retiennent l’attention à la lecture de cette biographie, le premier est peut-être le fait que Rueff constitue l’aboutissement d’une tradition de pensée française. Il est le représentant parfait d’une spécialité française, à savoir les « ingénieurs-économistes ». L’auteur consacre ainsi des pages passionnantes aux rapports entre Jacques Rueff et son professeur d’économie à l’Ecole Polytechnique, Clément Colson. Il rappelle tout ce que l’économie doit à Clément Colson, qui avait mis en évidence le mécanisme du prix, véritable étai de la pensée de Jacques Rueff. Celui-ci y est constamment revenu et a entrepris de le démontrer aussi bien mathématiquement que philosophiquement. Cette présence des mathématiques sous forme de démonstrations savantes est un des traits caractéristiques de l’œuvre de Rueff. Au passage, sans trop y insister, l’auteur rappelle à tous les détracteurs actuels de l’économie qu’il s’agit bien d’une science et non d’une méthode de divination. Le lecteur découvre chemin faisant une généalogie libérale qui ne passerait plus par Charles Dunoyer, Frédéric Bastiat et leur postérité mais par des hommes comme Augustin Cournot, Léon Walras, Clément Colson et Jacques Rueff – en gardant à l’esprit que ces pensées n’ont cessé de communiquer entre elles et de s’enrichir.
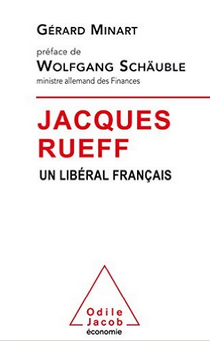 Le libéralisme de Rueff est aussi français, de manière plus allégorique, par l’attachement que celui-ci a porté à la langue française et à une expression littéraire de sa pensée. Il faut rappeler que Jacques Rueff entre à l’Académie française en 1964 et qu’il est chancelier de l’Institut entre 1964 et 1978. Il a eu l’occasion dans son œuvre d’évoquer l’importance qu’il attachait à la langue mais surtout la capacité, voire l’excellence, de la langue française pour dire le fait économique et social. Les nombreux extraits que reproduit Gérard Minart permettent de savourer cette prose rigoureuse et élégante qui cherche toujours à convaincre le lecteur sans pour autant oublier de le persuader.
Le libéralisme de Rueff est aussi français, de manière plus allégorique, par l’attachement que celui-ci a porté à la langue française et à une expression littéraire de sa pensée. Il faut rappeler que Jacques Rueff entre à l’Académie française en 1964 et qu’il est chancelier de l’Institut entre 1964 et 1978. Il a eu l’occasion dans son œuvre d’évoquer l’importance qu’il attachait à la langue mais surtout la capacité, voire l’excellence, de la langue française pour dire le fait économique et social. Les nombreux extraits que reproduit Gérard Minart permettent de savourer cette prose rigoureuse et élégante qui cherche toujours à convaincre le lecteur sans pour autant oublier de le persuader.
L’anti-Keynes
Jacques Rueff a été de son vivant un des plus vifs et des plus constants contradicteurs de Keynes. Bien avant la Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie, il a dénoncé le raisonnement économique et social de celui qu’il a rencontré lors de son séjour anglais. Le biographe restitue longuement et de manière extensive le débat qui opposa les deux hommes.
Comme Hayek, Rueff a toujours pris au sérieux Keynes. C’est pour cela qu’il n’a eu de cesse de s’opposer à lui. De la question extrêmement technique des réparations après la Première Guerre mondiale – et de leur corollaire, les dettes interalliées – à la question du chômage en Grande-Bretagne à la fin des années 1920 et au début des années 1930, pour finir au refus de l’ordre monétaire issu des accords de Bretton Woods, Rueff a toujours tâché de remettre en cause la vision de Keynes en se fondant sur le mécanisme du prix et sur les conséquences qu’il en a tirées pour les enjeux monétaires et sociaux. En ce sens, la pensée de Rueff conserve une actualité brûlante, notamment sur la question du chômage qui en France continue d’occuper les esprits.
Un libéralisme revisité
L’auteur prend aussi le temps de détailler l’inscription de Rueff dans les différents réseaux libéraux qu’il a pu fréquenter au cours de sa vie. Il a ainsi participé au colloque Walter Lippman consacré à la refondation du libéralisme classique dit « manchestérien » en août 1938. Parmi les réalisations de cet événement qui sera à l’origine de ce qu’on a appelé le néo-libéralisme, il y a été notamment réaffirmé l’importance du mécanisme des prix ainsi que la nécessité de l’intervention de l’Etat, à condition que cette dernière soit strictement encadrée. C’est d’ailleurs ce que Jacques Rueff avait annoncé dans une conférence célèbre organisée par le groupe X-crise, prononcée en 1934 et qui s’intitulait Pourquoi malgré tout je reste libéral[4]. C’est la principale source de désaccord entre Rueff d’une part et Hayek et Mises d’autre part. Si ces derniers croient en un ordre spontané, le premier prend ses distances avec cette idée et réaffirme l’importance d’un « ordre social », idée qui laisse une place pour une action, clairement délimitée, de l’Etat. Cela ne l’empêchera pas pour autant de participer à l’aventure de la société du Mont Pélérin ou à la création de l’ALEPS.
Cette conscience forte de l’Etat peut s’expliquer pour l’auteur par la « rage du bien public » qui anime Rueff. Tout au long de sa vie, il a refusé de séparer théorie et pratique comme il l’a montré en jouant le rôle de conseiller économique en 1928 auprès de Raymond Poincaré, en 1938 auprès de Paul Reynaud et surtout en 1958 auprès du général de Gaulle. L’appréciation plus que louangeuse que le général porta sur celui qui lui avait proposé son plan de redressement des finances et de l’économie invite d’ailleurs, incidemment, à reconsidérer la position du premier Président de la Vème République sur le libéralisme. Pour Jacques Rueff, le libéralisme ne peut porter ses fruits que si les libertés sont protégées et pour cela il est impératif que l’Etat fonctionne bien, par exemple en légiférant sur les monopoles ou sur les positions de rentes qui viennent fausser le libre mécanisme des prix. Le fervent engagement européen de l’économiste prend aussi son sens dans le cadre de son attention au service de l’Etat.
L’ouvrage de Gérard Minart vient ainsi combler un vide. Si l’auteur n’échappe pas au travers du biographe – celui de transformer son sujet en héros, en le présentant systématiquement sous un jour favorable, voire comme un démiurge à l’origine de toutes les réalisations bénéfiques advenus durant sa vie –, il propose une introduction éclairée à la pensée de Jacques Rueff. Il s’agit d’une invitation à lire les œuvres complètes de ce penseur quelque peu oublié pour apprécier à nouveau toute la pertinence et aussi l’importance de sa réflexion. Peut-être est-ce aussi une invitation à approfondir notre connaissance de l’histoire du libéralisme français au XXème siècle, à y chercher des réponses aux questions qui sont toujours les nôtres.
[1] MINART Gérard, Pierre Daunou, l’anti-Robespierre, Toulouse, Privat, 2001.
[2] MINART Gérard, Frédéric Bastiat, le croisé du libre-échange, Paris, L’Harmattan, 2004.
[3] MINART Gérard, Gustave de Molinari (1819-1912) : Pour un gouvernement à bon marché dans un milieu libre, Institut Charles Coquelin, 2012.
[4] http://www.alainmadelin.fr/new/bibliotheque/plus/rueff34.htm. Pour une analyse de ce texte voir, http://www.euro92.com/acrob/LaneRueff.PDF
crédit photo Flickr : takomabibelot












Aucun commentaire.