La modernité ou comment le pouvoir moderne nous a domestiqués
Fondapol | 27 août 2012
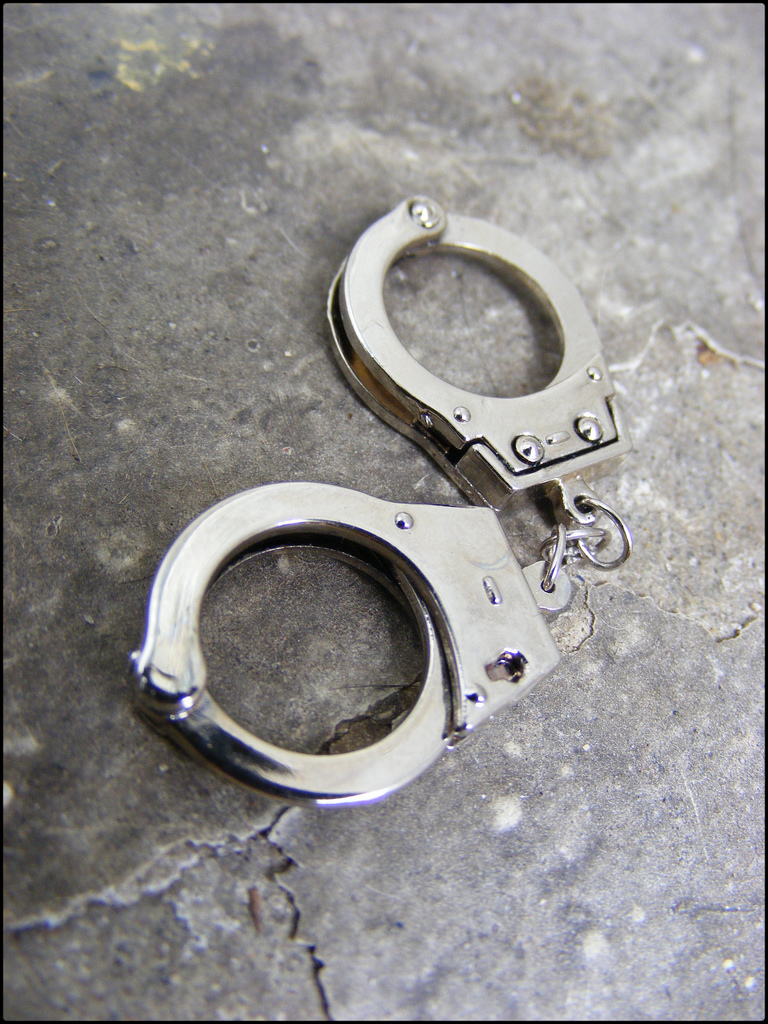 Ouvrage recensé : Dominique Séglard, Du pouvoir, Paris, Seuil, Coll. « Traces écrites », 2012, 286 pages, 27€.
Ouvrage recensé : Dominique Séglard, Du pouvoir, Paris, Seuil, Coll. « Traces écrites », 2012, 286 pages, 27€.
Les biais anthropologiques de la philosophie politique
Dominique Séglard montre que la pensée de Foucault permet un renversement d’une conception ancienne du pouvoir, qui aurait pour vocation de maintenir la cohésion sociale en limitant les instincts, pour que ne s’exprime que la partie sage de l’homme. Selon l’auteur, on retrouverait notamment cet héritage chez les penseurs du contrat social (Hobbes disait bien que « l’homme est un loup pour l’homme ») pour qui le corps social n’est constitué que par l’association de volontés libérées des passions.
Le corps, prison de l’âme
Pour Séglard, cette conception du politique procède d’une définition a priori de ce que l’homme est – l’homme a une âme/une conscience rationnelle – et de ce qu’il doit être-il doit soumettre son comportement à cette conscience.
Foucault a selon l’auteur déconstruit cette anthropologie, montrant que l’âme, la conscience, la personnalité sont des inventions qui peuvent être datées, des pratiques historiques qui ont pour fonction de domestiquer… les corps. L’âme devient alors la prison du corps. Cette conception de l’homme déconstruite, l’idée ancienne du pouvoir perd le fondement anthropologique qui faisait sa cohérence.
Un pouvoir diffus
Dès lors, comment définir le pouvoir ?
Séglard montre avec Foucault que le mot ne peut être employé au singulier. Il existe en fait de multiples relations de pouvoir de nature différente, qui maintiennent un lien social permanent : entre un élève et son professeur, entre un débiteur et un créditeur, entre les parents et leurs enfants. Le pouvoir ne se résume donc pas à la relation entre un Souverain unique et la société, mais s’infiltre dans tous les interstices des interactions entre les individus.
L’ubiquité du pouvoir
Séglard va plus loin, montrant que le pouvoir agit en profondeur sur les êtres. En effet, s’il est « conduite d’une conduite » et « dressage des corps » ce n’est pas pour autant qu’il se résume à un simple dispositif de répression et à la définition du licite et de l’illicite. Le pouvoir est une force affirmative.
C’est lui qui produit les normes qui s’imposent aux individus. Davantage, il forge l’objet des désirs. Ainsi, la mère qui offre des poupées à Noël pousse-t-elle sa fille, inconsciemment peut-être, à adopter un certain type de conduite qu’elle intériorisera par la suite. Séglard affirme enfin que le pouvoir produit le désir lui-même, en affirmant que l’homme est un être désirant, et en l’enfermant ainsi dans un certain type de comportement.
La naissance de l’Etat moderne
De là, Séglard s’interroge sur le type de mécanisme mis en place pour pouvoir « discipliner » le corps social et donc les corps individuels. Il revient en particulier sur le tournant de la fin du XVIIIème siècle, qui a vu l’émergence de l’Etat moderne. Une population plus importante et moins docile, la densification des relations économiques impose alors un changement de gouvernement. A cette époque, une rupture s’opère entre un Ancien régime qui exerce son pouvoir parce qu’il est visible des sujets un Etat moderne qui à l’inverse voit, surveille les citoyens. Séglard explique qu’à cette époque, on donne « un œil au pouvoir ».
We are Big Brother
C’est la Panoptique de Foucault, dont l’Etat moderne, anonyme et impersonnel, est l’incarnation. De là est né l’espace public, lieu où tout le monde est surveillé et peut surveiller les autres. De là aussi est né le règne de l’opinion, sorte de célébration du corps social prenant conscience de lui-même et qui, comme le montre Séglard, est en fait « ce que chacun sait sur les autres ». Le régime politique moderne est donc celui où chaque citoyen en général est un « Big Brother » particulier.
La discipline en 5 leçons
Si chacun est offert à la vue des autres, le pouvoir par la surveillance a aussi un versant éminemment actif et productif : la discipline. Formalisée pour la première fois à grande échelle par Frédéric II de Prusse pour reconfigurer son armée, la discipline s’est ensuite diffusée à l’ensemble du monde moderne.
Séglard la considère comme une technique de gestion des comportements et du corps des hommes dans leur individualité, qui répond à 5 critères selon Séglard :
1) C’est une technique de distribution spatiale des individus. Pensons à la salle de classe par exemple.
2) La discipline s’exerce sur les moyens plus que sur la fin de l’action. Ainsi, dans l’atelier, les mouvements des ouvriers sont décomposés et contrôlés : c’est le début du taylorisme.
3) Chaque personne est intégrée dans une structure hiérarchisée avec une surveillance pyramidale : le surveillant inférieur est observé par le surveillant supérieur et ainsi de suite.
4) La discipline repose sur un système d’annotation et d’enregistrement permanent afin de juger, classer, identifier et renvoyer les informations à l’échelon supérieur pour que rien n’échappe à « l’œil du pouvoir ». Ce sont par exemple les livrets scolaires ou ouvriers.
5) La discipline séquestre et range, que ce soit dans les salles de classe ou même dans les prisons.
Ainsi, la discipline est une technique individualisante du pouvoir qui domestique chaque personne isolément dans ses moindres gestes afin de la positionner à l’endroit où elle sera le plus utile à la société. Elle est ce que Foucault appelle une « anatomie du politique ».
Un autre regard
Dans cet ouvrage majeur, Séglard, et à travers lui Foucault, renouvellent en profondeur notre regard sur la politique. Ce ne sont pas seulement les théories classiques qui sont questionnées et remises en cause ; c’est une nouvelle figure du pouvoir, présent dans toutes les dimensions de l’existence humaine, qui est dessinée.
On peut se questionner sur la pertinence de la vision d’un pouvoir omniprésent, à l’heure où toutes les institutions se veulent modestes, où les libertés individuelles semblent progresser contre l’emprise des chefs, d’Etat comme de famille. Mais ce relâchement n’est-il pas le signe que le dressage est terminé, que le pouvoir a quitté les institutions pour établir son siège en chacun de nous, par le biais d’un conformisme si puissant que nous n’en sommes plus conscients ?
Mathias le Masne












Aucun commentaire.