La Prudence et l’Autorité
05 mars 2014
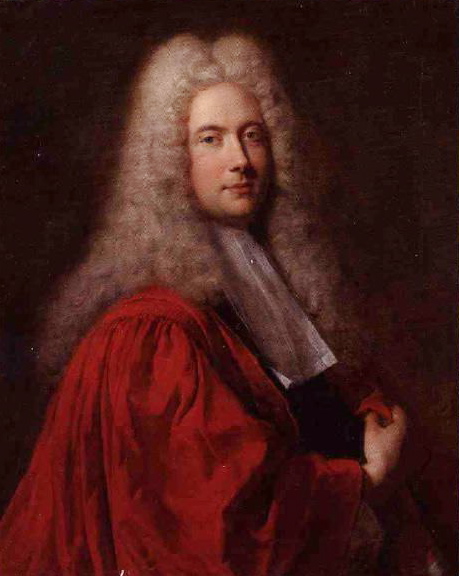 La Prudence et l’Autorité
La Prudence et l’Autorité
Antoine Garapon, Sylvie Perdriolle, Boris Bernabé, Juges et Procureurs du XXIème siècle, janvier 2014, Odile Jacob, 130 pages, 24,90 euros
C’est à Antoine Garapon, ancien juge pour enfants et actuel secrétaire général de l’institut des hautes études sur la justice, Sylvie Perdriolle, Présidente de chambre à la Cour d’appel de Paris, et Boris Bernabé, professeur d’histoire du droit, que la ministre de la justice, Christiane Taubira, a confié la rédaction d’un rapport en vue de la future réforme de la justice prévue pour le printemps 2014. La pertinence et le réalisme des mesures proposées font de cet ouvrage un miroir saisissant du devoir-être empiriquement établi de la justice française au XXIe siècle.
Un monde judiciaire en crise : concilier besoins croissants et réduction des moyens
On ne compte plus les réformes entreprises depuis deux décennies, au coup par coup, dans l’urgence, et sans réflexion profonde sur les tenants et aboutissants qu’elles ont eu sur la vie des juridictions. Songeons aux procédures d’aménagements de peine, ou encore aux tentatives de conciliations entre parties. Pourtant, force est de constater que le nombre de contentieux ne cesse d’augmenter, avec pour conséquence une saturation des tribunaux et, son corollaire, l’accroissement des délais de traitement des affaires.
Mais plus profondément, ce sont les professionnels du droit qui se retrouvent de moins en moins dans cette nouvelle organisation judiciaire, tandis que les justiciables sont en attente d‘une clarté, d’une rapidité et d’une efficacité accrues.
Comment faire face à un besoin sociétal de justice grandissant et à l’élargissement continu des missions confiées au juge (surendettement, contentieux de la famille, etc.) alors que, dans le même temps, les moyens humains et financiers, accordés aux juridictions s’amenuisent ?
Une voie possible : réformer la justice de l’intérieur en donnant la parole à ceux qui la rendent
Afin que cet ouvrage ne soit pas un énième rapport débouchant sur des réformes a minima et déphasée avec la réalité du milieu judiciaire, les trois auteurs ont adopté une démarche méthodologique innovante. Plutôt que d’utiliser une approche purement normative, détachée du quotidien judiciaire, et de penser la justice « telle qu’elle devrait être », ils nous proposent de partir des fondements du rôle dévolu historiquement à la magistrature française afin de comprendre les interrogations et les aspirations des hommes et des femmes qui rendent la justice au quotidien.
Les mesures qu’ils proposent tentent de concilier une évolution de l’organisation de la justice rendue nécessaire par le contexte social et budgétaire, avec l’idée que le corps de la magistrature a de sa place et de ses missions dans la République.
L’office du juge : l’identité de la magistrature comme socle de l’évolution des juridictions
Pour ce faire, Antoine Garapon, Sylvie Perdriolle, et Boris Bernabé nous invitent à nous pencher sur ce qu’est l’office du juge, défini par la doctrine comme « l’acte juridictionnel qui traduit la fonction judiciaire dans son essence ». Ils en relèvent six catégories :
– l’office jurisprudentiel, celui de dire le droit explicitement en tenant compte de ce qui a été décidé précédemment par les autres juges français et européens ;
– l’office processuel dont l’objectif est de trancher les litiges n’ayant pu être résolus par ailleurs en y apportant un traitement efficace et équitable ;
– l’office tutélaire qui a trait à la protection des personnes fragilisées ;
– l’office sanctionnateur, qui consiste à sanctionner les infractions sans omettre la nécessaire réintégration de l’individu dans la société ;
– l’office libéral et la nécessaire garantie des libertés individuelles ;
– l’office de vérité, celui d’établir la vérité des faits dans le cadre d’une procédure contradictoire, indépendante et argumentée.
Après avoir rappelé l’origine et l’évolution historique de chacun de ces six offices, les auteurs soulignent les défis auxquels les évolutions sociales, économiques, démographiques et technologiques les confrontent aujourd’hui. C’est de ces différents offices que découleront nécessairement des réformes efficientes (délégations de tâches, implication des acteurs sociaux dans les parcours de peine, meilleure utilisation des nouvelles technologies, etc.) qui permettront aux magistrats de s’adapter aux mutations de la société avec les moyens réduits qui sont aujourd’hui les leurs, sans pour autant remettre en cause ce qui fait leur identité et l’idée qu’ils se font de leurs missions.
L’ouvrage aborde également l’épineuse question de l’appel. Utilisés quasi systématiquement comme voie d’achèvement, aujourd’hui, les cours d’Appel font face à l’explosion des contentieux, au point de délégitimer le travail des juges de première instance. Les auteurs proposent notamment de s’inspirer du système anglais de la question sur l’office. « Quel est le point précis de la sentence du premier juge que vous contestez ? Argumentez. ».
L’office des magistrats du parquet est étudié à part, tant les missions qui leurs sont confiées reste particulières. Ce dernier chapitre vient compléter un travail dense, riche, et novateur sur ce à quoi doit faire face aujourd’hui le corps de la magistrature.
Vers une justice lisible, rapide, et acceptée par tous ?
De par leurs recherches historiques, mais aussi au travers d’enquêtes, de témoignages récoltés auprès de personnes confrontées quotidiennement aux problèmes de la justice, les auteurs fournissent, avec cet ouvrage, des propositions de réformes pertinentes et réalistes, pour la future organisation du système judiciaire français.
Plus encore, c’est l’ensemble des professionnels du droit (juges, avocats, greffiers..), des acteurs de la société civile (associations, acteurs sociaux…), mais aussi et surtout tous les justiciables potentiels que nous sommes, qui trouveront dans cet ouvrage des idées de mesures concrètes qui offrent aux français les moyens de pouvoir bénéficier d’un service de justice en phase avec ce que l’on est en droit d’attendre de la justice au 21ème siècle.
Claire Poncet












Aucun commentaire.