La robotique : solution au problème de la dépendance ? (8)
11 octobre 2013
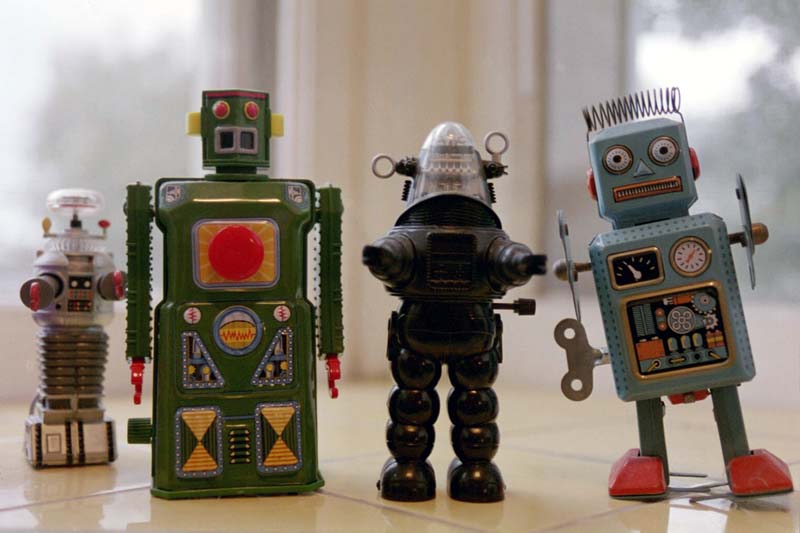 La robotique : solution au problème de la dépendance ? (8)
La robotique : solution au problème de la dépendance ? (8)
Le film Robot and Frank[1] retrace l’histoire d’un homme atteint de la maladie d’Alzheimer, à qui le fils va offrir un robot chargé de l’accompagner dans ses gestes au quotidien. De la fiction à la réalité, il n’y a qu’un pas : la robotique pourrait proposer des solutions concrètes à la perte d’autonomie en participant au mieux-vivre des usagers. Si elle ne peut être l’unique recours face aux enjeux de la dépendance, elle pourrait permettre de réduire les coûts de personnels à domicile, d’assister les aides-soignants et d’accompagner les personnes âgées dans leurs tâches quotidiennes.
La robotique servicielle serait à même de réduire la perte d’autonomie du million de personnes dépendantes en France[2], en répondant aux besoins spécifiques de chacune d’entre elles. Face aux troubles du comportement, les différentes fonctionnalités de ces robots sont multiples : télésanté, lien social, robots domotiques, ménagers ou thérapeutiques.
Des robots assistant les personnes dépendantes au quotidien
On peut catégoriser les robots d’assistance aux personnes âgées dépendantes en deux groupes distincts : d’une part, ceux qui ont une fonction d’assistance physique aidant aux activités de base, veillant à la sécurité de la personne (avec une fonction de monitoring), et d’autre part ceux qui disposent d’une fonction communicative apportant un soutien moral à la personne.
Parmi les robots d’assistance physique, certains sont déjà commercialisés en France, tels que les monte-personnes électriques, mais la robotique d’assistance aux personnes âgées va désormais plus loin. « Asimo »[3] est un robot conditionné pour venir en aide aux personnes âgées ou handicapées et est un véritable assistant technique au quotidien : il est capable d’enregistrer plusieurs commandes, comprend le langage des signes, et peut être interpellé par une tape dans le dos par exemple. Certains robots peuvent encore faire des shampooings (« Hair-Washing Robot »[4]), ouvrir un réfrigérateur, se saisir d’objets (« TWENDY-ONE »[5] ) ou aider à soulever une personne. Ce type de robot permet de pallier les déficiences physiques de la personne en perte d’autonomie.
La deuxième catégorie est celle des robots compagnons, programmés pour lutter contre les troubles cognitifs de perte de mémoire et de dépression. Ces robots compagnons ont un véritable rôle social, tel que le robot « Matilda »[6], conçu pour communiquer et interagir avec les personnes qui l’entourent, augmentant la bonne humeur ou diminuant la solitude de la personne. De même, le bébé phoque « Paro »[7] a notamment été conçu pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, sa forme et son toucher permettant l’interaction avec la personne en question. Ces types de robots ont aussi une finalité thérapeutique, notamment par la stimulation des capacités intellectuelles ou mémorielles des personnes. Enfin, certains robots ont pour but d’assurer la sécurité de la personne dépendante. On parle alors de téléprésence, télémédecine, de monitoring (Robot « Mamoru »[8]) ou de téléassistance, car ils peuvent simultanément détecter des situations anormales, prévenir le personnel soignant ou la famille grâce à une téléalarme ou rappeler la prise de médicaments.
Ainsi, la robotique d’assistance aux personnes âgées revêt un caractère utile et fonctionnel, mais également social. Néanmoins, l’évolution des robots de la dépendance tend aujourd’hui de plus en plus vers des robots humanoïdes, c’est-à-dire ressemblant à l’être humain, multitâches et capables d’assister la personne dépendante sans toujours avoir été commandés.
Les objectifs de la robotique servicielle
La robotique permettra-t-elle le maintien le plus longtemps possible des personnes dépendantes à leur domicile ? Va-t-elle accroître l’efficacité des hôpitaux et des maisons de retraite ? Les robots peuvent-ils réellement se substituer à l’aide fournie par les familles et le personnel médical ?
– Maintenir à domicile ?
La robotique de la dépendance pourrait favoriser le maintien à domicile et aider les personnes âgées dépendantes. Une grande majorité d’entre elles préfère rester à domicile, plutôt que d’aller en maison de retraite, et les établissements prenant en charge les personnes âgées en perte d’autonomie sont plus coûteux que le maintien à domicile de la personne. En France, le coût moyen d’une journée d’hospitalisation est de 700 euros, contre 200 euros pour une hospitalisation à domicile[9]. Ainsi, les robots d’assistance personnelle pourraient permettre de réduire les coûts liés à la dépendance : dès lors, ceux-ci pourraient être soutenus par l’État via la Sécurité sociale ? Le robot peut permettre de maintenir un lien vers l’extérieur entre le patient et le personnel soignant. Le « Human Support Robot »[10] (HSR), conçu pour aider les personnes âgées ayant des difficultés à se déplacer, connecté avec l’extérieur par une tablette, permet à la famille et aux personnels médicaux de communiquer avec la personne à distance via Skype. La téléassistance et la télémédecine ont donc vocation à faire vivre les seniors dépendants le plus longtemps possible à leur domicile et en lien avec la famille et les médecins. Pourtant beaucoup de robots font d’abord leur apparition en établissement plutôt qu’à domicile, tel que le robot « Roméo »[11], créé par la société française Aldebaran Robotics[12], qui assiste les personnes âgées dans leur vie quotidienne. Cependant, ces robots sont souvent très onéreux, de l’ordre de 100 000 euros, et il est difficile d’imaginer qu’un particulier puisse se l’offrir. En France, des robots moins coûteux sont en cours d’élaboration. Certains ont un objectif précis, tel que « Monimad »[13], destiné aux personnes ayant des difficultés à se déplacer. Cependant, ces nombreux robots pour les personnes dépendantes n’ont pas été spécifiquement conçus pour favoriser le maintien à domicile. En effet, des robots aides-soignants ont pour objectif d’assister les professionnels de santé dans leurs tâches, par exemple pour permettre une distribution efficace des médicaments (comme le robot « Actroid-F »[14], assistante infirmière destinée être utilisé dans les hôpitaux japonais).
– Une fonction thérapeutique ?
Le bébé phoque « Paro »[15] a été testé scientifiquement[16], en étant confié à plusieurs hôpitaux (au Japon, Etats-Unis, Suède, Danemark, Italie). Par des questionnaires, des échelles et le dosage urinaire, on a pu observer qu’après cinq semaines, l’humeur des patients s’était sensiblement améliorée, que le niveau de stress avait baissé (y compris chez le personnel soignant), que les interactions sociales augmentaient et que les symptômes dépressifs diminuaient. Après l’accident nucléaire de Fukushima, « Paro » a même été introduit dans des maisons de soins pour les personnes âgées, afin d’offrir un support psychologique suite à la catastrophe[17]. « Paro » a également été testé auprès des malades atteints d’Alzheimer et auprès d’enfants hospitalisés de plus de six mois pour leur redonner le sourire[18].
Les limites de la robotique d’assistance
– Les limites éthiques
Si les robots d’assistance petits, discrets, qui assistent les personnes âgées dans les tâches quotidiennes sont bien acceptés en France, des questions éthiques et juridiques se posent concernant les robots humanoïdes ou de forme animale[19]. Si des robots tels que « Paro » ont prouvé leur fonction thérapeutique grâce à la dimension affective qu’ils développent avec la personne âgée, ils peuvent aussi être à l’origine d’un leurre affectif pour les personnes qui s’y attachent. Sont-ils réellement perçus comme des robots par des malades atteints de la maladie d’Alzheimer, ou sont-ils confondus avec des êtres humains ? En Allemagne, l’utilisation du bébé phoque « Paro » dans une maison de retraite a eu pour conséquence d’isoler la personne qui l’utilisait du reste des pensionnaires[20].
Y a-t-il un risque de mise sous tutelle robotique ? L’éthique nous dicte de « ne recourir à la technologie que si ce recours est clairement utile à la qualité de vie et apporte un bénéfice au malade »[21], notamment en tenant compte des souhaits du malade. Les robots de téléprésence sont souvent en lien permanent avec le personnel médical et la famille. Si leur but est de donner davantage d’autonomie à la personne âgée, est-ce qu’ils ne finissent pas par la contrôler à l’encontre de sa volonté ? Par exemple, des caméras peuvent détecter et gérer les comportements anormaux de la personne pour prévenir son entourage en cas de chute, mais cela touche indéniablement à leur intimité. Les robots peuvent également avoir des réactions potentiellement imprévisibles : se pose alors un problème de confiance.
Outre ces questions éthiques, il existe des caractéristiques spécifiques à la France concernant la robotique, qui peuvent freiner son développement. L’acceptabilité sociale des robots, notamment des robots humanoïdes, est différente selon les zones géographiques : elle sera meilleure au Japon qu’en France. Au Japon, la culture du manga, ainsi que les religions bouddhistes et shintoïstes, qui autorisent d’accorder des âmes à des objets sans vie[22], créent un climat favorable à l’émergence de la robotique. Les sociétés asiatiques acceptent ainsi qu’un robot puisse créer un bénéfice psychique pour les personnes âgées, en les aidant à lutter contre l’isolement ou la dépression. En revanche, la société française craint que les robots finissent par remplacer le travail de l’homme (dans le cas de la dépendance, le personnel soignant). Robin Rivaton, dans Relancer notre industrie par les robots : les enjeux[23], explique qu’il y a une réelle inquiétude des Français vis-à-vis de la robotique, avec la vision naïve que certains ont de voir le robot comme l’ennemi des ouvriers, alors que celui-ci nécessite toujours l’intervention humaine. Par extension, le personnel de maisons de retraites ou de structures spécialisées pour les personnes dépendantes accepterait difficilement la présence de robots en tant qu’assistants.
Le coût onéreux des robots d’assistance aux personnes âgées freine leur commercialisation en France. Il s’agit d’une situation paradoxale, puisque l’un des objectifs de la robotique au service de la dépendance est la réduction des coûts liés au personnel soignant. La commercialisation à grande échelle des robots-assistants semble donc encore difficile et exige une réduction du prix de vente.
L’encadrement juridique des robots et notamment leur responsabilité civile, voire pénale, limite également leur développement en France. C’est pourquoi il faudrait créer un cadre réglementaire pour les robots serviciels à destination des personnes âgées. Isaac Asimov, dans la nouvelle Runaround[24], a exposé les trois lois de la robotique : un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni, restant passif, permettre qu’un être humain soit exposé au danger ; un robot doit obéir aux ordres que lui donne un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la Première loi ; et un robot doit protéger son existence tant que cette protection n’entre pas en conflit avec la Première ou la Deuxième loi. Ces trois lois de la robotique, si elles nous procurent un cadre éthique, n’ont cependant aucune force juridique. Les cadres juridiques, tant nationaux qu’internationaux, doivent encore être définis.
– Les limites techniques
La lenteur de déplacement de certains robots, ainsi que leur lourdeur, constituent également des critiques à leur égard. Par exemple, le robot « TWENDY-ONE » aidant les personnes à se lever ou à sortir de leur lit, mesure 1,5m pour 111 kilos[25].
Par ailleurs, les robots de compagnies ne font qu’imiter l’être humain, de manière souvent maladroite, avec des discussions enregistrées où le robot donne la réplique, sans réellement construire un dialogue. Les robots n’ont pas encore de réelles capacités de décisions ou d’expressions similaires à celles des hommes. Certains robots innovent néanmoins sur ce point. C’est par exemple le cas du robot « Ifbot » ou du robot « Matilda », qui peuvent soutenir une conversation grâce à une base de données de milliers de dialogues, en tenant compte des émotions de l’interlocuteur, comme l’anxiété chez les personnes atteintes de démence.
La gérontechnologie doit donc encore faire ses preuves pour s’affirmer comme une solution innovante permettant de résoudre les problèmes liés à la dépendance des personnes âgées. La robotique doit toujours être encadrée et nécessite souvent l’intervention d’ingénieurs[26] et de personnel médical. Cependant, à long-terme, l’intelligence robotique surpassera-t-elle l’intelligence humaine ? Une étude sur des robots médecins[27] développée par deux informaticiens américains a démontré que le pronostic des robots est plus pertinent de 41,9%, que ceux des médecins humains, alors même que leur coût d’utilisation est inférieur de 58,5%[28].
Claire Robert
Crédit photo : Flickr, peyri
[1] Jake Schreier, Robot and Frank, scénario de Christopher D. Ford, 2012.
[2] La France compte aujourd’hui un million de personnes dépendantes et on prévoit un quasi-doublement de la population âgée de 85 ans d’ici 2015, qui pourrait entraîner une augmentation de 25% du nombre de dépendants selon le ministère de l’économie et des finances.
[3] « Asimo » a été fabriqué par Honda, mais n’est pour l’instant qu’un robot de recherche et n’a pas encore été commercialisé.
[4] « Hair-Washing Robot » a été conçu par Panasonic.
[5] « TWENDY ONE » a été créé par le professeur japonais Shigeki Sugano (université Waseda). Il mesure 1m47 et pèse 11kg mais est toujours en cours d’élaboration.
[6] Le robot « Matilda » a été créé par Rajiv Khosla de l’université La Trobe (Melbourne, Australie) en coopération avec l’université de Kyoto (Japon) et a été développé par la firme nippone Nec. « Matilda » est un « PaPero » (« Partner Personal Robot »).
[7] Le bébé phoque « Paro » mesure 57cm et pèse 3kg. Il a été conçu pour créer de l’interaction entre la personne atteinte de démence et le robot. Très doux au toucher, il suscite le contact des patients.
[8] Gérontechnologie.net, Mamoru, un robot compagnon « aide-mémoire », 19 décembre 2008
[9] Selon la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).
[10] Le robot « Human Support Robot » a été développé par Toyota et fait partie du programme Partner Robot.
[11] Le projet « Roméo » est mené par le pôle de compétitivité français Cap Digital et financé par la Région Ile-de-France, par la Direction Général de la Compétitivité, de l’industrie et des Services et par la ville de Paris.
[12] Aldebaran Robotics est une société française de robotique créée en 2005.
[13] « Monimad » a été conçu par Viviane Pasqui, chercheuse au sein du Laboratoire de Robotique de Paris, et une unité mixte de recherche CNRS/Université Pierre et Marie Curie.
[14] Le robot « Actroid-F » a été conçu par le roboticien japonais Hiroshi Ishiguro.
[15] Le robot « Paro » est un robot thérapeutique développé par Takanori Shibata de la société AIST.
[16] Takanori SHIBATA et Kazuyoshi WADA, Robot Therapy: A New Approach for Mental Healthcare of the Elderly, in Gerontology, juillet 2010.
[17] Reuters, Robot Paro comforts the elderly in Fukushima, 8 août 2011
[18] Doctissimo, Paro, le robot bébé phoque aux vertus thérapeutiques, 14 décembre 2010.
[19] Le Nouvel Observateur, « Les 5 robots les plus inquiétants pour l’avenir de l’Homme,» 29 novembre 2012.
[20] Gérontechnologie.net, Paro : un robot de thérapie pour la maladie d’Alzheimer, 2 octobre 2009.
[21] Vincent RIALLE, Enjeux et questionnements éthiques : les espoirs et les peurs suscités par les nouvelles technologies, mars 2012.
[22] Gérontechnologie.net, Les robots de compagnie pour les personnes âgées, 2 octobre 2009.
[23] Robin RIVATON, Relancer notre industrie par les robots (1) : les enjeux, 19 décembre 2012.
[24] Isaac ASIMOV, Runaround, in Astounding Science-Fiction, 1942.
[25] Gérontechnologie.net, Les robots de compagnie pour les personnes âgées, 2 octobre 2009.
[26] Exemple du robot « Asimo » de Honda, considéré comme un des plus avancés technologiquement, alors que son utilisation nécessite encore le déplacement de plusieurs ingénieurs.
[27] Casey C. BENNETT et Kris HAUSER, Artificial intelligence framework for simulating clinical decision-making: a Markov decision process approach, in Artificial intelligence in Medecine, volume 57, issue 1, janvier 2013.
[28] Futura-Santé, Des robots remplaceront-ils bientôt les médecins ?, 19 février 2013.
Pour approfondir sujet la Fondation pour l’innovation politique vous propose de lire la note de Robin Rivaton : » RELANCER NOTRE INDUSTRIE PAR LES ROBOTS » (1) & (2)
Relancer notre industrie par les robots (1) : les enjeux by Fondapol
Relancer notre industrie par les robots (2) : les stratégies by Fondapol












Aucun commentaire.