Le sens de l’honneur peut-il transformer une société ?
06 juillet 2012
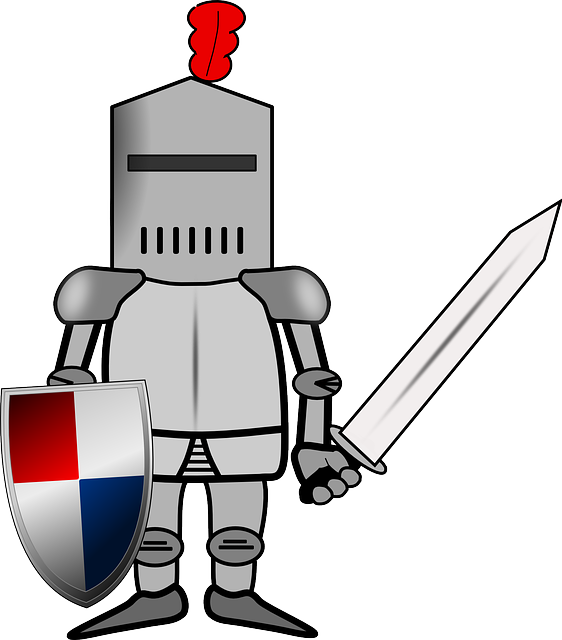 Kwame Anthony Appiah, Le code d’honneur, Comment adviennent les révolutions morales, mars 2012, Gallimard, 271 pages.
Kwame Anthony Appiah, Le code d’honneur, Comment adviennent les révolutions morales, mars 2012, Gallimard, 271 pages.
Logiques de l’honneur
Par révolution morale, l’auteur entend « un changement profond en un bref laps de temps » des règles de comportement, un retournement de perspectives si radical que les intéressés ne se souviennent plus des raisons qui, jusque là, légitimaient leurs actions.
Selon le philosophe, l’honneur est, pour les membres d’une société et sans qu’ils le sachent toujours, un critère essentiel de la bonne vie ou de la bonne action. Il se distingue de la morale par son indifférence à toute préoccupation altruiste. Selon la logique de l’honneur, il s’agit de vivre bien « sans que l’on pense que la seule chose pour vivre bien est d’être bon pour les autres ».
Le code de l’honneur propre à chaque société est le principal objet d’étude de l’auteur. Appiah souhaite en offrir une grille de lecture. Pour décrypter ce code, il se fonde sur une série de trois exemples : le duel en Grande Bretagne, le bandage des pieds en Chine et la traite négrière atlantique, trois pratiques très différentes mais qui ont fini par disparaître selon un mécanisme semblable.
Comment le duel a perdu son sens en Angleterre
En 1829, en Angleterre, Wellington et Winchilsea s’affrontent en duel. A cette époque, les arguments défavorables à cette pratique ne manquent pas, qu’ils soient religieux ou issus de la philosophie des Lumières. La presse elle-même tourne l’événement en ridicule. Quant aux deux intéressés ils n’y croient plus. Pourtant, ils se livrent tout de même à cette pratique ancestrale. Car au moment où Wellington et Winchilsea se battent en duel, l’emprise de l’aristocratie sur les institutions reste forte.
En fait, loin de la morale ou même de l’opinion publique, ce qui relèguera le duel au musée des curiosités c’est le changement des paramètres de l’honneur. La pratique du duel se propage dans les autres couches de la population et n’est plus le lieu d’expression « d’une égalité [d’individus] au sein d’une supériorité [de classe] ». Dès lors, il n’a plus de raison d’être.
Ainsi, suivant un raisonnement proche de Tocqueville, l’auteur impute la mort du duel au basculement d’un code de l’honneur basé sur l’appartenance à un groupe social particulier, à un code de l’honneur fondé sur le mérite plus adapté à une classe de fonctionnaire montante en Grande Bretagne.
Le bandage des pieds, une honte pour la Chine
En 1898 Kang Youwei, un intellectuel chinois envoie à l’Impératrice mandchou Cixi une requête demandant l’abandon de la pratique ancestrale du bandage des pieds des femmes. Cette coutume, en rendant le déplacement des femmes difficiles garantissait leur fidélité.
L’argument principal de l’intellectuel est fondé sur « l’honneur du pays » dont la conception évolue profondément avec l’ouverture de la Chine sur le monde et l’arrivée de missionnaires européens. De fait si le bandage des pieds était une pratique honorable pour l’élite de l’ethnie Han, dans un « monde de l’honneur » plus vaste, c’est-à-dire incluant des étrangers, le bandage des pieds faisait passer les Chinois pour des arriérés. Intériorisé par la classe dominante confucianiste, l’abandon du bandage des pieds s’est ensuite répercuté par un effet de « désescalade » jusqu’aux classes populaires.
Ouvriers et esclaves : même combat
Un processus semblable préside à la suppression de la traite négrière atlantique par la Grande-Bretagne.
Ainsi, l’abolitionnisme britannique a progressivement gagné en puissance en vertu de l’évolution des codes d’honneur parmi l’ensemble des citoyens.
Tout a basculé lorsque l’agitateur radical William Cobbett a affirmé que le sort de l’ouvrier en Grande Bretagne n’était pas plus enviable que celui de l’esclave aux Antilles. Cet argument fût repris par les organisations syndicales, les clubs politiques et a diffusé dans la classe populaire cette conviction que soutenir l’esclavage était déshonorant non seulement pour le pays mais aussi pour tous les travailleurs au nom de la dignité humaine. En passant à un « monde de l’honneur » plus vaste, concernant tous les travailleurs, le peuple britannique fût gagné à la cause abolitionniste : l’esclavage était alors condamné.
L’ensemble de ces exemples montrent ainsi que le code de l’honneur doit changer pour que disparaissent les pratiques les plus condamnables : l’honneur est ainsi toujours mobilisé avec succès en faveur de la morale.
Quelles sont les stratégies pour changer le code d’honneur ?
Cependant, Appiah relève que dans certains cas, les codes d’honneur peinent à évoluer, perpétuant certaines pratiques immorales. Ainsi, que ce soit en Sicile ou au Pakistan, la perte de la pureté d’une femme avant son mariage entraîne le déshonneur familial et parfois la mort de la « fautive ».
Ce blocage n’est pas une fatalité selon l’auteur, qui propose des « stratégies » pour faire évoluer ces codes l’honneur. Ainsi, par exemple, l’élargissement du « monde de l’honneur » place les tenants de l’ancien code d’honneur sous le regard du monde extérieur. C’est la stratégie de « la honte collective », qui pousse à abandonner les anciennes pratiques.
Puissance de l’honneur
En définitive, selon Appiah, l’honneur a une position ambivalente vis-à-vis de la morale. D’une part, il constitue pour un individu ou un groupe une «raison d’agir » en dehors du cadre de la morale. Cependant, il constitue un moyen efficace de transformer des sentiments moraux en normes publiques. Il est ainsi possible d’obtenir d’un homme d’honneur un acte moralement désirable mais trop difficile pour être moralement exigé. Selon l’auteur, l’honneur est une arme « puissante » qui permet de faire progresser la dignité humaine dans un monde hostile.
Un essai stimulant mais qui ne répond pas à toutes les questions qu’il soulève
D’une lecture stimulante, cet essai nous fait voyager à travers les pays et les époques, de l’Angleterre du début du XIXème siècle au Pakistan actuel en passant par la Chine Impériale. Au cours de ce périple, la notion d’honneur est peu à peu affinée.
On regrettera que la dernière partie de l’ouvrage, plus philosophique, ne tire pas toutes les conséquences des exemples donnés au cours de l’ouvrage. La réflexion, pourtant originale et puissante, sur les rapports entre honneur et morale pourrait être poussée plus loin. Kwame Anthony Appiah évoque ainsi « l’émotion » de l’honneur en l’opposant à la froide raison qui régit le monde moral. Qu’entend-il par là ? S’agit-il, avec l’honneur, de rendre à l’émotion ses titres de noblesse dans un monde commandé par une morale moderne abstraite et rationnelle ? L’honneur serait-il une nouvelle puissance normative à une époque où la morale est délégitimée et l’émotion survalorisée ? Ces interrogations restent malheureusement sans réponse.












Aucun commentaire.