« L’horreur religieuse » ou la revanche des passions
François de Laboulaye | 21 décembre 2016
 L’horreur religieuse de Joseph Macé-Scaron, Plon, 2016, 192 pages, 15,90 €
L’horreur religieuse de Joseph Macé-Scaron, Plon, 2016, 192 pages, 15,90 €
Un cri de rejet, brutal et entier, de la religion et de ce qu’elle représente sous toutes ses formes, tel est le propos de l’ouvrage intitulé « L’horreur religieuse » (ed. Plon, 2016) du journaliste, et Président du comité éditorial de Marianne, Joseph Macé-Scaron.
Son essai, qui alterne entre réquisitoire et inventaire à la Prévert de toutes les turpitudes commises au nom de la religion, part du postulat d’un retour irrépressible du religieux. Dans la lutte entre la raison des Lumières et le fanatisme moyenâgeux, le bien rationnel et le mal obscurantiste, l’ordre de la pensée et le chaos des pulsions, la « Religion Pride » emporte tout, justifie tout, subjugue tout. S’il est possible de débattre de politique, il n’est pas possible de critiquer le refus d’appuyer sur l’interrupteur un jour de shabbat, estime Dawkins. La religion avance, sûre d’elle-même et dominatrice, derrière son « mur protecteur » (Dawkins), profitant de ce « respect non mérité » qu’elle impose à ceux qui dirigent. D’ailleurs, le terrain est favorable, la classe politique s’est réfugiée dans le déni, le « padamalgamisme » et, à l’instar d’un Emmanuel Todd, un discours dont le «déterminisme fou» fait des bourreaux assumés de pauvres victimes ingénues.
Mais l’idée principale qui structure cet essai, c’est que, selon M. Macé-Scaron, obscurantisme et religions sont des alliés objectifs. Les trois « religions du livre », comme l’auteur appelle le judaïsme, le christianisme et l’islam, créeraient le désordre, le désarroi et la peur pour apporter, dans le même temps, ordre, consolation et paix. Elles fomenteraient, ainsi, les conditions pour se rendre indispensables. « Les religions sont comme les lucioles, elles ont besoin de la nuit pour briller » rappelle Joseph Macé-Scaron en citant Schopenhauer.
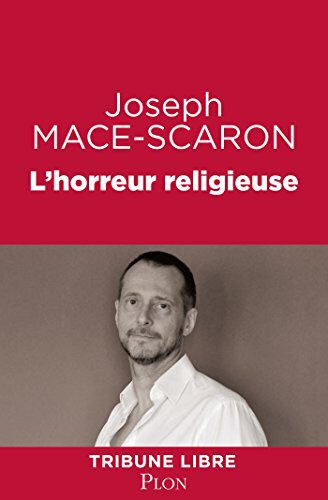
Combles de l’hypocrisie selon l’auteur, les religieux parent leurs discours des apparences de la raison. Ils ont la maîtrise des textes sacré et, au nom d’un principe pseudo-scientifique, « sola scriptura », imposent leur interprétation littéraliste et fondamentaliste aux masses crédules. L’effondrement du communisme dogmatique de l’après-68 a laissé la place aux « idéocraties » (Raymond Aron), déguisements par lesquels les religions ont su imposer, à nouveau, leur « totalitarisme réussi ». Leur système de pensée, qui se présente comme « réel », tente de donner une explication à tout – même à la souffrance qu’il orne des oripeaux de la vertu.
Face à cette déferlante religieuse, l’auteur appelle à résister au nom d’une nouvelle fierté : le « droit à l’irréligion ». Cela ne se fera pas sans payer le prix d’un renforcement de l’esprit critique « quitte à douter de tout » et de l’aveu que, tant que les religions renverront l’image d’un Dieu « démiurge, aussi jaloux et sadique que l’enfant qui arrache les ailes de l’insecte qu’il a emprisonné », tout homme sera un apostat en puissance.
Joseph Macé-Scaron élargit la critique « essentialiste » du phénomène religieux à toutes les religions. Au nom de quoi l’auteur se permet, il faut bien le dire, des généralités qui sont des approximations et des anachronismes que n’édulcore pas un style soutenu, agréable et coloré. En dénonçant l’horreur religieuse, il oublie les liens étroits entre religion et société civile, entre réflexion théologique et progrès des sciences qui ne sont pas toujours opposées. Entre, enfin, éthique et morale pratique. Mais, ce qu’a compris Joseph Macé-Scaron c’est que le combat antireligieux ne se fera plus, désormais, sur le terrain de la raison mais sur celui des passions et par cet essai il en montre le chemin.
« Crédit photo Flickr: Erstwhile. Human »












Aucun commentaire.