Moïse, Rousseau et Freud
28 février 2013
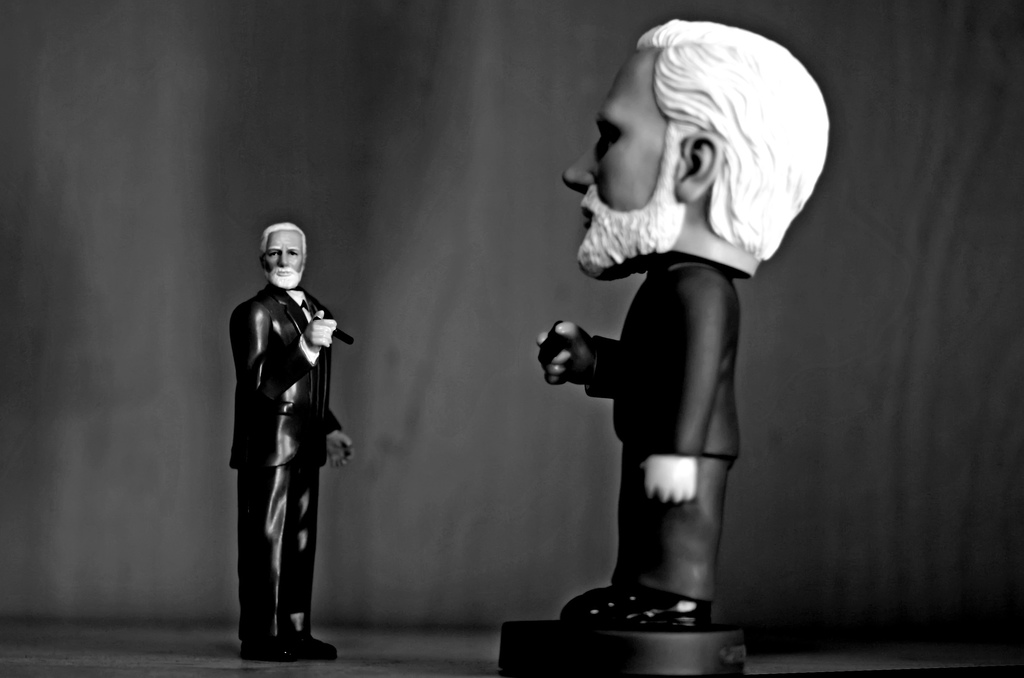 Moïse, Rousseau et Freud
Moïse, Rousseau et Freud
Bruno Karsenti, Moïse et l’idée de peuple, La vérité historique selon Freud, Cerf, coll. Passages, 2012
A travers la notion rousseauiste de contrat social, Bruno Karsenti, professeur de sociologie et de philosophie à l’EHESS, tente de comprendre comment se construit l’identité d’un peuple. Il s’appuie pour ce faire sur les trois essais de Freud rédigés entre 1938 et 1939 sur « Moïse et le monothéisme », où le psychanalyste s’interrogeait sur le succès du monothéisme juif et son étonnante durée.
Pour remonter aux sources de l’identité d’un peuple, Bruno Karsenti utilise une démarche originale, s’appuyant sur Rousseau et sur Freud. Selon l’auteur, chaque peuple trouve son origine dans un contrat social librement posé. Pour comprendre les conditions et les fondements de ce contrat, Bruno Karsenti s’appuie sur la notion de « vérité historique » définie par Freud comme la rencontre entre des vérités matérielles, des faits, et une vérité racontée, un récit sur les origines. Selon Karsenti, cette vérité historique éclairerait l’esprit dans lequel « l’acte par lequel un peuple est un peuple » est posé.
A l’origine de toute religion : le meurtre du Père
Selon Freud, à l’origine de l’humanité, tout groupement humain était constitué en horde primitive, sous l’autorité d’un chef absolu se réservant l’accès aux femmes. Le meurtre de ce « Père originaire » par les autres membres souhaitant eux aussi accéder aux femmes est selon Freud à la source de toute religion.
La culpabilité engendrée par la mort du Père entraînerait une recherche de réconciliation symbolique : dans les rites religieux, les descendants reproduisent le meurtre fondateur tout en cherchant à s’incorporer par « dévoration » la victime, figure divine symbolisant le Père assassiné.
Déni du meurtre de Moïse
Freud se penche en particulier sur l’exemple du peuple juif.
Le meurtre original est celui de Moïse, perpétré dans le désert par les sémites qu’il avait choisis pour être leur guide. Cependant, les circonstances de ce meurtre sont tellement traumatiques que les parricides en refouleront le souvenir jusqu’à en oublier l’enseignement de Moïse : rencontrant des tribus madianites dans le désert, les « proto-juifs » en acceptent le Dieu et les prêtres qui y sont rattachés.
Mais ce n’est pas la fin du culte rattaché à Moïse : ses plus proches compagnons, les lévites, conserveront clandestinement son message comme un « trésor ».
C’est ainsi que deux traditions juives se développent. La première, écrite, repose sur la dénégation du meurtre du Père originaire. La seconde, orale et secrète, est celle des lévites, qui vont jouer sur la culpabilité du meurtre pour faire triompher la figure « idéelle » de Moïse, élevé au rang de « grand homme ».
Le refus de l’incorporation malgré le meurtre: un « caractère » juif
Cette naissance complexe du judaïsme en fera une religion unique aux yeux de Freud.
A l’inverse des autres peuples qui, symboliquement, essaient de s’incorporer celui qu’ils ont tué, comme le psychanalyste l’explique dans Totem et Tabou (1909), les juifs ne « s’incorporent » pas Moïse.
Car Moïse n’est pas, pour les juifs, un « Père originaire » mais seulement un grand homme. Le Père des origines est appréhendé par déduction, à partir du message de Moïse, sous les traits d’un dieu désincarné dont il est interdit de prononcer le nom.
Fermant la voie au retour du sensible qu’aurait permis la « dévoration » de la victime, les juifs vont aller vers une pure abstraction marquée par une succession infinie de renonciations pulsionnelles.
Le psychanalyste y verra le triomphe de la spiritualité et un trait de « caractère » propre au peuple juif.
Une recherche de satisfaction propre au peuple juif
Selon Freud, ce caractère propre satisfait la fierté du peuple juif à plusieurs niveaux.
Un premier motif de satisfaction s’explique par le sentiment d’être élu. Ayant été choisis par Moïse, les juifs l’ont choisi en retour. C’est d’ailleurs ce qui rend la dénégation du meurtre si importante : reconnaître le crime de Moïse, c’est perdre l’élection.
La deuxième satisfaction vient de la tradition entretenue par les prêtres lévites, la loi et les prophètes. L’image idéale qu’ils ont construite de Moïse et de dieu confronte les juifs à un horizon auquel ils ne peuvent accéder. Si cela avive leur culpabilité, l’exigence qui leur est ainsi imposée est également motif de fierté.
Par ailleurs, les juifs ont été élus par un dieu d’autant plus grand qu’il est abstrait et unique. Cette grandeur divine donne aux juifs le sentiment d’être protégés. Ils n’attendent pas de rétribution pour les renonciations pulsionnelles auxquelles ils consentent mais tirent leur satisfaction du fait d’avoir été élu par un dieu ineffable.
Ainsi, la foi des juifs est selon Karsenti fondée sur un « parti pris pour l’idée » : la foi dans leur élection les enorgueillit au point de prouver au reste du monde qu’on peut aimer une idée au risque de choisir une ascèse sans cesse plus rigoureuse, contrepartie d’une « culpabilité insatiable ».
Retour au sensible et élection: le paradoxe occidental
L’auteur constate que la civilisation occidentale a hérité de cette exigence juive non-sensible, matrice d’une culture qui cherche sans cesse à se démarquer de la nature au nom d’un absolu. Ainsi du christianisme.
Néanmoins, Karsenti explique, reprenant l’analyse de Freud, que le christianisme inventé par Saint Paul a permis en partie le retour du sensible. En effet, à travers la Cène, la victime sacrifiée en expiation du meurtre du Père des origines, Jésus, se voit de nouveau incorporée.
L’antisémitisme serait la conséquence de chrétiens « mal baptisés » rejetant leur commune identité avec les juifs. Dévoyé, le retour au sensible chrétien entrerait en lutte avec la préférence juive pour l’idée et les renonciations pulsionnelles culpabilisantes qui en découlent.
Identité et liberté quels rapports?
Au terme de l’ouvrage, le lecteur est partagé. La richesse des connaissances, l’originalité de la démarche rendent la réflexion de l’auteur particulièrement stimulante.
Pour autant, on peut s’étonner que Bruno Karsenti recherche les fondements politiques d’un peuple dans un ouvrage où Freud tentait avant tout de comprendre le phénomène religieux.
D’autre part, en mobilisant simultanément le contrat social rousseauiste et la psychanalyse, l’auteur s’expose à la contradiction. En effet, Freud, se limite à l’étude des causes pulsionnelles des phénomènes humains : sa démarche est résolument déterministe. Or, la référence à Rousseau exclut quant à toute vision déterministe : la formation d’un peuple est un acte libre qui, par définition, n’a pas de cause.
François de Laboulaye
Crédit photo : Flickr, One From RM












Aucun commentaire.