« Nos ancêtres les Gaulois… »
19 mars 2012
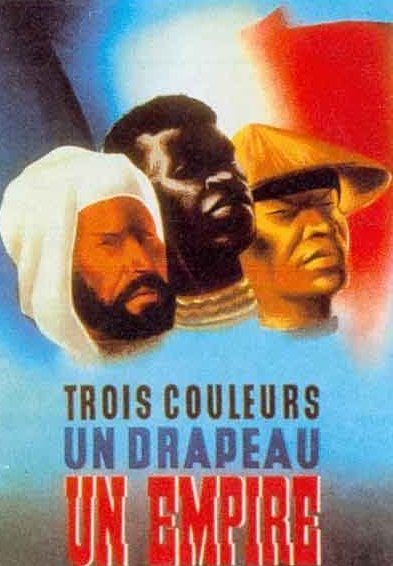 Pierre Singaravélou, Professer l’Empire, Les « sciences coloniales » en France sous la IIIe République, Paris, Publications de la Sorbonne, 2011, 410p.
Pierre Singaravélou, Professer l’Empire, Les « sciences coloniales » en France sous la IIIe République, Paris, Publications de la Sorbonne, 2011, 410p.
Apologie du métier d’historien
C’est entendu, la colonisation et son histoire sont devenues des sujets polémiques, matière à débats parfois plus mémoriels et politiques que scientifiques. Le premier mérite de Pierre Singaravélou est sans doute de faire la démonstration que l’on peut – que l’on doit? – réussir un ouvrage d’histoire qui ne tombe pas dans ces écueils. « Sans colère ni parti pris », comme Tacite se plaisait à définir le travail d’historien…
De colonisation, il n’est d’ailleurs jamais directement question dans cet ouvrage, qui ne satisfera sans doute pas les attentes de l’historiographie traditionnelle de l’impérialisme européen. L’auteur se désintéresse de l’administration ou de la conquête coloniale au profit d’une étude de l’élaboration progressive de ce qu’on a appelé les sciences coloniales. Le sujet est mal connu, notamment en France où les Post Colonial ou subaltern studies anglo-saxonnes qui s’y consacrent n’ont pas eu de pendant véritablement constitué. Pourtant, cet ouvrage révèle l’ampleur abyssale de cet objet de recherche, rappelée avec autorité par Christophe Charles dès la préface.
Histoire de l’Empire, histoire de France?
Quel est alors l’enjeu de Professer l’Empire? Une double ambition semble animer l’ensemble du livre. Le souci d’intégrer l’histoire coloniale à l’histoire de France d’une façon aussi inédite que convaincante ; et la démonstration de l’implication des institutions et acteurs de l’enseignement supérieur dans une histoire sociale et politique qui rechigne souvent à les étudier.
Pierre Singaravélou ouvre ainsi une page originale de l’histoire de France. Original, il l’est encore dans sa capacité à convoquer une pluralité de disciplines, de méthodes voire de sources souvent impressionante. Si certains supposaient les historiens trop imperméables aux autres disciplines [1], il leur rappelle l’histoire de l’interdisciplinarité en même temps qu’il s’en fait le héraut. L’analyse sociologique y a la part belle, et l’auteur nous convie à une chronique fouillée, aux accents parfois bourdieusiens, de l’université républicaine. L’étude des discours liés aux sciences coloniales indique en creux le legs laissé par Foucault et sa démarche historique sur l’idéologie, les discours d’Etat.
Les humanités de la colonisation
Les analyses des « sciences coloniales » livrent un nouveau regard sur l’enseignement supérieur républicain, qui semble vouloir méconnaître, aujourd’hui encore, ce qu’il doit à la colonisation [2]. On est surpris de découvrir des grandes écoles disparues (la « Colo »), des disciplines oubliées (la psychologie coloniale). On s’étonne plus encore à voir le rôle qu’elles jouent dans des biographies toujours actuelles ou du moins bien connues, telles celles de Pierre Messmer, étudiant à « Colo » avant de devenir premier ministre de Pompidou ; ou de Marcel Mauss, « père de l’ethnologie française » qui dût certainement son poste au Collège de France à ses réseaux coloniaux.
L’auteur excelle en outre à analyser les liens cultivés par les dizaines d’universitaires qu’il étudie avec le gouvernement et l’administration coloniales. Il met ainsi au jour une figure « exotique » dans l’histoire des intellectuels, si florissante depuis le travail de Pascal Ory et Jean-François Sirinelli [3]. En effet, le savant « colonial » se caractérise par une union étroite entre compétences pratiques et savoirs théoriques. Singaravélou rappelle d’ailleurs que « Colo » fut la seule véritable Grande Ecole voule par l’Etat républicain entre la fin du XVIIIe siècle et la création de l’ENA.
Cette figure du savant interroge avec justesse l’histoire des rapports entre savoir et pouvoir, dans leur dimension aussi bien institutionnelle que sociale. Car Professer l’Empire met en relief la création de réseaux dirigeant l’évolution de la pensée comme de la pratique coloniale, et montre leur dépendance mutuelle. Quand les sciences coloniales entrent en crise, dans les années 1930, c’est tout l’Empire et le colonialisme qui sont remis en cause.
Sciences coloniales ou colonialisme scientifique
S’il n’est dans cet ouvrage pas immédiatement question de colonisation, on est en droit de supposer que l’auteur cherche à apporter sa pierre à notre compréhension historique de l’impérialisme et du sentiment colonial en France. Ce constat n’est jamais plus clair que dans l’étude de la crise de l’ « enseignement supérieur colonial » des années 1930. Cette crise, autant disciplinaire qu’économique, est celle d’un enseignement déprécié, aux débouchés professionnels réduits et aux financements trop restreints. Le talent de Pierre Singaravélou est de faire la démonstration d’une simultanéité de cette crise avec celle que traverse l’Empire, qui commence à voir sa légitimité autrefois indiscutable écornée. La rentabilité économique autant que le bien-fondé éthique des colonies commence à être interrogés.
Pierre Tenne
[1] Détienne, Marcel, Comparer l’incomparable, Paris, Points essais, 2000, 190p.
[2] L’auteur témoigne ainsi de sa surprise à voir que la plupart des archivistes des grandes écoles ignoraient tout simplement les fonds coloniaux qu’ils possèdent.
[3] Ory, Pascal, Sirinelli, Jean-François, Les intellectuels en France de l’Affaire Dreyfus à nos jours, rééd. Paris, Armand Colin, 2002.












Aucun commentaire.