« Qu’est-il arrivé à la “Great Society ? » Réflexions sur l’avenir de l’Etat et de la politique
Fondapol | 19 juin 2014
 « Qu’est-il arrivé à la “Great Society ? » Réflexions sur l’avenir de l’Etat et de la politique
« Qu’est-il arrivé à la “Great Society ? » Réflexions sur l’avenir de l’Etat et de la politique
Tribune publiée dans le Financial Times, le 22 mai 2014.
Par John Micklethwait et Adrian Wooldridge
Il y a cinquante ans, Lyndon Johnson présentait son programme politique intitulé « Great Society ». Un projet selon lequel plus aucun enfant ne souffrirait de malnutrition et tous les jeunes seraient scolarisés; une société dans laquelle le racisme et l’injustice seraient combattues; et surtout, une société dans laquelle l’Etat serait en mesure de rendre la justice et d’offrir à tous des opportunités.
En général, la plupart des anniversaires passent inaperçus, et à juste titre. Celui-ci relève pourtant de la plus haute importance. L’ère de la « Great Society » est sans doute l’ultime marque de confiance des citoyens américains dans la capacité du gouvernement à améliorer leur vie quotidienne. L’élection de 1964 a opposé Lyndon Johnson à Barry Goldwater, partisan acharné d’un État minimal. Johnson a remporté une victoire écrasante…
Les années 1960 constituent également l’apogée de l’État providence européen qui avait d’abord été pensé par les membres de la Fabian Society, tels que Béatrice et Sidney Webb. Dans un premier temps, leurs idées n’avaient pas réussi à s’implanter sur le continent américain. Mais après la Grande Dépression et le succès collectiviste de la Seconde Guerre mondiale, le modèle de l’Etat planificateur était finalement devenu « à la mode ». La « Great Society » de Johnson était en réalité la version démocrate de la « Nouvelle Jérusalem », fondée par le parti travailliste britannique. L’expression même « Great Society » a été empruntée à Graham Wallas, un authentique « Fabian » britannique.
Aujourd’hui la politique américaine se trouve dans une impasse et le «grand libéralisme[1] de gouvernement » de Johnson a perdu de son influence. Dès les années 1970, lorsque la « Great Society » a commencé à perdre ses «guerres» contre la pauvreté, la criminalité et les inégalités (et le Vietnam du Nord), les électeurs américains se sont tournés vers des conservateurs tels que Ronald Reagan, qui présentait l’Etat comme la source du problème et non comme la solution; et des démocrates comme Bill Clinton, qui proclamait la disparition du « Big Government ». Aujourd’hui, seul un Américain sur dix déclare faire confiance aux responsables politiques, contre 60 % à l’époque de Lyndon Johnson.
Dans les faits, cependant, le « Big Government » demeure la pratique routinière de l’administration américaine. Bon nombre de programmes issus de la « Great Society », de l’assurance-maladie (Medicare) au National Endowment for the Arts, subsistent à l’heure actuelle. L’Etat a continué de croître, renforcé tour à tour par les républicains et les démocrates : George W. Bush a augmenté les dépenses publiques plus que n’importe quel autre président. Dans le même temps, les réglementations n’ont cessé de s’alourdir. Même Webb, le fils d’un coiffeur, aurait été surpris de constater qu’en Californie, sa mère aurait dû passer un an à étudier l’art de la coupe et du brushing pour acquérir une licence d’exploitation.
Aujourd’hui, l’Europe se trouve dans la même impasse – peut-être même davantage. Peu d’électeurs continuent de penser que les solutions viendront de leurs responsables politiques. Pourtant, l’Europe jouit encore d’un Etat providence particulièrement imposant : comme le rappelle la chancelière allemande Angela Merkel, l’Union européenne représente 7 % de la population mondiale, 35 % du PIB mondial et 50 % des dépenses sociales de la planète. Aujourd’hui, il s’agit moins de célébrer l’anniversaire de la « Great Society » que de réfléchir à l’avenir de l’Etat-Providence occidental. Il a été conçu pour une ère industrielle, quand les gens pensaient que la gestion scientifique par des experts et les économies d’échelle – semblables à celles des usines d’Henry Ford – pourraient réellement offrir égalité et justice. Désormais, il apparait obsolète.
La plupart des expériences innovantes en termes de gouvernance ont lieu bien loin de Washington: à Singapour, qui offre de bien meilleurs services publics à un moindre coût ; au Brésil, avec sa prise en charge « conditionnelle » des frais de santé, en fonction du comportement de l’usager; en Scandinavie, où les «socialistes» sont parvenus à réduire les dépenses de l’État (à 49% du PIB en 2013 contre 67% en 1993), à introduire des chèques scolaires et à relever l’âge de départ à la retraite. Aux États-Unis, les nouvelles dynamiques de gouvernance se trouvent dans les villes, où des maires pragmatiques expérimentent, en utilisant les nouvelles technologies.
Quel modèle pour remplacer la Great Society ? Pour les républicains, la réponse est simple : il suffit de réduire l’Etat. Mais cette solution instinctive se heurte à deux problèmes majeurs. Leur hypothèse selon laquelle l’Etat serait mauvais par nature implique qu’ils ne le prennent jamais au sérieux (Singapour dispose d’un petit Etat, mais paie ses meilleurs fonctionnaires 2 millions de dollars par an). Et, dans les faits, les conservateurs américains n’arrivent pas à se détacher d’un Etat fort : d’où le $ 1,3tn de dollars de niches fiscales dans le code des impôts des États-Unis, dont la plupart profitent essentiellement aux riches.
Pour les démocrates, le problème est encore pire. Ayant pris l’habitude de promettre toujours plus de droits à leurs électeurs, ils font face à une série de choix cornéliens : soit servir la société dans son ensemble (en améliorant les écoles), soit protéger les syndicats du secteur public (notamment les enseignants qui représentent une grande partie de leurs militants); et soit encore offrir des prestations universelles moins généreuses, soit orienter les dépenses en direction des personnes défavorisées.
C’est au travers de ces choix que la politique s’exprimera à l’avenir, des deux côtés de l’Atlantique. Ce ne sera pas aussi stimulant que les principes de la « Great Society ». Il s’agira principalement d’amincir et de moderniser l’administration, en adaptant les pensions à l’espérance de vie et en intégrant la technologie dans le secteur public.
Face à ce défi, les Etats-Unis – et l’Europe – doivent faire preuve de sang-froid et de pragmatisme. L’Etat n’est ni un monstre ni un sauveur, mais un élément indispensable d’une société digne qui, comme la plupart des organisations, fonctionne mieux lorsqu’il se concentre sur les points essentiels.
John Micklethwait et Adrian Wooldridge sont respectivement rédacteur en chef et chroniqueur Schumpeter au magazine The Economist. Ils viennent de publier «La quatrième révolution ».
Traduit de l’anglais par Mathieu Lyoen
© The Financial Times Limited 2014. All Rights Reserved.
Crédit photo : University of Houston
[1] Pour rappel, on notera qu’aux Etats-Unis, le « liberalism » fait référence à une sensibilité marquée à « gauche », différente de sons sens européen.


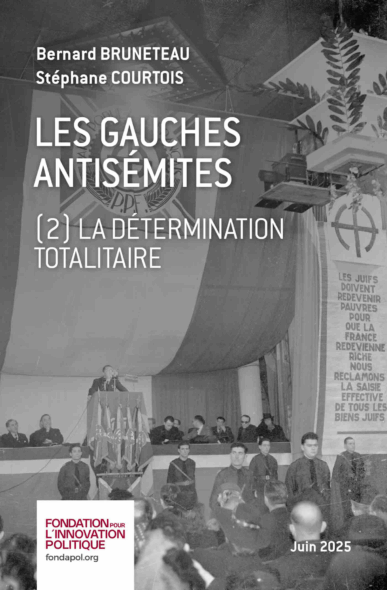
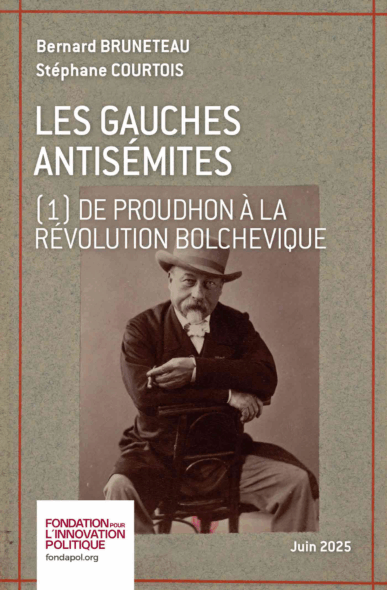


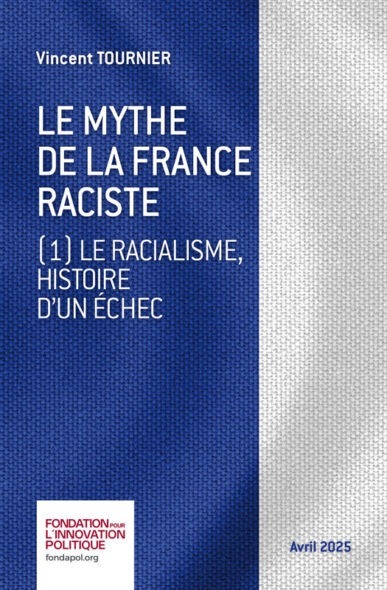





Aucun commentaire.