Réponse de Blandine Kriegel à l’article que Trop Libre a consacré à son dernier ouvrage
20 janvier 2012
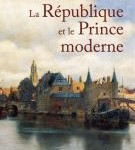 Suite à notre article du 28 décembre 2011, « Une histoire pavée de bonnes intentions », qui est une recension de l’ouvrage La République et le Prince moderne, son auteur, Blandine Kriegel nous a demandé de publier un droit de réponse. La rédaction du blog « trop libre » tient à signaler que les auteurs de ce papier sont Jean Senié, étudiant en histoire, et Christophe de Voogd, professeur à Sciences Po Paris, spécialiste des Pays-Bas.
Suite à notre article du 28 décembre 2011, « Une histoire pavée de bonnes intentions », qui est une recension de l’ouvrage La République et le Prince moderne, son auteur, Blandine Kriegel nous a demandé de publier un droit de réponse. La rédaction du blog « trop libre » tient à signaler que les auteurs de ce papier sont Jean Senié, étudiant en histoire, et Christophe de Voogd, professeur à Sciences Po Paris, spécialiste des Pays-Bas.
C’est avec une indignation et une consternation sans pareil que j’ai pris connaissance du « compte-rendu » de mon livre, La République et le Prince Moderne, publié dans le blog de la Fondapol.
Il cumule des attaques aussi basses que mal ajustées où l’approximation et l’incompréhension n’ont d’égale que l’incompétence. Très courageusement, comme cela s’est beaucoup fait entre juin 1940 et aout 1944, l’auteur a choisi l’anonymat d’un pseudonyme. Bien que, d’une manière générale, je ne réponde pas aux lettres anonymes, je me fais ici un devoir de vous prier de porter à la connaissance des lecteurs de la Fondation dont je fais partie, les rectifications qui s’imposent et vous serais très reconnaissante de bien vouloir publier ma lettre.
Passons sur la présentation surtitrée : « Une histoire pavée de bonnes intentions », « un sujet pas si neuf », dont l’intention non déguisée est de déconsidérer l’ouvrage dont plusieurs compte-rendus ont souligné la nouveauté, pour commencer par le fond : Le résumé aussi étroit que décalé, de ce que le courageux anonyme appelle « ma thèse » : « à l’occasion de la guerre entre l’Espagne et les Etats des « Pays de par-deça…un certain nombre de textes publiés par des juristes ou historiens français font émerger une nouvelle idée de la république, allant de pair avec l’idée du « Prince moderne…dont le contre-exemple est Philippe II d’Espagne » écrit-il.
La réflexion – et non la thèse qui n’était nullement écrite d’avance – que je tire de ma recherche est toute autre : elle s’inscrit dans l’étude de la généalogie de la république moderne, (où l’historiographie anglo-saxonne a pris une avance incontestable sur les études françaises, et avec laquelle je dialogue) pour établir le caractère européen de la naissance de la première république d’Etat, la République des Provinces-unies que je considère comme la première république moderne. Celle-ci est née d’un effort collectif où les Etats modernes, tels la France et l’Angleterre, ont joué un rôle décisif. Cette première république d’Etat a pu vaincre l’empire de Philippe II – dont je ne fais nullement le contre-exemple du Prince moderne – grâce à l’articulation de deux traditions différentes, celle des républiques de cité et celle du droit politique de la souveraineté. C’est dans l’articulation de ces deux traditions que des penseurs français ont joué un rôle décisif.
Si le rédacteur anonyme avait prit le soin de lire le chapitre développé que je consacre à la politique européenne ainsi que ma conclusion, sans se borner à la seule lecture de mon introduction, il ne pourrait pas écrire qu’il n’est ici question de l’Europe que, comme « un simple prolongement des idées, des projets et des désirs français ». Il ne pourrait pas davantage prétendre que le livre de Catherine Secretan, consacré à la seule histoire des Provinces-Unies et que je salue par ailleurs, avait traité, avant moi, le même sujet. Il ne me reprocherait pas enfin ce qu’il appelle mon « gallocentrisme ».
Ici, une deuxième incompréhension majeure se fait jour. Je m’estime très honorée du rapprochement qui est fait de mon travail avec celui de Michelet et si notre auteur avait quelques lectures, il pourrait également invoquer Edgard Quinet ou Waddington, que je cite plusieurs fois. Il ne s’étonnerait pas que, contrairement à lui, je ne considère pas qu’Hubert Languet soit seulement « un Dijonnais » (sic), ou Philippe de Marnix, « un Bruxellois » (re sic), puisque depuis longtemps, Edgard Quinet et Henri Pirenne ont montré que ce dernier appartenait à la Grande France et il prendrait toute la mesure de la découverte que je présente, à savoir l’importance dans « l’arrière-conseil » du Prince d’Orange, des théoriciens français dont évidemment le Prince d’Orange n’était pas seulement le bon élève… La place des Français ? Pourquoi demande t-il dit : « insister sur le caractère français de cet apport théorique ? » Et bien, Monsieur l’anonyme, d’abord tout simplement parce que cette place existe….
Parfaitement, des Français (Dumoulin, Baudoin, Languet, Duplessis-Mornay, Bodin, et alii,), excusez du peu, on bien joué un rôle décisif dans l’Insurrection des Flandres, intellectuellement et politiquement. Est-il si honteux de découvrir – oui c’est bien une nouveauté – et de ressusciter ce rôle s’ils l’ont effectivement rempli ? Cela ne l’est que pour ceux qui veulent laisser dormir la généalogie de la république moderne dans l’oubli et qui estime qu’ont ne peut saluer l’oeuvre des Français que si l’on est souverainiste et anti-européen… Si j’invite mon contradicteur non pas à relire, comme il l’explique avec suffisance, mais tout simplement à lire – ce serait déjà beaucoup – Hubert Languet, Philippe Duplessis-Mornay, François Baudoin, François Hotman, c’est précisément parce que, dans le cadre du concours qu’ils ont apporté à l’Insurrection hollandaise, ils ont posé les fondements du droit politique moderne qui a essaimé dans toute l’Europe.
N’est-il pas intéressant de constater que successivement, les Allemands avec Goethe et Schiller, à la fin du XVIIIe siècle, lorsque le problème de l’unité d’une Allemagne républicaine a été reposé, les Italiens au moment du Risorgimento, comme Verdi, et aujourd’hui le réalisateur Lech Majewski, un Polonais qui consacre son film à Bruegel, se tournent vers la naissance de la république des Provinces-Unies ?
Un autre reproche absurde consiste à souligner que je n’ai pas fait le point de tous les travaux néerlandophones sur l’histoire des Pays-Bas. Absurde parce que d’emblée, j’ai souligné que telle n’était pas mon intention et que mon ouvrage ne visait nullement à innover dans l’historiographie des Pays-Bas, puisqu’il s’agissait précisément d’une généalogie de la république moderne, et non de l’histoire locale des Pays-Bas. Ce projet ne m’a d’ailleurs empêché d’en prendre connaissance et d’essayer de restituer les résultats pour le public français qui ne la connait nullement.
Après le fond, le détail.
Le compte-rendu prétend me donner la leçon sur des erreurs et des confusions que j’aurais commises. S’il s’agit des coquilles, ma liste est – hélas ! – plus complète que les quelques-unes qui sont citées et qui, à l’évidence, seront rectifiées dans la seconde édition du livre. Mais ici, pour fustiger mes « coquilles », « Pertinax » prend deux exemples bien malheureux. Le premier : « un Pierre de l’Estoile, indument devenu précurseur de François Hotman ». Je n’ai rien écrit de tel mais simplement rappelé : « qu’Hotman a étudié le droit à l’université d’Orléans où dominent encore les conceptions de Bartole et de Balde, mais déjà transformées par l’humanisme juridique d’un Pierre de l’Estoile ». Arroseur arrosé par son ignorance de l’histoire du droit, mon critique ignore-t-il que je ne parle pas de l’auteur bien connu du journal chronique des règnes d’Henri III, Henry IV et Louis XIII qui commence en 1585, mais de son grand-père homonyme qui impressionna Calvin ?
Une autre « coquille », ou erreur, qui m’est encore reprochée me laisse sans voix : il s’agit de l’expression que j’ai utilisée pour présenter Guillaume d’Orange : « un Kennedy qui serait devenu de Gaulle avant d’être assassiné ». « Comparaison n’est pas raison », explique pesamment le sieur Pertinax, mais Monsieur l’Anonyme, je ne fais aucune comparaison, elle serait évidemment absurde ! On pourrait à loisir me rétorquer que de Gaulle est né avant Kennedy, que les exemples du XXe siècle ne sont pas ceux du XVIe siècle, etc, etc… J’utilise simplement une métaphore, oui une métaphore, pour faire comprendre au public du XXe siècle, quel type de personnage a été et est devenu Guillaume d’Orange. En France, « au séminaire », remarquait Stendhal, « tout bon raisonnement offense », mais apparemment, pour un esprit comme celui-là, toute métaphore aussi…
Laissant ensuite entendre que j’ignore le b-a-ba, de l’histoire politique du XVIe siècle, Monsieur Pertinax m’attribue ensuite deux erreurs où il donne des verges pour se faire fouetter. Ainsi me reproche-t-il avec hauteur, la confusion que j’aurais faite entre deux famille politiques de la France, « les Moyenneurs – un titre inventé par Mario Turchetti – rappelle-t-il, – qui agirent en 1561 – et les Politiques qui n’intervinrent que dans la décennie suivante ». Comme exemple des Moyenneurs, il donne notamment François Baudoin ! Je persiste et je signe : du point de vue qui est le mien, c’est-à-dire de l’aide des Français à l’Insurrection des Pays-Bas et non de l’histoire des partis politiques en France, Moyenneurs et Politiques ont bien agi dans le même sens, sinon en même temps, et l’action de François Baudoin, l’un des premiers à avoir pris partie pour la révolte des Flandres, est là pour le montrer.
La seconde confusion, qui m’est en vérité reprochée sérieusement sur le fond, mais ici comme ne passant, est de ne pas prendre partie pour les Guise (qu’au demeurant je cite assez peu) et de faire valoir une histoire qui n’est pas celle de la Maison de Lorraine ou du Parti de la Ligue. C’est là que gît le lièvre. Bien entendu, dans mon intérêt pour les Français qui ont pris parti pour la révolte des Flandres, c’est la France oubliée des grands théoriciens et érudits humanistes, protestants et politiques, qui resurgit… Je veux bien admettre que cela ne plaise pas à tout le monde. Mais il est piquant et, somme toute réjouissant, d’être accusée de gallocentrisme quand on montre ce visage là de la France…
Pour conclure, notre courageux anonyme esquisse de ses voeux ce que serait la véritable histoire du sujet que j’ai défriché. « Une réflexion – dit-il – qui ferait toute sa part au caractère déterminant des considérations religieuses dans ces nouvelles théories politiques ». Précisément, je ne fais que cela, montrer depuis trente ans, que nos penseurs réécrivent le droit politique moderne en partant des Ecritures. En critiquant notamment la notion de monarchie sacrée et le droit romain impérial et en utilisant les Ecritures, des penseurs français – ne vous en déplaise – ont bien donné un caractère déterminant aux considérations religieuses en lieu et place du droit romain impérial, et par là, ouvert la voie à l’Ecole du droit de la nature et des gens, comme je l’explique avec mes collègues anglo-saxons depuis trois décennies.
Notre auteur regrette aussi, que j’oublie « l’appartenance de la plupart de ces figures non à la France, mais à un ensemble médio-européen allant de Genève à Leyde, dont la réalité politique et surtout intellectuelle semble m’échapper ».
Elle m’échappe d’autant moins que je me suis appliquée, après Frances Yates et Beatrice Nicollier de Weck, à mettre en évidence l’existence d’une république des Lettres en formation à l’échelle de toute l’Europe. J’ai ajouté, et cela invite une fois encore à mieux qu’un règlement de compte expéditif mais à une discussion sérieuse, que cet ensemble n’est pas seulement celui d’une Internationale Protestante, c’est-à-dire influencée par la seule Réforme ou d’un parti religieux, mais constitue déjà l’esquisse d’une république intellectuelle politique.
Dans cet ouvrage qui aborde des problèmes inédits, je ne prétends nullement avoir tout inventé ni tout expliqué et suis la première consciente de ses limites. Il est possible que la part de réflexion que j’ai développée ici : l’opposition entre république d’Etat et république de cité – la seule chose que le critique anonyme me reconnaisse – soit contestable et contestée, mais pas en se trompant de sujet et de thématique… Car un travail de recherche et d’étude mérite mieux que cette lâche exécution fondée sur un semblant de lecture.
Dans le dialogue que j’ai noué depuis longtemps avec l’historiographie anglo-saxonne, j’ai eu maintes fois l’occasion de saluer la déontologie de ses membres capables de discuter et de s’opposer sans se défigurer. Elle est loin d’un tel compte-rendu, inspiré de l’esprit de certains séminaires (voire une fois encore Stendhal) ou du stalinisme, qui relève de ce que Marx avait appelé la discussion dans la mêlée, car, « dans la mêlée il ne s’agit pas – disait-il – de savoir si l’adversaire a tort ou a raison, il s’agit de l’atteindre ».
Pour m’atteindre, il faudrait que l’anonyme fasse preuve d’un peu d’honneur, en déclinant ses oeuvres et ses titres, et surtout soit capable d’argumenter à partir d’une lecture véritable, en m’opposant des faits plus établis et des concepts mieux réfléchis.
Blandine Kriegel , Professeur émérite des Universités












Aucun commentaire.