« Séparation des pouvoirs » et « indépendance de la justice » : et si on relisait Montesquieu ?
Christophe de Voogd | 17 mars 2014
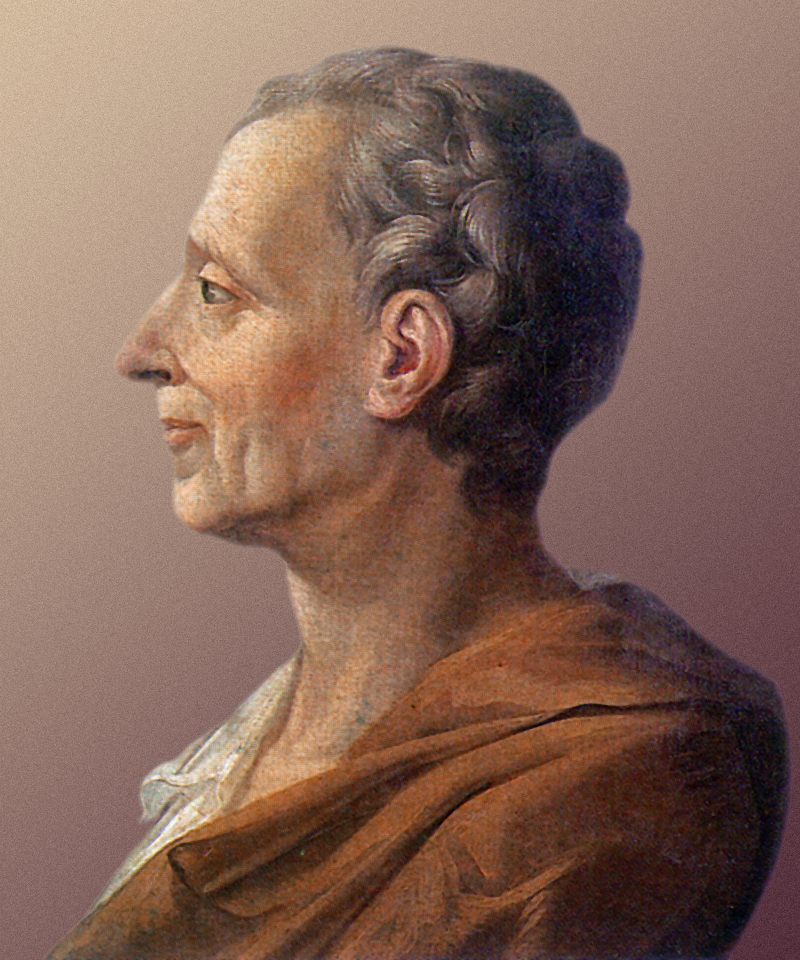 « Séparation des pouvoirs » et « indépendance de la justice » : et si on relisait Montesquieu ?
« Séparation des pouvoirs » et « indépendance de la justice » : et si on relisait Montesquieu ?
« Indépendance de la justice », « séparation des pouvoirs », tels sont les grands mots inlassablement répétés, de part et d’autre, dans le feuilleton à mille rebondissements des « écoutes Sarkozy ». Une invitation à prendre un peu de hauteur et à revisiter la pensée de Montesquieu qui pourrait bien dire le contraire de la vulgate juridico-politique. Et inspirer une nouvelle « distribution des pouvoirs », notamment le judiciaire, dans un pays où, faut-il le rappeler, la justice n’est qu’une « autorité ».
La distribution des pouvoirs contre l’abus de pouvoir
Montesquieu, victime comme tant d’autres grands penseurs, à commencer par Rousseau, de lectures à contresens (ainsi va l’histoire des idées) aurait été sans doute bien marri de se voir consacré comme « le père » de la séparation des pouvoirs et de l’indépendance de la justice. Or il n’emploie jamais cette dernière expression – nous verrons pourquoi – et il n’utilise qu’une seule fois le mot de « séparer » à propos des fameux trois pouvoirs, préférant parler de « division » ou de « distribution », car son propos est clair : il recherche non « le meilleur régime » encore moins la parfaite constitution, mais la limitation non seulement institutionnelle mais effective de tout pouvoir. Et cela pour une raison anthropologique fondamentale : « c’est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ».
De ce point de départ (qui précède, on l’oublie trop souvent, le fameux texte sur la Constitution d’Angleterre) découle plusieurs constats et recommandations qui sont diamétralement opposés à l’organisation de la justice en France et encore plus à nos pratiques judiciaires.
La justice, « un pouvoir si terrible parmi les hommes »
1/ La justice est non seulement un vrai pouvoir mais sans doute le plus redoutable car de lui dépend nos biens, notre liberté et, à l’époque de Montesquieu, notre vie même : c’est bien pourquoi elle est « si terrible parmi les hommes ». Elle doit donc faire l’objet d’une attention toute particulière, comme le fait Montesquieu lui-même en consacrant un livre entier au droit pénal (Livre XII), immédiatement après ses considérations institutionnelles (Livre XI). Dans ces conditions, il faudrait en finir aussi bien avec le rabaissement de la justice en France à une simple autorité (titre VIII de la Constitution) tout comme sa soumission au Chef de l’Etat, marquée par sa présidence (jusqu’en 2008) du Conseil supérieur de la Magistrature et théorisée par le fondateur de la V° République : « Il doit être évidemment entendu que l’autorité indivisible de l’Etat est confiée tout entière au Président par le peuple qui l’a élu, qu’il n’en existe aucune autre, ni ministérielle, ni civile, ni militaire, ni judiciaire qui ne soit conférée et maintenue par lui ». Voilà qui va directement à l’encontre de l’Esprit des lois qui affirme « qu’il n’y a point encore de liberté si la puissance de juger n’est pas séparée de la puissance législative et de l’exécutrice. Si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire: car le juge serait législateur. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d’un oppresseur ».
2/ Montesquieu en tire-t-il une théorie de l’indépendance de la justice comprise comme celle des juges? Nullement. C’est aussi le risque d’un « juge oppresseur » que la séparation des pouvoirs doit prévenir. Tout haut magistrat qu’il fût lui-même – ou plutôt parce qu’il connaissait de l’intérieur un milieu qui, comme tout autre, est naturellement porté à « abuser de son pouvoir » – Montesquieu ne cesse de mettre des gardes fous à la puissance des juges, au profit du justiciable : tribunaux non permanents, jury populaire, droit de récusation des juges par l’accusé.
Car ce que le citoyen doit craindre c’est « la magistrature et non les magistrats » et, en aucun cas, il ne doit pouvoir « se mettre dans l’esprit qu’il soit tombé entre les mains de gens portés à lui faire violence »…
« Pouvoir » et « puissance » : Montesquieu sociologue
3/Comme l’a bien montré une tradition de lecture qui remonte à Auguste Comte et va jusqu’à Raymond Aron et Louis Althusser, Montesquieu raisonne sur le fait du pouvoir, davantage en sociologue qu’en juriste : « Tout serait perdu si le même homme, ou le même corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçaient ces trois pouvoirs ». D’où l’usage fréquent du mot « puissance » (sociale) que Montesquieu utilise à la place de « pouvoir » (institutionnel).
Autrement dit, il aurait condamné la consanguinité des élites, mal français s’il en est, où les trois pouvoirs sont tous tenus par un « même corps du peuple» : les fonctionnaires. Et en matière de justice, il nous met en garde contre la confusion – si complaisamment entretenue en ce moment- entre indépendance de la justice et toute puissance des juges. Ainsi la séparation des ordres judiciaires est sans effet si « ces tribunaux différents sont formés par des magistrats du même corps; ce qui ne fait guère qu’une même puissance ».
Une conclusion analogue peut en être tirée sur le plan politique : s’il advenait que les juges partageaient les mêmes options que le pouvoir politique, une même confusion se produirait et « tout serait perdu ». Imaginons par exemple – exemple purement fictif bien sûr – la situation d’une grande figure de l’opposition poursuivie par des juges qui auraient exprimé publiquement leur hostilité politique à son égard…
« Je fais confiance à la justice de mon pays »
Au passage on comprend que des platitudes comme « je fais confiance à la justice de mon pays » n’ont strictement aucun sens : sans aucun doute, les juges sont compétents et dévoués. Et sans doute, vocation et expertise obligent, davantage que bien d’autres corps professionnels. Mais là n’est pas la question : le vrai enjeu est celui du recours ouvert contre les erreurs judiciaires, car celles-ci sont tout simplement inévitables, et contre les abus de pouvoirs, car ceux-ci sont toujours possibles. Comme le remarque finement et de façon prémonitoire Montesquieu lui-même : « Qui le dirait ! La vertu même a besoin de limite ». Or force est de constater qu’en théorie comme en pratique le recours contre un juge est quasi-impossible en France et dans le meilleur des cas, sans vraie portée : cf. Outreau….
Contrôle réciproque et non séparation rigide
4/ Mais la plus grande leçon à méditer, toujours à partir de son axiome premier sur l’abus de pouvoir est sans doute ailleurs : puisque tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser, « il faut que le pouvoir arrête le pouvoir ». Autrement dit, ce n’est nullement la séparation rigide des pouvoirs que recommande Montesquieu mais leur contrôle réciproque qu’il nomme (en toute cohérence) la « faculté d’empêcher» ou « d’arrêter ». Il faut donc que chaque pouvoir puisse prévenir la dérive des deux autres. Ce sont les fameux « checks and balances » de la constitution américaine : droit de veto présidentiel sur les lois, procédure de l’impeachment et nomination des juges de la cour suprême par l’exécutif sous contrôle du législatif. Les Etats-Unis où les leçons du baron de la Brède ont été bien mieux retenues qu’en France. Autre enseignement de l’histoire des idées : nul n’est prophète en son pays…
Au fait, où en est la réforme du CSM ?
Dès lors, il serait urgent en France que le Président de la République ne soit plus « le garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire » (art. 64) mais de la bonne administration de la justice ! Il serait de même urgent que la nouvelle réforme du Conseil supérieur de la magistrature, reportée comme tant d’autres, voit enfin le jour. Il est curieux que, dans tous les commentaires de ces derniers jours, le sort de cette réforme ait été oublié. Elle devait pourtant être présentée à nouveau au Conseil des Ministres au début de ce mois de mars !
Encore faudrait-il se rappeler, si réforme il y a, les sages recommandations de Montesquieu : éviter d’abord que les magistrats ne soient contrôlés par… les magistrats, comme le voulait le projet initial du gouvernement avec un CSM où ils seraient majoritaires, revenant ainsi sur les dispositions de la réforme constitutionnelle de 2008 et contredisant les préconisations de l’Esprit des Lois. Permettre ensuite aux citoyens un vrai contrôle d’une justice rendue, faut-il le rappeler, en leur nom. Le droit de saisine du CSM par les justiciables instauré par la même réforme de 2008 a été réduit à une coquille vide par la loi organique consécutive.
Serait-il dès lors possible, qu’au-delà de ses invectives contre les magistrats et de la brutalisation d’une corporation qui méritait plus d’égards, la faute impardonnable de Nicolas Sarkozy, en rendant les magistrats minoritaires dans le CSM et en créant le droit de saisine des justiciables, soit d’avoir voulu renforcer le contrôle extérieur d’un « pouvoir si terrible parmi les hommes » ?
Christophe de Voogd

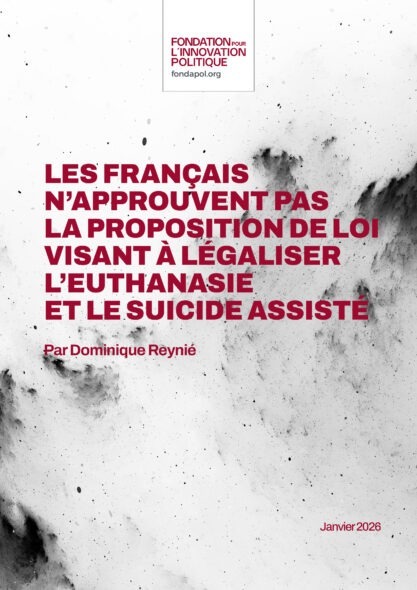










Aucun commentaire.