Sociologie du genre : un genre de sociologie comme les autres ?
Fondapol | 04 octobre 2012
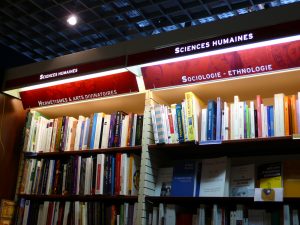 Ouvrage recensé : Isabelle CLAIR, Sociologie du genre, Paris : Armand Colin, collection « 128/Sociologies contemporaines », 2012.
Ouvrage recensé : Isabelle CLAIR, Sociologie du genre, Paris : Armand Colin, collection « 128/Sociologies contemporaines », 2012.
Etude fragmentée du corps social
La sociologie du genre est l’une des manifestations du retournement que n’en finit pas de subir, depuis les années 1960, la vie intellectuelle et politique des démocraties occidentales.
Traditionnellement, une large partie des penseurs de gauche plaçaient au cœur de leur réflexion la « question sociale », y subordonnant ce que les marxistes appelaient la « superstructure », c’est-à-dire tout le reste. En sens inverse, les intellectuels modérés ou conservateurs soulignaient la multiplicité et la complexité de faits sociaux qui ne pouvaient se réduire à la lutte de classes – pensons à Raymond Aron et ses 18 Leçons sur la société industrielle (1962).
Ce clivage s’est inversé. Aujourd’hui, c’est une partie de la gauche qui fragmente l’espace social, au nom d’une lecture progressiste du fait minoritaire (régionalismes et minorités culturelles, luttes sexuelles, féminisme) quand une partie des discours de droite, de nature holiste, s’attachent à la centralité du « peuple » perçu comme oublié. Seuls les libéraux, fidèles à leur paradigme contractuel, continuent à penser le lien social en termes de relations inter-individuelles.
Dans ce retournement historique, la notion de genre fait figure de dernier venu, dans tous les sens du terme.
Une légitimité académique discutable
Comme l’admet dans un passage très rapide l’auteure (p.64), la sociologie du genre reste peu explicative aux yeux d’une partie importante des sciences sociales françaises. En effet, son intérêt pratique reste faible, en comparaison avec d’autres branches de la sociologie (entreprise, consommation, éducation, santé), qui peuvent offrir des outils concrets à l’action publique.
Pour contrer cette objection, Isabelle Clair avance un argument étonnant pour une théorie aux origines contestataires : le succès sémantique et médiatique (le « buzz », diraient les jeunes générations) justifierait la pertinence du genre (pp.7-8). Du seul fait de la présence du genre dans le débat public, des moyens institutionnels devraient ainsi être accordés à son étude au sein de l’université, des centres de recherche et du service public- toute résistance laissant soupçonner un reste de phallocentrisme. Pour parler comme Pierre Bourdieu – d’ailleurs peu épargné dans l’ouvrage, il s’agit là d’un processus de « légitimation circulaire », en vertu duquel l’institution universitaire est sommée d’intégrer, selon des critères pour le moins flous, à la fois un nouveau paradigme et ceux qui la portent.
Le genre, généalogie d’un concept militant
Mais d’où vient le « genre » ? Paradoxalement, il faut attendre les deux tiers de l’ouvrage (p.80) pour connaître l’histoire de ce concept. Né à la fin des années 1960 dans le monde anglo-saxon, la théorie du « gender » vise à séparer le genre (réalité sociale) du sexe (réalité biologique). Sa formulation est issue des tendances les plus radicales du féminisme nord-américain, notamment la littérature Queer, et en particulier lesbienne. Aussi, le caractère militant se double d’un… caractère genré : l’immense majorité des auteurs utilisant le « genre » sont des auteures, issues de la nouvelle gauche des années 1960-1970, et nourries par l’ouvrage fondateur de Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe (1949).
La figure inaugurale de la femme exploitée
Dans les années 1960 et 1970, de manière concomitante, les sciences sociales soulignent que la femme occupe une place marginalisée par rapport à l’homme, y compris au sein des mêmes groupes sociaux. Moins qualifiée, moins bien payée- y compris pour une tâche comparable- la femme doit le plus souvent s’occuper des tâches ménagères dans le cadre du foyer. Son absence de l’ensemble des lieux de pouvoir a à peine été entamée par l’égalité politique et civique, acquise dans la quasi-totalité des démocraties après 1945. Dès lors, la sociologie du travail et la sociologie de la famille se mettent à réfléchir à la question de « l’exploitation féminine », matrice des nouveaux mouvements sociaux des Sixties.
La différence vue comme dépendance
Autre lieu d’émergence, les premières études sexuelles ont rapidement posé la question de la construction par la société des pratiques et des interactions sexuelles. La manière dont femmes et hommes vivaient- de manière différenciée- leur sexualité pouvait être lue selon l’assignation que la société faisait des rôles féminins et masculins en son sein.
Le genre, une discipline à part entière ?
L’auteure souligne les débats et conflits- notamment dans une tradition républicaine universaliste- qu’a entraînés l’émergence de l’étude sociologique du genre. Dans un premier temps, celle-ci a été considérée par certains auteurs- ainsi l’anthropologue Maurice Godelier- comme un instrument utile dans l’appareil méthodologique des sciences sociales.
D’autres penseurs, issus notamment du féminisme, constituent, à partir de 1970, des départements spécifiques (ainsi à l’Université de Provence ou à Paris VIII) d’études féminines. Depuis, les études de genre oscillent entre volonté de reconnaissance et volonté de préserver leur spécificité thématique, voire militante. En 1981-1986, la gauche au pouvoir favorise ainsi l’ouverture de structures de recherche consacrée aux questions féminines et genrées, comme en 1983 au CNRS.
Cette histoire heurtée débouche sur plusieurs paradoxes qui conduisent à s’interroger sur la validité de la sociologie du genre telle qu’elle existe.
D’une part, le terme de « genre » est aujourd’hui victime de son succès, au point d’être devenu un vocable fourre-tout, un mot « Mana », pour reprendre Claude Levi-Strauss- lui aussi plus ou moins suspect de machisme (p.73). Ainsi, dans les statistiques, les colloques et le langage savant, le mot « genre » a supplanté le mot « sexe », qui renvoyait à une connotation physique et crue. L’évolution policée –ou politiquement correcte- du langage explique dès lors le succès du terme plus que son caractère explicatif.
Seconde faiblesse : la sociologie du genre reste ambiguë sur son origine et ses aspects militants, d’autant que les enjeux de carrière ne sont pas absents dans une discipline qui a le vent en poupe.
Enfin, paradoxe suprême, (pp.88-89), la sociologie du genre ignore largement un des genres, le masculin en l’occurrence, quasi-absent de ses études. Or, on pourrait souligner que certaines formes de marginalisation ou de domination (prisons, échec scolaire, délinquance, phénomènes de bandes, accidents du travail…) concernent plutôt le « premier sexe ».
Le genre, symptôme de l’éclatement des sciences sociales
La conclusion de l’ouvrage illustre le retournement historique des sciences sociales décrit plus haut. Si le genre est un angle d’analyse, ses relations avec la classe sociale, l’ethnie ou d’autres critères sont complexes, et conduisent à une fragmentation toujours plus poussée de la compréhension. Ainsi, les sous-genres de l’étude des genres fleurissent, comme l’illustrent le « black feminism » ou l’analyse lesbienne radicale (qui affirme avec Monique Wittig que les « lesbiennes ne sont pas des femmes », p.83). Cette multiplication de champs d’études hybrides conduit à douter de la pertinence d’un paradigme construit exclusivement autour de la question des genres.
Mais ce flou académique est-il si étonnant de la part d’une discipline initialement conçue comme un instrument de subversion et de « dévoilement » d’une société perçue comme irrémédiablement aliénante ?
Victor Haumonté.
crédit photo : Flickr, Somethingintheair












Aucun commentaire.