Une éthique de la liberté
Fondapol | 03 mai 2011
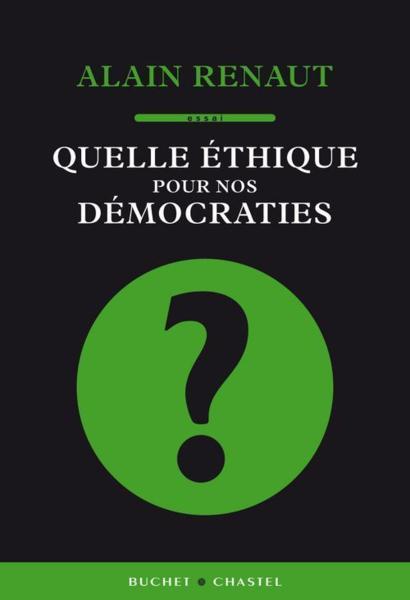 Alain Renaut, Quelle éthique pour nos démocraties ?, Paris, Buchet Chastel, Février 2011, 256 pages, 20 €.
Alain Renaut, Quelle éthique pour nos démocraties ?, Paris, Buchet Chastel, Février 2011, 256 pages, 20 €.
Entendons-nous d’abord sur les mots : de quoi est-il question aujourd’hui quand on parle d’« éthique » ou de « morale » ?
Alain Renaut remarque avec justesse[1] que ces deux termes renvoient à des étymologies analogues. Le substantif grec ethos, à l’origine de notre « éthique », signifie « conduite », là où le latin mores, qui a donné notre « morale », désigne « les mœurs ».
Or, l’éthique est très présente dans le débat public en ce début du XXIe siècle. Le philosophe ne saurait s’en indigner, même si les débats qui accompagnent cette « mode » ne vont pas toujours sans une certaine confusion. Il n’est donc pas superflu de réfléchir à une éthique possible pour nos démocraties ! Le prolifique Alain Renaut s’y consacre dans son dernier livre.
Quelles valeurs communes pour nos sociétés démocratiques ?
La montée en puissance de l’éthique dans nos sociétés est parallèle à celle de la liberté. Cette coïncidence soulève une difficulté sur laquelle Alain Renaut revient longuement dans son avant-propos. Comment ménager en effet en un temps de démocratisation « la possibilité d’accords (…) libres, mais néanm[2]oins assez convergents et consistants pour fournir les conditions de possibilité d’un véritable vivre-ensemble? ».
La religion a longtemps joué ce rôle de socle commun. Mais nous sommes entrés dans « l’âge de la sécularisation[3] » et devons nous résoudre à ce « qu’il n’y a pas de religion d’un peuple libre[4]». Quant à l’État, nous ne l’acceptons plus qu’à condition qu’il soit laïque – neutralité religieuse – mais aussi « moralement neutre[5] ». Dit autrement, cela signifie que nous attendons de lui qu’il renonce à toute prétention dans le choix des valeurs qui orientent la vie des individus.
Entre Charybde (l’universalisme dense) et Scylla (le libéralisme moral)
Alain Renaut dialogue dans les chapitres deux et trois du livre avec les deux positions qui s’affrontent en matière d’éthique : d’un côté, un universalisme dense qui ne renonce pas à la prétention d’enraciner la morale dans des valeurs transcendant les subjectivités ; de l’autre le libéralisme moral, fidèle à la tradition issue de John Locke revivifiée par Stuart Mill et à notre époque par John Rawls[6]. Ce dernier fait confiance au libre choix d’individus optant pour un « plan de vie » indiscutable à condition qu’il soit issu de leur seul consentement.
La première voie se définit comme une éthique de contenus, une éthique beaucoup plus substantielle. Elle est d’autant plus tentante qu’une société se sent agressée par des groupes rejetant le système démocratique. La voie libérale, quant à elle, est celle d’une « éthique de la procédure » qui s’inscrit pleinement dans les structures de l’État démocratico-libéral.
Une voie moyenne : l’éthique de la liberté
Les deux positions ont chacune leurs limites et leurs paradoxes. L’universalisme dense, qu’on pourrait aussi dénommer « éthique de la perfection », semble difficilement compatible avec le « gouvernement de chacun par soi-même » dont John Stuart Mill avait fait la caractéristique majeure des sociétés modernes[7].
Quant à la « morale minimale » de la position libérale, elle peut prendre la forme d’un anarchisme éthique incapable d’assurer un lien minimal entre les citoyens. Et même si elle évite cet écueil, elle bute sur le contour précis des « devoirs envers soi-même ». Au nom de quoi les définir ? Or Alain Renaut démontre avec brio que, sans devoirs envers soi, on ne saurait trouver chez un sujet libre la moindre assise pour des devoirs envers autrui.
Afin de pallier ces faiblesses, l’auteur propose une « éthique de la liberté » qui, sans retomber dans la tentation de l’universalisme, préserve l’idée de devoirs envers soi, en l’absence de laquelle les pires dérives pourraient advenir.
Insurpassable Kant ?
La conclusion du livre déçoit un peu cependant, qui fait retour au concept kantien de « dignité ». Pour Alain Renaut, il suffirait à former un rempart contre des conduites que ne parvient pas à condamner le libéralisme moral. Soit la prostitution volontaire, ou le « lancer de nains », exemple a priori anecdotique, mais dont l’auteur montre qu’il pose une réelle difficulté en termes éthiques[8].
D’autres notions pourraient figurer dans une telle éthique de la liberté, comme la « vulnérabilité » ou la « sollicitude »… Mais Alain Renaut se contente de les faire « surgir » dans les dernières lignes du livre, de façon assez peu convaincante[9].
Un problème de forme
A ce livre, qui se veut l’œuvre d’un philosophe dans la cité, on peut reprocher à la fois sa longueur et sa brièveté. Il n’est pas assez « ramassé » pour retenir constamment l’attention de ceux qui ne sont pas familiers de la matière philosophique brassée par l’auteur. Et trop bref si on considère cette dernière : elle ne peut être résumée en un peu plus de 200 pages sans raccourcis.
L’entreprise d’Alain Renaut mérite cependant d’être saluée pour son ambition et son courage. Qui peut en effet nier qu’il soit aujourd’hui urgent de réfléchir à une éthique pour nos démocraties ?
Philippe Granarolo, Agrégé de philosophie, Docteur d’État ès-Lettres, Professeur de Khâgne (h)
[expand title = « Notes »]
[1]Le chapitre 1 du livre distingue les différentes éthiques en présence : privée, publique et globale, rejetant comme stérile le distinguo entre « éthique » et « morale »
[2] P. 27.
[3]Formule empruntée à Charles Taylor, philosophe québécois avec lequel Alain Renaut a souvent dialogué dans ses derniers ouvrages. On trouvera en particulier un long débat avec les thèses de Taylor dans l’excellent ouvrage écrit en collaboration avec Sylvie Mesure, Alter Ego / Les paradoxes de l’identité démocratique, Paris, Aubier, collection Alto, 1999, pages 117-135, 139-143, 145-148, 164-167, et passim.
[4]P. 43.
[5]P. 46.
[6]La Théorie de la justice de John Rawls, ouvrage publié aux États-Unis en 1971, reste une référence pour tous les philosophes qui se penchent aujourd’hui sur la question de la justice. On trouve une traduction française de ce texte majeur dans la collection « Points ». Alain Renaut a consacré plusieurs livres à la question de la justice, dans lesquels il mène un riche débat avec les thèses de Rawls, en particulier Egalité et discriminations : un essai de philosophie politique appliquée (2007), Qu’est-ce qu’une politique juste ? Essai sur la question du meilleur régime (2004), Le Droit et la République (2000), etc.
[7]L’ouvrage de Stuart Mill De la liberté, publié en 1859 (traduction française, Gallimard, 1990), demeure la Bible du libéralisme moral. Renaut discute les thèses du philosophe utilitariste en particulier dans les pages 158 à 170 de l’ouvrage.
[8]Ce phénomène de société est analysé à la fin du livre, p. 244-245.
[9]A la décharge de l’auteur, il est permis de considérer que cette « ouverture » finale marque son intention avouée de poursuivre la recherche inaugurée dans ce livre. Quelle éthique pour nos démocraties ? pourrait devenir à cet égard un livre-programme un peu comparable, toutes choses égales, à ce que fut L’ère de l’individu (Gallimard) en 1989, ouvrage dont Alain Renaut n’a depuis cessé de creuser le sillon.
[/expand]












Aucun commentaire.