Une tragédie française
Fondapol | 23 avril 2011
Philippe Askenazy, Les Décennies Aveugles : Emploi et Croissance 1970-2010, Paris, Seuil, 2011, 308 pages, 20€.
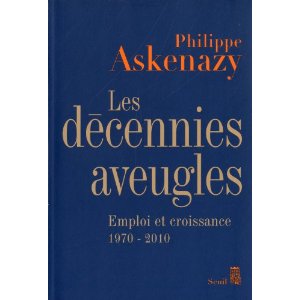 Philippe Askenazy est directeur de recherche au CNRS. Eminent spécialiste du marché du travail, il distribue dans ce livre les bons et les mauvais points aux politiques de l’emploi conduites par les gouvernements qui se sont succédés depuis les années 1970. Malgré des styles différents, ils auraient partagé une même vision de l’éducation et du marché du travail. Les fondements de cette politique auraient été posés par Raymond Barre entre 1976 et 1981.
Philippe Askenazy est directeur de recherche au CNRS. Eminent spécialiste du marché du travail, il distribue dans ce livre les bons et les mauvais points aux politiques de l’emploi conduites par les gouvernements qui se sont succédés depuis les années 1970. Malgré des styles différents, ils auraient partagé une même vision de l’éducation et du marché du travail. Les fondements de cette politique auraient été posés par Raymond Barre entre 1976 et 1981.
Pas d’adaptation sans vision
Philippe Askenazy se livre dans un premier temps à une relecture des politiques de l’emploi menées en France depuis le premier choc pétrolier de 1973, au miroir des grands tournants qu’ont su prendre les économies américaine et britannique.
A la suite du premier choc pétrolier en 1973, les Etats-Unis se sont convertis par exemple à la « nouvelle économie » des technologies de l’information et de la communication (TIC). Ils ont réussi à relever ce défi grâce à la « flexibilité » qui caractérise leur marché du travail ; d’après Philippe Askenazy, la conversion n’a été obtenue qu’au prix d’une précarisation des salariés et d’une croissance des inégalités de revenus.
En Grande-Bretagne, les réformes musclées de Margaret Thatcher n’ont réussi que parce qu’elles ont été mises au service d’un projet économique visionnaire : le développement de l’industrie financière fortement utilisatrice de technologies de l’information et de la connaissance.
Accusé Raymond Barre,…
Or, la France n’aurait pas su associer aux mouvements de déréglementation qui ont caractérisé son histoire économique depuis les années 1970 – qu’on songe à la suppression de l’autorisation administrative de licenciement en 1986 ou aux privatisations des années 1990 – une réelle vision de l’avenir économique du pays.
Philippe Askenazy met en cause à cet égard la politique initiée par Raymond Barre entre 1976 et 1981. Le second Premier ministre de Valéry Giscard d’Estaing avait, on le sait, la réduction des déficits publics comme point de mire et y associait une politique monétaire de réduction de l’inflation. Dans ce contexte, le chômage était envisagé comme un problème conjoncturel. Quant au chômage des jeunes, il était attribué, en cette fin des années 1970, à une inadéquation de leur formation aux attentes des entreprises.
Pour Philippe Askenazy, rien n’a véritablement changé depuis lors dans l’approche du marché de l’emploi. Soumis au diktat barriste, les gouvernements postérieurs auraient d’abord permis la précarisation du marché du travail. En cause ? Le développement des contrats à durée déterminée et à temps partiel, le recours abusif aux incitations fiscales pour encourager l’embauche des non qualifiés et l’orientation de la politique de l’éducation en faveur des filières courtes, alors même que la révolution technologique appelait au renforcement des formations généralistes afin de favoriser « l’adaptabilité » des salariés.
Qu’est-ce que l’hystérèse ?
On peut trouver schématique cet abrégé d’histoire des politiques conduites en France depuis la fin des années 1970… Mais Philippe Askenazy convainc lorsqu’il dénonce une politique de l’emploi conduite au jugé, sans véritable vision. Ainsi les dirigeants français ont-ils globalement ignoré la richesse des recherches conduites sur le fonctionnement du marché du travail en France. Un concept aurait pourtant pu trouver une application particulièrement féconde dans l’analyse des difficultés françaises : celui d’hystérèse.
L’hystérèse est un concept emprunté à la physique. Il décrit une situation dans laquelle le chômage augmente durablement, malgré la disparition des causes qui avaient provoqué sa hausse à l’origine. Comment l’expliquer ? Notamment par une analyse du marché du travail en termes d’insiders et d’outsiders. Cette grille de lecture permet de comprendre qu’un choc de conjoncture défavorable ou/et une politique de l’emploi inappropriée aient des conséquences durables, voire irréversibles sur les rapports entre insiders et outsiders… en faveur des premiers, évidemment !
Des solutions peu convaincantes
Au chapitre des solutions, le lecteur restera en revanche sur sa faim. L’auteur propose d’abord que l’Etat pousse indirectement les entreprises du secteur privé à revenir sur la précarisation de leurs salariés. Le mécanisme serait le suivant : l’Etat recruterait massivement sur un marché du travail tendu ; il offrirait aux fonctionnaires des conditions de travail optimales ; soumises à cette concurrence vertueuse, les entreprises seraient contraintes d’aligner les conditions de travail vers le haut, pour réussir à attirer la main d’œuvre dont elles auraient besoin. Mais que dire de la croissance de la dette publique dans un tel cas de figure ? Elle serait colossale, pour des effets aléatoires.
Philippe Askenazy considère en outre la remise en cause du contrat unique de travail à temps plein comme une nécessaire régression. Il n’est pas faux en effet de considérer que le temps partiel est plus souvent subi que choisi, en particulier dans les services. Pour autant, on ne peut ignorer que le développement des technologies de communication ouvre un champ infini de possibilités de collaboration ni exclusive, ni permanente entre entreprises et salariés. Est-il interdit d’espérer que ces nouveaux rapports employeurs-employés s’établiront sur la base d’un principe « gagnant-gagnant », chacun y trouvant plus de liberté ?
Les avatars contemporains d’Oswald Spengler
Philippe Askenazy a ainsi tendance à raisonner exclusivement en spécialiste du marché du travail lorsqu’il s’agit de proposer des solutions à la crise. Il pose un diagnostic assez consensuel en remarquant que la défiance règne à tous les étages de la société française, et qu’elle frappe tout particulièrement le pouvoir politique. Mais là encore, la solution avancée apparaît peu crédible, puisque le chercheur envisage tout simplement d’établir en France une monarchie constitutionnelle ! S’agit-il d’un trait d’humour ?
Les Décennies aveugles prennent donc (bonne) place parmi les livres qui diagnostiquent avec acuité un certain malaise français. Chaque science humaine a désormais, dans l’Hexagone, son analyste du déclin national. Avec ce livre, il n’est pas exagéré de dire que les spécialistes français du marché du travail ont trouvé leur Oswald Spengler…
Nathalie Janson est professeur d’économie à l’Ecole supérieure de commerce de Rouen.












Aucun commentaire.