Devenir européen et défi prométhéen
Ce texte, qui reprend l’intégralité de l’intervention prononcée par Bronislaw Geremek au Collège de France (colloque « Science et conscience européennes », novembre 2004), est fidèle à la haute exigence que cet historien de renom nourrit à l’égard de l’Europe. Et, plus particulièrement, à la place intellectuelle que celle-ci, selon lui, a tenu et doit continuer de tenir dans la nouvelle compétition internationale du savoir.
Dans ce texte très personnel, Bronislaw Geremek souligne l’importance des acquis économiques réalisés par l’Europe. Néanmoins, il souligne ce récent glissement sémantique du mot « Communauté » vers celui d’«Union», au moment même où le temps, voire l’urgence, est venu de faire non plus l’Europe, mais des Européens. C’est là le grand débat soulevé par la Convention sur la Constitution européenne. Mais il y a peut-être encore plus important : l’Europe doit aujourd’hui renouer avec la science, se réapproprier cette phrase de Hans-Georg Gadamer écrite à la fin du second conflit mondial : « le devenir de la science a formé l’Europe ». Au regard de l’Agenda de Lisbonne, resté lettre morte, ou du prestige déclinant des centres académiques européens, Bronislaw Geremek rappelle que la culture et l’éducation, qui définissent l’esprit européen comme son « insatisfaction créatrice », doivent être reconsidérées comme des priorités, et les sciences, placées au cœur de ce que l’auteur appelle la reprise du défi prométhéen.L’Europe vit un moment important de son histoire. Le demi-siècle de l’intégration européenne s’est passé sous le signe de l’économique et peut être inscrit dans le bilan positif du XXe siècle.
Dans ce siècle des régimes et idéologies totalitaires, de l’Holocauste, des deux guerres mondiales qui peuvent être considérées comme une seconde Guerre de Trente ans européenne, l’odyssée du projet européen apparaît comme une réussite indiscutable et singulière. La continuation de cette œuvre – et peut-être même sa survie – dépend à présent du dépassement critique et affirmatif à la fois de son acquis. L’Union Européenne s’interroge à présent sur sa dimension politique, sur sa place dans le jeu global, sur son avenir, sinon sur sa « finalité ». Le débat sur le Traité constitutionnel et celui sur l’Agenda de Lisbonne permettent de saisir l’ampleur des enjeux devant lesquels l’Europe se trouve.
En conséquence du long travail d’intégration et à travers des accessions successives des nouveaux pays membres il s’est formé en Europe un espace de la paix, de la coopération économique et du droit commun. Michel Rocard a eu raison de souligner que c’est un succès formidable. Il s’est réalisé dans l’Europe divisée et dans le contexte des tensions de la guerre froide, mais l’élargissement de 2004 a permis de lui donner la dimension de l’unification de l’Europe, conformément à ce que pensaient les pères fondateurs de l’unité européenne et ce que Robert Schuman a dit expressément.
Mais dans la pensée des pères fondateurs on retrouve aussi une autre aspiration encore et qui est souligné par le nom même donné au corps crée cinq ans après la fin de la dramatique et déchirante guerre européenne – la Communauté. Ce mot qui n’avait pas de place toute faite dans la vocabulaire juridique et discours politique modernes est tout un programme: attaché d’abord à l’acier et au charbon, ensuite a l’économie et enfin simplement à l’Europe il annonce un projet entrant dans les rapports humains de façon directe. Cette aspiration à créer une communauté a trouvé des chances nouvelles de réalisation au moment même de la disparition du mot dans l’appellation officielle de cet ensemble, quand l’Union a remplacé la Communauté. En fait, dans la logique même du développement de cet espace de coopération, il y a l’avancement de l’esprit européen, dans la continuation de deux expériences communautaires du passé européen, de la chrétienté médiévale et de la république moderne des lettres. Et c’est après le tournant historique de 1989 que les peuples européens se sont posé la question pourquoi ils veulent vivre ensemble, à quoi bon s’organiser en communauté, autour de quoi former une communauté. Le grand débat, avancé par la Convention sur la Charte des droits fondamentaux et ensuite par la Convention sur la Constitution européenne, n’est qu’à ses débuts, mais on pourrait dès maintenant voir la présomption qu’après avoir fait l’Europe il est temps de faire les Européens.
Je n’ai pas d’intention d’entrer dans l’analyse de l’état actuel de l’Union européenne et de son identité après les mutations fondamentales de 1989 et de 2004. On ne dira jamais assez combien important était que la réunification de l’Europe s’est faite autour de l’idée de la liberté et de l’esprit antitotalitaire. Dans le devenir de l’Europe aussi bien que dans son projet d’avenir la liberté est au centre même, a une force fondatrice aussi bien dans le mouvement des communes urbaines que dans l’affirmation nationale du Risorgimento ou dans l’épopée napoléonienne. A l’aube du XXIe siècle la liberté servait bien la prise de conscience européenne.
Mais cette prise de conscience européenne s’ouvrait aussi sur la science. L’Union européenne s’est dotée une économie puissante, assurant à sa population un standard de prospérité assez remarquable. Les critiques de sa faiblesse sur la scène internationale l’appelaient « nain politique », mais n’avaient pas de doutes qu’elle est un géant économique. Dans la situation actuelle il y a un doute est-ce que l’économie européenne n’est en train de perdre son souffle. Le programme de l’Agenda de Lisbonne voulait que l’économie européenne devienne la plus compétitive du monde grâce à la priorité donnée aux sciences et technologies de pointe, en se fondant sur la société d’information, de savoirs, de connaissances. Ce qui est frappant et même dramatique ce n’est pas que ce programme restait lettre morte jusqu’au présent, mais qu’il fallait le formuler : ce qu’il postule était, en effet, l’essence même de l’expérience européenne et semblait propre à l’histoire européenne depuis l’an Mil jusqu’au l’an Deux mille, dans ce millénaire à qui on donnait même le nom d’« européen ».
C’est bien l’esprit d’innovation qui semblait être intimement associé à l’Europe. Elle a su introduire des technologies nouvelles dans l’agriculture médiévale, utiliser la force du vent, développer les techniques militaires, créer des écoles et des universités, utiliser le charbon, le fer et l’acier, générer des révolutions industrielles, former des sociétés savantes et promouvoir les sciences, profiter de son propre génie d’invention et des inventions des autres civilisations. Ce n’est point un lien conjoncturel qui lie l’Europe à l’esprit prométhéen, ce soif de s’apprivoiser tous les secrets divins, toutes les forces de la nature, cette force téméraire de dépasser ce qui est acquis, pour aller en avant : c’est bien l’essence de l’Europe.
Cette vocation pathétique faisait parfois défaut à l’Europe. Dans les caractéristiques que l’art du Moyen Age attribuait aux parties du monde, l’Europe était associée à la guerre, l’Asie – à la richesse et c’était l’Afrique, celle des centres méditerranéens du savoir arabe, qui était associée aux sciences. A des époques diverses les Européens s’adonnaient à l’art guerrier plutôt qu’aux sciences et à la culture – aux yeux des Byzantins du XIIIe siècle ils n’apparaissaient que comme des rustres incultes. Mais ce sont les sciences et l’aventure prométhéenne qui ont formé l’identité européenne.
C’est à la sortie de la première guerre mondiale, en 1922-1923, qu’un Edmond Husserl dans ses cinq essais destinés à une revue japonaise portant le titre « Kaizo » (c’est-à-dire « Renouvellement »), expliquait comment la civilisation européenne entreprenait un « renouvellement éthico-politique » et exprimait sa capacité d’ « éducation universelle de l’humanité ». C’est de cette façon que la science européenne se proposait, d’après Husserl, à remédier à la crise de l’Europe exprimée par la Grande Guerre.
Un demi-siècle plus tard, après l’expérience de la seconde guerre mondiale, Hans-Georg Gadamer réclamait une réflexion sur le rôle de la science pour l’avenir de l’Europe. Il affirmait que « la science elle-même a déterminé l’Europe dans sa nature et son devenir historique, qu’elle définit les limites de ce qu’on appelle « européen ». […] C’est dans la seule Europe que cette figure spécifique de l’esprit qu’est la science a pu se constituer en création de culture autonome et dominante. » Et Gadamer n’hésite pas à conclure que « le devenir de la science a formé l’Europe. »
On peut se poser la question est-ce que cette foi dans la science prônée par Husserl et Gadamer en contrepoint aux convulsions de l’Europe du siècle passé reste encore valable maintenant quand l’Université et la Recherche en Europe se plaignent du manque des ressources nécessaires pour survivre et préserver leurs acquis et quand le prestige traditionnel des centres académiques européens semble décliner par rapport au potentiel intellectuel et technologique. Je crois, au contraire, que nous vivons le moment d’une prodigieuse prise de conscience que l’Europe doit faire face au défi du temps et qu’elle en est capable. Le débat actuel sur l’avenir de l’Europe fait apparaître non seulement la nécessite de promouvoir la recherche et le développement (R&D) ainsi que les technologies de l’information et de la communication (TIC), mais aussi le besoin impérieux de considérer la culture et l’éducation comme priorités européennes : c’est bien elles qui définissent l’esprit européen dans un mouvement continu où les doutes et les certitudes ne s’excluent pas mutuellement.
Je prends la liberté de mentionner quelques exemples des grandes interrogations qui exprimaient un trait dont la culture européenne est profondément imprégnée : l’insatisfaction créatrice.
On peut avoir des doutes si l’on peut voir dans une telle formulation de l’esprit européen une proposition valable pour la politique européenne. Je m’oppose à ces doutes. Il ne faut pas, à mon sens, penser que c’est l’approche pragmatique démontrant l’utilité immédiate des recherches scientifiques qui est la voie royale pour convaincre le monde politique de l’importance des sciences et de l’enseignement dans la construction européenne.
Après un demi-siècle d’intégration européenne, du succès du marché unique, de l’établissement des règles juridiques communes, de l’introduction réussie de la monnaie commune l’Union Européenne cherche maintenant à établir sa « finalité ». Je le répète : après avoir fait l’Europe, vient le temps de faire les Européens.
C’est dans la notion même de l’identité européenne qu’il faudrait introduire les sciences et les savoirs, l’inquiétude prométhéenne poussant vers le non conquis ou l’inconnu, la culture du doute, la promotion de l’excellence de l’enseignement et de la recherche. Un tel débat fera progresser la construction européenne et permettra d’avancer une politique européenne dans le domaine de l’enseignement et de la recherche.
En 1947, Karl Jaspers, dans son essai Vom Europäischen Geist, avançait que le propre de l’esprit européen est de produire sans cesse des thèses et antithèses, d’affirmer des attitudes et de les contredire, d’élaborer des idées et de les mettre en doute. Il est vrai que dans la pensée européenne il y avait aussi des instants de l’affirmation que la vérité est atteinte est que l’histoire est arrivée à sa fin, mais ils étaient tout de suite contredits par la réalité ou par la raison. La pensée européenne semble dire sans cesse, sur les traces d’Abélard, un « non » à chaque « oui », un « oui » à chaque « non » (je me réfère ici au traité de Pierre Abélard, Sic et non, écrit vers 1122). On peut voir dans ce trait de la tradition intellectuelle européenne – introduisant le doute et mettant en question les certitudes – une attitude juste et fructueuse, mais il est aussi évident que dans une telle perspective la pensée n’apporte pas toujours de combustible a l’action, et le rôle de l’intellectuel sur la place publique se limite très souvent au rôle du médecin qui sait tout sur le malade seulement quand il ne peut plus l’aider.
Il s’agit de l’épuisement de certaines traditions et institutions qui définissaient les cadres mêmes de l’existence humaine, mais aussi de l’apparition des signes précurseurs de l’avenir. Je pense à l’affaiblissement du paradigme du lien du sang auquel se référait aussi bien le concept de la famille que celui de la nation dans la longue durée européenne. Le contrat d’intérêt et le choix émotionnel le remplace de plus en plus dans la formation de la famille et dans l’existence de la nation. Ernest Renan, proclamant que la nation est le « plébiscite de tous les jours », a raison, aujourd’hui plus que jamais.
Deuxièmement, on constate que dans le développement de la science apparaît avec force une inquiétude éthique sur les limites de la recherche scientifique : cinquante ans après le débat sur l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins militaires, nous nous trouvons en face de l’interrogation majeure s’il y a une limite d’intervention de l’homme dans la fabrique de la vie humaine : cela concerne le clonage ou l’ingénierie génétique.
Troisièmement, les processus de mondialisation mettent en relief deux profonds ruptures dans les sociétés contemporaines : entre la richesse et la pauvreté des peuples, et entre la tendance globaliste ou universelle et la réaction hostile à tout pluriculturalisme. Dans les termes de Karl Popper on pourrait dire qu’a la « société ouverte » a l’échelle aussi bien globale que locale s’oppose la « société tribale » prônant un fondamentalisme ethnocentrique basé sur l’égoïsme à l’égard de l’autre, sinon la haine à l’égard de l’autre. On ne peut que s’inquiéter des attitudes du mépris et de l’hostilité à l’égard des immigrés dans une civilisation qui était ouverte et hospitalière à l’égard des autres et qui en tirait son dynamisme.
Face à ces trois grandes interrogations du monde en mutation on peut voir dans la réflexion intellectuelle des sic et des non, des thèses et des antithèses à travers lesquelles apparaît moins le vertige d’une accélération de l’histoire que la conscience des menaces et des chances de l’avenir.
On peut constater, primo, le retour à l’individu, dont un Andrei Sakharov opposant au système totalitaire une éthique de l’individu peut être considéré le personnage emblématique.
Secundo, la recherche d’un soc de valeurs fondamentales et la référence aux impératifs et aux exigences morales, bien enracinée dans la lignée d’Emmanuel Kant, s’associe à l’attachement à la liberté.
Tertio, l’économie et la culture contemporaines se caractérisent de plus en plus par une accélération des échanges ; les migrations brisent les barrières et les fermetures, les exclusions sociales, ethniques et culturelles deviennent de moins en moins acceptables, la lutte contre la pauvreté et la misère des peuples devient une partie naturelle des politiques de « sécurité humaine » au même titre que la prévention des conflits militaires ou des ruptures de la paix publique.
L’historien, étudiant la longue durée avec ses lenteurs, sinon son immobilisme, ou bien plongé – tout comme le politique – dans la course essoufflée des événements du temps court n’est pas à l’aise en pensant à l’avenir. Mais je pense que Fernand Braudel avait raison de réclamer à l’historien une place privilégiée dans le travail de penser l’avenir aussi bien parce que l’histoire donne un champ empirique le plus vaste pour ce travail, que par l’expérience de l’historien dans l’étude des changements et des mutations. Paul Valéry dans un de ses essais notait que « dans le passé, on n’avait guère vu, en fait de nouveauté, paraître que des solutions ou des réponses à des problèmes ou à des questions très anciennes, sinon immémoriales. Mais notre nouveauté, à nous, consiste dans l’inédit des questions elles-mêmes, et non point des solutions ; dans les énoncés, et non dans les réponses. »
L’Europe ne peut s’affirmer que dans la reprise du défi prométhéen, dans la volonté de placer les sciences au cœur de ses projets d’avenir.

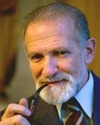











Aucun commentaire.