Combattre l'islamisme sur le terrain
Témoignage d'un préfet de la RépubliquePréface
Avant-propos
Introduction
Connaître
Combattre
Conclusion : c’est à nous, mais aussi peut-être d’abord à nos compatriotes musulmans, de livrer ce combat
Résumé
Alexandre Brugère livre le premier témoignage d’un préfet en exercice sur la lutte contre l’islamisme. L’enjeu est crucial. Les islamistes rejettent la séparation qu’exige la laïcité entre la vie spirituelle et la vie temporelle. Or, c’est la laïcité qui préserve l’organisation sociale de l’emprise de la religion. Ainsi, les valeurs républicaines font obstacle au modèle promu par les islamistes, elles garantissent les libertés individuelles, d’opinion ou de conscience, qu’il s’agisse de l’égalité entre les femmes et les hommes, entre les citoyens, qu’ils soient croyants ou non, d’une religion ou d’une autre, qu’ils respectent ou non les règles de leur religion.
Afin de saper ces valeurs, les mouvements politico-religieux « fréristes » et autres de même type recourent, notamment, au levier de l’« islamophobie », un néologisme mis au service d’un discours victimaire destiné à inhiber la critique et à libérer le champ à leurs revendications.
L’islamisme opère l’enfermement de millions de Français musulmans dans un communautarisme identitaire les séparant de cet ensemble plus vaste et uni qu’est la communauté nationale. Aussi, les « accommodements raisonnables », petits et grands, par calcul ou par paresse, sont autant d’entailles au pacte républicain : un cours d’histoire qu’on laisse interrompre sans conséquences, un terrain qu’on vend pour permettre, avant les élections municipales, l’extension ou l’implantation d’une mosquée, un islamiste patenté avec lequel on continue de discuter parce qu’il serait « représentatif » … Il importe de ne pas seulement dénoncer l’islamisme, il faut aussi le combattre.
L’auteur, Alexandre Brugère, est préfet des Hauts-de-Seine. Son témoignage est précédé d’un avant-propos du ministre de l’Intérieur, M. Bruno Retailleau.
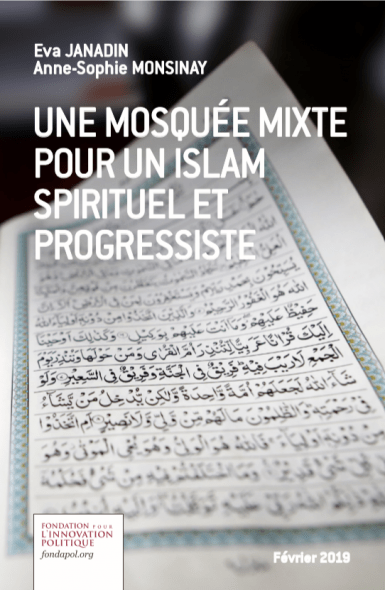
Une mosquée mixte pour un islam spirituel et progressiste
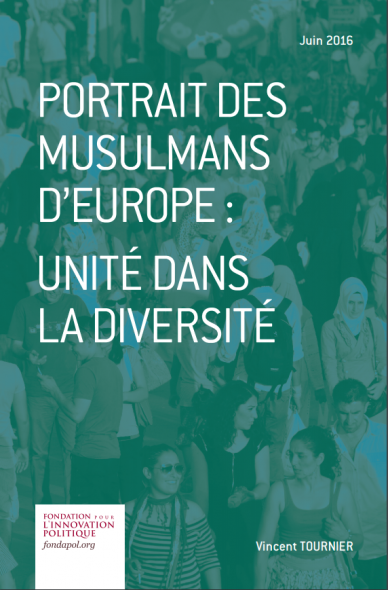
Portrait des musulmans d’Europe : unité dans la diversité
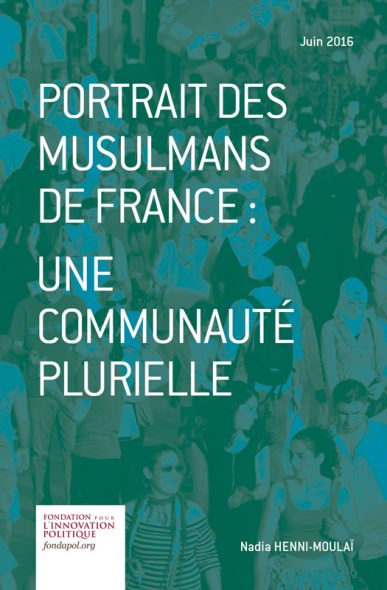
Portrait des musulmans de France : une communauté plurielle
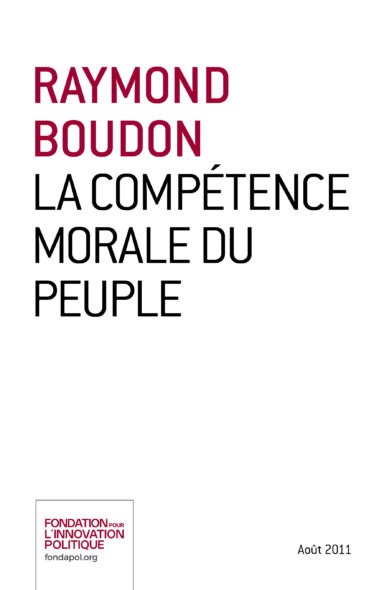
La compétence morale du peuple
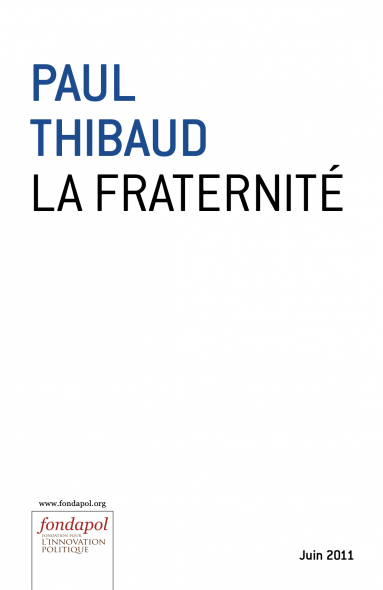
La fraternité
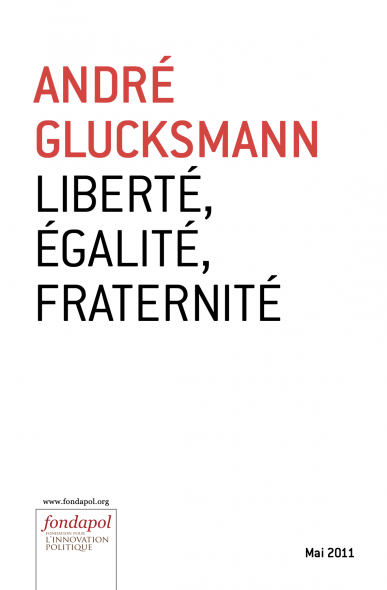
Liberté, égalité, fraternité
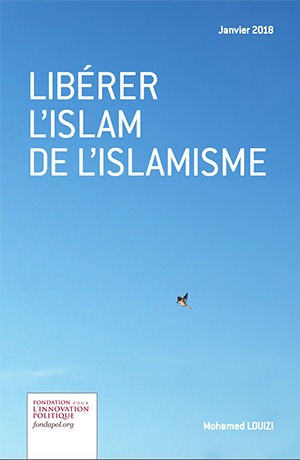
Libérer l'islam de l'islamisme
Préface
C’est un texte de combat qu’Alexandre Brugère, préfet des Hauts-de- Seine, publie avec le concours de la Fondapol. Un combat républicain, lucide et déterminé.
Lucide, parce que nous devons prendre conscience que l’islamisme ne se réduit pas à son expression djihadiste mais qu’il pratique également l’entrisme, dans les champs associatif, sportif, scolaire, etc. L’objectif poursuivi par cet islamisme souterrain est clair : porter un projet de société contraire à celui de la République française. Pour cela, il déploie une grande habileté : sur le terrain, il avance par petites touches successives ; dans ses discours, il retourne la rhétorique libérale contre notre régime de liberté, avec d’ailleurs la complicité de certaines forces politiques. Les Frères musulmans sont passés maîtres dans cet art du retournement des valeurs, de la dissimulation des vrais objectifs. Mais ils ne sont pas les seuls.
D’où la nécessité, pour la République, de se doter d’une réponse plus offensive. Pour faire connaître aux décideurs et au grand public la menace, dans sa nature comme dans ses manifestations. Mais également pour mieux former nos administrations et mieux organiser nos services dans cette lutte vitale contre l’entrisme islamiste. C’est le travail que mène actuellement le ministère de l’Intérieur, et qui aboutira à des propositions concrètes et précises.
Ce combat auquel appelle Alexandre Brugère, et qu’il mène déjà sur le terrain, n’est pas – réaffirmons-le avec force – un combat contre une religion. Car l’islamisme défigure la foi de nos compatriotes musulmans. C’est un combat pour la Nation. L’idée républicaine que nous nous en faisons. C’est-à-dire, non pas la superposition de communautés, comme autant d’éléments d’une société en pièces détachées ; mais l’affirmation, par-delà les origines et les confessions, d’un même sentiment d’appartenance : à la République que nous servons, à la France que nous aimons.
Bruno RETAILLEAU
ministre d’État, ministre de l’Intérieur
Avant-propos
La mosquée des Abeilles de Levallois a été inaugurée le 21 décembre 2023.
Un préfet est-il à sa place dans une cérémonie religieuse ? Je me suis naturellement posé cette question avant d’accepter, le 18 mars dernier, l’invitation de la mosquée des Abeilles de Levallois à participer à un iftar, la rupture du jeûne organisée chaque soir du Ramadan. Représentant de l’État dans le département, le préfet doit bien sûr en incarner la stricte neutralité, mais il doit également veiller à la liberté de culte.
Si j’ai accepté cette invitation, c’est d’abord parce que je savais Ali Essebki, président de l’association cultuelle de la mosquée des Abeilles, particulièrement attaché à promouvoir un « islam des Lumières » compatible avec la République. Nous avions fait connaissance avant même que je devienne préfet des Hauts-de-Seine, à l’époque où j’étais encore le directeur de cabinet du précédent ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin. Alors tout jeune responsable cultuel1, Ali Essebki avait fait acte de candidature pour rejoindre le forum pour l’islam de France (FORIF), la nouvelle instance de dialogue établie entre le culte musulman et l’État, sur laquelle je reviendrai plus longuement.
Ce soir-là, le président Essebki avait également souhaité convier des élus de tendances politiques différentes ainsi que des représentants des principaux cultes, parmi lesquels Monseigneur Rougé, évêque de Nanterre, et Élie Korchia, président du Consistoire central israélite de France ; l’effort d’ouverture allant jusqu’à proposer un buffet cacher servi par du personnel en kippa, ce qui donnait à cet iftar une dimension assurément très œcuménique !
Mais parmi les convives figuraient également les représentants de différentes mosquées du département adhérentes à l’Union des mosquées du 92 ou situées dans son orbite, et qu’Ali Essebki tentait de fédérer depuis plusieurs mois. Pour avoir porté un regard très attentif à la liste des participants, je savais que quelques-uns parmi eux étaient moins attachés aux principes républicains que mon hôte… Accepter d’y « rompre le jeûne » était donc, aussi, l’occasion inédite de prononcer à leur adresse un discours de vérité, sans complaisance. Le message porté serait clair : l’État sera intransigeant face à l’islamisme, et cette intransigeance doit être en premier lieu assumée par l’écrasante majorité des musulmans qui respectent les lois de la République.
À l’invitation de la Fondapol, je développerai ici le raisonnement sur lequel reposait ce discours, voulu comme un appel à mener sur le terrain un combat sans concession contre l’islamisme.
Pour la bonne information des lecteurs, le témoignage d’un préfet respecte nécessairement deux règles inhérentes à ses fonctions : d’abord le strict devoir de réserve qui s’impose à tout fonctionnaire et, bien sûr, la non-divulgation d’informations sensibles transmises notamment par les services de renseignement, dont l’appui quotidien nous est si précieux. Ces limites étant posées, voici mon témoignage.
Fronton d’une mairie avec la devise républicaine : Liberté, Égalité, Fraternité

Introduction
La foi, tout comme l’absence de foi, n’est pas un sujet comme un autre. C’est une question profondément intime. Si le fait de croire ou de ne pas croire est souvent le fruit d’une histoire familiale, le rapport à la religion reste toujours la résultante d’une équation très personnelle. Chaque génération vit sa spiritualité à sa manière, et au sein d’une même génération les dynamiques divergent. Pour s’en convaincre, il suffit de regarder autour de soi comment une même fratrie peut appréhender la foi de manières différentes. Selon d’où nous venons, mais aussi l’environnement dans lequel nous évoluons et les épreuves auxquelles nous sommes confrontés – et beaucoup d’autres déterminants que je serais bien incapable de lister de manière exhaustive ici –, le besoin de cultiver son propre jardin spirituel varie, tout comme la nécessité d’inscrire celui-ci dans le cadre figé proposé par une religion.
Si la question de la place du religieux dans nos vies revêt donc incontestablement un caractère sensible, qui explique pour partie les relations tortueuses entretenues entre les cultes et le pouvoir temporel, cela n’implique pas pour autant d’appréhender ce sujet avec tiédeur ; je vais même tenter ici de démontrer l’exact contraire. Cette sensibilité impose en revanche à l’acteur public qui se trouve confronté au sujet de faire reposer son action sur deux piliers fondamentaux.
Le premier pilier est la sincérité de la démarche : les Français sont un peuple intelligent qui voit venir de loin ceux qui ont « quelque chose derrière la tête » et mèneraient d’autres croisades que celles dont ils se réclament. Sur certaines tribunes, les propos tenus respirent tellement la haine vis-à-vis des millions de nos compatriotes musulmans que le message qui leur est renvoyé est clair : partez ! Mais partir où ? Ils sont, pour l’essentiel d’entre eux, Français, et rien ne changera cela. Le seul projet que sous-tend cette vision de notre société, c’est la guerre civile. À l’inverse, sur d’autres tribunes, l’entretien d’un discours victimaire et les œillades grossières adressées aux islamistes répondent à une stratégie décomplexée de conquête de suffrages électoraux et impliquent la mise à mort de l’idéal républicain. Là aussi, les choses sont sans doute plus simples pour un préfet auquel les postures et les arrière-pensées politiciennes sont, par principe, interdites. J’ajouterais également la nécessité de faire preuve vis-à-vis de ses interlocuteurs d’empathie, voire de bienveillance, deux qualités qui ne font jamais de mal dans les relations humaines à la condition qu’elles ne s’accompagnent pas de naïveté.
Le second pilier est la clarté absolue des convictions : le traitement de ces sujets exige de savoir ce dont on parle et d’avoir une vision précise de la société que l’on défend. Sur ce dernier point, pour un préfet, les choses sont assez simples : c’est la défense pleine et entière de la République. Tout à la fois régime politique et système de valeurs, la République fut critiquée selon les moments de l’Histoire par certains qui la trouvaient trop faible, quand d’autres la jugeaient au contraire trop dure… Ce qui montre sans doute qu’elle est un bon modèle ! Elle reste, en tous les cas et jusqu’à ce jour, le grand dénominateur commun qui unit tous les Français. Selon un sondage Ipsos1 réalisé il y a quelques années à la demande de l’Association du corps préfectoral, l’attachement aux valeurs de la République – liberté, égalité, fraternité – était aux yeux de nos compatriotes ce qui définissait le mieux le fait d’être Français. Voilà donc le socle commun autour duquel on peut (encore) espérer rassembler la Nation. On constatera d’ailleurs qu’il n’est remis en cause par aucune force politique, tout du moins publiquement.
S’agissant du sujet qui nous intéresse ici, la République française a forgé dans cette notion si singulière qu’est la laïcité le cadre dans lequel s’est construite la relation entre l’État et les cultes. Singulière au point qu’on parle, d’ailleurs, de « laïcité à la française ». Cette grande dame, qui fêtera le 9 décembre prochain ses 120 ans, a permis jusqu’alors de garantir la paix civile autour d’une salutaire cohabitation des consciences dans laquelle chacun est libre de vivre sa foi dans la République.
Elle repose sur quelques principes fondamentaux qu’il convient de rappeler. La laïcité, c’est bien sûr la séparation stricte entre les religions et l’État, qui ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. De cette affirmation découle la neutralité de l’État : aucune religion n’a la préférence de l’État ni n’est reconnue par celui-ci comme étant supérieure à l’autre. Mais la laïcité n’est pas pour autant la négation des religions puisque c’est aussi la garantie de la liberté de culte dès lors que cette liberté ne menace pas l’ordre public. À ce titre, c’est aussi garantir la sécurité de la pratique du culte, ce qui est aujourd’hui devenu un enjeu essentiel comme en témoigne l’importance des dispositifs de protection mis en place pour chaque grande fête religieuse.
Bien sûr, ces principes ne se sont pas imposés naturellement. Ils sont le fruit d’une lutte, et comme nombre de luttes, elle a connu son lot de violences. Dans le cadre du mouvement de laïcisation, les épisodes les plus brutaux nés de la période révolutionnaire ont laissé place aux débats parlementaires passionnés qui ont marqué le vote de la loi de 1905. Leur relecture nous rappelle d’ailleurs, s’il en était besoin, combien des visions divergentes de la société s’opposaient alors. Un mouvement qui aura donc pris plus d’un siècle !
La stabilité (remarquable) des grands principes de la loi de 1905 n’a cependant pas empêché celle-ci de connaître, outre les effets des jurisprudences successives du Conseil d’État et du Conseil constitutionnel pour en préciser l’interprétation, des modifications législatives ponctuelles, dont la plus récente fut apportée par la loi du 24 août 2021 visant à conforter le respect des principes de la République (loi CRPR), nous y reviendrons à plusieurs reprises dans la suite de ce texte.
Ce cadre offert par la laïcité a donc le mérite de la simplicité et de la souplesse, et pour l’éprouver au quotidien, j’en confirme, sans l’ombre d’une hésitation, la très grande modernité. Là aussi, aucune formation politique ne revendique sérieusement sa remise en cause, et de nouveau un sondage démontre le soutien à la laïcité par près de trois Français sur quatre2. Selon la même étude, elle constitue pour 70% des Français « un principe républicain essentiel ». Plus encore, ce principe « fait partie de l’identité de la France » pour 78% des personnes interrogées. Un résultat sans égal.
Seulement voilà, alors que rien ne semblait sérieusement menacer ce modèle, celui-ci fait l’objet ces dernières années d’offensives puissantes et répétées, menées cette fois-ci non plus par un clergé constitué, mais par les tenants de la vision radicale de l’islam. Et c’est dans l’interstice des grands principes qui structurent la laïcité que se mène une nouvelle bataille.
Connaître
Étienne Delarcher, Au coeur de l’islam de France. Trois ans d’infiltration dans 70 mosquées, Éditions du Rocher, 2024.
Établissements privés qui, n’ayant pas signé d’accord contractuel avec l’État, jouissent ainsi d’une plus grande liberté pédagogique et administrative.
Données fournies par les services de l’Éducation nationale.
Founé Diawara, nike.com, 26 juin 2023 [en ligne].
La menace doit d’abord être clairement nommée : ce sont les islamistes
Ils se présentent sous différents avatars qu’il n’est pas superflu de distinguer, car leurs modes d’action divergent. Pour décrire les choses simplement, les djihadistes sont dans une logique violente, les Frères Musulmans privilégient une approche politique de conquête sociale, quand certains salafistes dits quiétistes promeuvent une vie de repli en dehors de la République. Ce résumé à grands traits fait fi de multiples subtilités entre différents courants de l’islam, mais il a le mérite de formaliser une typologie d’approches auxquelles l’État est confronté concrètement sur le terrain : la violence, la conquête ou le repli.
Cependant, si ces courants sont en désaccords entre eux sur les moyens à mobiliser pour parvenir à leurs fins, ils se retrouvent sur l’essentiel : leur totale opposition à notre modèle républicain. Pour résumer cette idée d’une formule rapide, je dirais que, même non-violents, il ne peut donc y avoir de « bons islamistes » aux yeux de la République.
Ainsi, les islamistes « de tous bords » rejettent la séparation qu’impose la République entre la vie temporelle et la vie spirituelle à travers la laïcité, au motif que cette dernière limite l’emprise que peut avoir la loi religieuse sur l’organisation sociale. Ils rejettent aussi la République en tant que système de valeurs, notamment les plus fondamentales d’entre elles, c’est-à-dire celles qui sont inscrites dans notre devise. Prises en bloc autant qu’individuellement, ces valeurs sont l’absolu contraire du modèle promu par les islamistes, qu’il s’agisse de la liberté individuelle sans autres limites que le respect de lois votées dans un cadre démocratique, de l’égalité entre les femmes et les hommes ou encore de la fraternité entre les citoyens, qu’ils respectent ou non les règles de la morale religieuse.
Pour installer un rapport de force visant au renversement de ces valeurs, les mouvances fréristes misent sur le nombre, avec un carburant puissant : la victimisation face à « l’islamophobie ». Il ne s’agit pas de nier que des personnes musulmanes soient victimes de discriminations et d’agressions en raison de leur religion. C’est une réalité tangible vécue par nombre de nos compatriotes, et l’émotion intense née de l’horrible meurtre d’Aboubakar Cissé, alors qu’il priait son dieu à la mosquée de La Grand-Combe, en est un révélateur puissant, au-delà de ce que l’enquête dira des motivations réelles de son auteur. Mais chacun pourra constater comment ce néologisme qu’est « l’islamophobie », servi à toutes les sauces, de « l’islamophobie ordinaire » à « l’islamophobie d’État », est devenu un argument marketing imparable pour encourager des millions de Français à s’extraire de la communauté nationale. « Voyez comme les non-musulmans vous rejettent, quand nous vous proposons de nous rejoindre “comme vous êtes” » : toute une promesse !
Le modèle de société promu par les islamistes s’attaque à tous les champs de notre vie collective
Je le mesure chaque jour comme préfet : le modèle de société promu par les islamistes appelle à conquérir tous les champs de notre vie collective. Le culte bien sûr, ce qui est aujourd’hui le phénomène le mieux documenté, mais également l’éducation des enfants, la vie associative – de l’entraide alimentaire à la pratique sportive –, ou encore la vie municipale.
Arrêtons-nous quelques instants sur cette réalité qu’il convient de décrire avec autant de précision que possible. Je prendrai pour cela l’exemple du département dans lequel je suis en fonction, les Hauts-de-Seine.
Les lieux de culte
S’agissant des lieux de culte, j’ai choisi « d’entrée de jeu » d’être le plus transparent possible. Quelques semaines après ma prise de fonction, à l’occasion de la présentation publique de la feuille de route de l’État devant l’assemblée départementale, j’ai ainsi indiqué que sur les 34 mosquées et salles de prière que comptait le département, ma vigilance avait été attirée par les services compétents sur près d’un tiers d’entre elles, soit parce qu’elles étaient sous l’influence d’islamistes, soit parce que des islamistes aspiraient à en prendre le contrôle.
C’est à ma connaissance la première fois qu’une telle « opération vérité » était réalisée localement, et si le chiffre a pu dans un premier temps surprendre par son ampleur, j’ai rapidement senti chez mes interlocuteurs une forme de soulagement à ce que le représentant de l’État regarde la réalité en face et mette des mots sur les choses, comme la reconnaissance d’un premier pas vers l’action.
Disons-le là aussi clairement, aucune mosquée ne se revendique comme radicale. Auquel cas le travail d’entrave serait considérablement facilité ! Documenter ce caractère radical implique de considérer tout un faisceau d’indices, de recouper des informations souvent parcellaires et parfois anciennes. Il convient d’abord d’observer les responsables qui l’animent et les imams qui y prêchent. Leur rigorisme peut être caractérisé par leurs déclarations, les mouvances auxquelles ils adhèrent, les individus connus des services de renseignement qui composent leur entourage ou qu’ils ont invités à venir s’exprimer lors de conférences.
Mais dans un environnement fait de dissimulations et de doubles discours, la désormais fameuse taqîya, il convient surtout de rester (très) modeste sur notre capacité à capter des expressions tombant directement sous le coup de la loi. Même dans les mosquées radicales, les prêches ne contiennent plus – sauf quelques rares exceptions – de paroles répréhensibles expressis verbis qui permettraient d’engager sur cette seule base des procédures de fermeture solides. On sait même que certaines mosquées vont jusqu’à faire relire leurs prêches par des avocats pour priver les pouvoirs publics d’angles d’attaque. J’ajoute enfin que la publication, il y a un an, d’un livre-enquête écrit sous pseudonyme par un journaliste indépendant3 a constitué un véritable électrochoc. Les propos qui y étaient rapportés, tenus en marge des prêches, témoignaient de l’ambiance radicale régnant en nombre de lieux de culte qui n’avaient pas nécessairement attiré l’attention des services de l’État jusque lors.
S’agissant des mosquées qui font l’objet de stratégies de prises de contrôle, ce sont les phases de transmission qui sont les plus délicates, à l’image de ce que connaissent d’autres types d’organisations comme les entreprises privées par exemple. Le plus souvent, un responsable charismatique gagné par l’âge aspire à « passer la main », et des offres de service lui sont formulées par des individus peu recommandables. Dans un département comme les Hauts-de-Seine, la nouvelle génération de fidèles est riche en profils « classes sociales supérieures » (CSP+), en apparence modernes et intégrés, réussissant professionnellement dans des secteurs d’activité comme la finance ou le conseil, mais qui cultivent un discours et des réseaux aux antipodes de l’image qu’ils tentent de renvoyer.
Les réseaux sociaux
La lucidité commande enfin de considérer que beaucoup de choses ne se passent plus dans les mosquées, mais pour l’essentiel sur les réseaux sociaux qui comptent des dizaines d’influenceurs extrêmement suivis par la nouvelle génération. Ils allient, avec une redoutable efficacité, propagande islamiste et monétisation de leurs contenus, ce qui leur garantit par ailleurs une confortable source de revenus. L’expansion de l’usage de l’abaya, dans les établissements scolaires par exemple, jusqu’à ce que le gouvernement en prononce l’interdiction ferme, leur doit beaucoup.
L’éducation
La jeunesse constitue pour les islamistes, comme pour toute idéologie en conquête, une cible stratégique. Les écoles confessionnelles dites « hors contrat »4 sont bien sûr un point d’attention pour les pouvoirs publics. Les Hauts-de-Seine en dénombrent deux, situées à Nanterre, pour lesquelles nous diligentons des contrôles. Pendant longtemps, l’instruction en famille a pu également constituer une zone grise mais les restrictions introduites par l’article 49 de la loi CRPR, avec le passage d’un régime de déclaration à un régime d’autorisation, a considérablement réduit le risque de voir grandir des générations d’enfants perdus par la République. Si je prends là encore l’exemple des Hauts-de-Seine, le changement de régime a conduit à une baisse des demandes de 16%5. Le champ des structures, aux statuts privés ou associatifs, dispensant tout à la fois des cours de langue arabe et des enseignements islamiques, autrement appelées « écoles coraniques », fait également l’objet d’une grande vigilance.
Les associations
La vie associative est également un levier largement mobilisé par les islamistes. Elle le doit aux formalités minimales requises pour la création d’une association dans notre pays et à la faiblesse des contrôles dont celle-ci fait l’objet tout au long de son existence. En France, cela est peu connu, mais la liberté d’association revêt une valeur constitutionnelle.
Aussi, sans jamais assumer de caractère confessionnel dans leurs statuts, des kyrielles d’associations apparaissent et sont dans les faits réservées à un public musulman. Dès lors qu’elles ne sollicitent pas d’aides auprès des collectivités publiques ou le droit d’émettre des reçus fiscaux, elles vivent tranquillement leur vie, « en dehors des écrans radars ». Le contrat d’engagement républicain, qui figure à l’article 12 de la loi CRPR, par lequel les associations s’engagent à respecter les principes de la République, ne concerne d’ailleurs que les associations et fondations sollicitant des subventions publiques. Ces dernières leurs étant retirées en cas de non-respect dudit contrat.
Les structures promouvant l’entraide sociale sont ainsi particulièrement nombreuses. C’est un peu comme si le Secours catholique ne venait en aide qu’aux seuls catholiques…
Le sport
Il en est de même pour les associations sportives, ce qui est d’autant plus paradoxal que la pratique sportive est censée être un espace de dépassement et d’ouverture aux autres, sans distinction. Dans ces structures sportives communautaires s’entremêlent dimension confessionnelle et séparation des genres, certaines s’affirmant même ouvertement comme réservées à l’un ou l’autre des sexes. Interrogés par mes services, les responsables musulmans d’une association s’affichant jusque dans son intitulé comme masculine constatèrent avec étonnement qu’aucune femme ne les avait effectivement encore rejoints… Dans la même veine, le débat ancien sur les horaires différenciés dans les piscines pourrait paraître anodin s’il n’était pas une manière d’isoler les femmes du reste de la société.
Le sport en règle générale est d’ailleurs une cible de choix de l’offensive islamiste. Le caractère très récent du débat sur la place du voile dans les compétitions sportives démontre à lui seul qu’il s’agit pour les islamistes de conquérir de nouveaux espaces… Pourquoi la question ne s’était-elle jamais posée jusque lors ? Pendant des décennies, des générations de jeunes femmes musulmanes ont pu pratiquer leur sport en liberté sans que le non-port du voile soit vécu comme une contrainte indépassable. Bien au contraire, au nom des valeurs rappelées plus haut, le sport impliquait de laisser au vestiaire les origines sociales, culturelles ou religieuses, pour se concentrer sur tout ce qui est positif et fait la beauté du sport, et au premier rang le bonheur d’être ensemble.
Pour s’en convaincre, il suffit de regarder qui est le fer de lance de ce combat pour en comprendre la véritable finalité : un collectif baptisé les Hijabeuses, né voici cinq ans dans l’écosystème séparatiste grenoblois… Ce qui est d’autant plus inquiétant, c’est de constater que ces mouvements utilisent l’approche communautaire anglo-saxonne pour faire de l’inclusion non plus un modèle d’effacement des différences mais d’exaltation de celles-ci. Ils le font d’ailleurs avec la complicité de certaines entreprises, une marque comme Nike étant allée jusqu’à oser faire de ces Hijabeuses leurs égéries6. Leur responsabilité est immense dans la diffusion de l’idéologie islamiste, car vis-à-vis de jeunes publics, l’effet d’une marque comme Nike est sans commune mesure avec les avertissements que peut émettre la puissance publique clamentis in deserto.
Le commerce
Justement, le commerce est lui aussi un terrain de conquête islamiste. Bien qu’il réponde à une loi qui lui est propre et qui n’est en rien religieuse, celle du profit, le développement rapide des commerces communautaires s’inscrit dans le sillage des appels à l’entre-soi lancés par les islamistes. Empiriquement, chacun pourra constater en quelques années comment a été bouleversée l’offre commerciale dans certains quartiers, qu’il s’agisse de l’expansion des boucheries halal, des barbiers, des bars à chichas, des librairies islamiques et autres magasins de vêtements orientaux. Mais aussi comment, pour répondre à la demande et sans être victimes d’un quelconque entrisme islamiste, certaines grandes enseignes ont étoffé leur rayon halal…
La vie politique municipale
D’entrisme, en revanche, il est bien question s’agissant de la vie municipale. À un an d’un rendez-vous électoral essentiel, cela a tout lieu d’inquiéter. Et le sujet ne sera pas tant la constitution de listes communautaires revendiquées comme telles, qui à de rares exceptions près n’ont toujours enregistré que des résultats limités dans quelques territoires très ciblés, mais bien la présence de communautaires dans les listes. Là aussi, en transparence et dans le sillage des orientations du ministre d’État Bruno Retailleau, j’ai tenu à alerter les élus du département contre ce phénomène, et j’ai d’ores et déjà signalé à plusieurs maires la présence dans leurs conseils municipaux d’individus islamistes ou liés à des islamistes, de même que certaines tentatives d’approche portées à ma connaissance.
S’il peut y avoir de la naïveté ou de la méconnaissance quant à certaines affiliations, je n’en suis pas moins lucide sur le fait qu’une minorité de maires pensent ainsi se garantir les faveurs d’un électorat… Et comme ce genre d’alliances est rarement sans conséquences, il est certain qu’au cours du mandat, en retour, telle subvention pour une association « amie » ou tel permis de construire visant à l’extension d’une mosquée islamiste seront sollicités auprès du maire réélu. C’est pour cette raison que l’État a un rôle de devoir d’alerte en amont du scrutin.
***
Pris isolément, l’ensemble de ces faits pourraient paraître inoffensifs. Mais la redondance des mêmes identités parmi les différents acteurs en présence dans chacun de ces domaines à l’échelle d’un territoire permet d’établir l’existence d’écosystèmes islamistes locaux. C’est le cas lorsque je constate que le directeur de cabinet du maire d’une ville de mon département est à la fois à la tête d’une ou plusieurs structures s’apparentant à des « écoles coraniques », en plus d’être le secrétaire général de l’association culturelle d’une mosquée placée sous la vigilance de l’État.
La constitution de ces écosystèmes n’est cependant pas l’œuvre d’une « main invisible » qu’il suffirait de dissoudre un matin en conseil des ministres en guise de mesure d’entrave. La réalité est bien plus compliquée. Le mal est beaucoup plus pernicieux car il s’agit d’une idéologie qui se propage. Cela nous impose de mener pied à pied une bataille de valeurs, modèle contre modèle.
Combattre
Je veux notamment rendre hommage au travail de ses grands directeurs généraux avec lesquels j’ai eu la chance de travailler, de l’ancien ministre Laurent Nuñez, notre préfet de police, à Nicolas Lerner, notre directeur général de la sécurité extérieure (DGSE) et aujourd’hui Céline Berthon. La République doit beaucoup à cette femme et ces hommes d’État et, à travers eux, à l’ensemble des agents qui servent ou ont servi sous leur autorité.
Décret du 5 mars 2015.
Article 69 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Gilles Kepel, Le Prophète et la pandémie. Du Moyen-Orient au jihadisme d’atmosphère, Gallimard, coll. « Esprits du monde », 2021.
L’encadrement de l’instruction en famille en particulier, dont nous avons démontré plus haut l’intérêt.
Article 433-3-1 du code pénal (5 ans d’emprisonnement et 75.000 € d’amende).
La mise en danger d’autrui par la diffusion d’informations sur la vie privée, familiale ou professionnelle est désormais pénalement condamnable ; article 223-1-1 du code pénal (3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende).
Ce résultat n’a été rendu possible que par la détermination politique du ministre de l’Intérieur de l’époque, Gérald Darmanin, soutenu par le président de la République, et la constitution de dossiers solidement documentés par les services de l’État. À la manœuvre dans ce travail de fourmi autant que de limier, mon collègue préfet Louis-Xavier Thirode, actuel directeur-adjoint de cabinet du ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau, appuyé d’une structure dont on parle peu, mais qui joue un rôle central dans ce dispositif : la direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) du ministère de l’Intérieur. Il faut là aussi saluer l’action de sa directrice, son adjoint et ses agents qui y œuvrent quotidiennement, dans l’ombre, sans compter leurs heures, pour défendre la République.
Article L. 422-5-1 du code de l’urbanisme.
Les pouvoirs publics sont-ils restés inertes ? La réponse est clairement non, en particulier ces toutes dernières années. Les morts donnant aux menaces la force de l’évidence, les électrochocs provoqués par les attentats djihadistes de janvier puis de novembre 2015 ont réveillé les consciences et marqué le commencement d’une guerre totale contre l’action violente islamiste.
Les services de renseignement, au premier rang desquels la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), chef de file en matière de lutte anti-terroriste en France, ont été considérablement renforcés7.
Le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT)
Des outils nouveaux ont également été mis à la disposition des services de l’État. C’est ainsi qu’est né le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT)8, qui a pour but de mieux centraliser le suivi des individus susceptibles de basculer vers un engagement terroriste. Ce fichier reste aujourd’hui un outil de travail extrêmement utile. Chaque semaine, à l’occasion de ce qu’on appelle le groupe d’évaluation départemental (GED), sont passés en revue, avec le procureur de la République et les services compétents, les individus fichés au FSPRT du département. Dès ma prise de fonction, j’ai choisi la carte de la transparence en révélant publiquement que 252 individus étaient fichés au FSPRT dans les Hauts-de-Seine, dont 32 ressortissants étrangers.
D’autres outils pour lutter contre l’action violente
Au titre des dispositions particulièrement utiles issues de cette période noire des attentats djihadistes figurent également les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS). Dispositif de police administrative « à la main » du ministère de l’Intérieur, avec néanmoins un contrôle exercé a posteriori par le juge, les MICAS permettent d’imposer des obligations de pointages et des périmètres interdits à des individus considérés comme dangereux. Elles ont été très largement mobilisées, voici quelques mois encore, pendant les Jeux olympiques et paralympiques (JOP) de l’été 2024 afin de prévenir toute menace terroriste, alors que notre pays, qui accueillait le plus grand évènement du monde, était surexposé à un risque de cette nature. Directeur de cabinet du ministre de l’Intérieur pendant l’organisation des JOP, je peux témoigner que le sans-faute sécuritaire observé tout au long de ces semaines de compétition leur doit beaucoup.
Du côté du ministère de la Justice, aussi, les lignes ont bougé. Un parquet national anti-terroriste (PNAT), structure spécialisée dotée d’une compétence nationale, a été mis en place en 20199. Il est devenu un acteur central du dispositif de lutte anti-terroriste.
Aujourd’hui, les individus constituant une menace d’action violente sont suivis avec une extrême vigilance par l’ensemble des services de l’État, au niveau central comme local. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que nous évoluons dans un environnement sans risque, loin de là. Cela est d’autant plus vrai que nous entrons dans une phase nouvelle où les sorties de détention d’individus condamnés il y a une dizaine d’années vont se multiplier, ce qui n’ira pas sans provoquer une réelle mise sous tension des services compétents. De même, les enfants des djihadistes français partis sur zone, nés pour certains en Syrie, et qui ont été rapatriés ces dernières années, devront continuer de faire l’objet d’une attention redoublée, et cela dans la durée et à tous les stades de leur développement. Et pour compléter le tableau, les ravages liés à l’expansion des troubles psychiatriques et leur prise en charge insuffisante, chez les jeunes en particulier, peuvent faciliter le passage à l’acte.
Mais le combat contre les islamistes a priori « non violents » a, lui aussi, été bien engagé, en paroles mais surtout en actes.
2020 : le discours des Mureaux du président Macron et la lutte contre le séparatisme
Le 2 octobre 2020 aux Mureaux, dans un discours fondateur, le président de la République Emmanuel Macron a présenté une stratégie nouvelle dite de « lutte contre le séparatisme ». Il s’agissait là d’un véritable tournant, puisque c’est la toute première fois que les pouvoirs publics ne considéraient plus la seule radicalisation violente mais appréhendaient le développement du communautarisme comme un outil de fracturation de l’unité nationale.
Les deux sujets n’en restaient pas moins profondément liés, puisque outre la cause commune contre les valeurs de la République établie de facto entre djihadistes et islamistes non-violents, ces derniers sont apparus aux origines d’un climat d’hostilité à l’égard de tout ce que représente notre pays, propice à susciter le passage à l’acte violent d’individus instables. Alors que la menace dite « exogène », c’est-à-dire pilotée depuis l’étranger, s’était réduite à la faveur de l’affaiblissement de l’État islamique et de la montée en compétences de nos services de renseignement, c’est cette menace intérieure dite « endogène », stimulée à l’intérieur de nos frontières, qui s’est imposée ces dernières années.
Deux semaines après que le discours des Mureaux fut prononcé, le 16 octobre 2020, le professeur d’histoire-géographie Samuel Paty était assassiné par un jeune réfugié russe d’origine tchétchène, Abdoullakh Anzorov. Au-delà de la question des interactions avec des individus localisés à l’étranger, Anzorov fut d’abord influencé par la vidéo virale d’un militant islamiste, Abdelhakim Sefrioui. De ce mécanisme que le politologue, spécialiste du monde arabe contemporain et de l’islamisme radical, Gilles Kepel qualifia si justement de « djihadisme d’atmosphère10 », Samuel Paty fut la première victime.
Pour donner une traduction opérationnelle à cette stratégie de lutte contre le séparatisme, un projet de loi confortant le respect des principes de la République a donc été présenté au vote du Parlement. Ce fut chose faite après de longues heures de débats houleux11, permettant là aussi à l’État de se doter d’outils nouveaux.
Au-delà des mesures déjà citées, il convient de souligner le contrôle renforcé des associations et de leurs financements, une meilleure protection des agents publics, avec notamment l’instauration d’un délit de séparatisme visant à protéger élus et agents publics contre les menaces ou les violences pour obtenir une exemption ou une application différenciée des règles du service public12, la lutte contre la haine en ligne (dont le fameux « délit Samuel Paty13 ») ou encore le renforcement de la laïcité et de la neutralité dans les services publics.
La loi a également élargi les motifs de dissolutions des associations. Ces dernières années, certaines structures islamistes parmi les plus influentes, et qui prospéraient jusque lors sur le territoire national en toute impunité, ont pu être neutralisées. Ces dissolutions ont été accompagnées pour certaines d’entre elles par le gel de leurs avoirs, permettant ainsi de leur couper financièrement les ailes. Parmi ces dissolutions emblématiques, citons celles du Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF) et de BarakaCity en décembre 2020, décisions confirmées depuis par le Conseil d’État. Ces mesures ont incontestablement permis d’entraver leurs actions, même si ces structures ont tenté de poursuivre leurs activités depuis l’étranger14.
Ce travail se poursuit encore aujourd’hui, avec la décision portée le 16 avril dernier en Conseil des ministres par le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau de dissoudre le groupement de fait Sciences et Éducation. « Il faut imaginer Sisyphe heureux » disait Camus !
Flanqués de toutes les libertés évoquées plus haut, qu’il s’agisse de la liberté de culte, d’association ou de commerce, autant de vecteurs de diffusion potentiels de l’idéologie islamiste, sommes-nous engagés dans un combat équilibré ? Sans compter les réseaux sociaux, qui voient une attaque contre la liberté d’opinion dans toute tentative d’encadrer leurs activités …
À cette question soulevée régulièrement dans le débat public, le lecteur ne s’étonnera pas qu’on lui réponde par la négative. Non, bien sûr, le combat ne se déroule pas à armes égales. Nous sommes dans une démocratie libérale et un État de droit, ce qui nous contraint davantage que nos adversaires. Mais cela donne aussi une force incroyable à la décision publique, car sur une matière aussi sensible, elle lui évite tout réel procès en illégitimité. Voilà un point capital si la puissance publique veut être respectée par toutes et tous.
Alors, oui, nous nous battons avec des sacs de plomb accrochés aux pieds, mais nos victoires sont d’autant plus grandes qu’elles s’inscrivent dans le cadre de l’État de droit républicain, et peuvent être nombreuses et décisives, à la condition bien sûr qu’on y mette toute l’énergie qu’il faut. Libre au législateur d’ouvrir l’étau de la contrainte qui enserre les épaules des acteurs de terrain engagés dans cette lutte, mais nous touchons là aux limites du devoir de réserve qui m’incombe… Quoi qu’il en soit, les Français doivent savoir que, chaque jour, nous luttons contre l’islamisme.
La mise en place de mesures d’entrave
Pour les islamistes n’ayant pas la nationalité française, le droit des étrangers est un levier systématiquement interrogé. Le principe est simple : les étrangers qui troublent l’ordre public n’ont pas leur place sur le sol français, et l’islamisme – en ce qu’il induit des paroles et des actes contraires à la République – peut être assimilé à un trouble à l’ordre public. Pendant les quatre années où j’ai travaillé Place Beauvau, c’est-à-dire entre 2020 à 2024, cinq imams ont ainsi été expulsés. Le plus emblématique est incontestablement l’imam Hassan Iquioussen, expulsé du territoire national sur la base des propos haineux, aux antipodes de nos valeurs, qu’il avait tenus à l’occasion de prêches et de conférences. Après avoir épuisé ses voies de recours devant la juridiction administrative, Iquioussen avait fui en Belgique avant d’être finalement expulsé vers le Maroc le 13 janvier 2023. Ce long feuilleton médiatique s’était ainsi conclu par une victoire déterminante de la puissance publique contre l’une des figures de l’islamisme en France. Quant aux quelques marques de soutien qu’il avait reçues d’une partie des responsables du culte musulman, elles auront eu le mérite de révéler au grand jour leurs « ambiguïtés » et d’éveiller avec elles la vigilance des services de l’État à leur égard.
Comme rappelé plus haut, les lieux de culte font évidemment l’objet d’une attention particulière. Tout propos qui me serait rapporté, en ma qualité de préfet, et qui serait susceptible de poursuites pénales fait l’objet d’un signalement au procureur de la République, signé par le préfet de Police Laurent Nuñez ou moi-même selon la source dont il émane ; c’est ce qu’on appelle un « article 40 », en référence à l’article du code de procédure pénale auquel il renvoie.
S’agissant des projets d’extension ou de construction de mosquées, j’en dénombre 17 dans le département, qui fort heureusement ne sont pas tous portés par des structures islamistes ! Mais si les circonstances l’imposent, je peux être amené à alerter les maires auxquels il revient de délivrer le permis de construire. En la matière, et depuis la loi CRPR, le préfet formule bien un avis sur ces demandes de permis mais celui-ci est « simple15 », c’est-à-dire que la collectivité concernée doit le prendre en compte dans sa décision mais n’est pas obligée de le suivre.
Au-delà de ce que la loi nous permet de faire, je crois aussi aux vertus d’un autre moyen d’entrave, très puissant dans une société médiatique : la transparence. Un peu à l’image des vendeurs de drogue aux pieds des immeubles, les islamistes détestent la lumière : cela gêne le business ! J’ai déjà indiqué à mes interlocuteurs que je n’hésiterai pas à utiliser le levier de la dénonciation publique ou name and shame s’il est le seul à pouvoir stopper la progression des lieux de culte islamistes par exemple.
S’agissant des autres types de structures évoquées plus haut, comme les écoles, les commerces et les associations, je réunis chaque mois la cellule départementale de lutte contre l’islamisme et le repli communautaire (CLIR). Y participent les différentes administrations de l’État, qu’elles soient placées ou non sous mon autorité, l’administration fiscale entrant dans cette seconde catégorie. Nous examinons à cette occasion les situations de ces structures pour lesquelles nous soupçonnons une emprise islamiste. Et nous décidons de mesures d’entrave, sur la base le plus souvent de contrôles inter-administrations. En jouant avec toute la palette que nous autorise le droit, nous obtenons ici une fermeture temporaire ou permanente, là une importante amende.
À l’heure où j’écris ces lignes, la CLIR des Hauts-de-Seine examine un portefeuille de 60 cibles, un chiffre faible à la lumière de mes premiers mois d’observation. Pour « stimuler » ce vivier, j’ai donc sollicité l’ensemble des maires du département pour leur demander de me signaler toute structure qui leur semblerait correspondre à ce que nous recherchons. Ils sont un relai très précieux car, en étant au plus près du terrain, ils perçoivent des signaux faibles qui échappent aux services de l’État.
D’une manière générale, il serait illusoire de croire que l’État, seul, a tous les leviers. Nous agissons, comme je l’ai rappelé plus haut, dans le cadre d’un État de droit… dont l’organisation est, de plus, décentralisée. Les collectivités ont donc un rôle essentiel à jouer à travers la plénitude de leurs compétences et qui ne se limite pas au signalement de faits suspicieux ou à la signature ou non de permis de construire. Il peut s’agir, par exemple, d’une politique offensive de rénovation urbaine, consistant à « casser » les quartiers dans lesquels prospère le communautarisme en y créant davantage d’ouverture et de mixité. Ou encore du soutien à des actions associatives visant à faire pleinement adhérer la nouvelle génération aux valeurs de la République, celle-là même dans laquelle se joue – et en cela les islamistes ont raison ! – l’essentiel de notre bataille. Mais à défaut d’être volontaires pour mener le combat, les élus de la République devraient se donner pour premier devoir de ne pas accepter la main tendue par ses ennemis et refuser ainsi ce qui s’apparente à un pacte de corruption des consciences. Il vaut mieux parfois perdre une élection que perdre son âme. Ce message, je continuerai de le porter avec force au nom de l’État dans ce territoire encore, pour partie, préservé.
La construction d’un islam de France
Je crois enfin en un dernier moyen d’entrave, celui de l’émergence d’interlocuteurs républicains, légitimes et identifiés parmi les représentants du culte musulman. Car si l’État ne reconnaît ni ne préfère aucun culte, il conserve le droit de choisir au sein de ceux-ci ses interlocuteurs pour traiter des grandes questions relatives à la place faite aux croyants dans la société laïque. Au niveau national, le Forum pour l’Islam de France (FORIF) que j’évoquais plus haut, et sa déclinaison locale en assises territoriales, est en cela une initiative essentielle. Mis en place en 2022, le FORIF rassemble des acteurs de terrain reconnus pour leurs compétences, leur capacité à être force de propositions et leur aptitude au dialogue. Certains individus s’y sont vu interdire l’entrée au motif de la dangerosité de leurs idées, et c’est heureux. Des questions aussi essentielles que la sécurité des lieux de culte et la lutte contre les actes antimusulmans, le recrutement des imams ou encore la gestion des aumôneries y sont abordées. Lors de la session organisée le 18 février dernier, Bruno Retailleau y a notamment annoncé une mission parlementaire à propos de la question des « carrés musulmans » dans les cimetières, qui est un problème concret et douloureux pour de nombreuses familles, le manque de places pouvant contraindre au rapatriement à l’étranger de défunts pourtant nés en France.
La création du FORIF figure parmi un ensemble plus large de décisions visant à consolider un islam de France. Depuis le 1er janvier 2024, la fin du système dit des « imams détachés », c’est-à-dire la présence sur notre sol d’imams envoyés et rémunérés par des pays étrangers, est à ce titre un acte très important. Ces ministres du culte conservaient des liens forts avec leur pays d’origine en termes de formation, de doctrine, voire d’allégeance. Sans compter qu’ils ne parlaient pas toujours notre langue ni n’avaient assimilé notre socle de valeurs, notamment le principe de laïcité, et que certaines mouvances étrangères peuvent être qualifiées d’islamistes. L’impact sur le sujet qui nous occupe ici n’est donc pas mince, au-delà des questions d’ingérence qui sont un enjeu de souveraineté nationale.
Conclusion : c’est à nous, mais aussi peut-être d’abord à nos compatriotes musulmans, de livrer ce combat
L’islamisme propose un modèle de société. Pour le disqualifier, il ne suffit pas de le critiquer, il faut le concurrencer. Un cours d’histoire qu’on laisse interrompre sans conséquences, un terrain qu’on vend pour permettre l’extension d’une mosquée radicale, un islamiste avec lequel on continue de discuter parce qu’il serait « représentatif »… L’ère des « accommodements raisonnables », petits et grands, par calcul ou par paresse, comme autant d’entailles au pacte républicain, doit toucher à sa fin et là est notre responsabilité collective.
Quand la République recule, ce n’est pas parce que le modèle n’aurait pas la force suffisante pour mener ce combat, mais parce qu’en laissant prospérer ces accommodements, nous refusons d’appliquer tout à la fois la lettre et l’esprit d’intransigeance pourtant consubstantiels à la République. Nous devons affirmer la force inébranlable du contre-modèle que nous proposons. Le Premier ministre ne nous invite pas à autre chose quand il dit dans son discours de politique générale le 14 janvier dernier devant le Parlement que « la République n’existe que lorsqu’elle se fait respecter ». La République n’est pas un corpus mou, elle peut être indestructible et tranchante, pour autant qu’on s’en saisisse pleinement.
Les Frères musulmans et tous les avatars islamistes doivent être déclarés persona non grata et, chacun à notre place, État, collectivités, acteurs de la société civile, nous avons la responsabilité de les faire plier.
Mais c’est aussi, et peut-être d’abord, à nos compatriotes musulmans eux-mêmes de mener ce combat. Au moment de conclure mon propos, et comme je l’ai fait dans mon discours de la mosquée des Abeilles, c’est à eux que je veux m’adresser : la République vous aime, et vous y avez toute votre place. Dans votre écrasante majorité, vous avez fait vôtres au quotidien les valeurs de la République. À vous de mener cette lutte contre l’islamisme, dans vos familles, parmi vos amis, à la mosquée si vous vous y rendez. Ne laissez pas prospérer les discours de haine qui ne promettent en guise de dépassement que le repli et le recul, et que triomphent des idées de paix, d’égalité, de respect entre les genres et entre toutes les religions. Il en va de notre beau et grand pays tout autant que de votre belle et grande religion.


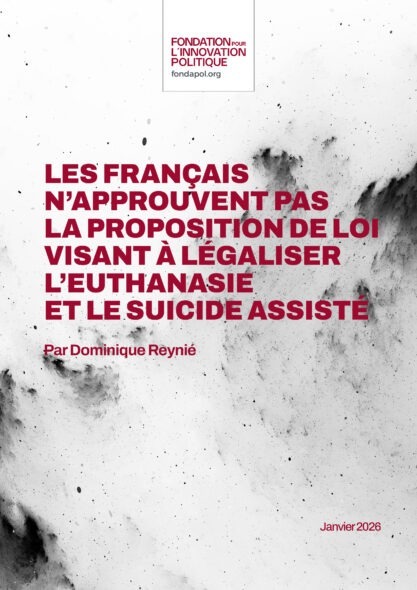










Aucun commentaire.