Enjeux juridiques d'une légalisation d'un « droit à l'aide à mourir »
Avant-propos
Les implications constitutionnelles : légalité, clarté de la loi et contrôle de proportionnalité
La création d’une dérogation majeure à l’interdit de tuer : enjeux de légalité et de précision
Le champ d’accès à l’« aide à mourir » : un critère extensif susceptible de fragiliser la loi
La question du refus de traitement comme déclencheur d’éligibilité : nécessité et proportionnalité
Les implications conventionnelles de la proposition de loi : la balance entre droit à la vie et euthanasie
Les implications de l’« aide à mourir » sur le droit de la santé et la protection des vulnérabilités
L’« aide à mourir » comme transformation de la finalité du soin et du rôle des professionnels de santé
L’expression d’une volonté fragile au cœur du dispositif : exigences classiques et risque d’une volonté juridiquement “allégée”
La protection des vulnérables face à un droit à mourir : un risque de bascule dans une logique de sélection implicite
L’« aide à mourir » comme facteur de recomposition de l’ordre public sanitaire
Les implications de l’« aide à mourir » en droit pénal : entre fait justificatif et insécurité normative
L’« aide à mourir » et la persistance des incriminations pénales autour du suicide
Les qualifications criminelles et délictuelles susceptibles de ressurgir en cas de non-respect des conditions légales
L’insécurité pénale comme conséquence de critères médicaux indéterminés
Conclusion
Une loi de fin de vie ou une loi de rupture : bilan des tensions juridiques majeures
Le risque d’insécurité normative : médicalisation, pénalisation résiduelle, contentieux
L’enjeu de cohérence axiologique : l’État peut-il autoriser ce qu’il a pour mission de prévenir ?
Résumé
L’étude analyse les enjeux juridiques majeurs de la proposition de loi instaurant un « droit à l’aide à mourir ». Ce texte ne constitue pas un simple aménagement du droit de la fin de vie, mais une rupture normative profonde, affectant les principes fondateurs de l’État de droit.
Sur le plan constitutionnel, la loi créerait une dérogation inédite à l’interdit pénal de tuer, en admettant qu’un consentement puisse justifier un acte létal. Or le principe de légalité impose des critères clairs et précis. Les notions d’« affection grave et incurable », de « phase avancée », de « pronostic vital engagé » ou de « souffrance insupportable » trop indéterminées, font peser un risque d’inconstitutionnalité et d’insécurité juridique. La question de la proportionnalité se pose également : l’atteinte au droit à la vie est-elle strictement nécessaire alors que le refus de traitement et les soins palliatifs existent déjà ?
Au regard de la Convention européenne des droits de l’homme, notamment de son article 2, la dépénalisation de l’euthanasie suppose des garanties strictes pour protéger la liberté du consentement et prévenir les abus. Le texte envisagé insuffisamment encadré, ne prévoit pas de contrôle a priori effectif.
En droit de la santé, l’« aide à mourir » transforme la finalité du soin : le médecin ne serait plus seulement chargé de soulager, mais pourrait administrer la mort. Le risque de fragilisation du consentement est exacerbé chez les personnes vulnérables (âgées, handicapées, isolées), exposées à des pressions sociales ou économiques.
Enfin, en droit pénal, toute méconnaissance des conditions légales de l’« aide à mourir » entraînera des poursuites pour empoisonnement, abus de faiblesse ou provocation au suicide. La réforme déplacera ainsi le risque pénal sans le supprimer, générant un contentieux important.
La légalisation de l’« aide à mourir » introduira une contradiction majeure : l’État, garant de la protection de la vie, deviendrait autorisé à en organiser la suppression, au risque de fragiliser la cohérence axiologique de l’ordre juridique démocratique.
Aline Cheynet de Beaupré,
Professeur de droit privé à l’Université d’Orléans.
Laurent Frémont,
Maître de conférences en droit constitutionnel à Sciences Po.
Didier Guérin,
Président honoraire de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
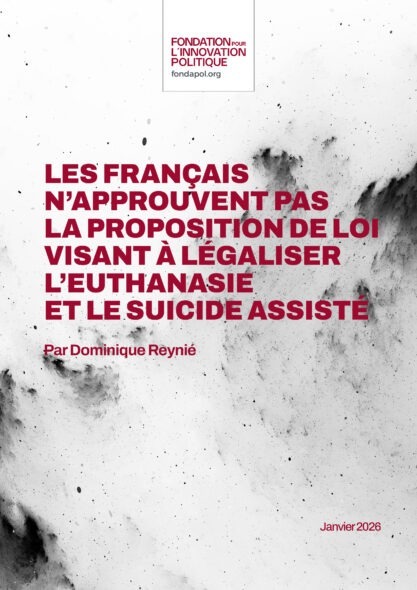
Les Français n'approuvent pas la proposition de loi visant à légaliser l'euthanasie et le suicide assisté
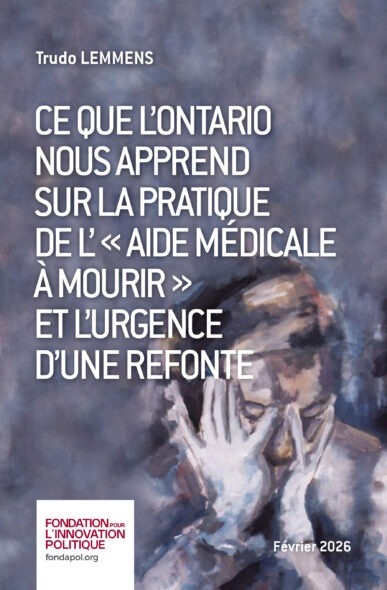
Ce que l'Ontario nous apprend sur la pratique de l'« aide médicale à mourir » et l'urgence d'une refonte
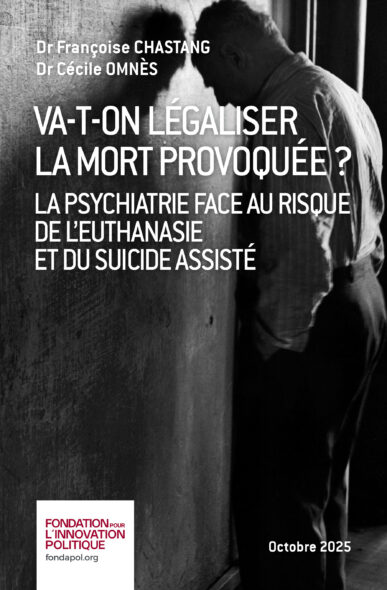
Va-t-on légaliser la mort provoquée ? La psychiatrie face au risque de l'euthanasie et du suicide assisté

Va-t-on légaliser la mort provoquée ? Le handicap face au risque de l'euthanasie et du suicide assisté

Va-t-on légaliser la mort provoquée ? La gériatrie face au risque de l'euthanasie et du suicide assisté

Les non-dits économiques et sociaux du débat sur la fin de vie
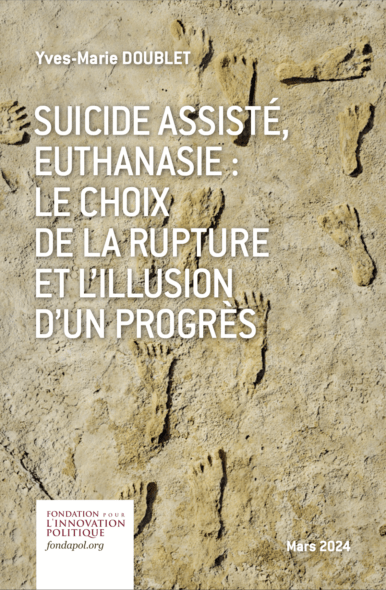
Suicide assisté, euthanasie : le choix de la rupture et l'illusion d'un progrès

Les mots de la fin de vie : ne pas occulter les termes du débat
La Loi par Jean-Jacques Feuchère. Marbre, 1852.
Place du Palais-Bourbon, VIIe arrondissement de Paris.

Copyright :
©Marie-Lan Nguyen/Wikimedia Commons
Avant-propos
Il est des textes qui ne se contentent pas de modifier une règle ou d’aménager une procédure, mais qui touchent au cœur même de ce qui fonde l’ordre juridique. La proposition de loi relative au « droit à l’aide à mourir » appartient à cette catégorie rare et grave : elle interroge la vocation première du droit dans une démocratie, sa fonction protectrice, et la signification même de l’État de droit.
Car le droit n’est pas seulement un instrument d’organisation sociale. Il est, avant tout, une institution de civilisation. Il exprime ce qu’une société décide de tenir pour intangible : la dignité de la personne humaine, l’égalité de toutes les vies, la protection des plus vulnérables. Lorsque la loi envisage de reconnaître, même sous des conditions supposément strictes, une assistance à mourir, elle ne se borne pas à répondre à une demande individuelle ; elle engage une transformation symbolique majeure : l’État devient susceptible d’autoriser ce qu’il avait pour mission première d’empêcher, à savoir l’atteinte volontaire à la vie.
Une démocratie se mesure à la manière dont elle traite ceux dont l’existence est fragilisée. La souffrance appelle la solidarité, le soin, l’accompagnement, non l’organisation juridique de la disparition. La tentation est grande, dans des sociétés où l’autonomie est devenue la valeur cardinale, de considérer que le consentement suffirait à fonder la légitimité d’un acte. Mais le droit a toujours su qu’il existe des limites : certaines atteintes demeurent illicites, même consenties, parce qu’elles touchent à l’ordre public humain, à ce qui rend possible l’idée même de sujet de droit.
C’est pourquoi l’examen de cette proposition de loi ne saurait être réduit à une controverse morale ou à un débat émotionnel. Il exige une réflexion juridique rigoureuse sur les implications légales, pénales, constitutionnelles d’une telle rupture normative. Car reconnaître un « droit à mourir » n’est pas seulement ajouter un droit de plus : c’est déplacer la hiérarchie des principes, reconfigurer le rapport entre liberté et protection, et poser la question vertigineuse de savoir si l’État peut demeurer pleinement fidèle à sa mission lorsqu’il consent à administrer la mort.
C’est à ces tensions, à la fois techniques et fondamentales, que cette étude se propose de répondre, en révélant les contradictions que la légalisation de l’« aide à mourir » pourrait faire naître au cœur même des principes fondateurs de l’État de droit démocratique.
Les implications constitutionnelles : légalité, clarté de la loi et contrôle de proportionnalité
La création d’une dérogation majeure à l’interdit de tuer : enjeux de légalité et de précision
Cass. crim., 23 juin 1838 : S. 1838, 1, p. 636 ; Cass. crim., 17 juill. 1851 : Bull. crim. 1851, n° 287 ; Cass. crim., 21 août 1851: S. 1852, 1, p. 286 ; DP 1851, 5, p. 23.
La proposition de loi relative au « droit à l’aide à mourir » institue une exception inédite à l’interdit pénal de donner la mort. Une telle dérogation, qui affecte l’un des principes les plus structurants du droit pénal, soulève des enjeux majeurs de légalité, de précision normative et de sécurité juridique. Elle impose d’examiner avec une particulière rigueur les conditions dans lesquelles le législateur entend encadrer ce nouveau fait justificatif, tant au regard des principes constitutionnels que des exigences fondamentales de cohérence de l’ordre juridique.
La rupture avec le principe classique d’inefficacité du consentement de la victime en matière homicide
L’essence même du texte relatif au « droit à l’aide à mourir » est de fonder légalement l’autorisation d’aider une personne à mourir par la fourniture ou l’administration d’une substance létale. Il s’agit ainsi d’instituer une dérogation fondamentale au principe, traditionnellement intangible en droit pénal français, selon lequel le consentement de la victime ne peut légitimer un acte homicide. La Cour de cassation l’a affirmé de longue date : dans un arrêt du 23 juin 1838, la chambre criminelle juge que le fait d’avoir donné la mort, même avec le consentement ou à la demande de la victime, n’ôte rien à la qualification criminelle de l’acte1.
Les exigences constitutionnelles de clarté et de précision de la loi pénale et de ses faits justificatifs
La création d’un fait justificatif neutralisant la responsabilité pénale doit satisfaire pleinement aux exigences constitutionnelles issues de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui consacre le principe de légalité des délits et des peines. Le Conseil constitutionnel exige que le législateur définisse lui-même le champ d’application des incriminations et des immunités de manière suffisamment claire et précise. Dans sa décision n° 98-399 DC du 5 mai 1998 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, il a censuré une disposition instituant une immunité pénale au bénéfice d’associations à but non lucratif « à vocation humanitaire » dont la liste devait être fixée par le ministre de l’Intérieur, au motif que le législateur n’avait pas déterminé avec une précision suffisante le champ de l’exonération. De même, dans sa décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, il a déclaré contraire à la Constitution une disposition instituant, dans des conditions imprécises et discriminatoires, une cause d’exonération de la répression pénale en matière d’édition de logiciels manifestement destinés à l’échange non autorisé d’œuvres protégées. Ces décisions illustrent une exigence renforcée lorsque la loi institue une dérogation à une incrimination pénale : la frontière entre le comportement autorisé et celui qui demeure réprimé doit être tracée avec une netteté particulière.
L’indétermination des notions médicales comme cause potentielle d’inconstitutionnalité
À cet égard, la condition fondamentale d’accès à l’« aide à mourir » fixée par le 3° du projet d’article L. 1111-12-2 du Code de la santé publique appelle une attention particulière. Les notions de « phase avancée », de « phase terminale » ou d’« engagement du pronostic vital », ainsi que l’appréciation d’une « souffrance psychologique constante et insupportable », reposent sur des critères médicaux et subjectifs susceptibles d’interprétations variables. Or, la méconnaissance d’une de ces conditions ferait disparaître le fait justificatif et pourrait faire basculer l’auteur de l’acte dans le champ d’incriminations criminelles, telles que l’empoisonnement.
Dans une telle configuration, l’exigence constitutionnelle de prévisibilité et de sécurité juridique prend une acuité particulière : la loi doit permettre aux professionnels concernés de déterminer avec suffisamment de certitude si leur comportement est licite ou pénalement répréhensible. À défaut d’une définition suffisamment précise des critères d’éligibilité et des garanties procédurales entourant leur vérification, le dispositif pourrait être regardé comme ne satisfaisant pas pleinement aux exigences du principe de légalité criminelle. La constitutionnalité de la dérogation instituée dépend ainsi étroitement du degré de clarté et de précision apporté à ces notions médicales structurantes.
Le champ d’accès à l’« aide à mourir » : un critère extensif susceptible de fragiliser la loi
L’affection grave et incurable engageant le pronostic vital : une condition juridiquement ouverte
Le texte permettrait l’accès à l’« aide à mourir » pour toute personne « atteinte d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée […] ou en phase terminale ». Si cette formulation paraît restrictive, elle repose en réalité sur l’agrégation de notions médicales dont la portée demeure largement ouverte. Les expressions « affection grave et incurable », « pronostic vital engagé », « phase avancée » ou encore « processus irréversible » ne correspondent pas à des seuils médicaux objectivables de manière uniforme et sont susceptibles d’interprétations variables selon les pathologies et les praticiens. En l’absence de critères temporels ou cliniques précisément définis, la détermination du moment à partir duquel la condition serait remplie demeure incertaine. Une telle indétermination fragilise la prévisibilité de la norme pénale, alors même que le respect de ces conditions constitue le fondement du fait justificatif neutralisant une incrimination criminelle. La condition tenant à l’engagement du pronostic vital apparaît ainsi moins comme un verrou strict que comme une notion juridiquement ouverte, dont l’extension dépendra inévitablement de l’interprétation qui en sera faite dans la pratique.
La multiplicité des termes pourrait laisser croire que le champ fixé est précisément déterminé. Leur analyse laisse cependant interrogatif. La formule « affection grave et incurable qui engage le pronostic vital en phase avancée » inclut de nombreuses maladies non mortelles à moyenne ou à courte échéance. L’entrée dans un processus irréversible marquée par l’aggravation de l’état de santé n’entraîne pas un décès certain dans un délai rapproché alors même que la médecine peut encore agir pour ralentir l’évolution de la maladie. Sur le plan temporel, le texte fixe donc une limite de départ – au demeurant, on vient de le voir, assez imprécise – mais pas de limite se référant au délai prévisible du décès.
Le risque d’extension du dispositif au-delà des situations de fin de vie rapprochée
En définitive, les termes utilisés englobent des affections de longue durée qui ne débouchent pas nécessairement sur une mort inéluctable à court ou à moyen terme. La condition de fond d’accès à l’« aide à mourir » est ainsi largement laissée à l’appréciation du médecin saisi de la demande, sans que le texte ne circonscrive clairement le dispositif aux seules situations de fin de vie rapprochée. Cette ouverture normative est susceptible de conduire, dans la pratique, à une extension progressive du champ des personnes éligibles, au-delà de l’objectif initialement présenté comme exceptionnel.
Or, dès lors que l’« aide à mourir » repose sur une immunité pénale neutralisant l’interdit de donner la mort, l’imprécision des critères d’accès peut soulever une difficulté particulière au regard du principe de légalité des crimes et des délits, qui exige une définition claire et prévisible des conditions dans lesquelles une telle dérogation est admise.
La question du refus de traitement comme déclencheur d’éligibilité : nécessité et proportionnalité
L’éligibilité créée par le patient lui-même : la fragilité du raisonnement juridique
Une autre interrogation constitutionnelle naît de la disposition selon laquelle a « droit à l’aide à mourir » la personne se trouvant dans les conditions de détérioration de santé qui viennent d’être évoquées et dont la souffrance est insupportable alors qu’elle a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement. C’est donc le patient qui, par son refus du traitement, met celui qui aide à sa mort dans les conditions du fait justificatif de l’« aide à mourir ». Ceci pourrait par exemple concerner une personne atteinte d’un mal incurable et qui refuse tout secours de la médecine. Se pose à cet égard des questions de nécessité, voire de proportionnalité de la dérogation faite à l’interdiction de porter atteinte à la vie d’autrui.
La proportionnalité de l’atteinte au droit à la vie : l’« aide à mourir » est-elle strictement nécessaire ?
Dans le cadre de la présente proposition de loi, la question centrale de la proportionnalité de l’atteinte au droit à la vie – garanti tant par l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme que par les exigences constitutionnelles découlant du Préambule de 1946 – conduit à s’interroger sur le caractère strictement nécessaire du dispositif d’« aide à mourir ». Le Conseil constitutionnel contrôle, de manière constante, que les atteintes portées à un droit ou à une liberté constitutionnellement protégés soient adaptées, nécessaires et proportionnées à l’objectif poursuivi.
En l’espèce, l’objectif invoqué est celui du respect de l’autonomie personnelle et de la dignité face à des souffrances jugées insupportables. Toutefois, la nécessité de la dérogation à l’interdiction de porter atteinte à la vie d’autrui doit être appréciée au regard de l’existence de mécanismes déjà reconnus par le droit positif, notamment le droit au refus de traitement et l’accès aux soins palliatifs. Si le patient peut, en refusant un traitement, créer lui-même les conditions d’éligibilité à l’« aide à mourir », la causalité normative de l’acte létal s’en trouve déplacée : l’intervention du tiers devient juridiquement permise non parce que la situation est médicalement inéluctable, mais parce qu’un choix subjectif a modifié l’état de fait. Cela soulève une interrogation sérieuse quant au caractère strictement indispensable de l’atteinte portée au droit à la vie.
La même analyse vaut pour l’inclusion de la souffrance psychologique, notion par nature évolutive et subjective, dont la délimitation imprécise pourrait conduire à un élargissement significatif du champ de la dérogation. Dès lors, la constitutionnalité du dispositif dépendrait de la capacité du législateur à encadrer rigoureusement les conditions d’accès et à démontrer que l’« aide à mourir » constitue, dans ces hypothèses, une mesure ultime, qu’aucune alternative moins attentatoire à la vie ne permet raisonnablement de remplacer.
Les implications conventionnelles de la proposition de loi : la balance entre droit à la vie et euthanasie
Du droit à la vie au droit à la mort provoquée
Le droit à mourir est-il totalement compatible avec la Convention européenne des droits de l’homme à appréhender sous l’angle de son article 2, considéré par elle comme « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. » ?
A cet égard, il faut de se référer à l’arrêt rendu le 4 octobre 2022 par la Cour européenne dans l’affaire Mortier c. Belgique (requête n° 78017/17), arrêt à l’occasion duquel un juge de la Cour, par une opinion dissidente, a d’ailleurs estimé qu’aucun cadre législatif entourant pareille pratique (l’euthanasie) – quelles qu’en soient la qualité ou les « garanties » associées – ne peut préserver le droit à la vie consacré par l’article 2 de la Convention.
La Cour européenne a, par cet arrêt, admis le recours à l’euthanasie en affirmant toutefois qu’il n’est pas possible de déduire de l’article 2 de la Convention un droit de mourir, que ce soit de la main d’un tiers ou avec l’assistance d’une autorité publique2 et en apportant dans sa décision d’importantes réserves qui vont maintenant être examinées.
L’encadrement requis par la Cour européenne : liberté du consentement et prévention des dérives
L’État doit :
– non seulement s’abstenir de donner la mort « intentionnellement » (obligation négative), mais aussi prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (obligation positive)3.
– empêcher un individu de mettre fin à ses jours si sa décision n’avait pas été prise librement et en toute connaissance de cause4.
La Cour européenne relève que le droit d’un individu de décider de quelle manière et à quel moment sa vie doit prendre fin constitue l’un des aspects du droit au respect de sa vie privée et qu’il ne peut être exclu que le fait d’empêcher par la loi une personne d’exercer son choix d’éviter ce qui, à ses yeux, constituera une fin de vie indigne et pénible, représente une atteinte au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention (§135). Il n’en demeure pas moins que, pour être compatible avec l’article 2 de la Convention, la dépénalisation de l’euthanasie doit donc être encadrée par la mise en place de garanties adéquates et suffisantes visant à éviter les abus et, ainsi, à assurer le respect du droit à la vie (§139).
Ces conditions sont-elles remplies par le texte envisagé ? On peut à cet égard, à titre d’exemples, et sans préjudice d’autres questions susceptibles d’être rencontrées, d’ores et déjà soulever quelques interrogations que des requérants pourraient soulever devant la Cour :
– La liberté de décision de la personne souhaitant l’« aide à mourir » alors qu’elle présente une souffrance psychologique pourra être mise en doute alors même que le texte n’exige pas qu’elle soit examinée par un psychiatre.
Permettre à cette personne de solliciter l’euthanasie sans vérification complémentaire médicale plus approfondie pourra être considérée comme ne présentant pas les garanties requises par la Cour européenne.
– Le collège pluriprofessionnel saisi par le médecin sollicité par la personne souhaitant recevoir l’« aide à mourir » jouera un rôle flou, donc d’une portée juridique indéfinie puisqu’il n’est pas précisé les modalités qu’il suivra pour prendre position et le médecin prendra seul sa décision qu’il notifiera, oralement et par écrit, à l’intéressée ainsi que, le cas échéant, à la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne.
– Les modalités de vérification du maintien de la volonté de la personne le jour de l’administration de la substance létale et de l’absence de pression des accompagnants sur elle ne sont pas précisées.
Les implications de l’« aide à mourir » sur le droit de la santé et la protection des vulnérabilités
L’« aide à mourir » comme transformation de la finalité du soin et du rôle des professionnels de santé
La finalité du soin, gravement modifiée, transforme la fonction du soignant, emportant avec elle une incidence sur les patients, ainsi que l’approche sociétale de la souffrance et du soin. Indépendamment de la lecture pénale de la question, apparaît déjà ici une rupture anthropologique majeure.
Du soulagement à l’acte létal : une redéfinition normative du soin
Face à la maladie ou à la souffrance, la réponse de la société ne serait plus la prise en charge, ni la guérison, ni le soin. Les soins palliatifs, s’ils écartent la finalité de guérison de la pathologie principale, exaltent le soin jusqu’à la mort en accompagnant dans la dignité le patient et en soulageant toutes les souffrances. L’inscription des soins palliatifs dans le Code de la santé publique exprime cet engagement de la société et en fonde la prise en charge.
Au contraire, inscrire l’administration de substance létale dans ce même Code et, partant, la considérer comme un soin, renverse le sens du soin et la mission des soignants, impactant frontalement la confiance des patients. Si le soin implique aussi « l’administration de la mort », le patient souffrant ou dégradé percevra le soignant comme un danger face à sa pulsion de vie naturelle.
La place du médecin dans un dispositif de mort administrée : la tentation de la toute-puissance
Le soignant lui-même, banalisant le geste létal, l’inscrira nécessairement dans sa mission. L’administration d’une substance létale ne « fera que » répondre à une demande du patient dans le cadre du « soin » apporté. Le médecin disposera dès lors d’un pouvoir exorbitant lui confiant la décision, voire le choix, de mettre fin à une vie selon des critères flous nécessairement dangereux. Tuer sera aussi soigner. Ce changement anthropologique est gravissime.
L’absence légale de tout contrôle a priori place le médecin sollicité dans une position anormalement discrétionnaire, aucunement compensée par le « collège pluridisciplinaire » de trois personnes pouvant se réunir en visioconférence, où le médecin spécialiste ne transmet qu’un simple avis et n’est pas même tenu d’examiner la personne.
L’expression d’une volonté fragile au cœur du dispositif : exigences classiques et risque d’une volonté juridiquement “allégée”
La volonté libre et éclairée comme condition de licéité : un standard fragilisé par le contexte de fin de vie
Si le droit des contrats repose sur un consentement libre et éclairé, l’implication d’une personne dans le dispositif « d’aide à mourir » s’avère plus délicat à appréhender. Avant le « consentement à », doit être surveillée la « volonté de ». Le patient demande, le médecin accepte éventuellement (sous quinze jours) puis le patient confirme, en deux jours, sa demande initiale. Le patient n’est nullement supposé « adhérer » à une proposition qui lui serait faite, il doit exprimer une volonté née d’une initiative personnelle (à tout le moins est-ce ainsi prévu…).
Pourtant, les réalités médicales présidant à la demande d’« aide à mourir » fragilisent gravement l’exigence, incontournable, d’une volonté libre et éclairée. La personne en fin de vie, nécessairement souffrante selon la proposition de loi, est vulnérable. Le Code de la santé publique se préoccupe de la protection des personnes vulnérables : en matière de consentement aux soins5, pour la consultation du témoignage de la personne de confiance6, la vulnérabilité est alors médicale, cognitive ou situationnelle. La proposition de loi, elle, ne se soucie nullement de telles protections.
La vulnérabilité comme facteur de distorsion du choix : douleur, isolement, fatigue, pression sociale
Le paradoxe juridique réside dans l’exigence de grandes souffrances conditionnant l’éligibilité, cette même souffrance rendant les personnes vulnérables. Douleur, isolement, fatigue, pression sociale constituent dès lors autant de facteurs de distorsion. Le caractère éclairé de la volonté est affecté.
La demande exprimée ne bénéficie pas d’un temps de réflexion, seuls deux jours étant imposés (quand il faut dix jours pour accepter une offre de prêt immobilier). Les influences ou biais sont légion autour de cette demande : sentiment d’être une charge pour les proches ou la société, difficulté croissante d’accès aux soins des personnes lourdement handicapées (manque de personnel, fragilité financière…).
La décision de mourir comme demande de reconnaissance : la frontière incertaine entre autonomie et abandon
Le non-accès aux soins nourrit une fausse liberté. Le caractère libre de la demande disparaît. Le sentiment d’abandon par la société conduit à une incitation sociale à mourir, le « droit » en étant offert aux personnes éligibles. Par la frontière incertaine entre autonomie et abandon, la décision de mourir tend à devenir une demande de reconnaissance.
Les souffrances, muées en critères d’éligibilité, peuvent pourtant être soulagées par les soins palliatifs. La volonté, ni libre, ni éclairée, est biaisée. Le texte inclut désormais les souffrances psychologiques et élargit d’autant son domaine d’application. Or les souffrances somatiques sont très souvent associées à des souffrances psychologiques. Rappelons qu’aucune consultation d’un psychiatre ni d’un psychologue n’est imposée par la procédure.
L’autonomie de la volonté associée au principe d’autodétermination s’avère d’autant plus défaillante que l’autodétermination fonde ici l’exclusion de tout recours de tiers à l’encontre de la décision. Face une demande létale, par nature irréversible, l’absence de surveillance ou de protection apportée par les proches ou par la société (Ministère public) relève de la défaillance juridique.
La protection des vulnérables face à un droit à mourir : un risque de bascule dans une logique de sélection implicite
Service public fédéral, « EUTHANASIE – Publication des chiffres pour 2024 de l’euthanasie en Belgique » [en ligne].
Agathe Barrois, Aline Cheynet de Beaupré, Va-t-on légaliser la mort provoquée ? Le handicap face au risque de l’euthanasie et du suicide assisté, Fondapol, 2025, [en ligne].
Les rapports des pays ayant légalisé l’euthanasie ou le suicide assisté révèlent le public effectivement atteint. L’âge constitue le critère premier.
En Belgique7, le nombre d’euthanasies augmente de 16,6% en 2024, 72,6% des patients étant âgés de plus de 70 ans.
Les personnes lourdement handicapées8 sont pleinement concernées par les critères d’éligibilité du texte exigeant une affection (et non une maladie), « quelle qu’en soit la cause ». La grande dépendance de ces personnes, souvent assistées d’aidants, rejoint autrement celle des personnes âgées. Au Canada, des experts des Nations Unies ont dénoncé le recours à l’aide médicale à mourir (MAID) pour des personnes handicapées hors situation de fin de vie dès 20219.
Le 26 août 2025, le Comité des droits des personnes handicapées (CDPH) a transmis ses recommandations à la France, l’invitant à assortir son projet de garanties fortes pour les personnes handicapées, sans plus d’effet.
Aucune disposition adaptée aux personnes handicapées n’est prévue par le texte. Les aidants sont totalement écartés de la procédure : leur avis n’est pas recueilli, ils ne sont pas informés de la demande, ni ne peuvent former de recours. Or, la personne lourdement handicapée peut être difficile à comprendre et aucune vérification par une personne compétente n’est prévue, générant un risque grave de mésinterprétation pour une personne autiste, tétraplégique ou non verbale notamment.
La précarité, enfin, devient un critère adjacent aux critères pathologiques pour motiver une demande d’euthanasie comme le reconnaissent peu à peu le Canada et la Belgique, les personnes vulnérables étant souvent fragiles financièrement.
L’« aide à mourir » comme facteur de recomposition de l’ordre public sanitaire
CEDH, 4 oct. 2022, req. 78017/17, Mortier c. Belgique.
Un inquiétant mouvement inversé est observé : l’accès aux soins se dégrade fortement alors que l’accès à une euthanasie facile est proposé aux patients.
L’absence de contrôle a priori : un risque structurel pour la protection des personnes vulnérables
La Cour européenne des droits de l’homme a reproché à la Belgique les défaillances structurelles de sa commission de contrôle a posteriori10. L’impérieuse nécessité d’un contrôle a priori a été mise en œuvre par l’Espagne par sa loi de 2021 accueillant l’euthanasie mais organisant une protection renforcée des personnes demandant à mourir. La vérification des conditions d’éligibilité et de l’effectivité d’une volonté libre et éclairée peut valider alors une autodétermination réelle. Offrir des recours aux proches ou au Ministère public, dans ce contexte irréversible et d’éminente vulnérabilité, relève d’une mission essentielle de l’État.
A mi-chemin entre le civil et le pénal, un boulevard risque de s’ouvrir à des personnes mal intentionnées profitant de l’absence de contrôle a priori, de la vulnérabilité de ces personnes, de leur dépendance et de la « protection » offerte par le délit d’entrave.
En cas de contrainte coercitive dans le couple, la lutte contre les violences conjugales ignore totalement ce risque de « crime parfait » d’un mari poussant sa femme à demander un suicide assisté, un « suicide incité ».
La prévention des dérives : contrôle, supervision et responsabilité des acteurs
L’arrêt québécois Gladu-Truchon (11 sept. 2019) est à l’origine d’un des principaux points d’élargissement des critères d’accès à l’« aide à mourir ». La lutte contre une éventuelle discrimination conduit inéluctablement à élargir les conditions posées par une loi sur l’accès à mourir une fois qu’elle aura été votée. Inéluctablement, les conditions posées seront considérées comme restrictives au regard de personnes dans des situations s’approchant des conditions légales. Le Québec compte dorénavant 8% de décès par euthanasie.
Banalisation du geste létal par certains médecins, difficultés de vie de certains citoyens, méconnaissance des soins palliatifs, peur des souffrances ou de la mort et mauvais accès aux soins conduiront à élargir systématiquement les conditions d’éligibilité.
Les exemples étrangers sont significatifs. La disparition de la condition d’âge minimum ouvre aux mineurs (Belgique) et jusqu’aux nouveaux nés (sans aucune expression de volonté) l’accès à l’euthanasie (Pays-Bas). Un âge plafond apparaît avec la notion de « vie accomplie » (projet des Pays-Bas) à partir de 75 ans. En 2027, au Canada, l’« aide médicale à mourir » sera étendue aux personnes atteintes de maladie mentale, malgré les réticences exprimées par le CDPH de l’ONU.
Plus que de dérives, il convient de parler d’évolution naturelle de l’idéologie de « mort provoquée ».
Les implications de l’« aide à mourir » en droit pénal : entre fait justificatif et insécurité normative
A notre époque, la pénalisation de la vie sociale est un constat évident et a des enjeux politiques et économiques de plus en plus importants. Il est clair que la mise en œuvre de l’« aide à mourir » sera à l’origine de contentieux pénaux, touchant pour une part à la réticence vis-à-vis de ce nouveau mode de fin de vie mais aussi aux désaccords familiaux qu’il provoquera. Or, cet aspect est demeuré relativement ignoré lors des discussions. Les personnes mettant en œuvre le dispositif devront donc s’y employer avec grande rigueur, non seulement pour des raisons éthiques mais aussi pour éviter les embûches qui conduiraient à l’application à leur encontre de règles pénales omniprésentes dans le domaine de la protection de la vie, les dispositions dérogatoires sur la fin de vie devant être appliquées de manière stricte, ce sous réserve, naturellement, que leur interprétation ne soit pas sujette à doute.
Plusieurs textes pénaux susceptibles d’être envisagés au regard de la mise en œuvre de la loi sur le « droit à l’aide à mourir » doivent donc être évoqués.
L’« aide à mourir » et la persistance des incriminations pénales autour du suicide
La provocation au suicide face au nouveau dispositif : continuité ou exception législative nécessaire
Le délit de provocation au suicide tenté et consommé par autrui, instauré par la loi du 31 décembre 1987 est prévu par l’article 223-13 du Code pénal qui dit : « Le fait de provoquer au suicide d’autrui est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d’une tentative de suicide. Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75.000 euros d’amende lorsque la victime de l’infraction définie à l’alinéa précédent est un mineur de quinze ans. » Il est aussi encouru une interdiction professionnelle.
La provocation peut être réalisée par tout moyen, oral, écrit ou gestuel, public ou privé. Le délit est constitué lorsque la personne, objet de la provocation, s’est effectivement donné la mort ou, du moins, a tenté de le faire et qu’il est établi que sans cette provocation le désespéré ne se serait pas donné la mort ou n’aurait pas tenté de le faire.
La provocation à destination d’une personne afin qu’elle recoure à l’« aide à mourir » entrera dans le champ d’application de cette incrimination de provocation. La légalisation de l’« aide à mourir » n’exclut pas en soi, en effet, cette incrimination pénale.
Pourra ainsi, par exemple, être poursuivi le membre du corps médical qui proposera à un patient qui ne lui fait aucune demande en ce sens le recours à l’« aide à mourir » comme la solution adaptée à son état de santé en lui indiquant les moyens de sa mise en œuvre. Dès lors, se pose une question essentielle dans les relations d’un médecin traitant avec son patient afin qu’il ne puisse lui être reproché d’avoir incité ce dernier à faire le choix de l’« aide à mourir ». Les médecins devront donc se montrer prudents, particulièrement face à des personnes déprimées auxquelles ils pourraient être tentés de recommander l’« aide à mourir », ce qui pourra être ultérieurement à l’origine de plaintes à leur encontre de la famille de la personne décédée.
La propagande ou publicité en faveur du suicide : articulation avec la promotion du dispositif légal
Demeure aussi applicable le délit de propagande ou publicité en faveur de produits, objets ou méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort étant précisé que le délit est constitué sans qu’il y ait nécessité d’un résultat caractérisé par un suicide ou une tentative de suicide consécutifs à l’acte de propagande ou de publicité. Ce délit introduit par la loi du 31 décembre 1987 figure désormais à l’article 223-14 du Code pénal qui dit : « La propagande ou la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de produits, d’objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ».
On rappellera la définition juridique de la publicité, donnée par le droit européen : « Toute forme de communication faite dans le cadre d’une activité commerciale industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations11 ».
La publicité peut se faire par tout moyen, notamment de presse, et aussi par la voie d’internet et des réseaux sociaux.
C’est ainsi qu’il a été jugé que constituait le délit le fait de publier dans un journal un entrefilet consacré à un livre présenté comme un «guide du suicide» préconisant environ vingt méthodes pour se donner la mort dont «l’asphyxie et l’overdose», le texte incriminé précisant les moyens de se procurer cet ouvrage, prétendument «censuré» en France, et communiquant l’adresse d’un site internet permettant de localiser l’association la plus proche ayant pour objet la défense du droit à la mort12.
Là encore, la publicité pour l’exercice du droit à mourir n’est pas exclue.
Les qualifications criminelles et délictuelles susceptibles de ressurgir en cas de non-respect des conditions légales
L’empoisonnement comme qualification structurante en cas de non-respect des conditions d’accès
Des poursuites pourront ainsi être engagées, à l’initiative du ministère public ou de parties civiles estimant que les conditions de l’« aide à mourir » n’étaient pas remplies à l’encontre du médecin ou de l’infirmier chargé d’accompagner la personne dans l’administration de la substance létale. L’acte commis constitue en effet, ainsi que déjà rappelé, le crime prévu et puni par l’article 221-5 du Code pénal : « Le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement » dès lors que la personne qui n’a pas respecté les conditions légales de l’« aide à mourir » a agi avec l’intention de donner la mort, la volonté criminelle étant établie du seul fait que le mis en cause connaissait l’effet mortifère des produits administrés au défunt13. Cette intention sera évidemment caractérisée chez le médecin ou l’infirmier et qui saura que la substance administrée a un caractère mortifère.
Pourra également être poursuivi comme complice le médecin qui aura pris une décision favorable au suicide assisté ou à l’euthanasie. Il en sera de même pour tous ceux qui auront participé en connaissance de cause à la mise en œuvre d’une « aide à mourir » ne remplissant pas les conditions légales.
L’abus de faiblesse et la captation de consentement dans un contexte de dépendance
Une personne ayant incité autrui à recourir au dispositif de l’« aide à mourir » pourra se voir reprocher d’avoir abusé de sa faiblesse due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, pour la conduire à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables, faits prévus et punis par l’article 223-15-2 du Code pénal14. C’est ainsi, par exemple, que le fait pour un descendant de faire état auprès de son ascendant de la charge matérielle et/ou psychologique qu’il représente pour lui et de le conduire ainsi à avoir recours à l’« aide à mourir » pourra constituer ce délit. Il en serait de même pour le médecin traitant qui conduirait un patient vulnérable à la décision de recourir à l’« aide à mourir ».
L’omission d’empêcher une infraction
Une autre disposition pénale devra aussi être présente à l’esprit des personnes qui auraient connaissance d’applications ou de risques d’application déviantes de la loi : l’omission d’empêcher une infraction, prévue et punie par l’article 223-6, alinéa premier du Code pénal. L’indifférence ne saurait être un refuge pour ceux qui, dans le cadre privé ou dans le cadre professionnel, rencontreraient des situations de mise en œuvre de l’« aide à mourir » ne rentrant pas dans le cadre de la loi et ne réagiraient pas.
L’insécurité pénale comme conséquence de critères médicaux indéterminés
CEDH, Mortier c. Belgique (requête n° 78017/17), 7 octobre 2022, §79.
L’imprécision des critères d’éligibilité comme facteur de risque pénal pour les praticiens
La vigilance s’imposera aux intervenants qui devront, non seulement pour des raisons d’éthique, mais aussi en prévention de tout risque pénal, s’assurer qu’ils appliquent strictement la loi. On peut prévoir qu’à cet égard, les organes ordinaux joueront un rôle de veille déontologique et aussi de conseil aux praticiens. Le risque pénal devrait au demeurant dissuader ceux qui seraient tentés de ne pas s’insérer dans le cadre légal. On peut enfin être certain que l’immense majorité des médecins soucieux qu’ils sont de faire en sorte que la vie l’emporte dans toute la mesure du possible seront soucieux d’appliquer scrupuleusement les conditions légales de l’« aide à mourir ». Le devoir de vigilance s’imposera aussi aux personnels des établissements accueillant des personnes malades âgées sur des situations d’abus de faiblesse incitant les personnes à demander à mourir.
Pas de contentieux ante mortem
Les litiges au stade ante mortem seront ceux évoqués à l’article L1111-12-10 du Code de santé publique selon lequel « la décision du médecin se prononçant sur la demande d’« aide à mourir » ainsi que la décision de mettre fin à la procédure dans les conditions prévues au 2° de l’article L1111-12-8 ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande, devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun. » A ce stade, concernant cette disposition, on remarquera que l’action d’un proche est exclue.
Il n’a pas non plus été prévu un signalement à l’autorité judiciaire permettant de suspendre la procédure d’« aide à mourir » lorsqu’il résulte de celle-ci des soupçons d’infraction au préjudice du patient.
A l’évidence, la complexité des situations humaines rencontrées conduira à des contestations juridiques postérieures au décès, notamment en raison de différends familiaux.
Le contentieux pénal comme régulateur de fait du dispositif d’« aide à mourir »
Le ministère public pourra naturellement ouvrir des enquêtes préliminaires ou saisir un juge d’instruction quand il lui sera signalé une mise en œuvre de l’« aide à mourir » susceptible d’avoir été réalisée en violation des conditions prévues par la loi.
Des proches de la personne défunte pourront aussi après le décès engager des procédures pénales, en se constituant parties civiles notamment du chef d’empoisonnement, ce qui pourra aboutir à des mises en examen, voire à des condamnations de médecins ou d’infirmiers ayant participé à l’« aide à mourir » d’une personne. Au demeurant, on notera que pour la Cour européenne des droits de l’homme, le recours au droit pénal s’impose lorsqu’il y a une dénonciation ou une plainte par un proche du défunt indiquant l’existence de circonstances suspectes, les autorités étant alors dans l’obligation de mener une enquête pénale15.
Ces risques de contentieux seront d’autant plus importants que les membres de la famille du défunt pourront avoir été totalement tenus à l’écart de la procédure préalable à l’« aide mourir » et apprendre brutalement le décès.
Par ailleurs, des différends familiaux pourront se cristalliser à l’occasion du décès d’un parent, les membres d’une fratrie pourront par exemple mettre en cause l’un d’entre eux pour avoir incité le défunt à ce choix de mourir, notamment pour des raisons d’intérêt successoral.
Conclusion
La proposition de loi relative à l’« aide à mourir » se présente comme une réforme de fin de vie destinée à répondre à des situations de souffrance extrême, en consacrant une autonomie ultime du patient dans le choix de sa mort. Pourtant, l’analyse juridique conduit à constater qu’elle excède largement le cadre d’un simple ajustement sanitaire ou bioéthique. Elle engage une transformation normative profonde, en introduisant dans l’ordre juridique français un dispositif autorisant, sous conditions, l’administration ou la délivrance d’une substance létale. Dès lors, la question centrale n’est pas seulement celle d’une nouvelle liberté offerte au patient, mais celle de la portée systémique d’une telle légalisation sur la cohérence du droit, la protection des vulnérabilités et la fonction même de l’État de droit.
Une loi de fin de vie ou une loi de rupture : bilan des tensions juridiques majeures
L’étude a mis en évidence que cette proposition de loi constitue moins une continuité qu’une rupture. Certes, le droit français a déjà reconnu des droits fondamentaux en fin de vie : refus de traitement, interdiction de l’obstination déraisonnable, sédation profonde et continue jusqu’au décès. Mais l’« aide à mourir » introduit un changement de nature : il ne s’agit plus d’accompagner le mourir, mais d’autoriser juridiquement un acte dont l’objet est de provoquer la mort.
Cette mutation affecte plusieurs branches du droit. En droit de la santé, elle transforme la finalité du soin et reconfigure le rôle du médecin, désormais susceptible d’être impliqué dans un geste létal. En droit pénal, elle impose la construction d’un fait justificatif exceptionnel, venant redessiner les contours de l’interdit fondamental de tuer. En droit constitutionnel, elle soulève des interrogations majeures quant à la précision des critères d’accès, à la proportionnalité de la dérogation et au respect du principe de légalité. Enfin, sur le plan des principes fondateurs, elle fragilise l’indisponibilité de la vie et la dignité comme norme d’ordre public, en érigeant la volonté individuelle en facteur potentiel de licéité de l’acte létal.
Ainsi, la loi apparaît comme un texte de bascule : elle ne se contente pas de réguler la fin de vie, elle modifie la place de la mort dans le droit.
Le risque d’insécurité normative : médicalisation, pénalisation résiduelle, contentieux
Au-delà de la rupture axiologique, la proposition de loi comporte un risque important d’insécurité normative. Les conditions d’accès à l’« aide à mourir » reposent sur des notions médicales et existentielles difficilement objectivables : affection grave et incurable, phase avancée, souffrance insupportable, volonté libre et éclairée. Ces catégories, nécessairement ouvertes, laissent une marge d’appréciation considérable aux praticiens, ce qui rend inévitable une variabilité des pratiques.
Dans ce contexte, le droit pénal demeure un horizon constant. Même si la loi prévoit une autorisation, toute irrégularité procédurale ou contestation ultérieure pourrait conduire à la résurgence des qualifications criminelles les plus graves, notamment l’empoisonnement. Le dispositif ne supprime donc pas le risque pénal : il le déplace, en instaurant une frontière incertaine entre l’acte légalement autorisé et l’acte criminel.
Il en résulte une judiciarisation probable : contentieux sur la validité du consentement, sur l’interprétation des critères médicaux, sur la responsabilité des professionnels, sur les pressions familiales ou sociales. La mort administrée, loin de pacifier le droit de la fin de vie, pourrait ainsi générer une conflictualité accrue, tant pour les soignants que pour les proches, et renforcer une médecine défensive où l’acte ultime serait entouré d’une surveillance juridico-pénale permanente.
L’enjeu de cohérence axiologique : l’État peut-il autoriser ce qu’il a pour mission de prévenir ?
Enfin, l’enjeu le plus décisif demeure celui de la cohérence axiologique de l’État de droit. Une démocratie se définit par la protection universelle des personnes, en particulier des plus vulnérables. Le droit moderne s’est construit sur l’idée que certaines valeurs – la dignité, l’intégrité, la vie – ne peuvent être abandonnées à la seule logique du choix individuel, car elles constituent le socle même de l’ordre juridique.
Reconnaître un droit à mourir, même encadré, revient à faire de l’État non plus seulement le garant de la vie, mais l’instance susceptible d’organiser légalement sa suppression. Or l’État de droit peut-il autoriser ce qu’il a historiquement pour mission de prévenir : l’atteinte volontaire à la vie d’autrui ? Peut-il demeurer fidèle à sa vocation protectrice lorsqu’il devient l’opérateur technique de la disparition sur demande ?
Derrière la rhétorique de l’autonomie, se profile ainsi un risque plus profond : celui d’un abandon institutionnalisé des fragilités humaines, d’une hiérarchisation implicite des vies selon leur état de santé, leur dépendance ou leur souffrance. Une société véritablement humaniste se mesure peut-être moins à sa capacité à organiser juridiquement la mort qu’à sa capacité à accompagner la vulnérabilité, à renforcer les solidarités, et à garantir à chacun une dignité réelle jusqu’au terme naturel de l’existence.
Ainsi, la légalisation de l’« aide à mourir » ne constitue pas seulement une réforme de fin de vie. Elle introduit une contradiction axiologique profonde dans l’ordre juridique démocratique : elle fragilise l’indisponibilité de la vie, relativise la dignité comme norme d’ordre public, transforme l’autonomie en licence d’auto-exclusion et renverse la mission protectrice de l’État. Derrière l’autonomie proclamée se profile le risque d’un abandon institutionnalisé, et derrière la compassion, celui d’une rupture du principe d’égale protection des vies. En ce sens, la mort administrée apparaît moins comme un progrès juridique que comme une fracture dans l’architecture normative de l’État de droit.

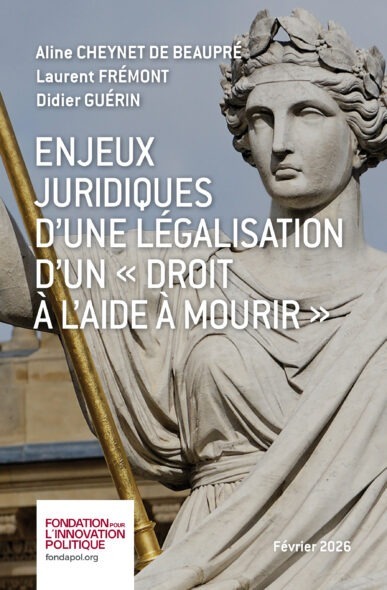
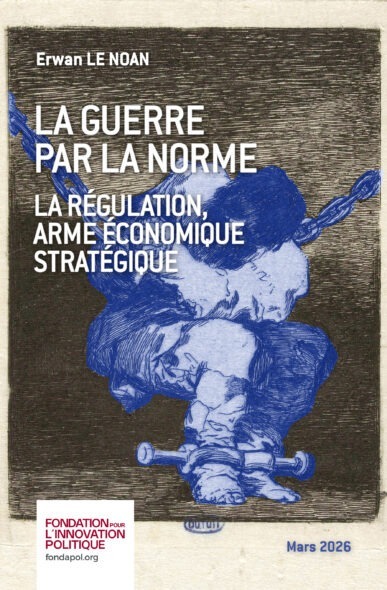




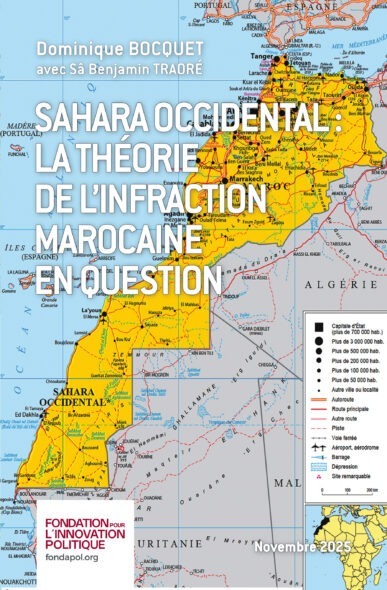

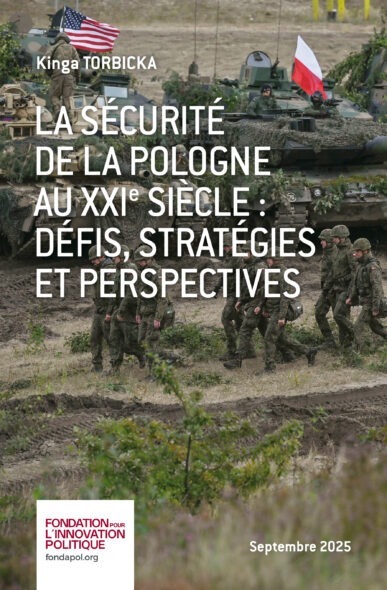
Aucun commentaire.