Introduction
Le nouveau visage de l’agriculture mondiale
L’agriculture du monde confrontée aux défis de la croissance humaine
Vers une agriculture off-shore
Le nouveau paradigme de l’alimentation
Y a-t-il une vie après la PAC ?
Une Europe très fragmentée
2013, et après ?
Quatre idées pour passer d’une politique de guichet à une politique de projet
La coopérative, arme fatale du monde agricole
Favoriser leur croissance
Élargir le cercle des amis
Une enseigne lisible des Coop
Un label pour l’agroalimentaire français, des filières mieux organisées
Un discours rénové : pour que les paysans parlent aux consommateurs
La loi et le gendarme
Conclusion
Introduction
Pascal Perri, La Bataille du pouvoir d’achat, Eyrolles, 2008.
La terre, notre terre, le premier des facteurs de production selon le regretté professeur Samuelson, est, avant le travail et le capital, l’objet d’âpres débats en ce début de millénaire : débat sur l’environnement, débat sur l’avenir de notre alimentation, débat sur l’enjeu du territoire. Dans la dix-huitième édition de son manuel, rédigé avec William Nordhaus de l’université de Yale, Paul Samuelson ajoutait, visionnaire, que « dans le monde encombré d’aujourd’hui, il faut élargir le champ des ressources naturelles pour y inclure l’air pur et l’eau potable ». Pendant longtemps, les grands acteurs du monde agricole français ont pensé que l’agriculture allait rester aux marges de la mondialisation et que le statut de notre agriculture française était éternel. Ils se sont imaginé que les règles de la mondialisation n’allaient pas s’appliquer aux productions agricoles. Mais, à présent, il n’existe plus de sanctuaire agricole français. Il est temps d’intégrer cette idée, non pour baisser pavillon mais pour construire un modèle qui s’insère durablement dans l’avenir, qui permette simultanément aux paysans français de gagner leur vie grâce à leur activité professionnelle, et aux consommateurs de retirer satisfaction de leur alimentation. Le ministère actuel en charge de ces dossiers est celui de l’Alimentation et de l’Agriculture. Juste retour des choses : le lien entre le producteur et le consommateur est enfin consacré.
On ne peut comprendre les enjeux de la politique agricole sans une double vision : vision macroéconomique de l’agriculture mondiale et de ses performances globales, et vision microéconomique qui prenne en compte les comportements individuels des agents économiques. La mondialisation de l’agriculture se traduit par l’arrivée de nouveaux consommateurs sur le marché. La Chine, l’Inde, le Brésil, la Russie viennent alimenter la demande mondiale. La classe moyenne chinoise – 120 millions de personnes – accède aux critères du standard de vie nord-américain : la consommation moyenne annuelle de viande par Chinois est passée de 13,7 kilos en 1980 à 59 aujourd’hui1. Ces changements de comportement ne sont pas sans conséquences sur les grands équilibres de prix. L’émergence de nouveaux besoins change les règles et interroge les modèles agricoles qui gouvernaient le monde, à tel point que se développe en Afrique ou en Amérique du Sud des agricultures off-shore, chinoises, coréennes ou saoudiennes. On croyait l’agriculture attachée aux territoires des États, mais les baux emphytéotiques signés par la Chine en Afrique sur des millions d’hectares traduisent une nouvelle stratégie. L’agriculture chinoise, deux fois plus productive que celle de l’Inde, a envoyé une partie de sa main-d’œuvre dans les usines des grandes villes et se développe là où les ressources en eau et les terres arables sont disponibles. Nous allons voir comment les nouvelles frontières de l’agriculture mondiale s’adaptent aux exigences de volume et de prix des consommateurs d’aujourd’hui. De l’autre côté de la chaîne, il faut observer les nouveaux comportements des consommateurs, notamment français, afin d’identifier leurs aspirations en termes de volume, de prix ou de qualité. Les agriculteurs ont souffert de ne pas avoir écouté la société. Ils payent aujourd’hui le prix fort pour s’être comportés comme de simples marchands de matières premières. Avec la fin programmée de la politique agricole commune (PAC), en 2013, ils vont devoir s’adapter pour trouver leur place sur le marché et dans la société.
Le nouveau visage de l’agriculture mondiale
L’agriculture du monde confrontée aux défis de la croissance humaine
Émilie Lanez, « Neuf milliards en 2025, et moi, et moi, et .. », Le Point, nº 1952, 11 février 2010, p. 61.
La moitié des céréales produites dans le monde servent à l’alimentation du bétail.
À la fin de sa vie, Claude Lévi-Strauss avouait ne pas reconnaître pas le monde dans lequel il vivait, rappelant qu’il était né dans un monde avec 1 milliard d’individus. Nous en sommes aujourd’hui à 6 milliards…
Éléments repris par Arnaud Parienty, « Faut-il acheter local ? », Alternatives économiques 15 février 2010.
L’expression « agriculture mondiale » ne traduit pas la complexité de la situation, elle ne donne pas satisfaction à l’observateur qui entend rentrer dans les détails. Comment, en effet, comparer les petites exploitations de millions de fermiers indiens, de moins d’un hectare, et les 300.000 mégafermes des grands pays développés ? On retiendra que, sur le milliard d’affamés sur la surface du globe, 70% sont des fermiers. Inégalités de foncier et de moyens. Il n’y a dans notre monde que 27 millions de tracteurs pour 1,5 milliard d’agriculteurs. Ces inégalités se retrouvent dans les rendements. Deux exemples :
- 1.000 litres de lait de production par an pour une vache malienne ou burkinabaise, 6000 pour un bovin français et 10000 pour un animal dans une exploitation laitière au Danemark ;
- 1 tonne de céréales par hectare en Afrique, 4 tonnes en Asie, 7,5 en Europe et jusqu’à 9 tonnes par hectare en Amérique du Nord.
Pour soutenir les agricultures des pays du Sud, des réformes d’ajustement structurel ont été conduites en Afrique. Les paysans de ces régions ont été invités à passer d’une agriculture vivrière à une agriculture de marché. La promesse était simple : « Cultivez des productions éligibles aux grands marchés internationaux et, avec les revenus que vous en tirerez, vous mobiliserez des revenus pour nourrir vos familles et pour investir. » À ce jour, les promesses de cette politique n’ont pas été tenues. La volatilité du prix des matières premières agricoles (MPA) a ruiné les fermiers du Sud et plongé certains d’entre eux dans la famine. Le marché libre n’a pas tenu toutes ses promesses, loin s’en faut! L’échec des politiques agricoles dans les pays en voie de développement doit servir de leçon au moment où se profile un autre grand défi, celui de la démographie. Le défi alimentaire se double ici d’un défi environnemental. Émission de CO2, émission de méthane, encore plus dangereux, utilisation ou, plutôt, surutilisation des ressources en eau : les enjeux nous ramènent aux deux idées de base de la science économique, la rareté et l’efficacité. La rareté foncière est relative. Comme le rappelait récemment le professeur Marc Dufumier dans le journal Le Point : « On cultive aujourd’hui 1,5 milliard d’hectares, il reste 4,2 milliards de terres cultivables non exploitées2. » Ces chiffres sont pour partie contestés par des organisations paysannes. Le volume de terres immédiatement cultivables serait, selon elles, très sensiblement inférieur, surtout quand on ne retient que les surfaces immédiatement disponibles à la culture. En revanche, une majorité des membres de la communauté agricole s’accorde à reconnaître que le critère de l’efficacité est plus que jamais requis. Il faut produire plus, dans des conditions durables, en épargnant les terres arables, les ressources en eau et la qualité de l’air. Les agronomes estiment que les réserves de terres arables seront suffisantes, mais le débat dépasse, et de loin, les besoins physiologiques estimés à 2.200 calories par jour et par individu. La question, c’est d’abord le modèle alimentaire. Le développement économique et l’ouverture au monde s’accompagnent d’une véritable transformation des habitudes alimentaires dans les pays émergents. La croissance démo- graphique et la mondialisation s’accompagnent aussi de la diffusion au reste de l’humanité du modèle de consommation occidentale. La ration de viande progresse et les alimentations traditionnelles reculent. À ce rythme, il faudra passer de 1,5 milliard de bovins à 2,6 milliards pour satisfaire les nouveaux consommateurs. Mais, dans ce cas, les chiffres donnent la migraine : on voit mal comment les prix de l’alimentation animale pourraient rester stables3.
Prenons un autre exemple pour évaluer les dégâts collatéraux, celui du prix de l’eau dans le monde. Elle est vendue très en dessous de sa valeur. C’est une des raisons de sa surutilisation. Or, il faut 14.000 litres d’eau pour produire 1 kilo de bœuf ! À l’autre bout de la chaîne, l’élevage est responsable de 18% des émissions totales de gaz à effet de serre, c’est plus que les transports ! Bientôt, la planète ne sera plus en état de remplir l’assiette des « nouveaux riches » de la mondialisation. Dans ce contexte, certaines voix écologistes n’hésitent pas à développer une nouvelle forme d’eugénisme alimentaire. Ces voix disent qu’il faudra à brefs délais réduire la natalité. Ils ne disent pas encore comment et où, mais c’est sans doute l’étape suivante.
L’autre aspect de la croissance démographique qui va durablement peser sur les modèles agricoles est celui de l’étalement urbain. Le risque d’une désertification radicale des campagnes n’est pas nul. La population croît, comme le remarquait Claude Lévi-Strauss avant sa disparition, mais elle croît surtout dans les villes4. Les 3 milliards potentiels d’êtres humains qui naîtront dans les cinquante ans à venir seront, dans leur immense majorité, des urbains. Les géographes et urbanistes estiment que ces nouveaux venus viendront alimenter les banlieues informelles des grandes métropoles. Ces villes moyennes devront les accueillir et deviendront des mégapoles, c’est-à-dire des agglomérations de plus de 5 millions de personnes. Pour ces nouveaux urbains, les questions liées à la logistique et au transport des produits agroalimentaires seront au moins aussi importantes que la production elle-même. Des études récemment menées sur le bilan carbone des produits alimentaires semblent bien tordre le cou aux idées reçues. En Europe, par exemple, la production se fait souvent sous des serres chauffées qui consomment en réalité plus d’énergie que le transport aérien. Pour les salades et les fraises sous serres, 1 kilo produit appelle la mobilisation de 4 kilos de pétrole. Le bilan carbone des serres chauffées est bien plus mauvais que celui du fret aérien ! Le retour à la proximité ne serait donc pas une règle absolue. Il existe cependant une grande différence entre le fret aérien et le fret maritime. Selon l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), le bilan carbone des bananes produites aux Antilles françaises et trans- portées par bateau reste acceptable : la consommation d’énergie serait de 63 grammes de pétrole par kilo, c’est-à-dire moins qu’un trajet de 4 kilomètres en voiture vers le supermarché5 ! Tous ces éléments montrent qu’un audit économique et écologique des modes de production et de distribution des produits agroalimentaires est plus qu’urgent, au moins pour mettre un terme aux prophéties vaguement scientifiques des nouveaux sorciers de la nature.
Vers une agriculture off-shore
La Chine représente 25% de la population mondiale, mais ne dispose que de 9% des terres arables. Cet immense pays souffre aussi d’un handicap en eau douce : 7% des réserves mondiales pour satisfaire environ 20% des besoins ! Durant la période des Jeux olympiques de Pékin, une partie de la population des banlieues de la capitale a été purement et simplement privée d’eau potable pendant plusieurs semaines afin que la ressource en eau soit directement affectée aux Jeux, aux athlètes et au public. La Chine tente donc de repousser les murs de ses frontières. Elle développe une stratégie d’externalisation de ses cultures, notamment en Afrique où elle défend ses intérêts contre les anciennes grandes puissances. En 2008, la République populaire de Chine a loué plus de 2 millions d’hectares sur le continent africain, soit l’équivalent d’un pays comme la Slovénie. Le total des flux financiers liés à ces achats ou location longue durée de terres arables représente une enveloppe de 30 milliards d’euros : 1,5 million d’hectares loués au Soudan (où la famine est pourtant mortelle pour des dizaines de milliers de personnes), 100.000 hectares au Mali et l’équivalent de la région Auvergne en Zambie. Les Chinois s’installent sur place, construisent des routes et des équipements collectifs et importent une partie de la main-d’œuvre et des semences.
Un pays comme l’Arabie saoudite suit le même chemin. En raison de la flambée des prix des MPA, la note alimentaire de ce pays est passée de 8 à 20 milliards de dollars en quelques années. À ce compte-là, il est plus rentable de se projeter hors de ses frontières pour investir sur le long terme. Les rendements sont d’ailleurs attractifs pour les investisseurs. Fonds privés ou fonds souverains asiatiques, le rendement financier est de 400% en Afrique et de 40% en Pologne ou en Ukraine, où des opérateurs agricoles français ont pris position.
Le nouveau paradigme de l’alimentation
Jean-Francis Pécresse, « Patriotisme alimentaire », Les Échos, 24 février 2010.
Le développement à grande échelle de ce nouveau type d’agriculture délocalisée interroge tous les modèles agroalimentaires anciens. La notion d’« espace vital » réapparaît dans notre histoire sous une forme inattendue. Que devons nous en conclure ? Les sociétés technologiquement très avancées ont tendance à oublier les concepts fondamentaux du développement. Notre humanité a attendu sept millions d’années pour atteindre le milliard d’individus et des centaines de générations pour par- venir à un seuil satisfaisant de couverture de ses besoins alimentaires. Encore faut-il ne pas regarder à la loupe, car la suffisance alimentaire est un luxe dans notre monde, les chiffres du Fonds mondial pour l’alimentation nous le rappellent régulièrement. La conquête de la souveraineté alimentaire est encore en filigrane dans nos livres d’histoire et de géographie. L’agriculture est une des clés du développement. Elle constitue la base de la pyramide du développement humain. Cette idée que l’agriculture devrait être sanctuarisée et isolée du champ politique est régulièrement mobilisée pour interrompre la réflexion et explorer de nouvelles politiques agricoles et alimentaires durables. Dans le même registre, on se trompe quand on dénonce le péril libéral qui pèserait sur l’agriculture. La vérité des faits oblige à dire qu’il n’existe pas de modèle libéral dans ce domaine, sauf peut être en Argentine. Les États-Unis, présentés comme le porte-drapeau du libéralisme économique, sont en réalité interventionnistes quand il s’agit par exemple de voter la loi d’orientation agricole pluriannuelle, le Farm Bill. La loi-cadre agricole votée en 2008 a augmenté l’enveloppe aux agriculteurs américains pour la porter à plus de 300 milliards de dollars sur cinq ans. Le Congrès a très largement adopté ce dispositif, en contravention des règles du cycle de Doha sur le commerce mondial. Le président américain Bush s’y était formellement opposé, mais les diplomates européens présents aux États-Unis ont avoué que cette opposition n’était que de pure façade. La loi américaine sur l’agriculture traite les deux aspects du problème : en amont, de l’aide aux producteurs, grâce notamment au dispositif Average Crop Revenu Election (Acre) qui vise à stabiliser les recettes des grandes cultures ; en aval, de l’aide aux pro- grammes alimentaires intérieurs. Dans un pays qui compte 50 millions de pauvres, le gouvernement fédéral consacre des aides massives au soutien à la consommation des plus défavorisés. Cette réalité participe au nouveau paradigme de l’alimentation dans le monde. Pour la seule année 2008, le budget fédéral a consacré 95 milliards de dollars à l’agriculture, dont plus de 60% dédiés à l’aide alimentaire intérieure.
Loin des idées reçues, il convient d’admettre que le paysage mondial de l’agriculture est en recomposition. En partie sous la pression des consommateurs. Les enjeux nutritionnels sont devenus des débats de société. Le « patriotisme alimentaire », pour reprendre une expression de Jean-Francis Pécresse, traduit une des nouvelles formes du souverainisme agricole6. Pour dire les choses plus directement, le contenu de nos assiettes intéresse les politiques. Le regard qu’ils portent ne concerne plus seulement les volumes, mais aussi la qualité des produits consommés. La nouvelle approche agricole et alimentaire intègre désormais les para- mètres du bien et du mal. Attention toutefois à ce que les normes de santé publique ne viennent, à terme, remettre en question les libertés individuelles, à commencer par celle de remplir librement son assiette avec les produits de son choix! Au même moment, un courant de relocalisation des productions agricoles semble se développer en Europe. Au cours de l’été 2009, le gouvernement britannique a soutenu une opération visant à privilégier les fruits, les légumes et les produits de l’élevage du Royaume-Uni. Il est vrai qu’en plein été les supermarchés anglais proposent des fruits cueillis à l’autre bout de l’Europe, parfois même au-delà, à des prix substantiellement élevés pour les classes moyennes britanniques et, qui plus est, à la qualité gustative fort médiocre.
En France, le ministre Bruno Le Maire plaide également pour une agriculture attachée aux territoires. L’intention est louable, mais elle n’apporte pas de réponse aux différentiels de compétitivité de nos productions. Deux exemples viennent douloureusement rappeler la réalité de notre marché par rapport à nos concurrents européens. En France, le prix de la main-d’œuvre participe pour moitié au coût global de production et de collecte des fruits et légumes français : en Allemagne ou en Espagne, les coûts de main-d’œuvre maraîchère sont deux fois inférieurs. Et dans le secteur de l’élevage, le coût du travail dans les industries de transformation allemandes est de 20 à 50% inférieur au coût du travail en France, selon les qualifications. Les vaches de réforme française sont transportées en Allemagne, abattues sur place, et reviennent en France sous forme de viande hachée dans nos supermarchés moins chère qu’une viande transformée en France.
Y a-t-il une vie après la PAC ?
Une Europe très fragmentée
Observatoire international des filières porcines, 2009.
La PAC appartient à l’histoire de la construction européenne. Elle tient une place comparable aux premiers accords sur le charbon et l’acier dans le Panthéon européen des accords politiques. La PAC a représenté jusqu’à 40% du budget de l’Europe. Elle avait pour objectif de soutenir l’activité agricole, y compris dans les territoires reculés, de fournir des revenus aux agriculteurs et des prix stables aux consommateurs. Elle a été un outil de la paix retrouvée en Europe et une promesse de progrès pour les anciens et les nouveaux européens. Aux origines de la Communauté, les premiers grands européens ont compris que le partage du blé pouvait empêcher la guerre. Pendant longtemps, la PAC a été un formidable outil de croissance. L’Europe est devenue le deuxième exportateur mondial dans le secteur agricole, mais elle importe plus qu’elle ne vend à des pays tiers. Pour les consommateurs, la PAC a offert la garantie de prix de base relativement stables. En trente ans, grâce aux aides à la production agricole, le budget des ménages français pour l’alimentation est passé de 30% du revenu à moins de 15%. Dans les années 1990, il convenait de dégager du revenu net disponible pour acheter des technologies de l’information et de la communication et des loisirs. Les aides aux agriculteurs ont ainsi « libéré » du pouvoir d’achat pour ces nouveaux centres de coûts des ménages en réduisant proportionnelle- ment la part du revenu consacrée à l’alimentation. En dépit des procès qui sont régulièrement instruits à l’égard de la « malbouffe », notre espérance de vie continue à croître. C’est le signe que le productivisme, indispensable pour répondre au défi de la demande croissante, a su concilier les volumes et les exigences nutritionnelles.
La PAC est aujourd’hui remise en cause sous le double effet de la marchandisation des productions agroalimentaires et de ses propres errements. La surproduction a généré des montagnes d’excédents, le financement des marchés a lourdement obéré les finances européennes, en un mot l’usage abusif de la PAC a détruit la PAC. Les premiers coups de boutoir contre la politique européenne sont à resituer dans le cadre des négociations mondiales sur le commerce et les échanges (GATT). Une nouvelle politique agricole européenne a vu le jour en 1992. Les paysans français situent généralement la dégradation de leur situation personnelle à cette date charnière. Les productions ne sont plus aidées mais, en contrepartie, la Communauté soutient le revenu des agriculteurs. Ces aides sont cependant insuffisantes pour assurer un revenu décent à la grande majorité des agriculteurs, et profitent prioritairement à certains secteurs. Le mouvement syndical agricole français reste à ce jour très critique à l’égard des politiques de libéralisation de l’agriculture. Il dénonce avec une certaine maladresse la libéralisation des marchés et développe une rhétorique très centrée sur le protectionnisme : « Préservons notre agriculture, nos territoires et nos agriculteurs. » La crise dans le secteur du lait montre que nos productions ne sont pas toujours compétitives. Comment harmoniser l’agriculture européenne sur un vaste territoire, qui compte des pays de taille très modeste, aux productions très spécialisées comme les pays du Nord européen, des pays anglo-saxons promoteurs d’une vision entrepreneuriale de l’agriculture comme la Grande-Bretagne et un pays comme la France qui soutient une agriculture généraliste, adaptée à sa géographie variée ? L’union sacrée européenne n’existe pas sur les questions agricoles, et pour cause. Les pays du Nord sont producteurs de viande, essentiellement de viande de porc. Ils veulent acheter les céréales, c’est-à-dire l’alimentation animale, le moins cher possible. Au Danemark, nulle ambition d’aménagement du territoire, la politique agricole est d’abord une politique industrielle tournée sur les volumes et les prix bas. Le pays produit presque 2 millions de tonnes de porc par an, dans de très grandes coopératives d’abattage, et en exporte plus de 85 %7. Début 2010, Danish Crown, la première entreprise danoise du secteur porcin, a menacé de délocaliser ses usines d’abattage en Allemagne où les coûts de main-d’œuvre sont moins élevés. C’est dire que, pour les coopérateurs danois, le patriotisme économique n’a pas de sens. On ne sera donc pas étonné de retrouver le royaume du Danemark en tête des pays dit « libéraux » qui entendent changer les règles de la PAC, notamment toutes celles qui visent à soutenir artificiellement les marchés. Entre l’Europe du Nord et les pays latins de la Communauté, les Pays-Bas défendent une vision de l’agriculture inspirée de contraintes territoriales et climatiques. Le territoire hollandais est piqueté de milliers de serres chauffées, sous lesquelles sont cultivées des tomates, des fraises ou des fleurs. Mais la première activité de ces grands ensembles est de produire de l’énergie électrique par cogénération. La production agricole devient dès lors l’accessoire de l’activité et non le principal. On pourrait aussi évoquer les grandes serres irriguées du sud de l’Espagne ou les entreprises de production agricole du Royaume-Uni pour compléter ce tableau de l’agriculture européenne. En réalité, l’expression agriculture européenne relève de la doxa, c’est- à-dire d’un ensemble de considérations vagues et sans fondement, de préjugés ou de présuppositions plus que d’une appréciation rationnelle et encore moins scientifique. Nous avons vu que si les conditions de circulation des produits agricoles sont libres dans l’espace communautaire, les invariants géographiques et climatiques, les règles sociales changent selon les latitudes. Un courant de pensée s’est développé en réaction aux politiques agricoles communes des dernières décennies. Il porte la vision d’une Europe agricole ultraspécialisée par région, et abandonne toutes les considérations d’aménagement de l’espace qui avaient prévalu depuis la Seconde Guerre mondiale. Pour les tenants de cette nouvelle stratégie agricole, l’Europe se diviserait en grandes zones de production : au sud du continent, de grandes serres de fruits et légumes, le réservoir européen de primeurs ; au nord du Massif Central, des plaines de la Limagne jusqu’aux frontières russes, de grandes étendues de céréales ; des productions porcines, bovines et laitières de la Bretagne à la Scandinavie ; et, au milieu de cette nouvelle peau de léopard, quelques agriculteurs témoins, « jardiniers de la nature », notamment dans les zones de montagne ou de moyenne montagne, et producteurs de spécialités locales. Cette vision d’une agriculture industrielle ne peut évidemment que sus- citer l’hostilité des agriculteurs et éleveurs français. Elle semble pour le moment abandonnée sous l’impulsion de la France, mais ce feu rouge de Paris impose désormais une obligation de résultat aux tenants de l’autre politique. Il faut faire la démonstration que le modèle actuel est viable et, pour y parvenir, les élus et les agriculteurs français vont devoir sortir de la logique des subventions pour s’inscrire dans celle de la réforme.
2013, et après ?
Le président de l’Autorité des marchés financiers Jean-Pierre Jouyet a été chargé d’identifier de nouveaux outils de régulation des marchés agricoles.
La nouvelle politique agricole commune de l’Europe après 2013, date de fin de la PAC actuelle, devra tenir compte des accords internationaux, tel celui de Doha, qui postulent par principe la libéralisation des marchés agricoles. À défaut, c’est la nouvelle organisation mondiale du commerce qui volera en éclats avec les risques d’un conflit commercial large, profond et douloureux pour nos exportations agricoles. La France et ses voisins ne peuvent prétendre à constituer un sanctuaire agricole isolé du reste du marché. La crise que traversent les paysans est-elle pour autant celle du libéralisme ? On peut le contester en rappelant que les causes de l’envolée des prix des MPA, puis de leur effondrement, sont pour partie liées à la politique monétaire du gouvernement américain. Au préalable, rappelons ici que la Réserve fédérale répond aux directives de l’exécutif américain, à l’inverse de la situation européenne. Pour mieux comprendre, revenons aux origines de la crise financière. La Banque centrale américaine émet une grande quantité de liquidités sur le marché pour soutenir la consommation des classes moyennes américaines. Les consommateurs américains achètent les produits made in China. Le big deal sino-américain est à ce prix : les États-Unis ouvrent leur marché aux productions chinoises, les Chinois financent le déficit public américain. Par voie de conséquence, la consommation américaine alimente les excédents commerciaux chinois, qui viennent eux-mêmes abonder les fonds souverains. On estime que la Chine détient aujourd’hui plus de 2.000 milliards de dollars dans ses réserves. Une partie de cet argent est à l’œuvre pour spéculer sur les matières premières agricoles. Il est en effet plus rentable de prendre position sur les marchés à terme du sucre ou du blé que d’investir en Bourse. Les rendements de l’argent investi sont supérieurs et les risques moins grands. La spéculation sur les MPA a radicalisé les lois de l’offre et de la demande, et fait grimper les prix en pénalisant successivement les consommateurs, puis les agriculteurs quand ces mêmes prix s’effondraient. L’Europe ne doit pas ignorer la réalité des marchés agricoles. Le monde paysan s’est très longtemps réfugié dans des postures victimaires. On peut dénoncer le jeu des spéculateurs, on doit le combattre, mais les professions de l’agroalimentaire ne feront pas l’économie d’une réflexion sur leurs pratiques. Les jeunes générations de paysans ont un regard nouveau sur le métier. C’est à travers eux qu’un nouveau modèle verra le jour. À ce stade, la PAC 2013 est loin d’être bouclée. Le monde paysan, et on le comprend, milite en faveur d’une régulation rationnelle qui permettrait aux producteurs de lisser leurs revenus et aux consommateurs de bénéficier de bons rapports qualité/prix. Les premières déclarations du nouveau commissaire européen à l’Agriculture, le Roumain Dacian Ciolos, laissent à penser que les aides directes seront maintenues pour les agriculteurs et que le budget de la PAC 2013-2020 sera « suffisamment important », selon l’expression du député européen Michel Dantin (UMP-PPE). Au-delà des questions budgétaires, l’approche politique européenne privilégie désormais de nouvelles stratégies de développement. M. Ciolos soutien l’idée de « normes européennes » qui agiraient sur les marchés comme des outils de différenciation par rapport aux productions hors Communauté. Ces nouvelles normes, connues des consommateurs, viendraient identifier l’offre européenne sur la base d’un cahier des charges qualitatif ambitieux. M. Ciolos entend également privilégier les « circuits courts » qui ont conquis une partie des citadins, pour partie hostiles à une consommation à contre-saison. Le débat sur la PAC 2013 ne peut donc être traité à part des autres grands dossiers de l’agriculture et de l’alimentation. Les États ont le devoir de trouver des règles du jeu qui respectent la liberté des marchés mais limitent la spéculation sur l’alimentation du monde, et les paysans doivent imaginer des formules d’organisation qui en font, non plus seulement des producteurs de matières premières, mais de vrais entrepreneurs de la terre, producteurs de MPA et créateurs de valeur ajoutée8.
Quatre idées pour passer d’une politique de guichet à une politique de projet
La coopérative, arme fatale du monde agricole
Dans la plupart des cas, la nature même de l’activité agricole induit l’isolement et la solitude de l’exploitant. Le paysan est au milieu de ses champs, séparé de ses voisins par de grandes étendues. Dans la majorité des cas, la culture de biens de grande consommation ou de matières premières est une activité à fort volume et aux marges étroites. Dans les agricultures modernes comme les nôtres, la taille joue un rôle déterminant. Mais la particularité la plus singulière de l’activité d’exploitation de la terre ou de la mer est celle du vivant. Les paysans travaillent sur du vivant. Ils ne sont à l’abri ni des caprices de la terre, ni des maladies végétales, ni des aléas climatiques. C’est sans doute pour toutes ces raisons que certains d’entre eux, en dépit de leur tempérament individualiste, ont décidé de se constituer en coopératives. Le monde coopératif, les Coop de France rassemblées sous une seule bannière depuis peu, porte 45% de l’agroalimentaire français. Beaucoup de consommateurs ignorent que les marques Paysan Breton, Candia, Banette, Yoplait, Isigny, Échiré, Matines, Poulet de Loué, D’Aucy, Daddy, Beghin Say, Francine, Jacquet, Cellier des Dauphins, Loïc Raison, Nicolas Feuillate sont toutes des marques coopératives. Les Coop représentent un chiffre d’affaires de 80 milliards d’euros et emploient 150.000 salariés en France. Il est donc temps de changer le regard que les Français portent sur les coopératives, souvent perçues comme des regroupements informels de producteurs certes sympathiques, mais un tantinet désuets. Les Coop ont été le plus gros amortisseur de la crise des prix agricoles au cours des deux dernières années. Elles ont sauvé des pans entiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire. Comparé à d’autres entreprises, le taux de défaillance des coopératives est marginal. Les Coop incarnent une forme originale et efficiente du capitalisme moderne. Elles sont des entreprises du marché non opéables et non délocalisables. Leur structure financière comporte une part de capital impartageable, c’est-à-dire attaché indéfectiblement à l’outil de travail. Leurs actionnaires sont des coopérateurs et des fournisseurs, peu soucieux de rendements élevés du capital à très court terme mais attachés à la productivité des investissements.
La coopérative repose sur une idée centrale de la nouvelle Loi de modernisation agricole : le contrat. La coopérative s’engage à recevoir la production des coopérateurs, les coopérateurs s’engagent à fournir toute leur production à la coopérative à un prix accepté par tous, quels que soient les prix du marché « libre ». Les Coop entendent prévenir les risques. Grâce au rassemblement des adhérents, elles permettent d’acheter moins cher les intrants, les semences, et de vendre plus cher les productions de leurs adhérents. Les coopératives ne forment pas un aimable patronage de paysans aux contours collectivistes. Elles respectent l’équité et non l’égalité. Elles savent reconnaître la qualité des productions livrées et font preuve de discernement dans la rémunération des apports respectifs. La coopérative est une arme de guerre économique redoutable sur les marchés. Elle offre toutes les options pour fournir un cadre adéquat au monde paysan, pour mieux s’organiser et rémunérer le travail de chacun. Les coopératives sont plus efficaces que les subventions. Que peut-on faire pour les aider à se développer ?
Favoriser leur croissance
La holding Siclae rassemble cinq coopératives et ouvre son capital à tous ses membres et au personnel salarié des Coop avec un minimum de souscription de 550 euros et un plafond à 55.000 euros.
Entretien avec l’auteur, 4 mars 2010.
Gérard Maillet, directeur général adjoint de Coopagri Bretagne, interrogé par Les Échos, 1er mars 2010.
De nombreux dirigeants de coopératives ont compris la nécessité d’accélérer le regroupement de leurs organisations. Les Coop françaises sont encore de petite taille. À l’échelon mondial et sur les grandes cultures, elles ne sont pas assez concentrées. Des regroupements horizontaux ont eu lieu dans l’est de la France ces derniers mois9. L’ambition est de devenir leader des grands marchés ou, à défaut, dans les trois principaux acteurs mondiaux. Le défi de cette croissance est aussi celui de la gouvernance : comment grossir (ou grandir) à l’échelle du monde en demeurant coopératif, c’est-à-dire respectueux des tables de la loi coopérative fondées sur la proximité, l’équité et la démocratie économique ? Les coopérateurs devront préférer les unions de coopératives aux fusions de coopératives qui éloignent les hommes du centre de commandement. Elles devront inventer un modèle de gouvernance décentralisé et flexible favorisant la circulation des flux d’information du haut vers le bas et du bas vers le haut. Dans une Coop, la gouvernance est un facteur d’efficacité économique. Son succès repose sur la bonne entente du binôme président (représentant des coopérateurs) et directeur général ; elle dépend aussi de la lisibilité du projet industriel.
« Un projet d’entreprise clair et partagé associé à une bonne lecture du marché, et la coopérative est sur les bons rails », témoigne André Foellner, le directeur général de Coopérative agricole de Colmar10. La pédagogie de la gouvernance est, elle aussi, un facteur d’efficacité : « Il faut expliquer, documenter et informer en temps réel, ajoute André Foellner. Les coopérateurs ne sont pas des pions, ils attendent non seulement des résultats, mais aussi un lien de coordination avec les instances dirigeantes. Dans une coopérative, nous savons qu’il n’est de richesse que d’hommes, mais aussi qu’il n’est de faiblesse que d’hommes. » À l’autre bout du pays, en Bretagne, trois coopératives, Coopagri Bretagne, CAM 56 et Eolys, ont choisi de fusionner leurs activités, « parce que l’agriculture nécessite cette mise en ordre de bataille11 ». La mutualisation des compétences, le développement de l’innovation et la rationalisation des coûts « contribueront à pérenniser les exploitations agricoles des adhérents des trois sociétés ».
Dans les secteurs de grandes cultures, dans celui des fruits et de la viande, le modèle coopératif permet de réduire les coûts de production et d’apprécier la valorisation des productions. Il doit assurer la taille critique des entreprises adhérentes. Le regroupement des acteurs ne sera pas non plus sans effet sur le rapport de force entre agriculteurs, industriels et distributeurs. Le modèle des Coop permettra aux agriculteurs de réduire la part des subventions qui compensaient la faiblesse du tissu agricole fragmenté de notre pays.
Élargir le cercle des amis
Le Fonds stratégique d’investissement (FSI) abondé par l’État et la Caisse des dépôts et consignations a investi début mars 150 millions d’euros dans la coopérative Limagrain, le quatrième semencier mondial. Un nouvel investissement du même ordre devrait suivre en Champagne. L’entrée de capitaux publics dans des structures coopératives consacre le principe coopératif et marque une étape vers l’âge adulte de ces structures déjà anciennes. Les enjeux ne sont pas minces : améliorer les plantes pour répondre aux besoins alimentaires et faire face à la concentration déjà très engagée dans le secteur. Pour les agriculteurs coopérateurs, la marge se trouve pour partie dans le génie génétique. Le géant américain Monsanto, spécialisé dans les produits phytosanitaires, a donné la priorité aux semences. Pour réussir, les agriculteurs français de demain devront maîtriser la filière, des semences jusqu’à une partie de la transformation et de la commercialisation de leurs productions. Le FSI apporte le sérieux institutionnel au travail accompli par le mouve- ment coopératif. Les jeunes agriculteurs porteurs d’une nouvelle vision de leur métier doivent à tout prix s’insérer dans ce vaste mouvement de consolidation des secteurs de la chimie verte, de l’agriculture et de l’agroalimentaire.
Une enseigne lisible des Coop
Les consommateurs attendent un message du monde des champs. Les jeunes citadins et ceux qu’on appelle parfois abusivement les bourgeois bohèmes, les bobos, souhaitent consommer avec discernement. Les coopératives de France rassemblent des céréaliers, des éleveurs, des maraîchers, des vignerons. Tous les secteurs de l’agriculture y sont représentés. Les coopératives bénéficient d’une chance historique pour développer un label, adossé à des valeurs simples, comme la proximité et la saisonnalité. Ce label, reconnaissable par tous les consommateurs, n’a pas vocation à se substituer à la grande distribution. Il sera un circuit de vente additionnel, dans les fermes ou en dehors. Tous les paysans n’y auront pas accès : les céréaliers n’ont rien à vendre en direct aux consommateurs. En revanche, pour beaucoup d’autres, la distribution de leurs productions constituera non seulement un revenu supplémentaire, une partie de la valeur ajoutée, mais elle leur permettra aussi de reprendre le contact avec les Français. Les grandes enseignes de la distribution jouent déjà sur ce registre : les produits du terroir, les régions qui « ont du talent », tous ces produits issus d’une agriculture proche, qualitative et humaine sont dans leurs rayons et au centre de leur communication. Après avoir raté le rendez-vous des années 1970 en abandonnant leurs productions aux seuls transformateurs et distributeurs, les paysans laisseront-ils passer le train une seconde fois ? Les agriculteurs français n’ont d’autre choix que d’élargir les frontières de leurs métiers actuels, et le mouvement coopératif, déjà rassemblé, doit serrer les coudes autour de ses dirigeants pour soutenir toute initiative visant à consolider le développement des circuits courts.
Un label pour l’agroalimentaire français, des filières mieux organisées
William Villeneuve, Le bonheur est dans les Entretiens avec Pascal Perri, Florent Massot, 2010.
Les agriculteurs français affirment, à juste raison, que la réglementation française est la plus exigeante du monde en matière sanitaire et dans le secteur de l’environnement. Nos cultures biologiques ne font pas exception à cette règle du mieux-disant. « Les écarts de qualité sont importants entre nos labels bio et ceux de nos voisins », assure William Villeneuve, président des Jeunes Agriculteurs12. Nous sommes le peuple qui mange assis et qui consacre au repas une importance symbolique. Par culture, nous aimons nos territoires, nos terroirs et leurs productions de qualité. L’identité française est aussi dans l’assiette, au sens où il existe une géopolitique alimentaire. Les exigences de la réglementation française ne sont pas un handicap. Les paysans et la société française doivent en faire une chance et se les approprier. Un label portant les engagements des agriculteurs français en matière de qualité et de respect des cycles naturels serait de nature à rassurer les consommateurs et agirait sur le marché comme un puissant outil de différenciation. Le protectionnisme est aberrant, mais la différenciation qualitative est plus efficace et plus durable. L’agriculture, parce qu’elle touche à notre mode de vie, à nos habitudes et à notre santé, peut être l’objet d’une préférence. Non pas une préférence qui s’exprimerait par des barrières d’entrée sur notre marché, mais une préférence fondée sur un choix volontaire : celui de la qualité et des normes de santé et environnementales les plus élevées. Une distinction qualitative sanctionnée par un label ou une marque « France » pourrait être mise en œuvre. Nos partenaires européens n’ont pas tous la même représentation de l’agriculture. Les pays du Nord sont moins exigeants. Aux Pays-Bas, le port de Rotterdam est une « véritable passoire », affirment les syndicalistes de Jeunes Agriculteurs. Les Hollandais « laissent passer n’importe quoi au mépris des règles communautaires », ajoute le dirigeant d’une coopérative. Les agriculteurs français auraient tort de s’accrocher à l’idée d’un cordon sanitaire autour de nos frontières. La France devra vivre avec ses voisins, les plus proches et les plus lointains.
Il existe cependant une place pour un nouveau marché, additionnel à celui des grands volumes. Témoin, le succès des Associations de marchés paysans (Amap), qui comptent désormais 200.000 clients chaque année. Les consommateurs souscrivent un « abonnement » auprès de leur fournisseur. Celui-ci est installé à proximité et ne propose que des produits de saison. Il s’engage à remplir un panier chaque semaine. Les Amap ont remis au goût du jour les notions de saison, de produits de la terre, de culture raisonnée. Elles marquent une forme de défiance grandissante à l’égard de la consommation à contre-saison et traduisent le besoin de mieux maîtriser ce qui est consommé. Dans ce contexte, la marque « France » est une chance qu’il faut saisir et théâtraliser. Les paysans français ont là l’occasion de reprendre l’initiative en direction de l’opinion.
Un discours rénové : pour que les paysans parlent aux consommateurs
Le salon de l’Agriculture est le plus visité de France avec 700000 visiteurs chaque année, soit 1 % de la population française.
Les agriculteurs français n’ont pas mené le travail d’information et de conviction qu’ils auraient dû conduire auprès des consommateurs et des citoyens. Ils ont raté leur rendez-vous avec l’opinion, laissant le terrain à l’industrie agroalimentaire et aux distributeurs. Les Français aiment l’agriculture13, mais ils se méfient des agriculteurs, souvent en raison du matraquage des intégristes verts. Le mouvement syndical agricole et son organisation majoritaire, la FNSEA, se sont trompés de stratégie. Le discours syndical dominant ne s’adresse qu’aux paysans eux-mêmes ou, à défaut, aux pouvoirs publics, français ou européens, souvent sous la forme d’ultimatum. Presque jamais à l’opinion, c’est-à-dire aux clients. Fausse route ! L’image de paysans français toujours en quête de nouvelles subventions, cette image d’une paysannerie pleurnicharde et revendicatrice a brouillé le message et terni l’image des agriculteurs. En cantonnant l’activité agricole au seul domaine des aides et des subventions (à tort ou à raison), les agriculteurs se sont progressivement éloignés des Français. Ils ont éveillé la méfiance, la suspicion autour de leur activité et de leurs revenus. La FNSEA a toujours été un relais auprès des gouvernements, elle a construit une relation intime avec le politique, mais l’a-t-on jamais entendu dire clairement que les subventions aux agriculteurs étaient en réalité des aides à la consommation, pour permettre à tous les Français d’acheter leur alimentation dans des conditions de prix acceptables ?
Certains jeunes agriculteurs ont pris conscience du piège qui se referme aujourd’hui sur la profession. Ils savent que le discours sur les subventions, les aides ou les « compensations » est à bout de souffle. Au congrès des Jeunes Agriculteurs, en 2009, le thème des débats donnait déjà le ton : « Les agriculteurs sont-ils des entrepreneurs comme les autres ? » Poser la question, c’était déjà en partie y répondre. Comme nous l’avons dit, le sauvetage de notre agriculture repose sur un nouveau pacte entre la République, ses territoires et ses paysans ; il s’inscrit aussi dans la rénovation du dialogue avec les citoyens-consommateurs. Mais avant tout, c’est bien des agriculteurs eux-mêmes qu’il dépend. « Tous les chefs d’entreprise savent à l’avance à quel prix ils vont vendre leur production, expliquent les dirigeants de Jeunes Agriculteurs. Dans ce domaine, nous ne sommes pas à égalité. » La Loi de modernisation de l’agriculture (LMA) introduit la notion clé de contrat entre producteurs et transformateurs. Elle place au cœur du dispositif un outil qui devrait précisément donner de la visibilité aux chefs d’entreprises agricoles. Dans le cas des productions agricoles soumises aux aléas climatiques et agronomiques, les acteurs de la filière agroalimentaire pourraient s’accorder sur le principe de prix encadrés. Il ne s’agit pas de remettre en cause la liberté des échanges, mais au contraire d’adapter les règles méthodologiques de fixation des prix à la typologie du marché pour faire en sorte que les entrepreneurs agricoles bénéficient d’une garantie de revenu minimum. Quoi qu’il en soit, c’est bien dans cette direction, celle d’un entrepreneuriat agricole mieux organisé et mieux protégé par la loi, que les paysans français iront chercher le salut de leurs exploitations et celui de notre agriculture.
La loi et le gendarme
Les paysans, et en particulier leurs organisations professionnelles, gagneraient à sortir du discours compassionnel pour accepter le marché et demander l’application de ses règles. Pendant trop longtemps, la baisse des prix a été compensée par des subventions aux producteurs. Quand la colère montait, on augmentait la dose de morphine pour calmer le patient ! Cette politique, apparemment amicale, est sans doute l’un des plus mauvais services qui a été rendu aux agriculteurs de France. La maladie a été neutralisée par de puissants calmants, mais aujourd’hui il faut se réveiller et le réveil est douloureux. Les paysans ne manquent cependant pas d’arguments à faire valoir auprès du public et des décideurs. Le dispositif prévu dans la LMA en faveur d’une meilleure organisation des filières et des interprofessions est un premier pas utile. Dans un secteur connexe, la Loi de modernisation économique (LME) avait déjà ouvert des pistes pour mieux observer le respect des règles de concurrence. Sur des marchés très (trop) volatiles, seul un Observatoire des marges (et non uniquement de la concurrence) doté d’un vrai pouvoir de sanction aura suffisamment d’influence pour que les baisses de prix de matières premières agricoles se retrouvent – a minima – dans les prix des produits finis. Ce qui a manqué jusqu’à maintenant, c’est avant tout un vrai gendarme. Une loi comme un contrat ne sont efficaces et durables que s’ils contiennent une clause pénale. À ce jour, les différents outils de soutien aux règles de concurrence exercent un pouvoir d’observation. Pour être tout à fait efficace, l’Observatoire des marges doit se doter d’outils méthodologiques incontestables. En premier lieu, il doit siéger en permanence pour suivre en temps réel la chaîne de valeur entre producteurs, transformateurs et distributeurs. Ensuite, il doit concevoir tous les outils d’analyse qui permettront de comprendre et de modéliser la part de matière première dans les processus de transformation agroalimentaire. On sait, par exemple, que le lait entre pour 60% dans la composition d’un yaourt, que les pâtes alimentaires sont constituées à 90% de blé dur…, bref, les indicateurs ne manquent pas pour éclairer la chaîne de valeur et dénoncer les comportements irresponsables, pour l’amont comme pour l’aval. Les paysans attendent une initiative dans ce sens. Ils sont les plus mal lotis dans la chaîne de valeur. La production de base est devenue la variable d’ajustement. Si l’ambition est de maintenir en France des agriculteurs vivant de leurs productions, il faut mieux partager la valeur. « La comparaison entre nos prix de cession et les étiquettes dans les supermarchés affirme William Villeneuve, montre bien que nous sommes les plus mal payés du circuit. Elle montre aussi qu’il y aurait de la place pour que chacun gagne honorablement sa vie. »
Conclusion
Institut de l’élevage, Rapport France laitière 2015, septembre 2009.
La crise financière a relégué au second plan les crises alimentaires. On a pensé que le monde allait être ruiné. Personne ne s’est demandé s’il allait être affamé ! Le veau d’or contre le veau tout court… Dans le secteur agricole, comme dans d’autres domaines, la mondialisation exprime deux tendances apparemment contradictoires : l’exigence de très grands volumes et le besoin de proximité. Les terroirs n’ont jamais été autant plébiscités. La renégociation de la PAC devra en tenir compte. Mais gare aux mirages ! S’il est bien un secteur où le mot libéralisme a été utilisé en dépit du bon sens, c’est bien celui des productions agricoles. Les cours des matières premières sont certes l’objet d’une forte spéculation sur les marchés, comme à la Bourse de Chicago, mais aucun autre secteur n’a été soutenu avec autant de constance que celui de l’agriculture. La nouvelle PAC devra pro- poser des efforts acceptables : dans le cas du marché du lait, les Français ont à faire valoir des contrastes régionaux et les territoires de montagne ne peuvent pas être mis en concurrence avec les régions de plaine. La montagne couvre 35% des territoires de l’Union, mais elle n’abrite que 15% des exploitations et assure 11% de la production14. Pour 1 tonne de lait collecté, le surcoût « montagne » est de 62 euros. La PAC ne pourra pas faire l’économie d’un débat sur les territoires. À défaut, les agriculteurs de moyenne montagne en France, en Allemagne, en Autriche, en Finlande, en Espagne ou en Pologne devront accepter le rôle de jardinier de la nature. Le maintien d’activités économiques rentables dans ces zones est la seule garantie de leur survie, puis de leur développement. En montagne, un emploi agricole induit jusqu’à dix emplois.
L’agriculture est dans ces régions une garantie pour soutenir l’activité touristique. Les résidents britanniques qui vivent dans le Limousin se seraient-ils installés sur place s’il n’était resté que des champs en jachère ? L’agriculture structure et maille le territoire. Les dirigeants politiques de l’Europe ne doivent pas l’oublier.
Mais le monde paysan a lui aussi un effort à produire. La LMA va lui donner de nouveaux outils d’excellence. Les agriculteurs vont devoir se concentrer, se regrouper, mutualiser leurs forces et s’approprier une partie de l’aval. L’offre coopérative qui permet tout cela n’a pas encore été suffisamment explorée. L’idéal coopératif associe la terre, le terroir et les territoires, c’est-à-dire, l’actif de production, la production elle-même et toutes les activités indirectes et induites. L’étude de l’économie agricole de ce début de xxie siècle renvoie à l’étude de notions économiques de base : la rareté et l’efficacité. Les ressources de ce monde sont rares et limitées. La croissance de la population, les exigences qualitatives et la préservation de l’environnement imposent de les exploiter encore plus efficacement. La nouvelle génération de paysans qui travaille avec l’aide de l’informatique et d’Internet, la génération des experts de la nature et du vivant, agronomes et chefs d’entreprise, cette génération doit rénover le compromis républicain autour de notre modèle agricole. Il est urgent de refonder un lien durable, solide et documenté, entre la nation et ses paysans.

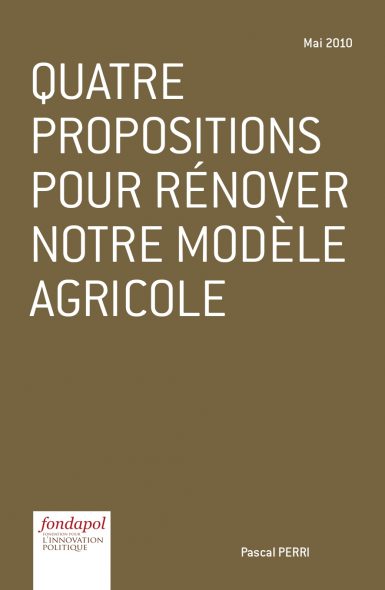











Aucun commentaire.