Politique économique : l'enjeu franco-allemand
Introduction
Centralisation vs régionalisation*1
Formation des élites vs formation des entrepreneurs
Ordolibéralisme vs colbertisme : une approche bottom Up vs top down
Le rôle de la monnaie et de la banque centrale
La mise en œuvre de la Politique économique
La place de la Politique industrielle
Les inconvénients du système fédéral allemand
La dimension européenne : Gouvernement économique européen
Conclusion
Résumé
Tout le monde perçoit que la coopération franco-allemande est devenue le pilier porteur de l’intégration européenne et, il y a deux ans, à Berlin, le couple franco-allemand a célébré en grande pompe les cinquante ans du traité de l’Élysée. Français et Allemands sont des voisins très proches, mais, en même temps, se connaissent à peine. Cette méconnaissance réciproque est la source de maints malentendus entre les deux pays. Cette ignorance n’épargne pas les dirigeants politiques. Il existe notamment une profonde incompréhension entre les deux peuples en matière économique. C’est en particulier en termes de compétitivité que le fossé se creuse actuellement entre les deux rives du Rhin. L’origine de ces divergences entre la France et l’Allemagne s’explique, entre autres, par la structure centralisée de la France et la structure décentralisée, c’est-à-dire fédérale, de l’Allemagne.
En France, pendant des siècles, la monarchie a su créer un territoire stable, animé d’un mercantilisme d’État, appelé colbertisme, comme ordre économique. En revanche, au début du xixe siècle, le Saint-Empire romain germanique dénombrait plus de trois cents territoires souverains, et encore trente-cinq après sa disparition. Aujourd’hui, l’Allemagne compte seize Länder, avec autant de parlements et de gouvernements régionaux.
Les divergences entre la France et l’Allemagne sont la conséquence d’un enracinement de longue date dans l’histoire économique des deux pays et se reflètent toujours dans de nombreux domaines et thématiques, notamment quant au rôle de l’État et de la monnaie dans l’économie, dans la mise en œuvre de la politique économique, dans la place de la politique industrielle et dans la formation professionnelle.
Au final, il est difficile de conclure à l’infériorité ou à la supériorité d’un système économique centralisé ou décentralisé, mesuré par la croissance économique. La France a connu par le passé une croissance plus forte que l’Allemagne, et vice versa. En revanche, on peut conclure des données historiques que la France a connu deux périodes de croissance forte de 4 à 5% dans la seconde moitié des années 1980 et celle des années 1990, durant des périodes de convergence étroite avec la politique économique et budgétaire de l’Allemagne, notamment par le rétablissement de l’équilibre budgétaire qui devenait une condition indispensable pour une croissance économique durable. Malheureusement, cette expérience budgétaire d’une croissance par consolidation budgétaire, et non l’inverse, semble être tombée dans l’oubli en France.
Le regard porté vers le passé nous enseigne une seconde découverte : toutes les unions monétaires ont échoué lorsqu’elles n’étaient pas accompagnées par la formation d’un État central ou par un abandon de la souveraineté nationale de la part des pays membres sur les domaines centraux et leur transfert à un niveau communautaire (fédéral). Le succès durable du tandem franco-allemand est devenu la condition préalable si l’on veut éviter un éclatement de la zone euro et passe nécessairement par le retour à la vérité budgétaire, c’est-à-dire à l’équilibre budgétaire, et non l’inverse, qui alimente la dette d’un pays et, à terme le fragilise.
Wolfgang Glomb,
Économiste, ancien directeur des Affaires européennes au ministère des Finances allemand et membre du conseil d’orientation de l’Institut Thomas-More.
Henry d'Arcole,
Ancien auditeur au Contrôle général économique et financier (CGEFI) des ministères économiques et financiers (Bercy).
Introduction
Les rapports entre Français et Allemands se caractérisent à la fois par une extrême sympathie et par une grande méconnaissance réciproques. Côté allemand, on retient toujours l’image d’une France comme étant le paradis terrestre. «Vivre comme Dieu en France», ce vieux dicton n’a pas perdu de son actualité. Côté français, l’Allemagne est surtout perçue comme un pays terne, discipliné, peu attirant, mais en même temps considéré comme un modèle. «Suivre l’Allemagne» est devenu depuis quelques années le leitmotiv des gouvernements français. Le fossé entre sympathie et méconnaissance semble se creuser davantage en raison d’un certain manque de curiosité par rapport à ce qui se passe des deux côtés du Rhin. L’ignorance réciproque est la source de maints malentendus entre Paris et Berlin. Une défiance latente est souvent à l’ordre du jour. En Allemagne, on craint toujours une Europe «à la française», et en France, une «germanisation» de l’Europe.
Dans ses deux premières parties, cette note expose les origines historiques et culturelles des divergences entre les deux peuples et, dans les deux suivantes, elle insiste sur le rôle de l’État et de la monnaie dans l’économie. Les cinquième et sixième parties décrivent l’organisation de la politique économique en France et en Allemagne, et l’importance de la politique industrielle pour les deux pays, tandis que la septième partie souligne les faiblesses de l’Allemagne et que la huitième et dernière partie aborde la dimension européenne dans ce contexte. La conclusion explique le besoin urgent de réformes pour la France.
Centralisation vs régionalisation*1
Voir Reinhart W. Wettmann, « Le Très Envié Mittelstand Allemand. Retour Sur Les Raisons Du Succès Des Pme Outre-Rhin », Analyses Et Documents, Friedrich-Ebert-Stiftung, Mai 201
Bien que proches voisins, Français et Allemands se connaissent à peine. Cette méconnaissance réciproque est la source principale de mauvaises compréhensions entre les deux peuples dans de nombreux domaines et thématiques. Les deux peuples portent un regard très stéréotypé sur leurs voisins dont ils connaissent mal les traditions et les modes de pensée. L’ignorance n’épargne pas les dirigeants politiques, en dépit d’un système dense de consultations et de coopérations entre les deux gouvernements et les parlements.
Il existe notamment une forte incompréhension entre Allemands et Français en matière économique, tout particulièrement en ce qui concerne la politique industrielle. Les divergences entre la France et l’Allemagne sont la conséquence d’un enracinement de longue date dans l’histoire politique et économique des deux pays. Dans l’ensemble, l’origine de ces divergences s’explique par la structure centralisée de la France et la structure décentralisée de l’Allemagne.
En France, pendant des siècles, la monarchie centralisée a pu faire reculer les frontières extérieures et créer un territoire stable. Le mercantilisme d’État, ou colbertisme, a poussé à la centralisation de l’économie, dans laquelle les manufactures royales, protégées contre la concurrence étrangère, assuraient la satisfaction des besoins de la cour, de la noblesse et du clergé en leur fournissant notamment des tissus précieux, des outils mécaniques et des armes.
En revanche, au début du xixe siècle, le Saint-Empire romain germanique dénombrait plus de trois cents territoires souverains, nombre réduit à trente-cinq par fusions ou annexions lors de sa disparition. En 1871, lors de la proclamation de l’Empire allemand, il n’en restait plus que vingt-cinq. Aujourd’hui l’Allemagne compte seize Länder, et autant de parlements et de gouvernements.
Cette décentralisation de l’État allemand a joué un rôle essentiel dans le développement des PME, le Mittelstand allemand, très envié par ses voisins. Dans les petits États allemands, c’étaient de petites manufactures qui produisaient les marchandises afin de répondre aux besoins modestes des petites cours princières et des populations locales. Les petites manufactures ont dû s’adapter à une concurrence acharnée entre elles. Face à la grande variété d’ordres judiciaires et de régimes douaniers souverains qui prévalait dans l’Allemagne du xixe siècle, les manufactures et les jeunes entreprises industrielles furent très tôt contraintes de se tourner vers l’exportation. C’est ainsi qu’elles ont pu prendre pied au-delà de leurs frontières et réduire en conséquence les coûts unitaires élevés, caractéristiques des petites manufactures. L’industrialisation de l’Allemagne a donc conduit très tôt à l’épanouissement d’un vaste secteur privé et exportateur composé de PME.
Formation des élites vs formation des entrepreneurs
À la différence de la France, les petits États allemands ne disposaient pas d’un système éducatif élitiste par le biais de grandes écoles, dont celles d’ingénieurs. C’est ce qui explique la mise en place dans les PME allemandes de formes d’organisation moins hiérarchiques que patriarcales, sorte de coopératives associant les fondateurs d’entreprises, les ingénieurs et les ouvriers qualifiés. En outre, avec la décentralisation, la formation professionnelle en alternance centrée sur l’apprentissage reste un des facteurs de réussite de ces PME. Ce système de formation fournit aux entreprises des ouvriers hautement qualifiés et participe ainsi au très bon niveau de qualité de leurs produits. Le système allemand, traditionnellement plus souple, forme des entrepreneurs davantage prêts à conquérir les marchés étrangers, exploitant des niches pour leurs produits et prêts à prendre des risques.
Ce système a su mettre en avant le marché et ses acteurs industriels en développant un système éducatif décentralisé, capable de répondre aux attentes des entreprises, en adaptant l’offre aux changements techniques que l’entreprise ou l’agent commercial peuvent observer ou imposer en raison des évolutions de la demande. Ce système assure une meilleure insertion des jeunes en Allemagne et un suivi de la qualité des produits allemands, eux- mêmes parfaitement adaptés aux marchés extérieurs, ce qui explique, entre autres, un taux de chômage des jeunes bien inférieur à celui de la France.
À l’inverse, le système français, fortement hiérarchisé et strictement réglementé, forme une classe de technocrates, excellents chercheurs, économistes et hauts fonctionnaires, ainsi que des ouvriers d’État, souvent ne correspondant pas aux besoins de l’industrie sur le marché, comme constaté par exemple par le rapport Gallois en 2013. Ce système s’est jeté dans les bras d’une technocratie composée de hauts fonctionnaires, d’ingénieurs d’État, d’administrateurs civils ou d’énarques qui imposent une vision d’«en haut», en toute bonne foi, mais aux compétences sans limites ou sans contrôle face à un pouvoir politique instable et impuissant. Conçue dans un monde cloisonné, cette haute fonction publique connaît une extension de ses prérogatives, protectrice de ses intérêts et de ses carrières, entretenue, d’une part, par un système éducatif basé sur les concours donnant accès aux grandes écoles (principe du numerus clausus) et structurant toute la hiérarchie pour l’ensemble des carrières, et, d’autre part, par les directions des ressources humaines (surtout au sein des grandes administrations) qui maintiennent un système discriminatoire dont les limites se révèlent actuellement avec la perte de compétitivité. Peu en prise avec les réalités économiques, incapable d’appréhender les tendances du marché, cette technocratie (ou mandarinat) accapare le pouvoir politique et économique, d’autant plus facilement qu’il est centralisé, en se répartissant les meilleurs postes, ce qui laisse peu de place à la promotion interne ou à l’expérience acquise dans le secteur privé.
De plus, cette composition des «élites» issues des grandes écoles et réparties en «grands corps», empêche toute attractivité d’un poste de PDG au sein d’une PME ou d’une ETI (entreprise de taille intermédiaire) en province par rapport à un poste «plus prestigieux» de directeur ou de cadre supérieur dans une grande entreprise réputée en France et sur le plan mondial, et où un échec n’aura que peu d’influence sur sa carrière. On peut douter que cette mentalité formatée selon trois principes immuables – sélection, élitisme, hiérarchie – soit surmontée dans un proche avenir pour faire face aux évolutions du marché et aux nouveaux défis – concurrence, ouverture, flexibilité.
Ordolibéralisme vs colbertisme : une approche bottom Up vs top down
Voir Wolfgang Glomb, Le Tandem franco-allemand face à la crise de l’euro, fondation pour l’innovation politique, mars 2011
Il en va de même des convictions divergentes en matière de doctrine économique et du bon fonctionnement de l’économie dont les origines sont strictement historiques. En Allemagne, cet ordre est fortement associé au nom de Ludwig Erhard, premier ministre de l’Économie sous le chancelier Adenauer, fondateur de la Ordnungspolitik allemande qui, dès l’origine, prenait en compte les aspects sociaux nécessaires. La Soziale Marktwirtschaft était née. Ses fondements reposent sur une confiance totale dans les forces du marché qui exigent, pour leur plein déploiement, autant de liberté que possible et pas plus de régulation que nécessaire2.
À l’opposé, en France, aux lendemains de la guerre, l’idée d’organisation l’emportait sur l’idée de marché car le pays était à reconstruire et à moderniser. Selon les forces en présence à la Libération, c’était à l’État d’organiser l’économie, et la formule magique était «moderniser par le haut», d’où la place des nationalisations et de la planification engendrant une économie fortement administrée et rigide, conçue de manière mécaniste, et présentant le service public comme une sorte de sacerdoce laïc, voire un dogme sacré. Pour les dirigeants français, l’État peut toujours diriger l’économie comme un moteur électrique mis en marche par simple poussée sur le bouton vert, mais les ratés sont nombreux. L’État doit peser de tout son poids sur la vie économique du pays, et donc en contrôler tous ses acteurs, directement ou indirectement.
Un des grands problèmes de l’interventionnisme gouvernemental est qu’il requiert une ingérence permanente dans l’économie, souvent dans des directions opposées par rapport aux tendances ou aux nécessités. Le meilleur exemple en est la fixation de la durée du travail par la loi à partir de 2000. L’introduction des 35 heures coïncide avec le déclin de la compétitivité du secteur manufacturier français qui, pourtant, excédait celle de l’Allemagne au cours des années précédentes. Parallèlement, la contribution de l’industrie au PIB reculait en France, jusqu’à atteindre actuellement 12 % contre 25 % en Allemagne. Or, par la suite, il a fallu faire des pieds et des mains pour renverser cette tendance à la désindustrialisation de la France en cherchant à augmenter la compétitivité industrielle. En attendant, selon le Global Competitiveness Report 2014-2015 du World Economic Forum de Davos, la France se classe en vingt-troisième position (l’Allemagne en cinquième) sur 144 pays sur le plan mondial, derrière tous les pays industrialisés.
Autre exemple, dès septembre 2012, le nouveau gouvernement a augmenté les impôts sur les entreprises de 10 milliards d’euros et abrogé l’assouplissement des charges sociales financé par une augmentation de la TVA décidée par son prédécesseur. Ce n’est que depuis un an, avec l’introduction en 2013 du crédit impôt compétitivité emploi (CICE), que le pacte de responsabilité figure à l’ordre du jour, c’est-à-dire la suppression des cotisations familiales par les entreprises, avec toutefois pour contrepartie l’augmentation du nombre des embauches. Ceci montre clairement l’absurdité de l’intervention publique au cas par cas ou de la politique du donnant-donnant qui succède à celle du ni-ni (ni nationalisation ni privatisation) de 1989. Quel fonctionnaire d’État serait-il mieux en mesure de gérer une entreprise que le propriétaire lui-même ou son PDG ? Quel fonctionnaire peut juger si le Smic actuel est approprié et combien d’ingérences gouvernementales peut digérer le marché du travail ? Les dogmes politiques des 35 heures et du Smic sont sacro-saints en France. Mais il faut quand même le reconnaître : ce qui est économiquement faux ne peut être correct politiquement, et ne le sera jamais. Les lois économiques s’appliquent aussi en France.
De surcroît, il faut une armée de fonctionnaires pour contrôler le fonctionnement de chaque nouveau régime. Et ce n’est pas par hasard si l’on compte en France 95 fonctionnaires d’État pour 1.000 habitants, contre 50 en Allemagne. Les dépenses publiques ont atteint 57% du PIB contre 47% en Allemagne, et la dette souveraine s’approche inexorablement des 100% du PIB contre 75% en Allemagne (après avoir atteint 81% en 2012). En fin de compte, le gonflement du secteur public est une des conséquences indirectes de l’introduction des 35 heures, sans pour autant que l’on constate une amélioration des services publics.
Ce colbertisme ringard n’a jamais eu de racines en Allemagne. Ce qui reste de cette attitude française, c’est une politique industrielle très active de la part du gouvernement, d’une ampleur inconnue en Allemagne, avec des programmes publics prestigieux, comme le TGV ou le Concorde. De tels projets ont tendance à être réalisés au détriment des petites et moyennes entreprises qui continuent à être le moteur des exportations allemandes, la colonne vertébrale de la croissance économique allemande.
Le rôle de la monnaie et de la banque centrale
Cette instrumentalisation de l’économie se reflète d’ailleurs dans les conceptions divergentes du rôle de la monnaie dans l’économie. Pour les Français, la monnaie est un instrument de pouvoir politique, au service de l’État qui doit financer l’équipement et la modernisation du pays. Dès 1945, entre la rigueur prônée par le rationnement monétaire et la facilité de la planche à billets, c’est la seconde solution qui est retenue. L’État se substitue au marché financier en transformant l’épargne liquide des particuliers en capitaux à long terme au profit des secteurs de base (énergie, sidérurgie, transports, etc.) et des entreprises publiques. Par la suite, les pouvoirs publics ont encouragé une politique de la demande par la consommation, ce qui a conduit le pays à l’inflation et à des ajustements par la dévaluation (à parité égale entre le franc français et le Deutsche Mark en 1949, celui-ci valait 3,35 francs en 1987, cours auquel la parité se maintient au sein du système monétaire européen (SME) jusqu’à l’avènement de l’euro en 1999).
À l’opposé, en Allemagne, la monnaie ne sert pas à des objectifs politiques et n’est pas à la disposition du politique : elle est plutôt placée en dehors du jeu politique. La seule prérogative gouvernementale en ce domaine est la garantie de la stabilité monétaire, dont seule la banque centrale est responsable. Son indépendance n’est pas un mythe, mais un élément fondamental et pérenne de l’ordre économique en Allemagne.
L’aversion de la population allemande à l’égard de toute déstabilisation monétaire s’explique par les difficultés monétaires (hyperinflation et réforme monétaire) connues par l’Allemagne dans la première moitié du xxe siècle. Ce sont ces expériences traumatisantes qui expliquent actuellement l’opposition de nombreux hommes politiques allemands envers la politique monétaire aventurière de Mario Draghi et la plainte déposée auprès de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe contre des achats de titres souverains par la Banque centrale européenne (BCE). En anticipation de ce programme massif qui devrait déclencher un tsunami de liquidité en euros, la Banque centrale suisse ne se voyait plus en mesure de défendre le taux plancher entre le franc suisse et l’euro, et l’a aboli à la mi-janvier 2015 pour rétablir son indépendance monétaire – un vrai signe de méfiance contre la politique de planche à billets (quantitative easing, ou QE) de Mario Draghi.
La mise en œuvre de la Politique économique
Toutes ces divergences entre la France et l’Allemagne se sont enracinées dans l’histoire des deux peuples et tendent à influencer la politique actuelle dans tous les domaines, notamment à l’égard de l’organisation de la politique économique des gouvernements.
Tandis que le sort des PME et de l’économie régionale est suivi par les seize Länder et leurs propres ministères compétents, c’est le gouvernement fédéral qui s’occupe des grandes lignes de l’économie allemande. Sur la base des objectifs politiques fixés dans le contrat de coalition de chaque nouveau gouvernement, c’est le ministère de l’Économie qui prend l’initiative de formuler la politique économique du gouvernement, c’est-à-dire par la préparation du rapport économique annuel du gouvernement fédéral. Le chancelier, avec une toute petite équipe de conseillers, n’intervient que rarement ; toutes les décisions importantes sont prises au sein du cabinet de chaque ministre, avec une position forte du ministre des Finances qui peut empêcher toute législation ayant des répercussions financières. Ce n’est que le chancelier qui a le droit de veto contre lui. Le rôle du parlement, le Bundestag, est assez limité. En règle générale, une majorité de députés vote les lois présentées par le gouvernement.
Au sein des ministères, les fonctionnaires dans les services bénéficient d’une indépendance exceptionnelle. Un système de cabinets ministériels comme à Paris n’existe pas, c’est seulement une petite équipe de conseillers autour du ministre qui s’occupe plutôt du déroulement du travail quotidien que de la conception de la politique. Un cabinet composé de cinquante conseillers, comme à Matignon ou à Bercy, est impensable à Berlin. Chaque chef de bureau est autorisé à présenter à son ministre une note avec des propositions. Cette note peut être commentée par la voie hiérarchique, mais ni modifiée ni supprimée. Puis chaque fonctionnaire peut demander que sa note lui soit renvoyée avec la signature du ministre. Rien ne peut disparaître comme dans le triangle des Bermudes. Hans Tietmeyer, l’ancien président de la Bundesbank – lui-même directeur général au ministère de l’Économie pendant des décennies – aimait à dire que les fonctionnaires forment la colonne vertébrale d’un ministère, et ce sont eux, avec leur expertise, qui sont appelés à soutenir le ministre.
En outre, à Berlin, le système ministériel est transparent et égalitaire. Les salaires des fonctionnaires sont publics, chaque fonctionnaire du même grade touche la même rémunération, quel que soit le ministère. Des primes pour certains conseillers, comme dans les cabinets ministériels à Paris, sont impensables à Berlin. Les promotions s’appuient sur des critères objectifs, notamment selon l’ancienneté des candidats. Cependant, on n’a pas le souvenir d’un jeune fonctionnaire de 30 ans nommé chef de service ou directeur général. Mais on se souvient d’un directeur de cabinet français qui, voulant parler à son homologue allemand et ignorant qu’un tel poste n’existait pas en Allemagne, a finalement accepté de parler au directeur général compétent. En revanche, celui-ci a refusé de parler à son collègue français après avoir appris qu’il avait l’âge de son fils… Tout ceci illustre assez bien l’incompréhension permanente entre Paris et Berlin.
Sur les dossiers européens ou internationaux, la position du gouvernement allemand est d’abord coordonnée entre les ministères avant d’être présentée au conseil des ministres par le ministre lui-même. À Bruxelles, il s’agit en particulier de la coordination des politiques économiques nationales relatives à la souveraineté nationale. Pendant les négociations en vue de la préparation des rencontres ministérielles, les fonctionnaires sont largement indépendants. L’ « instruction spécifique » comme instrument de travail est inconnue en Allemagne, tout comme les expressions «parapluie» ou «être couvert». C’est le fonctionnaire lui-même qui est responsable du résultat, il ne peut pas trouver d’excuses sous le prétexte d’instructions. L’échec ou le succès retombent uniquement sur lui
La place de la Politique industrielle
Ces divergences dans la politique économique sont particulièrement visibles dans le domaine de la politique industrielle, un corps étranger dans l’idéologie allemande. Le gouvernement allemand se contente de fixer le cadre juridique pour les activités des entreprises. Par la suite, c’est à elles de se débrouiller sur le marché, sans soutien, sans subvention du côté de l’État.
La grande exception de cette non-interférence publique a été l’intervention de l’ancien chancelier Schröder auprès de l’entreprise surendettée de construction Holzmann pour éviter sa faillite. Le résultat a été néfaste. Deux ans plus tard, Holzmann a été obligée de se déclarer définitivement en faillite. L’intervention du chancelier Schröder n’a apporté que des dettes supplémentaires.
Le gouvernement a compris la leçon. En 2010, il n’est pas intervenu pour sauver une autre entreprise de construction, Hochtief, menacée d’un rachat par son concurrent espagnol ACS, beaucoup moins important que Hochtief. Le rachat a eu lieu, Hochtief a été démantelé et des milliers d’emplois ont été détruits. De même, encore récemment, le gouvernement s’est abstenu d’intervenir lors de la faillite d’une grande chaîne bas de gamme de grande distribution Schlecker. Sa faillite a coûté trois mille emplois. Il va de soi que les appels réguliers d’un président de la République pour créer des «champions nationaux» tomberaient outre-Rhin dans l’oreille d’un sourd, surtout dans le cadre d’un marché mondial intégré.
Les inconvénients du système fédéral allemand
Le système fédéral allemand est loin d’être un modèle pour d’autres pays. Il atteint la limite de sa viabilité en mettant en péril la stabilité financière de l’Allemagne. Ainsi le système de péréquation financière entre les seize Länder exige actuellement que trois Länder du sud de l’Allemagne, en particulier la Bavière, paient des subventions de l’ordre de 9 milliards d’euros par an aux treize autres Länder (notamment suite au coût élevé de l’Aufbau Ost en raison de la situation désastreuse des Länder de l’ex-RDA afin de réaliser l’unification économique). Pourtant, l’écart économique entre le Sud et le Nord ne s’est pas réduit. Il risque de persister encore longtemps.
Le souci moral d’équité perpétue ce système de redistribution entre régions riches et pauvres. Les Länder subventionnés n’ont aucun intérêt à faire des efforts pour améliorer leurs comptes publics, sachant que leurs déficits budgétaires seront financés par les collectivités donataires. Celles-ci perdent leurs incitations à continuer une politique de rigueur. Les Länder donataires ont déjà porté plainte devant la Cour constitutionnelle de Karlsruhe pour mettre fin à ce cercle vicieux. Les parallèles avec la zone euro sont évidents. Un rachat des titres souverains par la BCE risque d’affaiblir la pression sur les États périphériques en vue d’assainir leurs finances publiques et d’introduire un système de péréquation financière à l’échelle européenne par la banque centrale sans aucun mandat politique ou démocratique.
En outre, le système électoral allemand rend le pays de plus en plus ingouvernable. Le scrutin proportionnel permet à chaque parti politique d’être représenté au Bundestag s’il a franchi la barre des 5% des votes. Depuis les années 1950, l’Allemagne n’a connu que des gouvernements de coalition. Le processus de décision est fastidieux. Les décisions sont prises au plus petit dénominateur commun.
La grande coalition actuelle ne facilite pas la gouvernance de l’Allemagne. En plus, tous les actes législatifs ayant un impact financier exigent l’approbation de la Chambre des représentants des Länder, le Bundesrat. Dans le passé, c’était souvent l’opposition qui y disposait de la majorité. Le compromis politique et le consensus deviennent inévitables à un moment où les enjeux sont immenses dans tous les domaines.
La dimension européenne : Gouvernement économique européen
L’idée d’un interventionnisme gouvernemental ou d’un étatisme n’a jamais vraiment pu se développer en Allemagne. De toute façon, la question de l’ingérence de l’État dans l’économie se pose sous une autre lumière depuis la signature du traité de Rome en 1957. Depuis lors, les pays membres de l’Union européenne se sont engagés à coordonner étroitement leurs politiques économiques au sein du conseil et de les considérer comme une question d’intérêt commun, ce qui signifie que les États ont déjà abandonné leur souveraineté nationale jusqu’à un certain point.
Cet impératif de coordination s’est encore renforcé dans la zone euro. En revanche, la convergence effective des politiques économiques dans l’Union européenne prouve le non-respect de cette obligation. Le peer pressure de Bruxelles a été plutôt un coup d’épée dans l’eau. À maintes reprises, la Commission européenne a recommandé à la France de libéraliser son marché du travail, une recommandation adoptée même par le Conseil des chefs d’État et de gouvernements. Les résultats sont connus. C’est toujours l’opportunité politique qui prévaut. Faute de sanctions, les institutions européennes sont impuissantes. Même un gouvernement économique européen (GEE), proposé par la France depuis des décennies, n’y a rien changé. La question principale est de savoir si les pays membres sont, d’une manière fiable, prêts à transférer leur souveraineté nationale au niveau européen. La question est plutôt rhétorique, car la réponse est claire.
En revanche, on peut se poser la question de savoir quelle serait l’organisation de la politique économique la plus apte à coordonner étroitement les prérogatives nationales avec d’autres pays membres. À première vue, on peut conclure que ce sont, dans le doute, des États qui ont respecté les traités européens et qui ont déjà délibérément abandonné une partie de leur autonomie au marché, c’est-à-dire des États à idéologie plutôt libérale qui connaissent le frein à l’endettement et qui pensent que la croissance est source de progrès social.
Conclusion
ifo institut für Wirtschaftsforschung, communiqué de presse du 12 janvier 201 l’ifo institut für Wirtschafts- forschung (i-forschung) est un institut de recherche économique installé à munich responsable de l’indice ifo Geschäftsklimaindex qui est un indicateur du moral des patrons allemands.
« Investir En France ? Bof… », L’Express, No3311, 17-23 Décembre 2014, P. 48-51.
Si l’on prend la croissance économique comme critère de succès ou d’échec d’une organisation centralisée ou décentralisée en politique économique, il est de toute évidence difficile de parvenir à une conclusion. Depuis 1980, date de l’entrée en vigueur du système monétaire européen (SME), la France a connu une croissance plus forte que l’Allemagne pendant des années, et vice versa.
Finalement, on peut conclure de ces faits deux observations importantes :
- la France a connu deux périodes de convergence étroite avec l’Allemagne et, en même temps, de croissance forte de l’ordre de 4 à 5%, beaucoup plus forte qu’en Allemagne. C’était d’abord dans la seconde moitié des années 1980, après le tournant radical de la politique de Mitterrand d’un socialisme à la française vers une politique du franc fort, puis, dix ans plus tard, pendant la période de la préparation à l’introduction de l’euro et le respect des critères de convergence de Maastricht pour entrer dans la zone euro. Or la convergence de stabilité avec l’Allemagne, notamment le rétablissement de l’équilibre budgétaire, devenait une condition indispensable pour une croissance durable. L’expérience d’une «croissance par consolidation budgétaire», et non l’inverse, semble actuellement être tombée dans l’oubli ;
- ce succès n’était dû à la pression ni de l’Allemagne, ni de la Commission européenne de Bruxelles, mais à la pression des marchés financiers. C’étaient eux qui imposaient une politique d’abandon : les promesses électorales du PS devenaient nulles si l’on voulait éviter une catastrophe économique nationale.
La feuille de route du gouvernement Mauroy – notamment après l’explosion des dépenses publiques et la nationalisation de la quasi-totalité des banques et de sept grands groupes industriels – fut sanctionnée par une montée des taux d’intérêt, de l’inflation et du déficit commercial, et simultanément par une forte dévaluation du franc français concomitante à une fonte des réserves de change afin de défendre la monnaie sur les marchés financiers. En conséquence, une politique de stabilité et de rigueur devenait inévitable dans les années précédant le passage à la monnaie unique afin de ne pas risquer des sanctions du marché et la non-qualification de la France pour l’entrée dans l’Union économique et monétaire (UEM). La relance économique s’est produite quelques années plus tard, une expérience réalisée aussi par Margaret Thatcher et Gerhard Schröder avec leurs politiques de réformes qui ont surtout profité à leurs successeurs.
Cette fonction des marchés a largement été affaiblie par la politique de sauvetage de l’euro à partir de 2010, et la déclaration du président de la BCE Mario Draghi de sauver l’euro «coûte que coûte» s’est conclue par un programme de rachats d’emprunts d’État sur le marché secondaire renforcé. Heureusement, il y a encore d’autres mécanismes de sanctions par lesquels «l’économie peut se venger», selon l’expression de Pierre Mendès France, figure de la gauche française.
L’un de ces mécanismes est notamment la délocalisation de la production française à l’étranger, mettant en péril le potentiel de production française et la fuite de capitaux à l’étranger. En Italie, les sorties de capitaux nettes ont augmenté de 60% entre juillet et décembre 2014, phénomène dû à la politique erronée de réformes du Premier ministre Matteo Renzi3. De même, le nouveau Premier ministre grec a déjà dû renoncer à ses promesses électorales vu la fuite massive de capitaux de la Grèce mettant en péril la relance de la croissance. L’avenir montrera qu’aucun gouvernement – grec, espagnol ou français – ne peut échapper à la vertu du mécanisme de marché, comme l’ont montré l’Irlande, le Portugal ou même l’Espagne qui peuvent à présent engendrer croissance, baisse du chômage et progrès social.
Un autre mécanisme est la fuite des cerveaux et des contribuables, occultée par la classe politique française, menaçant l’avenir de la France. Le brain drain n’est plus une expression étrangère en France. Les inquiétudes des représentants de l’industrie étrangère ont largement été exprimées lors de la récente édition du rendez-vous des États de la France, mi-décembre 2014, créés par Denis Zervudacki, qui réunissait plus de 500 personnes autour de 72 responsables de filiales françaises de multinationales4. Ces personnes ont confirmé le résultat d’un sondage Ipsos selon lequel les trois quarts des patrons estimaient que la France n’est «pas très» ou « pas du tout attractive » pour l’étranger, et que l’image de la France auprès des sièges mondiaux n’est pas positive. Parmi les mesures pouvant avoir un impact positif sur l’attractivité de la France figurent la diminution des coûts du travail, la flexibilité du marché de l’emploi, la simplification des procédures (réforme du Code du travail) et la suppression des 35 heures. Ce vote – quasiment un vote «par les pieds» – souligne le besoin urgent de la France à mettre en œuvre des réformes fiables de libéralisation et de dérégulation pour mieux s’intégrer dans l’économie globalisée.
L’idée d’une économie dirigée par l’État ou d’une politique économique «par le haut» atteint ses limites et sa fin en dépit du fait que les sociaux- démocrates allemands ont pu s’imposer dans la nouvelle grande coalition par l’introduction d’un Smic généralisé, par un frein à l’augmentation des loyers dans les grands centres et par l’âge de la retraite à 63 ans.
Il est vrai que le pouvoir politique peut dominer un certain temps, mais au final c’est toujours la loi économique qui prévaut – ou pour le dire avec les mots de Talleyrand : «On peut tout faire avec des baïonnettes, sauf s’asseoir dessus.»

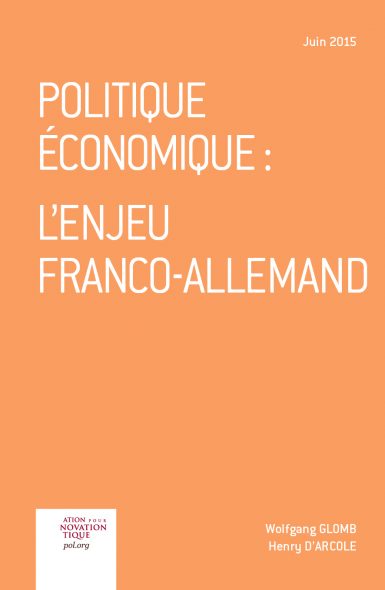
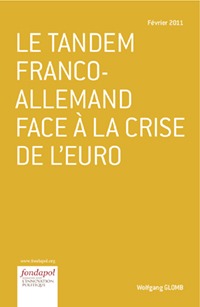
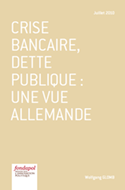











Aucun commentaire.