Pour son quatorzième Café de l’innovation, la Fondation pour l’innovation politique a reçu Dominique Mehl, directrice de recherche au CNRS pour son ouvrage Les lois de l’enfantement. Procréation et politique en France, 1982-2011 paru aux Presses de Sciences Po. Don de gamète, procréation médicalement assistée, gestation pour autrui, homoparentalité, nouvelles formes de familles, lois sur la bioéthique autant de sujets au cœur de l’actualité dont nous avons débattu avec Dominique Mehl. Entre les lois de bioéthique de 1994 et celles de 2011, aucune modification. Pourtant ce sujet de société est révolutionné par les progrès scientifiques et la possibilité pour les individus d’avoir recours à ces techniques à l’étranger.
Les lois de l’enfantement – Café de l’innovation… par fondapol
Résumé de l’interview avec Dominique Mehl, Les lois de l’enfantement
Parlons d’abord de la question du don de gamète. A la lecture de votre ouvrage, on est frappé de voir que très peu d’études auprès des personnes concernées ont été menées. Comment une réglementation aussi ferme (l’anonymat absolu du donneur) peut reposer sur si peu d’enquêtes ?
C’est un peu le problème de la façon dont on aborde les questions de procréation médicalement assisté. Le dispositif français s’est mis en place très vite pour aller vers une 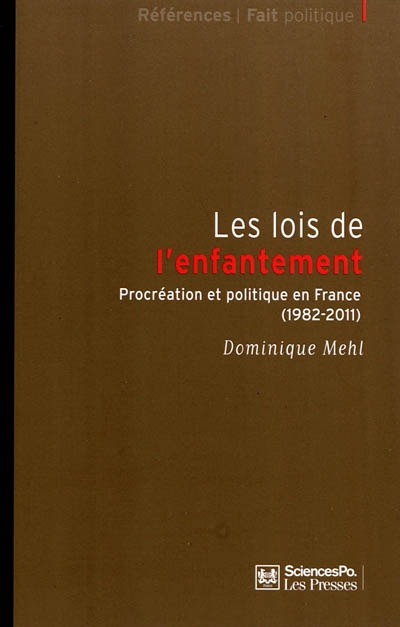 loi, au lieu de laisser faire les pratiques et de réfléchir sur les expériences. On a eu dès le début des années 1980, marqué par la création du Comité d’éthique et par la tenue des Etats généraux de la bioéthique, jusqu’à la loi de 1994 un débat entre spécialistes, décideurs politiques et intellectuels. La parole des patients n’était pas prise en compte, sans doute au début de leur propre fait, ces derniers étant peu enclins à brandir le drapeau des modes particuliers auxquels ils avaient eu recours pour avoir un enfant, mais effectivement il y a eu très peu d’enquêtes. Le don de sperme, celui d’ovocytes, puis la gestation pour autrui (« mères porteuses ») légale dans d’autres pays, ont pourtant profondément bouleversé les données de la procréation (plus encore que la fécondation in vitro, qui palliait l’infertilité mais ne bouleversait pas la parenté puisque le géniteur et la génitrice restaient les parents légaux) et auraient du soulever un débat bioéthique plus large. L’intervention d’une tierce personne suscite en effet bien des questions : quel statut donner à ce tiers ? Doit-il y a voir une transparence ou devait-on l’exclure du cercle familial ? Risquait-il de déstabiliser le couple parental ? Le débat, qui était à l’époque de nature idéologique voire philosophique et voyait s’opposer une position a priori contre une autre position a priori, déboucha sur l’anonymat des dons.
loi, au lieu de laisser faire les pratiques et de réfléchir sur les expériences. On a eu dès le début des années 1980, marqué par la création du Comité d’éthique et par la tenue des Etats généraux de la bioéthique, jusqu’à la loi de 1994 un débat entre spécialistes, décideurs politiques et intellectuels. La parole des patients n’était pas prise en compte, sans doute au début de leur propre fait, ces derniers étant peu enclins à brandir le drapeau des modes particuliers auxquels ils avaient eu recours pour avoir un enfant, mais effectivement il y a eu très peu d’enquêtes. Le don de sperme, celui d’ovocytes, puis la gestation pour autrui (« mères porteuses ») légale dans d’autres pays, ont pourtant profondément bouleversé les données de la procréation (plus encore que la fécondation in vitro, qui palliait l’infertilité mais ne bouleversait pas la parenté puisque le géniteur et la génitrice restaient les parents légaux) et auraient du soulever un débat bioéthique plus large. L’intervention d’une tierce personne suscite en effet bien des questions : quel statut donner à ce tiers ? Doit-il y a voir une transparence ou devait-on l’exclure du cercle familial ? Risquait-il de déstabiliser le couple parental ? Le débat, qui était à l’époque de nature idéologique voire philosophique et voyait s’opposer une position a priori contre une autre position a priori, déboucha sur l’anonymat des dons.
Le statut quo prévalut pendant quelques années, mais il devint très difficile à maintenir quand les enfants issus des premiers dons atteignirent l’âge de la majorité. Sans désavouer leurs parents, une partie de ceux qui connaissaient les conditions particulières de leur naissance (bien que ne disposant pas de statistiques, on estime à un tiers le nombre d’enfants sachant qu’ils sont issus du don) émirent publiquement le souhait de connaître leur donneur.
Pouvez-vous nous expliquer les motivations de ces enfants nés d’un don lorsqu’ils recherchent des informations sur leur donneur ?
Il est difficile de dresser un tableau précis car ils sont assez peu nombreux. Leurs motivations sont multiples : alors que certains accordent un statut particulier au donneur (qu’ils désignent comme leur père ou mère biologique, par rapport au père ou à la mère social). La plupart estime qu’il ne s’agit pas d’un père ou d’une mère mais pas non plus d’un gamète et ils veulent obtenir des informations : aspect physique pour savoir s’ils leur ressemblent, pourquoi a-t-il donné, connaître leurs demi-frères ou demi-sœurs (puisque jusqu’à la dernière révision de la loi, le donneur devait avoir préalablement enfanté). Enfin, chez certains, le fantasme de l’inceste est très présent (comment savoir si la personne que je rencontre n’a pas avec moi des liens de sang ?). Pour beaucoup, le simple fait qu’on leur refuse légalement tout accès à leur généalogie est ressentie comme une profonde injustice. Par comparaison, un enfant adultérin, a, lui, au moins le droit d’enquêter (même si ses recherches n’aboutissent pas). Tous ces éléments jouent en faveur d’une remise en cause de l’anonymat des dons.
La remise en cause de l’anonymat des dons pourrait-elle présenter des risques, notamment une baisse des dons ?
A long terme, ce n’est pas le cas. En effet, dans les pays où l’anonymat a été levé (Suède et Angleterre notamment), on a constaté dans un premier temps une baisse des dons, qui sont ensuite revenus à leur niveau précédent. La différence réside dans l’évolution du profil des donneurs : alors que les donneurs anonymes souhaitaient faire un simple don de cellules corporelles, les nouveaux donneurs ont le sentiment de faire un véritable don de parenté. De plus, certains donneurs anonymes se sont manifestés auprès d’associations de défense des droits des enfants nés d’un don pour exprimer leur solidarité : devant la souffrance des enfants, ils affirment qu’ils seraient d’accord pour lever l’anonymat. Enfin, il est important de souligner que le mythe de l’enfant venant frapper à la porte d’un père ou d’une mère biologique pour renouer un véritable lien de parenté est rendu impossible par l’interdiction légale de formuler une demande de reconnaissance en paternité (contrairement au cas d’un enfant né d’une relation adultérine).
Pour calmer toute inquiétude, les propositions faites en France par les associations lors de la révision de la loi de bioéthique étaient les suivantes : le don resterait anonyme pour les parents et le donneur (pour éviter aux parents légaux la menace fantasmatique d’un troisième personnage qui viendrait s’immiscer dans le couple ou dans leurs rapports avec l’enfant), et les centres garderaient des informations sur le donneur qu’ils transmettraient à la demande de l’enfant à sa majorité. Cela pourrait évidemment présenter des risques mais permettrait une transparence sur l’histoire. Ces requêtes n’ont pas été entendues, puisque les lois 1994 et de 2011 sont très similaires, notamment à cause du conservatisme de la classe politique. Il faut dire que le sujet est complexe et suscite souvent des réactions épidermiques : pour les hommes ayant été obligés d’avoir recours à un don de sperme, par exemple, l’aspect « deuil de sa propre virilité » est très important, comme le fantasme qui consiste à voir dans l’autre homme un homme plus puissant qui pourrait être une figure de remplacement. La situation est sensiblement différente pour les femmes, car ayant porté l’enfant elles n’ont pas le sentiment d’avoir été complètement exclues du processus.
La gestation pour autrui est un tabou aujourd’hui en France, alors qu’elle a toujours existé. Pourquoi ?
La gestation pour autrui est en effet une pratique très ancienne mais qui s’opérait dans le cadre familial : une femme était par exemple inséminée par le mari de sa sœur qui ne pouvait avoir d’enfant. Dans ces cas, la génitrice restait donc la gestatrice. La révolution apportée par la procréation médicalement assistée est l’extraction de l’ovocyte d’un corps féminin, qui sera ensuite fécondé dans un autre corps, découpant ainsi la fertilité d’une femme en deux dimensions. Cette méthode est dénoncée par une majorité de féministes comme une instrumentalisation du corps de la femme (celui-ci n’étant pas réductible à un abri, à un utérus).
Quels seraient les moyens pour encadrer la gestation pour autrui et éviter les dérives ?
Il existe de très nombreuses façon d’avoir un encadrement strict de cette gestation pour autrui, qui balaierait les inquiétudes les plus souvent formulées : ne pas rémunérer le don (se contenter d’une compensation financière des frais de la grossesse), et soumettre les mères porteuses à des contrôles gynécologique, psychologique, et bioéthique (comme c’est déjà le cas en Angleterre). Le modèle anglais est particulièrement intéressant à ce niveau.
Il est très difficile de connaître l’avis des français sur ce sujet, car peu de personnes sont réellement au fait de l’investissement physique et affectif que suppose ce type de grossesse. C’est pourquoi les enquêtes qualitatives apportent des informations plus intéressantes sur ce sujet que les enquêtes quantitatives.
Vous soulignez dans votre ouvrage, un paradoxe important : alors que les femmes célibataires peuvent avoir recours à l’adoption, elles ne peuvent pas utiliser les méthodes de procréation médicalement assistée. Pourquoi ?
Il s’agit là du tabou le plus solide de notre société. Alors que le sens initial de la loi sur l’adoption était de permettre que soient recueillis des enfants sans parents suite à une guerre ou un décès brutal, le désir d’enfant chez une femme célibataire souhaitant avoir recours à la procréation assistée est parfois interprété (à tort) comme un acte égoïste ou de fantaisie. Les psychologues, psychanalystes, et psychiatres sont également (mais pour d’autres raisons) majoritairement très hostiles à un huis clos mère-enfant. En réalité, le désir d’enfant des mères célibataires s’explique par une évolution sociologique récente : les couples étant de plus en plus fragiles, il n’est pas rare d’avoir 35 ans et de n’avoir ni mari ni enfant. L’idée vient alors qu’on pourrait inverser l’ordre d’entrée en famille : un enfant d’abord, puis un homme si par chance l’occasion se présentait. Le but n’est pas pour ces femmes de faire un enfant sans homme ou contre l’homme, mais de le faire dans un contexte où, par hasard ou par malchance, l’homme n’est pas là.
Une refonte du droit de la famille n’est-elle pas nécessaire face à toutes ces évolutions ?
Il est effectivement nécessaire de penser une refonte du droit de la famille français sur le plan de la filiation légale, puisqu’il existe des enfants nés de mères porteuses dans d’autres pays qui vivent sur le territoire français. Actuellement, celui des deux parents qui n’est pas considéré comme le parent légal rencontre de nombreuses difficultés (il ne peut par exemple pas sortir un enfant du territoire ni autoriser une intervention chirurgicale sur l’enfant). Si l’actuelle majorité prévoit de régulariser la situation de ce deuxième parent, c’est une réforme plus profonde qui serait souhaitable, prenant en compte les évolutions de la société (et notamment le phénomène de la pluriparentalité, auquel l’auteure préfère l’expression de « famille élargie », dans laquelle le donneur a un rôle à disposition : parrain, bienfaiteur…). De nombreuses solutions sont envisageables, mais cette révision devra impérativement donner aux enfants des repères fixes (dans les cas de la procréation médicalement assistée comme dans celui de l’adoption, la parenté ne peut pas être défaite, alors que c’est le cas pour la procréation naturelle).

Aucun commentaire.