
« Abstention », pourquoi ce mutisme ?
L'Informateur Corse Nouvelle | 10 décembre 2021
Plus glaçant encore que le Silence des agneaux, le mutisme des urnes ! Au lendemain des élections régionales et départementales de juin dernier, il y avait du gros malaise dans l'air : dans leur immense majorité, les Français s'étaient abstenus.
Et s'il leur prenait la fantaisie d'en faire autant pour la présidentielle et les législatives de 2022 ? Au surlendemain de cette déclaration de désamour pour la chose publique, Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, amorçait la constitution d'une mission d'information sur le phénomène de l'abstention et les moyens d'y remédier.
Dans ce cadre, il avait sollicité le concours de la Fondapol qui a rendu sa contribution en novembre. Constat et pistes de réflexion.
Initialement prévues en mars et repoussées de trois mois en raison de la pandémie, les élections régionales et départementales 2021 ont été marquées par un taux de participation que Richard Ferrand, président de l’Assemblée nationale, devait qualifier d’« historiquement bas dans l’histoire de la Ve République ». Le scrutin régional n’a en effet mobilisé que 33,28 % des électeurs français au premier tour et 34,69 % au second. Quant aux élections départementales, elles affichaient peu ou prou les mêmes taux de participation : 33,32 % puis 34,36 %. II y a certes eu des exceptions, comme la Corse, où la participation à l’élection territoriale a dépassé les 57 % au premier tour et frôlé les 59 % au second, avec des taux de bulletins nuls ou blancs inférieurs à 1 %. Ce phénomène de l’abstention n’est pas nouveau. Selon le ministère de l’Intérieur, l’érosion de la participation aux élections, qu’elles soient législatives, présidentielles, municipales, européennes, régionales ou cantonales, remonte à la fin des années 1980. Avec, il est vrai, des variations notables selon l’objet de la consultation. C’est notamment sensible pour les législatives : l’abstention, qui plafonnait à 23 % en 1958 et avait atteint son plus bas niveau (17 %) en 1978, est passée à 34% en 1988 pour se hisser à 51,3 % en 2017.
Toutefois, estimait Richard Ferrand en juin 2021, cette désaffection des urnes a « atteint des proportions telles que nous ne pouvons pas nous en tenir à des raisons conjoncturelles, alors que nous sommes à un an des élections présidentielle et législatives ». D’où la création d’une mission d’information permettant « d’identifier les ressorts de l’abstention et les mesures permettant de renforcer la participation électorale ».
Pour nourrir ses travaux, le président de l’Assemblée nationale a fait appel à la Fondation pour l’innovation politique (Fondapol).
En novembre 2021, la Fondapol a publié l’étude produite sur ce sujet, dirigée par son directeur général, Dominique Reynié. Pour ses auteurs, quoiqu’elle ne touche pas tous les scrutins avec la même intensité et puisse fluctuer selon les périodes, l’abstention électorale en France, «avérée de longue date» et qui se manifeste également à l’occasion des élections professionnelles, ne constitue cela dit « en rien un phénomène isolé dans le monde des démocraties occidentales ». Et des états ayant en commun «des dynamiques abstentionnistes similaires» partageraient également « de nombreux facteurs à l’origine de cette désaffection des urnes de la part de leurs citoyens ». Par exemple, pour la France et les États-Unis, le fait que la procédure d’inscription sur les listes électorales n’y est pas automatique, à l’exception des citoyens accédant à la majorité qui sont inscrits d’office. Ainsi, il y aurait en France une frange de la population en droit de voter, représentant en moyenne 10 % de l’électorat potentiel, qui n’est pas inscrite sur les listes électorales, ce taux pouvant même atteindre les 30 % d’adultes dans les quartiers ou zones géo graphiques les moins favorisés. Or, « cette mal-inscription sur les listes électorales en France se présente comme l’une des premières causes de l’abstention » selon la Fondapol qui pointe également « l’émergence de la décentralisation mitterrandienne », les transferts de compétences aux collectivités territoriales ayant contribué à une perte de lisibilité des scrutins et, par voie de conséguence à l’augmentation de l’abstention. Et puis il y a ce qui ressort comme étant « un des signaux forts de cette crise de la représentation », à sa voir que, pour une partie de l’électorat, l’abstention apparaît comme « un instrument de protestation manifestant le refus de l’offre politique et caractérisant la défiance grandissante à l’égard du politique ».
Que ce soit en Europe comme aux États-Unis le principe du vote est consacré, fait observer le document remis par la Fondapol à Richard Ferrand : 96 % des Européens et 98 % des Américains jugent important de pouvoir voter pour les candidats de son choix mais aussi, dans des proportions strictement identiques, de « pouvoir participer soi-même à la prise de décision ». Là où les choses se gâtent, c’est lorsqu’on interroge sur son utilité: 36 % des Européens considèrent que « voter ne sert pas à grand-chose » contre 17 % des Américains. Cette désillusion européenne touche davantage les démocraties les plus récentes, issues de l’effondrement du communisme et, parfois, elle y est même dominante, comme en Croatie (69 %) et en Bulgarie (62 %), ou très présente, comme en Slovaquie (47 %), en Roumanie (46 %), en Lettonie (45 %), en Lituanie (44 %), en République tchèque (43 %) et en Hongrie (40 %). Cela étant, le désenchantement n’épargne pas des démocraties plus anciennes, comme l’Italie (38 %), la France (39 %) ou la Grèce (41 %). En revanche, parmi les pays où l’on considère le plus
volontiers qu’il est « utile de voter car c’est par les élections que l’on peut faire évoluer les choses », on trouve la Finlande (67 %), l’Autriche (70 %), l’Allemagne (70 %), les Pays-Bas (72 %), la Suisse (76 %), la Norvège (78 %), le Royaume-Uni (80 %), la Suède (81 %) et le Danemark (84 %) mais aussi la Pologne (76 %) et le Portugal (76 %).
Les résultats de la cinquième vague de l’indicateur de la protestation électorale, conçu parla Fondapol (les enquêtes étant administrées par l’institut OpinionWay) remontent à octobre 2021. Ils montrent, pour la France, une disposition au vote protestataire (ne pas voter, voter blanc ou voter populiste) qui, quoiqu’en baisse de six points par rapport à la quatrième vague, reste très élevée: 72 % des personnes interrogées seraient enclines à privilégier cette voie pour le premier tour de l’élection présidentielle de 2022. Dont 49 % qui se disent prêt à s’abstenir ou à voter blanc. Dans le détail, 34 % ont répondu qu’ils pourraient s’abstenir et 40 % qu’ils pourraient voter blanc. C’est du côté des femmes que ces options sont les plus marquées: elles ont été 41 % -contre 28 % chez les hommes- à dire qu’elles pourraient s’abstenir et 45 % -contre 35% des hommes- à répondre qu’elles pourraient voter blanc. En ce qui concerne les catégories sociales, la tentation de l’abstention est plus forte chez les personnes à bas revenu: 46% des répondants dont le revenu du foyer est inférieur à 1 000 euros mensuels pourraient s’abstenir, contre 24 % de ceux dont le revenu du foyer est égal ou supérieur à 3 500 euros. De même, 54 % de ceux ayant un revenu inférieur à 1 000 euros pourraient voter blanc, soit 22 points de plus que ceux dont les revenus sont égaux ou supérieurs à 3 500 euros (32 %). Par ailleurs, la propension à s’abstenir est plus importante que la moyenne des sondés chez les répondants qui ont une image positive des Gilets jaunes, des anti-vax ou des anti-passe sanitaire. Toutefois, chez ces sondés-là, c’est la proportion de ceux qui excluent catégoriquement ou qui n’envisagent pas de s’abstenir qui l’emporte pourtant.
En outre, il apparaît dans les résultats de cette cinquième vague que 30 % des répondants qui pourraient s’abstenir au premier tour disent vouloir le faire parce qu’ils ont « le sentiment que c’est la même politique qui est menée quelque soit le parti au pouvoir », 26 % parce que les différents candidats dont on parle aujourd’hui ne leur conviennent pas, 17 % parce que la politique en général ne les intéresse pas, 14 % parce qu’ils entendent protester contre le système politique à répondre qu’elles pourraient voter blanc. actuel et 12 % parce qu’ils pensent que leur vote à l’élection présidentielle ne servira à rien. Fait notable, « le potentiel de la protestation électorale est sensible à l’utilisation régulière des réseaux sociaux »: la propension déclarée à voter populiste, s’abstenir ou voter blanc au premier tour de l’élection présidentielle de 2022 est plus importante chez ceux qui les utilisent quotidiennement -et tout particulièrement Twitch, TikTok et Telegram- à savoir, selon les résultats sur l’échantillon de cette cinquième vague, les moins de 35 ans, les femmes, les chômeurs, les hommes et femmes au foyer et les personnes dont le revenu mensuel du foyer est inférieur à 1 000 euros.
Reste à voir comment inverser cette tendance à la protestation. Les auteurs de l’étude destinée éclairer les travaux de la mission d’information ont identifié vingt-et-une pistes de réflexion. On y trouve notamment des suggestions telles qu’apporter des réponses plus souples au problème de la « mal inscription », en permettant une inscription plus tardive sur les listes électorales (actuellement fixée en France au sixième vendredi précédant le 1er tour de l’élection) ou encore mettre en place des bureaux de vote itinérants. Le vote à distance, notamment via Internet est en revanche jugé peu opportun voire dangereux, tandis que la question du vote dès16 ans est vue comme une option à considérer. D’autres pistes laissent plus perplexes, telle que cette question: « Peut-on concevoir un lien civique sans lien fiscal direct? » En cinquième position dans cet inventaire, est mentionnée la nécessité d’attester la souveraineté du suffrage et de respecter les décisions électorales: «N’ont pas été pris en compte les choix des citoyens à l’issue du référendum national ayant débouché sur le rejet du Traité constitutionnel européen, en 2005, et le référendum local ayant débouché sur la décision de construire l’aéroport de Notre-Dame-Des-Landes» rappellent à cet effet les auteurs. Pas plus d’ailleurs que ne semblent avoir été pris en compte les choix exprimés par près de 59 % des électeurs corses lors des dernières territoriales. Peut-être qu’en effet, les citoyens seraient plus enclins à voter s’ils n’avaient pas le sentiment que la réponse à leur expression via les urnes se bornait à un « après tout, l’important est de participer ».
Lire l’article sur icn.corsica.
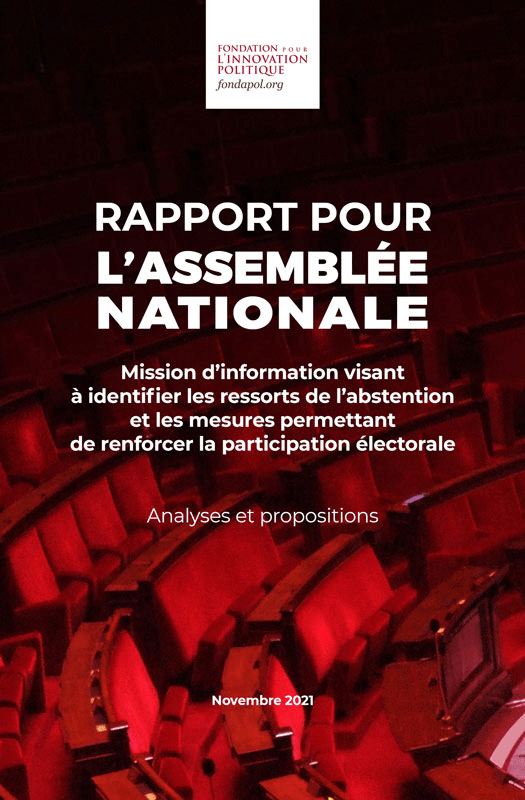
Dominique Reynié (dir.), Rapport pour l’Assemblée nationale sur l’abstention. Mission d’information visant à identifier les ressorts de l’abstention et les mesures permettant de renforcer la participation électorale, (Fondation pour l’innovation politique, novembre 2021).
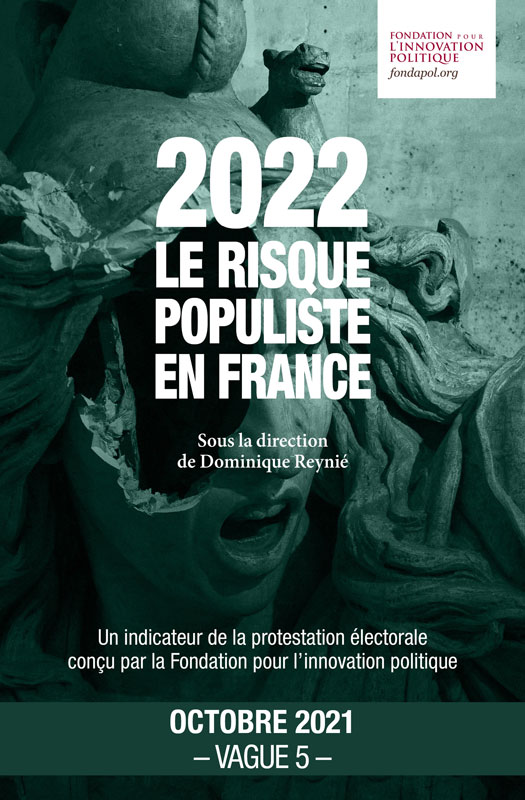
Dominique Reyié (dir.), 2022, le risque populiste en France (vague 5), (Fondation pour l’innovation politique, octobre 2021).












Aucun commentaire.