
Accord de 1968 sur l’immigration : « Les Algériens rient de notre naïveté »
Charles Sapin, Géraldine Woessner, Xavier Driencourt | 24 mai 2023
ENTRETIEN. Pour l’ancien ambassadeur Xavier Driencourt, la France doit risquer la crise diplomatique si elle veut assainir sa relation avec l’Algérie.
Ambassadeur de France en Algérie pendant sept ans, sous les quinquennats de Nicolas Sarkozy et d’Emmanuel Macron, Xavier Driencourt a rédigé une note, à la demande de la Fondapol, think tank libéral dirigé par Dominique Reynié, sur un pan méconnu du régime d’entrée et de séjour des étrangers en France : celui de l’accord franco-algérien de 1968. Alors que l’exécutif remet sur l’établi, après des mois d’atermoiements, son projet de loi sur l’immigration et l’intégration, le diplomate détaille ce régime particulier qui, selon lui, entrave toute possibilité de réforme.
Le Point : Les concertations sur le projet de loi Immigration vont démarrer. Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a prévenu qu’il ne toucherait pas à l’accord de 1968, qui régit les conditions d’entrée et de séjour des Algériens en France. En quoi est-ce une erreur ?
Xavier Driencourt : Cet accord a été signé peu après ceux d’Évian de 1962, alors que la population algérienne comptait une dizaine de millions d’habitants et que la France, en pleines Trente Glorieuses, recherchait une main-d’œuvre francophone. Il visait à faciliter l’installation des Algériens en France, en leur accordant un certain nombre d’avantages. Aujourd’hui, le contexte a changé, mais ces avantages subsistent ! Les Algériens ont droit à un certificat de résidence administrative pour tout visa de plus de trois mois, ils peuvent obtenir un titre de séjour au bout d’un an, le regroupement familial est facilité, les étudiants peuvent transformer leur visa d’étudiant en titre de séjour permanent. Ils échappent également aux règles favorisant l’intégration. Toutes ces dispositions sont exorbitantes au regard du droit commun, et on ne peut pas les changer car les traités internationaux, dans l’ordre juridique français, l’emportent sur les lois.
En clair, nos lois sur l’immigration ne concernent pas les Algériens ?
Elles ne les ont jamais concernés. En 1986, les visas ont été imposés à tous les pays, y compris aux Algériens, par le gouvernement de Jacques Chirac, mais nous n’avons jamais réussi à maîtriser cette immigration. Aujourd’hui, 12,6 % des immigrés vivant en France sont algériens, et plusieurs millions de personnes sur notre territoire sont d’origine algérienne. C’est pourquoi un projet de loi qui exclurait une dénonciation de l’accord de 1968, extrêmement protecteur, réduirait à presque rien les chances de maîtriser l’immigration.
Il a pourtant été possible, en 2021-2022, de réduire considérablement l’octroi de visas…
À la fin de mon premier passage à Alger en 2012, 213 000 visas étaient accordés. À mon retour en 2017, nous étions passés à 410 000 ! À Lille, à Marseille, à Lyon, les préfets alertaient sur les difficultés qu’ils rencontraient pour gérer un si grand nombre d’arrivées. J’ai donc demandé aux ministres de l’Intérieur et des Affaires étrangères, Gérard Collomb et Jean-Yves Le Drian, quelles étaient leurs instructions. Devais-je poursuivre la tendance et délivrer 800 000 visas ? Stabiliser à 410 000 ? Revenir au chiffre de 2012 ? Ils étaient embarrassés mais, soutenus par les préfets concernés et le ministère de l’Intérieur, nous avons mis en place à partir de fin 2017 un plan d’action qui a permis de réduire à 280 000 le nombre de visas délivrés, en un peu moins d’un an. Fin 2021, cette politique s’est étendue au Maroc et à la Tunisie qui, comme l’Algérie, refusaient d’émettre des laissez-passer consulaires, sans lesquels il n’est pas possible de réaliser les obligations de quitter le territoire français (les OQTF). Mais cela n’a pas marché, a-t-on dit, et six mois plus tard, on revenait à la normale.
Les gouvernements successifs ont eu conscience du problème, mais ont tous renoncé à dénoncer ces accords. Comment l’expliquez-vous ?
Ces accords font un peu figure d’acte fondateur des relations franco-algériennes, et sont symboliquement lourds. Dans la mentalité du peuple et des dirigeants algériens, il existe une sorte de « droit au visa », perçu comme la contrepartie de cent trente-deux ans de colonisation. La France est détestée, mais on exige de pouvoir s’y rendre librement. Nous n’en retirons pour notre part aucun avantage, ni sur le plan des laissez-passer consulaires, qui restent délivrés au compte-gouttes, ni sur le plan des visas octroyés aux Français souhaitant se rendre en Algérie – très limités, notamment pour les religieux ou les journalistes. Pourtant, tout serrage de vis dans l’octroi des visas déclenche de violentes crises.
Vous l’admettez : dénoncer l’accord de 1968 serait perçu, notamment par le président Abdelmadjid Tebboune, attendu en juin à Paris, comme une « déclaration de guerre ».
Ce serait une sorte de bombe atomique ! Il faut comprendre que ces visas sont un facteur de stabilité en Algérie. La société algérienne va mal. 70 % des 43 millions d’habitants ont moins de 30 ans, et cette jeunesse a peu de loisirs, pas d’emplois, pas de logements… Le Hirak, ce mouvement contestataire qui a entraîné la chute du président Bouteflika, a été durement réprimé par les militaires qui ont repris le pouvoir. La corruption existe. Face à un avenir qui paraît bouché, la jeunesse trouve des exutoires dans la religion, le sport, la violence… et les visas ! La perspective de rejoindre la France fait office de soupape. Nous ne sommes qu’à l’aube du problème, c’est pour cela qu’il faut agir.
Vous appelez clairement notre gouvernement à utiliser cette « bombe atomique » ?
Nos dirigeants hésitent, car ils redoutent une tempête diplomatique, mais aussi la pression des quelque 10 % de Français ayant, de près ou de loin, un lien avec l’Algérie – un lien charnel, intime. Mais ils font dans le même temps une erreur d’analyse en pensant que les embrassades, la contrition et les tapes dans le dos permettront d’amadouer leurs homologues algériens, qui reviendraient à une position plus raisonnable. Ceux qui tiennent le pouvoir à Alger ont été formés dans l’ex-URSS brejnévienne des années 1970, ils fonctionnent au rapport de force. Aujourd’hui, ils savent au fond que cet accord de 1968 n’a plus lieu d’être, et rient de notre naïveté.
À quoi ressemblerait le « jour d’après » ?
Inévitablement, l’Algérie rappellerait son ambassadeur à Paris et pourrait même rompre les relations diplomatiques. Elle pourrait également cesser toute délivrance de laissez-passer consulaires, donc refuser de reprendre ses clandestins, et expulser des Français d’Algérie. Ce serait une crise majeure, à la une de tous les journaux. Mais il faut braver cela, afin d’établir un rapport de force qui permette, lorsque les choses se calmeront, de redéfinir notre relation avec l’Algérie sur des bases plus saines, notamment sur la question migratoire, qui est l’un des aspects importants de notre relation. Il faut être lucide : il n’existe pas de manière apaisée d’atteindre cet objectif.
Gérald Darmanin a affirmé que la dénonciation de l’accord de 1968 aurait pour conséquence « de retourner à la situation ex ante, donc circulation libre et totale entre les deux territoires ». Se trompe-t-il ?
Il devrait approfondir le sujet. On peut toujours mettre fin à un traité international, comme le prévoit la convention de Vienne sur le droit des traités. Nous reviendrions alors au dispositif de droit commun, régi par le code de l’entrée et de séjour des étrangers en France. À nous et aux Algériens, ensuite, de renégocier un autre accord particulier, si l’on veut préserver une relation spéciale, mais adapté aux circonstances de 2023.
Retrouvez l’entretien sur lepoint.fr
Xavier Driencourt, Politique migratoire : que faire de l’accord franco-algérien de 1968 ?, mai 2023




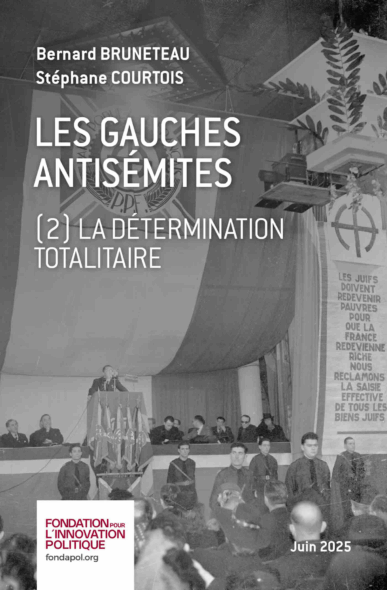
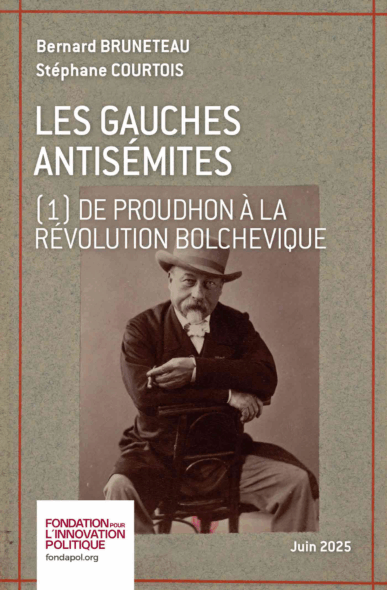


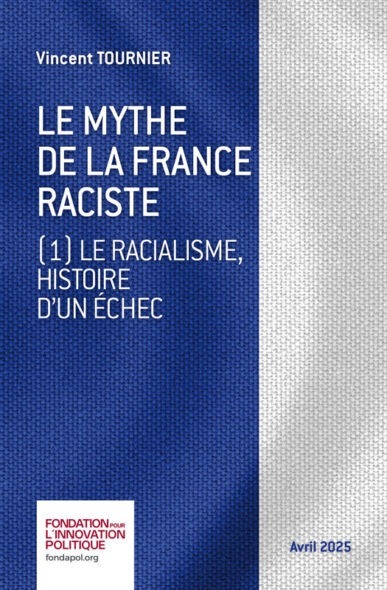



Aucun commentaire.