« Manzoni, dans son roman Les Fiancés, qui se déroule pendant l’épidémie de peste à Milan en 1630, raconte comment le tribunal de la santé de la ville a ordonné qu’un char transportant les cadavres nus d’une famille entière morte ce jour-la soit conduit au milieu d’un rassemblement à l’occasion de la fête de la Pentecôte ‘’afin que la multitude pût y voir une preuve horrible de “l’épidémie”.
C’est ce que rapporte l’historien et professeur à l’université de Berkeley Thomas Laqueur dans AOC, qui s’interroge dans cet article sur le rôle des chiffres en lieu et place des cadavres aujourd’hui. Car force est de constater que « personne ne nous confronte à des cadavres nus lors de rassemblements interdits comme à Milan au XVIIe siècle. » À défaut de cadavres, seuls les chiffres nous permettent de prendre conscience de l’ampleur de la pandémie. Ce sont les sciences sociales qui se chargent de porter la mort à notre connaissance quotidienne, et plus Thucydide, Shakespeare, Defoe ou Manzoni.
Nos morts sont disséminés, cachés. Le nombre de décès (848) dû au Covid-19 depuis le début de la pandémie sur les 12 305 km2 du comté de Los Angeles représente environ un cinquième des décès dus à la peste (3880) survenus au cours d’une seule semaine (du 15 au 22 août 1665) sur les 3,1 km2 des paroisses de la Cité de Londres. Pour les habitants de ces dernières, les chiffres et les statistiques sociales rudimentaires confirmaient l’horreur de ce qu’ils voyaient. Pour nous, une science des données bien plus avancée, sous ses nombreux avatars, est en grande partie tout ce que nous pouvons connaître.
Nous regardons ces chiffres avec attention, parfois même avec « enthousiasme », comme s’ils étaient les seuls à nous connecter avec la réalité, là où les pouvoirs publics ont échoué, si bien, affirme l’auteur du Travail des morts, que l’ »on se souviendra du coronavirus 2020 comme l’épidémie de sciences sociales de l’ère moderne. Le déluge de données et d’analyses est tel que leur quantité même a modifié, d’un point de vue qualitatif, la manière dont la plupart d’entre nous – ceux qui ne sont pas directement au contact des malades et des mourants – pensent cette crise. »
Vivre ou mourir ?
Penser la mort, penser notre rapport à la vie et à la mort, et partant à ce que signifie ce confinement, c’est l’objet de récentes tribunes parues ces derniers jours. Prises de position iconoclastes, encore minoritaires mais qui se multiplient, et qui suscitent le débat, autour du choix politique de la protection de nos vies versus nos libertés fondamentales. Ce fut le philosophe André Comte-Sponville dans Le Point et dans Le Temps, l’historien Giorgio Agamben dans L’Obs, le philosophe Michaël Foessel dans Télérama, dont nous avons rendu compte ici, la psychologue et écrivaine Marie de Hennezel sur France Culture et dans Le Monde.
Le débat est ouvert, il est complexe et passionnant. On pourra lire par exemple la discussion entre André Comte-Sponville et le philosophe Francis Wolff dans Philosophie Magazine qui publie en ligne un extrait.
Dans une tribune parue dans Libération, le philosophe Abdennour Bidar enfonce le clou : « Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond du tout dans le système général de la civilisation humaine moderne, et qui doit nous inquiéter bien plus que tout le reste, pour que nous nous trompions de la sorte sur le fondamental : le sacré, la dignité humaine, la liberté. »
Car, pour le philosophe, avec la meilleure volonté du monde et dans le souci de bien faire, « avec toute notre intelligence, notre science, nos technologies, etc. nous avons réagi à la crise de façon tellement déshumanisée et déshumanisante, tellement irrationnelle derrière les apparences de la plus grande rationalité, que cela signe sans appel la fausseté parfaite de notre vision du monde, de notre mode de pensée, du sens que nous avons, ou prétendons avoir, de notre humanité même. »
En fait, relève Abdennour Bidar, au nom de la vie, nous lui avons ôté toute signification :
Oui il fallait protéger la «vie nue» dont parle Giorgio Agamben. Oui il y a d’admirables héros du quotidien qui ont pris soin de cette vie nue, et l’ont sauvée parfois. Mais comme il nous en a averti, et Michel Foucault avec lui, on ne peut pas, sous peine de renier notre humanité, choisir la préservation de cette vie nue «toute seule», de cette vie biologique au détriment de ce qui en fait une existence humaine en lui donnant son sens, son prix, sa grandeur : partager ses moments décisifs, naissance, maladie, vieillissement, mort ; respecter tout ce que j’ai appelé le sacré, la dignité, la liberté. C’est cet équilibre dans les valeurs que nous avons manifestement perdu, dont nous avons été manifestement incapables. Nous avons voulu sauver la vie mais nous l’avons, à l’inverse, coupée de tous les liens qui la nourrissent, vidée de toutes les significations qui la font grandir. Cesser d’exister pour rester en vie ? Cette contradiction est accablante.
Droit de vie et de mort
Cependant, les choses ne sont pas simples, comme le souligne la juriste Anne Levade sur le site de France Info. Le fait que « la quasi-totalité des recours déposés et traités en urgence par les juges dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire n’ont pas pour objet de faire constater que les droits et libertés sont limités à l’excès mais, tout au contraire, d’enjoindre au gouvernement de prendre des mesures plus protectrices de la santé » est un motif de surprise pour la professeure de droit public, qui la conduit à s’interroger sur les limites de ce qu’elle considère comme une surenchère. Car, se demande cette membre du conseil de surveillance de la Fondation pour l’innovation politique, qui participe à ce #EtAprès avec le think tank Terra Nova, au nom de quoi le font-ils ? « Si l’on en croit les requérants, non pas au nom du droit à la santé mais, de manière évidemment plus symbolique, pour garantir le droit à la vie. »
Or, nous dit la juriste, « le droit à la vie n’est pas et ne peut pas être un droit-créance » au même titre par exemple que le droit à l’instruction, le droit à la santé ou encore le droit qu’a chacun d’obtenir un emploi, qui impose des garanties de service public en échange d’obligations pour les individus. « Mais le droit à la vie fût-il un « droit à », on voit mal en quoi pourrait consister la créance. Que le droit à la santé impose à l’État de prendre toute mesure d’intérêt général de nature à assurer la protection de la santé relève de l’évidence. »
En revanche, déplacer le propos sur le terrain du droit à la vie implique de changer de paradigme. « C’est faire le choix de la surenchère puisque, par nature, ce droit ne peut connaître de limites. Enjoindre à l’État de garantir le droit à la vie, c’est exiger de lui qu’il empêche de mourir et, pour ce faire, nous interdise à tous de vivre libres. »
Dans les Carnets de l’EHESS, le philosophe Luc Foisneau, directeur de recherche au CNRS et spécialiste de la pensée politique moderne, convoque le Léviathan de Hobbes, publié en 1651, pour nous éclairer.
Nous avons accepté ces restrictions de liberté facilement. Pourquoi ? C’est, pour le philosophe, parce que « ces contraintes nous sont imposées au nom d’un droit fondamental à la vie. Or, tel est bien l’argument qui conduisit Hobbes, dans son Léviathan, à justifier notre renoncement à un droit naturel illimité au profit de l’autorité de l’État. Il nous faut renoncer au droit à toutes choses pour obtenir en échange les conditions normatives d’une préservation effective, en obéissant à une autorité qui dispose d’une compétence générale en matière de coordination de nos actions. »
Pour Luc Foisneau, notre confinement et ses modalités ne font donc que mettre en relief les raisons qui nous poussent, collectivement, a accepter l’existence normative de l’Etat, en total accord avec la théorie du Léviathan de Hobbes. « En continuant à faire ce qui contribue en temps ordinaire à notre bien-être – voir nos amis, sortir ou travailler en équipe –, nous exercerions certes nos droits fondamentaux mais nous le ferions au détriment de ceux des autres, et notamment de leur droit fondamental à rester en vie. »
Inégalités
Le droit fondamental à rester en vie, oui, peut-être, mais sommes-nous tous égaux devant la maladie ? Pour l’éditorialiste Polly Toynbee, dans le Guardian, la réponse est non. Si le coronavirus touche tout le monde, il ne le fait pas la même manière que l’on soit Premier Ministre ou chômeur de Liverpool. Une faute qui incombe, selon elle, aux politiques menées par le parti conservateur ces dix dernières années.
Et là encore, ce sont les statistiques qui le prouvent : le taux de mortalité du coronavirus dans les quartiers populaires est deux fois plus élevé que dans les quartiers aisés.
Choquant mais pas surprenant pour Polly Toynbee pour qui ces chiffres suivent un motif que ceux qui travaillent sur l’impact de la richesse sur la santé connaissent bien : « Pour la première fois depuis un siècle, les femmes qui naissent aujourd’hui dans les quartiers les plus démunis mourront plus jeunes que celles nées avant elles. Pour la première fois, la mortalité infantile a augmenté. Notre pays [le Royaume-Uni, ndrl] est entré dans cette crise en marche arrière sociale. »
Et si la différence d’espérance de vie d’un bout à l’autre de l’échelle sociale était déjà de 22 ans avant le coronavirus, « l’amoncellement deux fois plus rapides des cercueils à Blackpool et MiddlesBrough que dans les zones aisées du pays est une bombe politique à retardement. »
Alors que Boris Johnson a promis de prolonger l’espérance de vie de 5 ans d’ici 2035 pour les classes les plus pauvres en favorisant l’accès à la santé, Polly Toynbee conclut : “Cela concerne les symptômes, pas la cause. L’inégalité est responsable du déclin de la longévité, et ce gouvernement n’a aucune chance de l’inverser sans transformer radicalement les chances de la vie. Cinq ans de vie saine de plus? Nous devons tenir les pieds du gouvernement face à cette promesse. »
Se relever
Il va bien falloir se relever. La question c’est : comment ?
Pour le neuroscientifique Sébastien Bohler, auteur du livre Le Bug humain. Pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l’en empêcher, sur le site de Télérama, si nous choisissons de muscler une partie spécifique de notre cerveau (celle qui permet de restreindre la seule satisfaction de nos envies), la situation actuelle pourrait offrir une occasion inédite de changer notre rapport au monde. Car notre cerveau dispose de nombreuses ressources « dont la première est de renoncer à certaines libertés grâce au pouvoir d’inhibition du cortex préfrontal : il bloque les pulsions du striatum qui désire consommer, voir des amis, sortir… Ce pouvoir d’inhibition, d’ordinaire occulté dans nos sociétés d’assouvissement immédiat des désirs, se trouve soudain remusclé. Les choses se reconfigurent dans notre cerveau, nous changeons nos priorités et notre rythme de vie, et devenons aptes à goûter à des plaisirs plus simples — l’odeur d’une fleur, les subtilités de la cuisine, l’écoute d’une musique douce. Nous percevons mieux les petites saveurs. Reste à savoir si à l’avenir, après la crise, nous saurons exploiter cette force d’inhibition sur le temps long. »
Pour créer une société basée sur autre chose que l’envie de domination et de croissance permanente, il faudra activer un autre circuit de notre cerveau, plus profond, et programmé depuis toujours pour interpréter le monde à travers des grands récits […] Il sera donc primordial de faire le lien, par un récit qui donnera du sens, entre l’épidémie actuelle et notre mode de production et de consommation — ce n’est toujours pas évident pour beaucoup de gens. Sans ce lien, le Covid-19 sera un traumatisme sans lendemain. Mais si l’épidémie débouche sur un discours signifiant, connectant passé, présent et avenir, alors nous pourrions enclencher un nouveau conditionnement de nos cerveaux. Et un nouveau circuit du plaisir. Car ce n’est pas une fatalité génétique : les normes sociales peuvent tout à fait stimuler le plaisir, en valorisant par exemple les comportements de coopération plutôt que de compétition. L’enjeu capital sera donc de porter collectivement des discours récompensant l’altruisme, afin d’activer cet autre circuit du plaisir.
Ce discours, ce nouveau récit, plusieurs économistes tentent d’en dessiner les contours, tel Muhammad Yunus dans une tribune au Monde. Le Prix Nobel de la paix nous appelle à repenser le monde d’après sous le prisme écologique et social. L’après coronavirus nous donne l’opportunité de penser à une économie différente, pensée comme un moyen et non une fin :
La crise du coronavirus nous ouvre des horizons pour ainsi dire illimités pour tout reprendre à zéro. La possibilité de faire table rase pour concevoir matériel et logiciel, à neuf.
Il ne s’agit pas de relance mais d’une reconstruction à la vocation première sociale : « La reconstruction pour l’après-coronavirus doit partir de ce principe fondateur : la conscience sociale et environnementale comme pilier central de toutes les décisions. Les Etats doivent faire en sorte que pas un seul dollar n’aille à des entités ou projets qui n’œuvrent pas, avant toute chose, à l’intérêt social et écologique de la société. (…) »
Dans ce grand plan de reconstruction, Muhammad Yunus propose « de donner le rôle central à une nouvelle forme d’entrepreneuriat appelée le ‘’social business’’. Une entreprise de ce type a pour seul objet de résoudre les problèmes des individus, sans but lucratif pour les investisseurs autre que celui de récupérer leur mise. Une fois l’investissement initial amorti, tous les bénéfices sont réinjectés dans l’entreprise. »
Son plan de reconstruction serait organisé autour d’un rapprochement des citoyens et de l’Etat car il doit « abolir la division traditionnelle entre citoyens et pouvoirs publics. On part du principe que le rôle des citoyens est de prendre soin de leurs proches et de payer leurs impôts, et qu’il incombe à l’Etat (et dans une moindre mesure, au secteur associatif) de prendre en charge les problèmes collectifs que sont le climat, l’emploi, la santé, l’éducation, l’eau, etc. Le plan de reconstruction doit abattre ce mur et encourager tous les citoyens à s’engager en créant leurs entreprises sociales. Leur force ne dépend pas de l’envergure de leur projet, elle tient à leur nombre. »
Si nous ratons ce virage de la reconstruction écologique et sociale c’est une catastrophe encore plus grande qui nous attend, tant du point de vue d’autres catastrophes naturelles que du point de vue de la colère des populations. Alors que « du désespoir et de l’urgence de l’après-coronavirus, un Etat adoptant la bonne attitude pourra faire émerger un foisonnement d’activités comme on n’en a jamais vu. C’est à cette aune que l’on mesurera la qualité des dirigeants : montrer la voie d’une renaissance radicale du monde, par des moyens inédits, en fédérant tous les citoyens. »
Pour aller plus loin
Deux articles supplémentaires qui ont attiré notre attention:
– Dans un entretien à Libération, le philosophe Philippe Van Parijs estime qu’il est temps d’adopter un revenu de base : « Le revenu de base doit contribuer à la réalisation de l’objectif de plein-emploi, au sens de la possibilité d’accès par toutes et tous à un emploi rémunéré qui ait du sens pour celles et ceux qui l’occupent. En facilitant le va-et-vient entre emploi, éducation et activité bénévole, il constitue le complément naturel d’un apprentissage permanent qui doit désormais s’étaler sur toute l’existence. Il doit nous permettre d’être plus nombreux à travailler et plus nombreux à être désireux et capables de travailler plus longtemps. Du fait de son caractère inconditionnel, le revenu de base confère la liberté de ne pas travailler. C’est en cela que ses défenseurs lui attribuent un potentiel émancipateur ».
– Jeffrey Sachs, ancien artisan des libéralisations des économies post-soviétiques devenu partisan de Bernie Sanders, trace les contours de son « monde d’après » dans Mediapart : une économie libérée du produit intérieur brut, moins financiarisée, et se concentrant sur les déterminants d’un « bonheur humain » : « Remettre le bien collectif dans notre vie politique, cela signifie accorder moins d’importance au PIB et travailler à ce que toute la société puisse satisfaire ses besoins et atteindre le bien-être. »





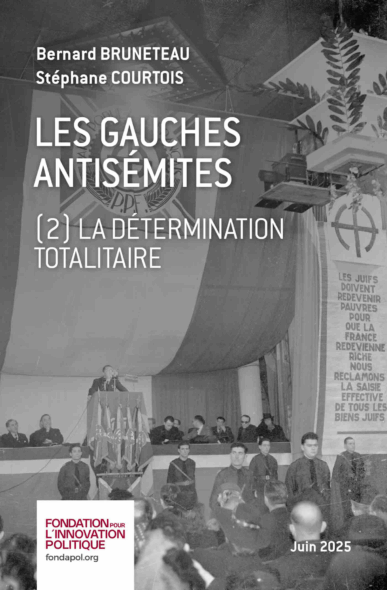
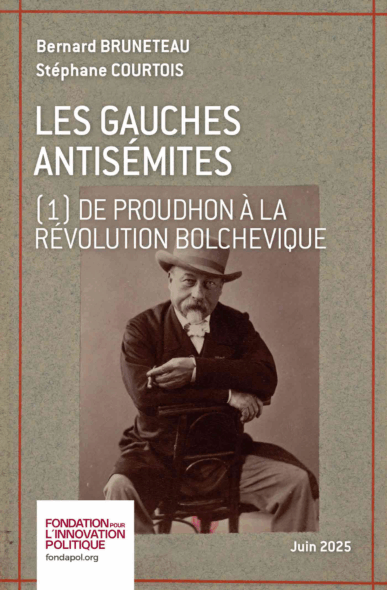


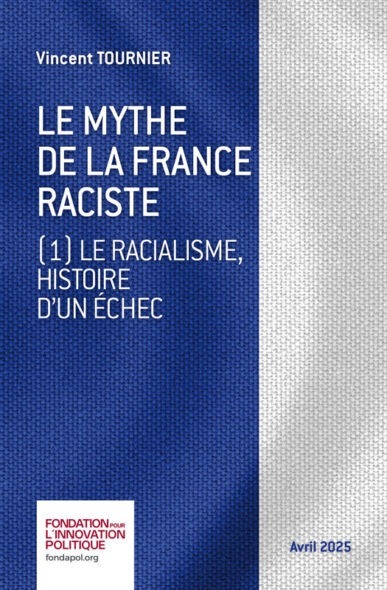



Aucun commentaire.