
Encadrer la GPA et la PMA dans une vraie politique de la vie
Dominique Reynié | 03 octobre 2014
Tribune de Dominique Reynié parue le 3 octobre 2014 dans Le Figaro.
Alors que de nouveaux rassemblements de la Manif pour tous auront lieu dimanche, Dominique Reynié estime que la société doit privilégier la vie humaine, quelle que soit la forme de la famille qui l’accueille.
En 2011, la Fondation pour l’innovation politique préconisait l’extension du mariage civil aux couples de même sexe, ainsi que le droit d’adoption, dans les règles d’habilitation existantes. Les propositions étendaient la réflexion sur les conditions dans lesquelles la procréation pouvait être accessible, qu’il s’agisse de la PMA ou de la GPA, y compris aux couples de même sexe. Dans son article publié ici sous le titre «Le mariage pour tous n’est pas un problème accessoire» (24/09/2014), Vincent Trémolet de Villers considérait le risque d’un «affranchissement de tous les déterminismes» et de «l’application de la loi du marché dans les domaines les plus intimes». Il peut être utile de prolonger la discussion en proposant une justification alternative de ces nouveaux droits.
Forme sociale fondamentale, la famille est sans cesse redéfinie, moins par la loi que par les comportements démographiques et sociaux. Le «mariage pour tous» a pris place dans des sociétés où le schéma familial est déjà totalement bouleversé. Il y a longtemps que la famille ne se présente plus seulement sous les traits réputés traditionnels du couple hétérosexuel, marié, avec enfants. De nos jours, les couples mariés n’ont pas toujours d’enfants ; les enfants naissent majoritairement hors mariage (56,4 % en 2013 selon l’Ined) ; plus d’un tiers des mariages s’achèvent par un divorce, la proportion atteint 50 % dans les grandes villes. Les couples avec enfants qui divorcent donnent le jour à des familles monoparentales – soit aujourd’hui 20 % des familles, le chiffre a triplé en quarante ans – ou à des familles recomposées qui concernent 1,5 million d’enfants (Insee), donnant lieu de fait à des nouvelles formes de parentalité. La vie de couple et la vie de famille s’organisent de plus en plus souvent hors mariage: union libre, couple de fait, concubinage ou pacs.
Faut-il craindre cette évolution? Plus qu’une forme de famille en particulier, c’est la famille qui est essentielle, parce qu’elle est cette unité sociale fondamentale au sein de laquelle des enfants adviennent, sont protégés, éduqués sous la responsabilité de parents qui les conduisent à l’autonomie de la majorité et de la citoyenneté. Il n’y a pas d’ordre social sans famille. Ni l’école, ni l’entreprise, ni l’État ne parviendraient à socialiser les individus, c’est-à-dire à ordonner la communauté, s’il n’y avait pas des millions de cellules familiales. Ainsi, même si les individus sont libres de fonder une famille ou non, il demeure vital pour la société que des familles se constituent pour accueillir des enfants. C’est pourquoi on ne peut pas considérer qu’un couple marié, hétérosexuel et sans enfant plus conforme au principe de la famille qu’un couple de même sexe avec enfants. Pour autant, ce n’est pas au nom d’un «droit à l’enfant» qu’il faut concevoir les nouvelles formes de famille et de parenté, mais depuis le désir d’avoir charge d’âme parce qu’il est conforme à l’intérêt de la société, car elle disparaîtrait si ce désir s’éteignait. Or, si ce désir se manifeste, c’est parce qu’il est, au sens strict, dans la nature des choses, tant il est vrai que le désir de persister dans son être anime tout vivant. À travers ce désir, qui se réalise socialement sous la forme de la famille et de la parentalité, c’est donc aussi la vie qui s’accomplit comme la pure puissance énergétique qui est au principe de toute chose.
L’ouverture du mariage civil aux couples de même sexe et l’accès de ces couples au droit d’adoption et de procréation doivent se comprendre dans le cadre d’une politique de la vie. Les termes techniques de PMA et de GPA font surgir des images épouvantables de chaînes de reproduction industrielle où des femmes seraient comme des machines. Mais le don du sang, de moelle épinière, le don d’organes, au cours de sa vie ou après sa mort constituent autant de gestes d’une gravité exceptionnelle. Ils sont strictement encadrés et l’on n’y voit pas, chez nous, une mise en exploitation des donateurs mais plutôt la générosité, le partage du vivant, et finalement une expression de la vie comme «l’ensemble des forces qui résistent à la mort» (Xavier Bichat, Recherches physiologiques sur la vie et la mort). De même, le don de la vie peut devenir l’un de ces actes magnifiques, de grande portée morale et politique. C’est à nous d’imaginer la régulation et la ritualisation qui permettront d’inscrire ces formes d’avènement de la vie humaine dans un cadre consacrant la dignité des individus et les valeurs d’une société exigeante.
N’est-il pas frappant de constater qu’aujourd’hui les possibilités nouvelles de voir advenir la vie suscitent une opposition plus vigoureuse que celles qui permettent de l’interrompre? Pourquoi la mobilisation contre la loi Taubira de 2013 a-t-elle été supérieure à celle suscitée, en 2014, par l’évolution du droit d’avortement. La loi Veil de 1975 instaurait un droit à l’avortement pour toute «femme enceinte que son état place en situation de détresse» ; l’amendement du 21 janvier 2014 a remplacé la notion de «détresse» par «le droit des femmes à choisir ou non de poursuivre une grossesse». Des parlementaires UDI et UMP qui avaient combattu le mariage entre les personnes de même sexe ont accepté de voter un amendement qui efface presque entièrement la tension éthique attachée à l’acte d’interrompre la vie et la violence radicale qu’il implique. Une politique de la vie aurait pu les conduire, à l’inverse, à soutenir le mariage entre les personnes de même sexe et à refuser de supprimer la référence à la détresse des femmes concernées par l’avortement.
Il en va de même pour l’évolution du discours sur «la fin de vie». Nombreux sont celles et ceux qui semblent disposés à installer comme un droit de plus en plus ordinaire la décision de mettre fin à la vie de quelqu’un, qu’il s’agisse de soi-même ou d’un autre. On ne peut s’opposer à l’émergence de nouvelles formes d’avènement de la vie humaine et, en même temps, soutenir le développement des nouvelles pratiques d’interruption de la vie sans y voir une contradiction majeure ni en redouter les conséquences.
Nul n’est propriétaire de lui-même. La société n’est pas non plus la propriété de ses membres ; elle est la condition pratique de leur venue au monde et de leur existence ; elle est aussi la condition politique pour que leur vie, au-delà de l’existence même, accède à la dignité qu’appelle leur humanité. Il en découle qu’une société est une expression de l’humanité tout entière et, en ce sens, qu’elle lui doit des comptes sur ce qu’elle fait de la vie humaine en particulier, mais aussi de la vie en général. C’est le sens de tout universalisme, religieux ou profane. Enfin, c’est l’existence humaine qui appartient au vivant, qu’Emmanuel Levinas a pu décrire comme un surgissement d’être dans un océan de néant (Totalité et infini). Le but de la société est la persistance de l’humanité dans l’accomplissement de sa singularité. Son devoir est de repousser aussi loin que possible la venue du temps où l’Univers ira de nouveau sans humanité, sans notre condition, unique, qui est de donner à la vie la conscience de son existence, de sa grande vulnérabilité et de contempler son infinie beauté.
Lisez l’article sur lefigaro.fr.



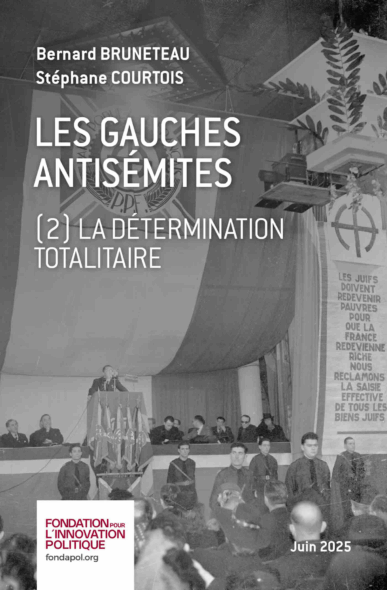
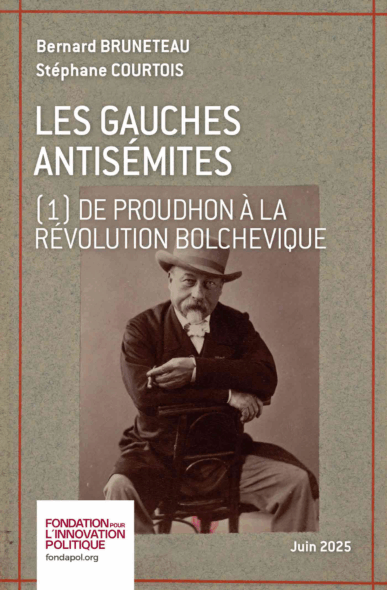


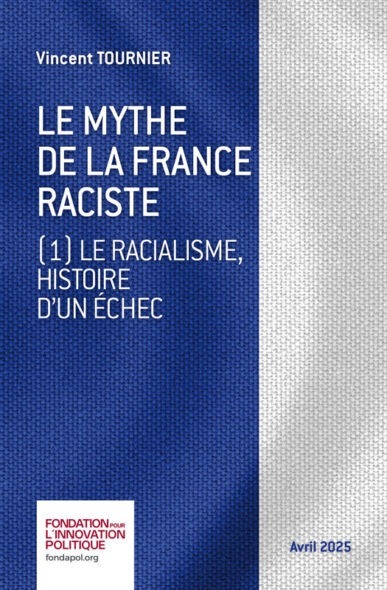




Aucun commentaire.