
Les concepts woke traversent l’Atlantique de plus en plus vite
Marie-Amélie Lombard-Latune | 20 juillet 2021
Une étude de la Fondation pour l'innovation politique se penche sur la perméabilité grandissante entre les campus américains et les facs françaises.
Après avoir étudié à l’université britannique d’Exeter en 2018, Pierre Valentin est revenu « vacciné » contre « une culture de la victimisation où chacun est en permanence offensé », dit-il. L’étudiant en master de Science politique à Paris 2 signe aujourd’hui une étude en deux parties pour la Fondation pour l’innovation politique, intitulée « L’idéologie woke. Anatomie du wokisme » et « L’idéologie woke. Face au wokisme ». La couleur est clairement affichée, le parti pris assumé, le résultat pas inutile pour appréhender les ressorts de ceux qui se décrivent comme « éveillés » (la traduction de woke) aux « injustices de race ou de genre qui pèsent sur les minorités ».
A quoi ressemble un militant woke ? En s’appuyant sur un sondage de l’Ifop de février 2021, Pierre Valentin décrit, à gros traits, « une femme, âgée de 18 à 35 ans, diplômée (ou bientôt diplômée), issue d’une famille aisée, qui a voté pour Benoît Hamon ou Jean-Luc Mélenchon à l’élection présidentielle de 2017 et qui déclare aujourd’hui une proximité politique avec LFI ou EELV ». En février 2021, seuls 14 % des Français interrogés avaient déjà entendu parler de la notion de « pensée woke ».
L’auteur de l’étude se penche sur la diffusion de ces mouvements aux Etats-Unis. Avec une nette accélération au milieu des années 2010, date à laquelle la « iGeneration », née autour de 1995 et nourrie d’iPhones, est arrivée sur les campus. Il note aussi la rapidité avec laquelle ces phénomènes s’exportent depuis les Etats-Unis. Le mot « whiteness » (« blanchité ») explose dans le monde anglo-saxon au début des années 1990, écrit-il, prend son essor en France en 2004-2005, stagne entre 2011 et 2014, puis redémarre. Ces dernières années, les concepts et expressions liés traversent l’Atlantique à plus vive allure. Les mouvements MeToo et Blacklivesmatter ont eu un impact évident sur cette cadence.
Au sein des entreprises, les formations « Diversity, Equity, Inclusion trainings » se multiplient. Avec le désormais célèbre exemple de Coca-Cola dont les employés étaient invités à « être moins blancs » et à se « détacher de la solidarité blanche »
« Décoloniser » les maths. L’écriture inclusive, en revanche, est quasiment une spécificité française, règles grammaticales oblige : « Elle a semblé jaillir de nulle part vers 2013-2014. » Des tentatives de la copier existent avec ce woman transformé en « womXn » afin de gommer le « man ».
Dans les facs américaines, après les sciences sociales, ce sont les STEM (science, technology, engineering and mathematics) qui sont désormais concernées. Des appels à « décoloniser » les maths surgissent. Le domaine biomédical est gagné par le mouvement. Au sein des entreprises, les formations « Diversity, Equity, Inclusion trainings » se multiplient. Avec le désormais célèbre exemple de Coca-Cola dont les employés étaient invités à « être moins blancs » et à se « détacher de la solidarité blanche ».
Pour Pierre Valentin, la vague woke, qui, en réaction, « accentue le clivage entre les élites et le peuple, peut provoquer le même phénomène qu’aux Etats-Unis : le vote Trump ». En Grande-Bretagne, souligne-t-il citant le politologue Frank Lutz (qui travaille pour les républicains américains et intervient sur Fox News) , le clivage woke/non woke est « récemment rentré dans les trois sujets les plus importants aux yeux de l’électorat ».
Lisez l’article sur lopinion.fr.
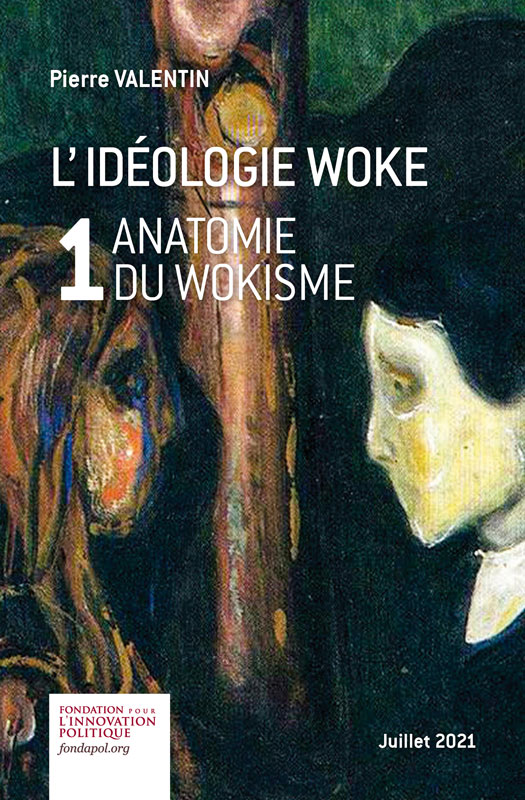
Pierre Valentin, L’idéologie woke. Anatomie du wokisme (1) (Fondation pour l’innovation politique, juillet 2021).
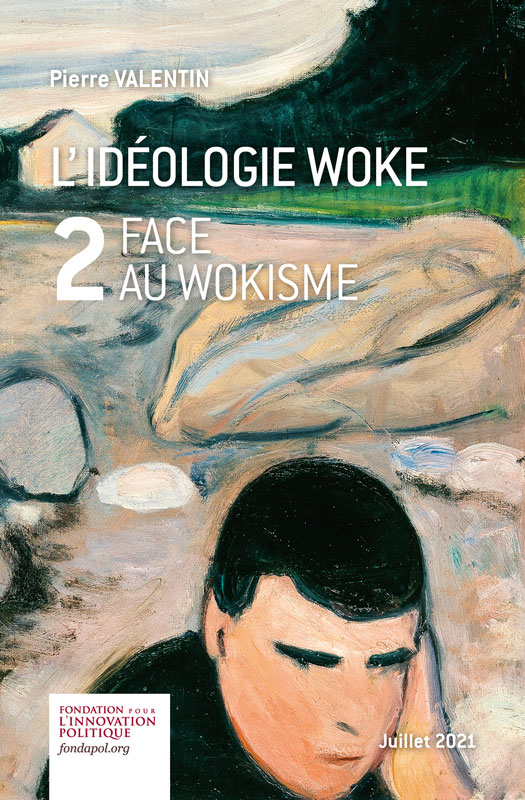
Pierre Valentin, L’idéologie woke. Face au wokisme (2) (Fondation pour l’innovation politique, juillet 2021).












Aucun commentaire.