
Voile dans le sport : « L’ONU défend des pratiques discriminatoires au nom de l’égalité »
Clément Pétreault, Razika Adnani | 28 septembre 2023
INTERVIEW. L’Organisation des Nations unies a dénoncé l’interdiction par la France du port du voile à ses athlètes lors des prochains JO. L’islamologue Razika Adnani réagit.
La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a annoncé cette semaine l’interdiction du port du voile islamique par les athlètes françaises lors des compétitions, au nom de la laïcité. Cette décision a été publiquement réprouvée par Marta Hurtado, la porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de l’homme de l’ONU.
Le Point a demandé à Razika Adnani*, philosophe et islamologue franco-algérienne, d’analyser la situation. Autrice de plusieurs ouvrages, elle est membre du conseil d’orientation de la Fondation de l’islam de France et membre du conseil scientifique du centre civique du fait religieux.
Le Point : La France, en interdisant le port du voile à ses athlètes en compétition, se place-t-elle en contradiction avec les valeurs du sport ?
Razika Adnani : La France interdit le port du voile lors des compétitions, parce qu’elle refuse que la pratique qui soumet les femmes à un statut inférieur s’immisce dans le sport. L’égalité est un fondement de la République. Elle n’admet pas que le voile, qui déshumanise l’homme, s’infiltre dans le sport, alors que la civilisation française a érigé le respect de la dignité humaine en une valeur sociale, morale et politique. Elle s’interdit de faire la promotion d’une pratique qui légitimise la violence, car le voile a été imposé aux femmes, libres et mariées, pour les distinguer des esclaves et des prostituées qui, elles, n’avaient pas le droit de se voiler afin que les hommes puissent librement les agresser et les violer. Le verset 59 de la sourate 33 recommande également aux femmes musulmanes de mettre leur djalabib (robes longues) afin que les hommes les reconnaissent et ne leur nuisent pas. Refuser les discriminations à l’égard des femmes, ne jamais promouvoir ce qui porte atteinte à la dignité humaine ou légitimise la violence doit être la plus grande valeur de sport.
En réponse à l’interdiction du voile islamique en compétition, le Haut-Commissariat aux droits de l’homme a estimé que « personne ne devrait imposer à une femme ce qu’elle doit porter ou non ». Cela signifie-t-il que l’ONU renvoie dos à dos la France et des théocraties comme l’Iran ?
Cela signifie que l’ONU aborde la question du voile en se fondant sur le principe de liberté qu’elle veut appliquer à tous de la même manière. C’est l’argument de ceux qui défendent le voile parmi les Occidentaux en faisant fi des éléments qui l’entourent : son discours, son histoire et sa culture… Car s’ils le faisaient, ils comprendraient que le voile n’a jamais été une liberté pour les femmes musulmanes. Il leur a toujours été imposé par les hommes, la religion et la société.
Quand l’ONU évoque le principe d’égalité, ce n’est pas celle qui accorde aux hommes et aux femmes les mêmes droits. C’est considérer que la pratique qui discrimine les femmes mérite les mêmes égards que la pratique qui accorde aux femmes les mêmes droits qu’aux hommes. Elle condamne pareillement celui qui impose le voile aux femmes et celui qui veut les protéger de cette pratique archaïque. Une pratique qui, pourtant, est à l’origine de la claustration des femmes et de la privation de tous leurs droits. L’ONU défend une égalité qui est en réalité un non-sens et une mise à mort du principe de l’égalité.
L’ONU condamne-t-elle avec le même zèle des régimes qui imposent le voile à leurs athlètes féminines, tout en leur interdisant certaines disciplines, comme la lutte, la boxe, la natation, le volley et la gymnastique ?
L’ONU est une institution dont les positions ou les condamnations n’ont aujourd’hui aucune importance ni incidence sur la politique des pays concernés. La preuve en est que l’Afghanistan, un des pays les plus pauvres et les plus faibles, ne réagit pas à ses condamnations pour maltraitances des filles et des femmes. L’interdiction de certaines disciplines sportives aux femmes par certains régimes islamiques s’inscrit dans la logique du voile, dont l’objectif est de faire disparaître le corps de la femme du regard de l’autre et du sport qui est une activité physique et un spectacle. Le voile islamique ne permet pas aux femmes de participer aux compétitions sportives internationales, hormis peut-être les jeux d’échecs. Le jour où les islamistes auront plus de pouvoir, ils ne permettront plus aux femmes d’exercer des activités sportives. D’ailleurs, les talibans ont interdit le sport aux femmes et les ont privées d’autres droits. Mais les pays musulmans ne se sont pas mobilisés pour défendre les droits des Afghanes comme ils l’ont fait pour dénoncer l’autodafé du Coran…
La représentante de l’ONU a rappelé mardi que la Convention pour l’élimination des discriminations à l’égard des femmes faisait obligation à la France de prendre « toutes les mesures nécessaires pour modifier tout modèle social ou culturel fondé sur l’idée d’infériorité ou de supériorité de l’un ou l’autre sexe ». Ce qui est une manière assumée de demander à la France de renoncer à l’interdiction du voile. Cela signifie-t-il que le voile est compris comme un signe culturel et non cultuel ?
Que le voile soit compris par l’ONU comme un signe culturel et non cultuel, cela n’empêche pas qu’il soit une pratique discriminatoire et que c’est paradoxal de défendre au nom de la lutte contre les discriminations, une pratique discriminatoire.
Les musulmanes qui portent le voile ou qui le revendiquent, le considèrent-elles comme un signe cultuel et non culturel ?
Certes, la dissimulation de la chevelure de la femme, considérée comme la partie indispensable du voile, n’est recommandée par aucun verset coranique. Le foulard est pourtant ce que les athlètes exposent pour montrer qu’elles sont musulmanes. Les athlètes ne couvrent pas non plus leur corps avec une robe longue et ample (ou abaya) comme le recommandent les religieux et le verset 59 de la sourate 33. On l’a vu avec la Marocaine Nouhaila Benzina lors de la Coupe du monde féminine de football. Le caractère culturel du voile s’accentue quand on sait qu’il existait bien avant qu’il ne soit récupéré par les religions. La position des commentateurs qui ont affirmé que les femmes devaient dissimuler leur chevelure s’expliquait par le fait que leur travail interprétatif était indissociable de la culture à laquelle ils appartenaient.
Pourquoi aucun autre pays ne semble comprendre le principe de l’émancipation par la neutralité religieuse ?
La laïcité et la neutralité de l’État sont reconnues par d’autres pays dans le monde tels que l’Angola ou le Portugal, ce qui prouve que beaucoup de pays ont compris l’importance de la neutralité de l’État vis-à-vis des religions. La France n’est pas non plus la seule à prendre des décisions contre le port du voile. L’Azerbaïdjan a interdit le voile à l’école, l’Égypte a interdit le voile intégral à l’école. De toute manière, plus les femmes qui utilisent la liberté – argument de la gauche et du néoféminisme pour défendre leur voile – se couvriront, plus les islamistes diront que leur voile n’est pas assez conforme à la charia… jusqu’à ce qu’ils les enferment totalement. La Marocaine Nouhaila Benzina en a fait l’expérience lorsqu’il lui a été rappelé qu’elle ne devait tout simplement pas, en tant que musulmane, jouer au foot.
* Elle a publié pour la Fondapol Maghreb : l’impact de l’islam sur l’évolution sociale et politique, en décembre 2022.
Retrouvez l’article sur lepoint.fr
Razika Adnani, Maghreb : l’impact de l’islam sur l’évolution sociale et politique, Fondation pour l’innovation politique, décembre 2022.
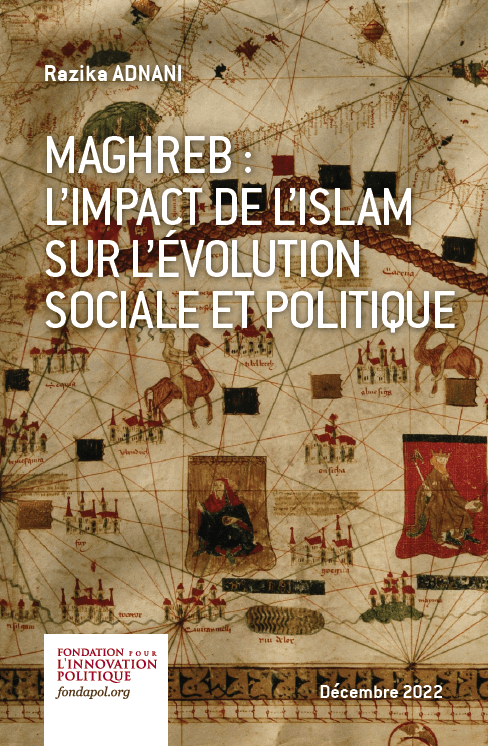












Aucun commentaire.