"Les pays émergents, Approche géoéconomique" de Laurence Daziano : le débat
Fondapol | 04 janvier 2015
 Trop Libre vous propose un compte-rendu de l’échange autour du livre de Laurence Daziano Les pays émergents, Approche géoéconomique organisé par la Fondation pour l’innovation politique
Trop Libre vous propose un compte-rendu de l’échange autour du livre de Laurence Daziano Les pays émergents, Approche géoéconomique organisé par la Fondation pour l’innovation politique
Par @Emmanuel Blézès, avec @HemisphèreDroit
Le mardi 2 décembre, la Fondation pour l’innovation politique organisait un nouveau débat au cour duquel les participants étaient conviés à discuter du dernier livre de Laurence Daziano : Les pays émergents, Approche géoéconomique, publié chez Armand Colin.
Dominique Reynié, directeur de la Fondation pour l’innovation politique, présente ses trois invités. Laurence Daziano est économiste, membre de la Fondapol où elle avait déjà publié La nouvelle vague des émergents et L’urbanisation : une chance pour la France. Anne-Marie Idrac fut Secrétaire d’Etat au commerce extérieur de 2008 à 2010. Elle a ainsi vu de près l’émergence de nouvelles puissances économiques. Jean-Claude Paye, ancien président de la Fondation pour l’innovation politique, fut secrétaire général de l’OCDE de 1984 à 1996.
Dominique Reynié souligne l’originalité du livre. Tout d’abord, la globalisation n’y est pas simplement décrite comme un simple phénomène économique : l’auteur y analyse les bouleversements sociaux, démographiques, culturels et religieux qu’elle implique. Le livre ne limite pas son étude aux sociétés occidentales. En regardant les émergents, nous voyons « un monde qui va bien ». Le niveau de vie, l’espérance de vie sont en hausse (gain de 9 ans chez les émergents ces vingt dernières années), la famine perd du terrain. A priori, tout processus de démondialisation s’apparenterait à un frein de la dynamique ainsi engagée.
C’est la description de l’interdépendance des économies nationales que retient Anne-Marie Idrac. Le développement de chaînes de valeurs industrielles a accompagné la fin de la division internationale du travail : les pays riches devaient vendre leurs technologies produites à partir des matières premières importées des pays les plus pauvres. La fin de ce modèle obsolète permet de dépasser le vieux clivage Nord/Sud. Les pays émergents sont désormais engagés dans la révolution technologique. Ils nous donnent une « leçon », selon les mots d’Anne-Marie Idrac. Ce sont les pays de l’envie de travailler, de l’espoir. Attitude dont les Européens devraient s’inspirer.
Laurence Diazano prend la parole pour présenter son livre et mettre en contexte la notion d’émergence. Celle-ci intervient à la fin du XXe siècle, lorsque la chute du mur de Berlin consacre la fin de la confrontation de deux modèles idéologiques. La Chine en est l’exemple le plus évocateur.
Les réformes de Deng Xiaoping ont opéré le tournant de l’économie de marché. La Chine est aujourd’hui une puissance mondiale. Cette puissance s’appuie sur un renforcement des liens régionaux : elle a récemment annoncé son souhait de créer une banque asiatique des infrastructures. Mais la Chine se voit surtout comme l’« empire du Milieu ». Elle veut désormais façonner un monde à son image et déplace le centre du monde de l’Atlantique vers le Pacifique. La Banque Mondiale la place 2ème au classement des économies mondiales en terme de PPA (Parité Pouvoir d’Achat). Cet indicateur a ses limites mais augure le poids de la Chine dans la richesse produite.
Mais l’émergence ne se limite ni à la Chine ni à l’acronyme « BRICS » (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud). C’est un phénomène beaucoup plus vaste qui touche des pays qu’on mentionne peu dans le débat français. L’auteur parle à ce titre des BENIVEM (Bangladesh, Ethiopie, Nigeria, Indonésie, Vietnam, Mexique). La spécificité des BRICS se situe dans leur souhait de jouer un rôle politique dans les instances internationales à la hauteur de leur poids dans l’économie mondiale. Dans ce monde qui change, la France doit mobiliser ses atouts si elle veut encore peser.
Retrouvez le débat filmé en intégralité sur le site de la Fondation pour l’innovation politique
Jean-Claude Paye souligne à son tour la grande diversité des pays dits « émergents ». Parmi eux, les pays africains joueront un rôle crucial. La France saura-t-elle tirer le parti de la francophonie ? demande-t-il. La réponse de Laurence Daziano est nuancée. L’Afrique va doubler sa population d’ici 2050. Certes, cette population est majoritairement francophone mais la francophonie doit désormais passer d’un espace linguistique à un espace économique. La Chine et la Turquie demeurent les deux premiers partenaires économiques de l’Afrique. La France a, quant à elle, perdu la moitié de ses parts de marché avec l’Afrique depuis 2000.
Comme le remarque Dominique Reynié, la Russie est symptomatique de la diversité des émergents. La Russie a fondé son développement sur l’exploitation des hydrocarbures, s’appuyant sur un Etat fort. Conscient de ses fragilités, le pays se tourne vers l’Asie où des accords gaziers sont régulièrement signés. Anne-Marie Idrac ajoute que l’émergence est aussi un concept politique. Il n’y pas de grand pays sans progrès institutionnel. A ce titre, l’Inde devra prouver sa capacité à faire du fédéralisme un moteur de l’unité du pays avant d’être considéré comme une grande puissance, au même titre que les vieux pays industrialisés.
Ainsi la mondialisation ne bouleverse pas seulement les pays occidentaux. Les sociétés changent, les instances politiques des pays émergents sont appelées à prendre leurs responsabilités (réduction des émissions de gaz à effet de serre, entrée à l’OMC, …) aboutissent chez les populations à ce que Dominique Reynié nomme « déstabilisation existentielle ». Les émergents sont brutalisés par un processus qui les emporte. Ces pays interrogent nos propres certitudes. La Chine nous apprend que la démocratie n’est pas le seul modèle politique à permettre le développement, l’enrichissement.
Face à des réalités complexes, des hiérarchies en recomposition, Laurence Daziano a tenu à terminer son intervention en rappelant les critères faisant d’un pays un « émergent » :
- la population : jeune, éduquée, importante (100 M. au moins)
- la croissance économique (5%)
- l’urbanisation (au moins 50%)
- les infrastructures (accès à l’électricité, réseau de transport, …)
- la stabilité politique (elle rassure les investisseurs)
« La France doit se mettre en ordre de bataille », conclut l’auteur.
Crédit photo : José Antonio ; Armand Colin

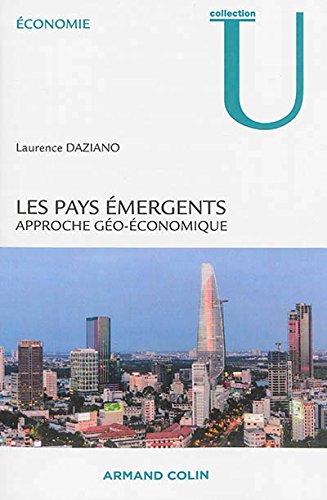











Aucun commentaire.