Sahara occidental : la théorie de l'infraction marocaine en question
Chronologie
Sigles et acronymes
Introduction
Partie 1
La formation du noeud juridique
Chapitre I. Un cas de décolonisation atypique
L’empire chérifien et sa grammaire politique à nulle autre pareille
Une colonisation tardive et spécifique
Les frontières, question non tranchée à l’indépendance
Le patchwork des possessions espagnoles
L’indépendance par étapes
Chapitre II. Les « trois âges » du droit international
Le sacre de la souveraineté (1648-1945)
La priorité à la stabilité et interdiction des annexions (1945 à nos jours)
L’autodétermination comme levier de décolonisation
Chapitre III. Évaluer la marche verte
La « préhistoire » de la Marche verte
La portée de la Marche verte
Partie 2
Le dénouement du noeud juridique
Chapitre IV. La guerre et la diversification des sources juridiques
L’entrée en scène de la Cour internationale de Justice
L’entrée en scène du Conseil de sécurité
Les résolutions du Conseil de sécurité
Les phases du conflit
Les inflexions marocaines
Cessez-le-feu et préparatifs de référendum
Mohammed VI, le développement et le plan d’autonomie
Du polycentrisme juridique aux tokens56
Chapitre V. Guérilla judiciaire au Luxembourg
Une irruption judiciaire dans la politique extérieure
Les arrêts de la Cour au regard du droit européen
Les arrêts de la Cour au regard du droit international
Chapitre VI. Vers une sortie du conflit
L’argument des “droits historiques” : atouts et contraintes pour le Maroc
Avantages et inconvénients de l’évitement juridique pour la France
L’enrichissement du référentiel marocain
Équité et légalité
Conclusion
Bibliographie sélective
Résumé
Depuis 50 ans, le conflit du Sahara occidental est pendant devant les instances internationales.
En 1975, le Maroc a fait acte de souveraineté sur ce vaste territoire désertique, jusque-là colonie espagnole. Il estime qu’il lui avait antérieurement appartenu. Ce point de vue est contesté par le Front Polisario, mouvement indépendantiste soutenu par l’Algérie. La communauté internationale a adopté une attitude ambivalente, retenant l’idée d’une infraction du Maroc au droit international, tout en se montrant de plus en plus conciliante avec ce pays, qui exerce une souveraineté de fait dans les régions concernées. Cette ambivalence crée une situation peu compréhensible et difficile à démêler.
Ce rapport revient sur les racines de l’antagonisme entre l’Algérie et le Maroc, ainsi que sur la géographie et l’histoire du Sahara occidental. Il revisite la théorie de l’infraction marocaine à travers une relecture du droit international applicable. Il préconise un dépassement du conflit par une prise en compte de ses causes profondes.
Dominique Bocquet,
Ancien élève de l’ENA et enseignant à Sciences Po Paris
avec le concours de Sâ Benjamin Traoré,
Professeur de Droit international public
Carte du Maroc figurant depuis octobre 2024 sur le site officiel du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français
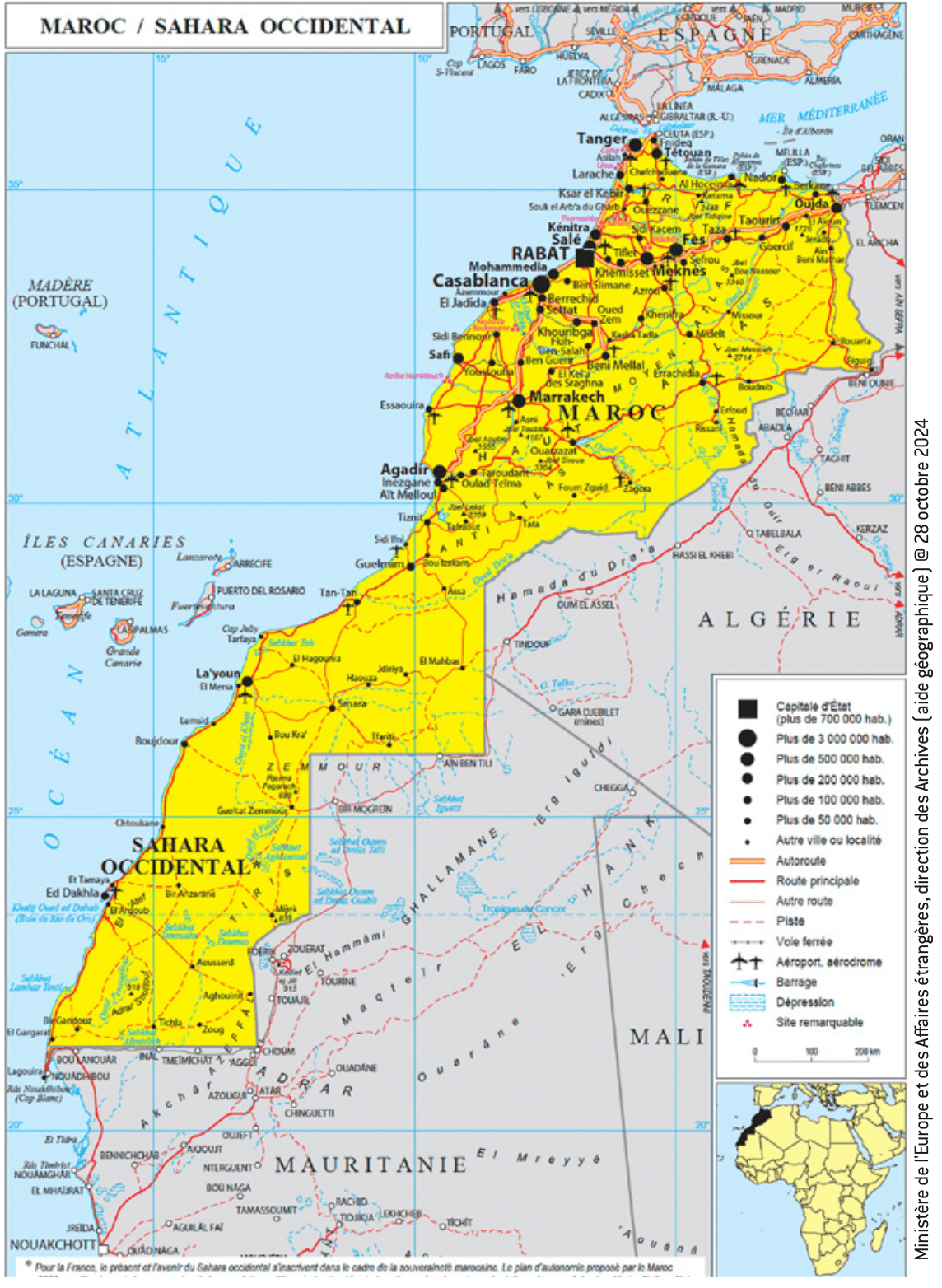
Carte du Grand Maroc publiée en 1956 par l’Istiqlal

Source :
Conférence de presse d’Allal el Fasso, Le Caire, 4 juillet 1956.
Carte Universalis 2025
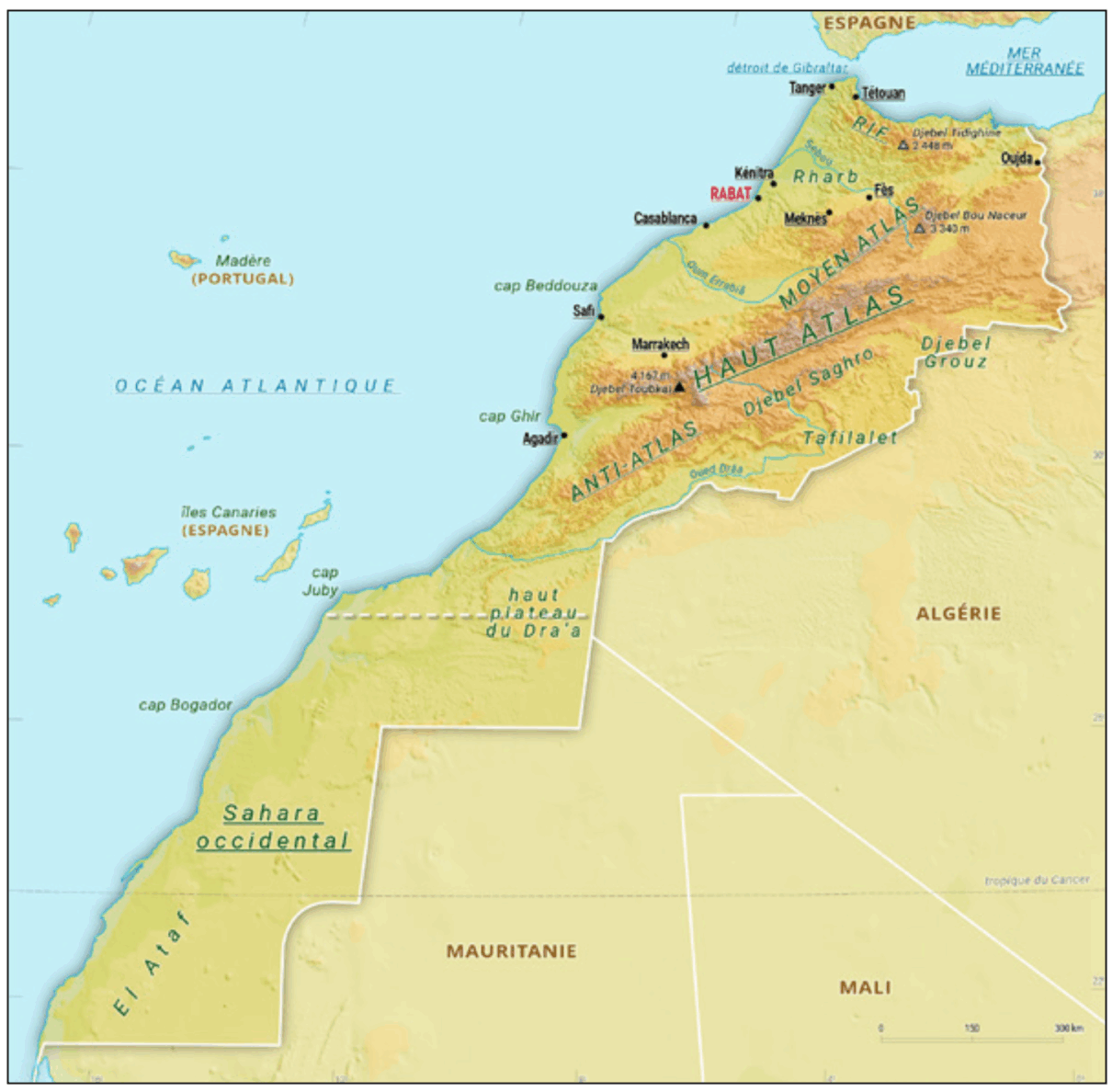
Source :
Universalis, Carte physique du Maroc [en ligne].
Chronologie
Ancien élève de l’ENA et enseignant à Sciences Po, Dominique Bocquet prépare un livre sur le conflit du Sahara occidental. Il a notamment été conseiller d’Hubert Védrine et chef du service économique de l’Ambassade de France au Maroc. Il est chercheur au Policy Center for the New South de Rabat. Le présent rapport a été établi à la demande de Dominique Reynié, directeur général de la Fondapol, et rédigé pour le compte de cette fondation.
Sâ Benjamin Traoré est professeur de droit international public. Sa thèse, soutenue à la faculté de droit de l’université de Neuchâtel, s’intitule L’interprétation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, Contribution à la théorie de l’interprétation dans la société internationale. Il enseigne à l’Université Mohammed VI de Rabat.
1884 : prise de possession espagnole au Rio de Oro (partie sud du Sahara occidental)
1912 : traité de Fès, instauration du Protectorat franco-espagnol au Maroc
1920 : prise de possession espagnole en Saqia El Hamra (partie nord du Sahara occidental)
1956 : fin du Protectorat et indépendance du Maroc. L’Espagne conserve entre autres le Sahara occidental, Tarfaya, Ifni, etc.
1957-1958 : action de l’ALN au Sahara occidental et en Mauritanie, réaction française (Écouvillon)
1958 : restitution au Maroc de la bande de Tarfaya
1963-1966 : Ifni et Sahara occidental évoqués à l’ONU, puis portés sur la liste des TNA
1969 : la ville d’Ifni restituée par l’Espagne au Maroc
1972 : manifestation de Tan-Tan (Maroc) en faveur de la réunion du Sahara occidental au Maroc
29 avril 1973 : création du Front Polisario, à Zouerate (Mauritanie)
6 novembre 1975 : Marche verte (350.000 civils marocains pénètrent au Sahara occidental)
14 novembre 1975 : Accords de Madrid, partage du Sahara occidental (Maroc-Mauritanie)
27 février 1976 : le Front Polisario proclame la RASD avec le soutien de l’Algérie
1976-1980 : attaque des armées marocaine et mauritanienne par le Polisario, réfugiées à Tindouf
1979 : la Mauritanie évacue le Sahara occidental, entrée du Maroc
1981 : Hassan II évoque la possibilité d’un référendum
1982 : RASD admise à l’OUA
1984 : Hassan II s’engage pour le référendum à l’ONU (septembre) ; le Maroc quitte l’OUA (novembre)
1991 : cessez-le-feu, mise en place de la Minurso par le CS ONU (6 septembre)
2006 : Mohammed VI annonce un plan d’autonomie interne
2007 : le CS ONU salue la proposition de plan d’autonomie, « base sérieuse de négociation »
2017 : le Maroc réintègre l’OUA (devenue Union africaine), sans préalable d’exclusion de la RASD
2020 : « Accords d’Abraham » et reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara
2022 : l’Espagne déclare le plan d’autonomie « base la plus sérieuse et crédible » pour un règlement
2024 : lettre du président Macron au roi (souveraineté marocaine « présente et future » au Sahara)
2025 : cinquantenaire de la Marche verte (6 novembre)
Sigles et acronymes
AGNU (ou AG) : Assemblée générale des Nations unies
ALN : Armée de libération nationale (Maroc)
CIJ : Cour internationale de Justice (La Haye)
CJUE : Cour de Justice de l’Union européenne (Luxembourg)
CORCAS : Conseil royal consultatif pour les affaires sahariennes
CS ONU : Conseil de Sécurité des Nations unies
FAR : Forces armées royales marocaines
FLN : Front de libération nationale (Algérie)
GPRA : Gouvernement provisoire de la République algérienne
Istiqlal : Parti de l’indépendance (Maroc)
Minurso : Mission des Nations unies pour l’organisation du référendum au Sahara occidental
OCP : Office chérifien des phosphates
ONU : Organisation des Nations unies
OUA : Organisation de l’unité africaine (1963-2002)
Polisario : Front populaire de libération de la Saqya El-Hamra et du Rio de Oro
RASD : République arabe sahraouie démocratique
TNA : Territoires non autonomes (liste de l’ONU)
UA : Union Africaine (depuis 2002)
UE : Union européenne
UNFP : Union nationale des Forces populaires
USFP : Union socialiste des Forces populaires
Introduction
Karim El Aynaoui a bien voulu partager avec moi, en toute indépendance d’esprit réciproque, ses intuitions personnelles sur les causes du conflit. Le rôle du révolutionnarisme comme déterminant idéologique en faisait partie.
Voici un demi-siècle, le Maroc a fait acte de souveraineté au Sahara occidental, auparavant occupé par l’Espagne. Le 6 novembre 1975, une foule de 350.000 Marocains, conduite par le roi Hassan II, pénétrait sur le territoire, forçant Madrid à négocier. En dépit du caractère désertique de ce vaste territoire, essentiellement parcouru par des nomades, un conflit a surgi, qui n’est pas purgé cinquante ans après.
Ses tenants et aboutissants restent un mystère. En France et en Espagne, pays largement associés, sur la durée, à la cause marocaine, la perplexité est à son comble. La raison est simple. D’un côté, ces deux pays voient la souveraineté marocaine sur ce territoire comme effective et légitime. D’un autre côté, ils s’abstiennent de la déclarer légale.
L’incertitude juridique créée par la non reconnaissance légale est une gêne pour les entreprises, un frein aux investissements et un obstacle au développement. Elle permet au Front Polisario, mouvement armé soutenu par l’Algérie, de revendiquer l’indépendance au nom du droit international.
Comment sortir de cet imbroglio ? La réponse est politique mais pas seulement. Sur ce terrain, le Maroc marque des points décisifs. Sa diplomatie a gagné en efficacité. Le cercle des pays le soutenant s’élargit. Le Conseil de sécurité reconnait de plus en plus l’autonomie du territoire comme base la plus sérieuse de règlement, au détriment de la thèse indépendantiste.
Mais, juridiquement, le Sahara occidental demeure un « territoire non autonome ». La liste en est arrêtée, non par le Conseil mais par l’AG de l’ONU, compétente en matière de décolonisation. Classer le territoire comme non décolonisé revient à contester la souveraineté marocaine. Le droit à l’autodétermination est invoqué pour accuser Rabat d’infraction au droit international. Un autre aspect est « l’intangibilité des frontières héritées de la décolonisation », notion propre à l’Afrique et consistant à interdire toute modification des frontières, même par la négociation. Le Maroc aurait transgressé cet interdit en effaçant sa frontière avec l’ancien Sahara espagnol. Avec cet argument, le Polisario et l’Algérie ont obtenu en 1982 l’admission à l’OUA de la RASD (République arabe sahraouie démocratique).
Que valent ces arguments ? Étonnamment, ils ont été peu contredits dans le débat public. La tactique utilisée au départ par le Maroc et la France n’y est pas étrangère. Elle consistait à esquiver un débat juridique biaisé. Nous étions en 1975. Dans les instances internationales, le haut du pavé était tenu par une idéologie révolutionnariste qui diabolisait le régime d’Hassan II et glorifiait les mouvements armés de libération3. L’Occident était intimidé et le Maroc, condamné d’avance.
Inévitable à court terme, l’évitement juridique n’allait pas manquer d’avoir, sur le débat intellectuel, les plus grandes conséquences : il a produit l’impression d’un plaider-coupable. Puisqu’elle était peu critiquée devant le grand public, la thèse de « l’infraction marocaine » au droit international est apparue comme une évidence, même à ceux éprouvant de la bienveillance envers ce pays. L’opinion aurait été déroutée à moins.
Aujourd’hui, si Français et Espagnols n’abordent pas la question juridique à la racine, le succès du Maroc sera présenté par certains comme une défaite du droit et un fait accompli. Est-ce une bonne issue pour le droit ? Est-ce la meilleure issue pour le Maroc ? Est-ce, pour les autres parties prenantes (dont l’Algérie), une sortie par le haut ? La présente étude montre la fragilité des résolutions internationales initiales et invite les chercheurs à un travail de réinterprétation.
C’est-à-dire un bloc opaque dont on est prié d’accepter les résultats sans droit de regard sur leur mode d’élaboration.
| Méthodologie du rapport
Ce rapport se concentre sur les articulations principales du raisonnement. Elle ne prétend pas recenser tous les faits mais s’efforce de restituer les nuances gommées par un débat manichéen, lequel est pour beaucoup dans l’image d’un conflit gelé. Elle se focalise sur l’esprit du droit et son interaction avec l’histoire et les sciences humaines, c’est-à-dire le contexte. Ceci n’aurait pas été possible sans l’aide du Professeur Sâ Benjamin Traoré. Sa thèse sur L’interprétation des décisions du Conseil de sécurité, soutenue à Neuchâtel, fait autorité. Il a bien voulu se prêter à des échanges nourris pour faciliter la rédaction de ce texte, puis le relire attentivement. Ce rapport lui doit beaucoup. Dans cette affaire, le droit international était souvent invoqué comme une boîte noire4. En m’aidant de ses réflexions sur l’interprétation (en général) et le Sahara (en particulier), je propose l’inverse au lecteur : ouvrir le capot du moteur et montrer comment ce droit fonctionne. |
Partie 1
La formation du noeud juridique
Chapitre I. Un cas de décolonisation atypique
Cet angle d’analyse m’a été suggéré par Sâ Benjamin Traoré. Sa perception de juriste rompu aux problématiques de décolonisation a convergé, sur ce point, avec mes recherches historiques sur la notion de « singularité marocaine ». Voir l’article de Dominique Bocquet,« Singularités marocaines et perplexités françaises », Commentaire, numéro 182 (été 2023) [en ligne].
Expression qui signifie « Bouleversement social amené à renverser l’état des choses actuel ».
La méthode d’analyse des relations internationales prônée par Raymond Aron a parfois été définie, en langage soutenu comme le « réalisme idiosyncratique ».
Si le dossier du Sahara occidental apparaît indéchiffrable, c’est que l’on a gommé son histoire et sa spécificité. On a cru y voir un cas classique de décolonisation. Il s’agissait, au contraire, d’un cas profondément atypique5. De là une certaine complexité. On se doit d’assumer cette complexité si l’on veut tirer au clair un sujet que le simplisme ne peut que déformer.
Tout est atypique dans ce dossier. En premier lieu l’histoire du Maroc, empire millénaire à la grammaire politique unique au monde. Ensuite sa stratégie de décolonisation, l’indépendance par étapes, plutôt que le grand soir6. Enfin la « nature » du Sahara occidental : un territoire plus désertique que la Patagonie et seulement parcouru par des nomades.
Encore est-ce omettre le passif des relations Maroc-Algérie dans une affaire où celle-ci n’est officiellement qu’une tierce partie (elle n’affiche pas de revendication territoriale et n’a qu’une frontière commune très limitée avec le territoire), tout en étant citée dans les procédures comme « intéressée au conflit », phénomène peu fréquent en droit international, même s’agissant d’un pays voisin.
C’est par ces spécificités qu’il faut commencer. Elles nous invitent à nous souvenir de la grande leçon de Raymond Aron sur les relations internationales : chaque situation doit être étudiée en soi, en se défiant des grilles de lecture préétablies7.
L’empire chérifien et sa grammaire politique à nulle autre pareille
Cette avance ne fut pas retenue. Ce Sultan était grand polygame. Versailles ne voyait pas une fille du roi dans un harem. La relation bilatérale (établie depuis au moins François 1er) n’en fut pas moins relancée.
Le Maroc n’est pas un cas de décolonisation « standard ».
En Afrique subsaharienne, le colonisateur a souvent débarqué, au XIXe siècle, dans des contrées marquées par le morcellement linguistique et ethnique. La question de savoir si l’État existait déjà ou non demeure controversée ; il n’était pas présent partout, et les logiques tribales occupaient encore une place prépondérante. Dans cette configuration, il a souvent été considéré que c’était le colonisateur qui avait promu la notion d’État moderne, à travers les « États coloniaux », appelés à servir ensuite de socle aux indépendances.
En Afrique du Nord, de larges entités existaient et la diversité linguistique était limitée (arabe dialectal et langues berbères). Au Maroc, la colonisation a trouvé un État préexistant : un millénaire, avec des relations commerciales sur plusieurs continents et des ambassades en Europe.
L’indépendance était incarnée par un Sultan, doté d’une légitimité religieuse en tant que « commandeur des croyants ». Son rôle : défendre le pays, notamment face à l’Espagne. Pendant huit siècles (VIIIe ‑XVe siècles), musulmans et chrétiens s’étaient partagé la péninsule ibérique, avec une profonde interaction entrecoupée de guerres. On a retenu les guerres, on a oublié l’interaction. Malgré l’expulsion cruelle des musulmans et des juifs à la fin du XVe siècle, l’Espagne est le pays européen ayant la plus forte imprégnation culturelle arabo-musulmane. Réciproquement, l’afflux des Andalous a fait du Maroc le pays sud-méditerranéen le plus familiarisé avec l’Occident chrétien.
L’Espagne fut ensuite pendant un temps la première puissance mondiale. C’est à cet empire (il est vrai accaparé au XVIe siècle par la conquête de l’Amérique) et à l’Empire ottoman (présent jusqu’en Algérie) qu’ont résisté les Marocains. La méthode était de faire bloc derrière le Sultan quand leur terre était attaquée. En outre, au XVIIe siècle, le Sultan Moulay Ismaël, l’un des premiers de l’actuelle dynastie alaouite, a réorganisé ses armées. Elles se sont acquises une réputation d’invincibilité, pour plusieurs siècles.
D’ailleurs, ce même sultan sollicita la main d’une fille de Louis XIV. Point besoin d’être géopoliticien pour deviner : la France apparaissait comme l’alliance de revers face à l’Espagne. Il y avait là une convergence d’intérêts et, aussi, le germe d’une relation élective, antérieure à l’épisode colonial. Voilà, pour le Maroc, un second lien de taille avec l’Europe8.
Les Sultans n’étaient pas des rois à l’européenne, s’appuyant sur une hiérarchie féodale et cherchant l’unification culturelle et administrative. Hormis en temps de guerre, leur rôle était limité. Le pays était localement dominé par les tribus. Le fait tribal maghrébin était contrebalancé par des facteurs d’unité tangibles (les langues, la religion, etc.). Néanmoins les conflits demeuraient nombreux, à telle enseigne que l’on opposait traditionnellement le « bled makhzen », partie du pays payant régulièrement l’impôt au Sultan, au « bled siba », partie plus rebelle et au sein de laquelle celui-ci devait guerroyer pour obtenir son tribut.
La relation au Sultan était l’allégeance. L’allégeance est un lien symboliquement majeur, concrétisé par des serments écrits. Il fait partie du corpus juridique marocain. Il garantit la solidarité face aux ennemis extérieurs mais il n’implique pas l’obéissance absolue dans tous les domaines. De là, le terme d’« empire » (et non « royaume ») chérifien qui apparaît, employé jusque dans les années 1950 pour désigner le Maroc.
Une colonisation tardive et spécifique
Journal officiel de la République française du 27 juillet 1912, Décret du 20 juillet 1912, Publication du traité de Fez, du 30 mars 1912 relatif à l’organisation du protectorat français au Maroc [en ligne].
Conversation avec Mehdi Benomar, directeur de recherches au PCNS.
Pour Pascal Ory, « la présence d’une institution de droit local, dans le cas du Maghreb français, au Maroc et en Tunisie, change complètement les données identitaires », Qu’est-ce qu’une nation ?, Gallimard, 2020, page 68.
Diplomate français, Résident général de France en Tunisie (1882 – 1886).
Avec une difficulté majeure pour la période Hassan II : le manque de cadres de haut niveau, domaine dans lequel le Maroc a énormément progressé depuis.
La première défaite alaouite d’envergure intervient en 1844, face à une France achevant sa conquête de l’Algérie. Par la force, elle interdit au Sultan de soutenir face à elle des rébellions tribales algériennes. Mais le souverain conservait de grandes capacités militaires. Paris ne se hasarda pas à conquérir le pays. Toutefois, ce dernier continua à s’affaiblir du fait d’une anarchie interne assez répandue (le Sultan devant donc lutter sur plusieurs fronts) et d’un archaïsme persistant face à une Europe en pleine ascension économique et tendant à l’impérialisme.
En 1912, lorsque l’institution monarchique fut prête à transiger sur la souveraineté, il était trop tard pour que la France puisse engager d’importants moyens militaires (bruits de bottes en Europe). Le même contexte lui interdisait de s’imposer seule au Maroc. Le Protectorat fut établi par le traité de Fès du 30 mars 19129. Un partage eut lieu avec l’Espagne, qui se voyait rétrocéder la gestion d’une partie du Protectorat et conservait par ailleurs des possessions non comprises dans le périmètre de ce dernier.
L’unité du pays était soulignée dans les textes. Mais, dans les faits, la dualité de puissances coloniales allait être une source de dissociation. Cet effet partiellement centrifuge de la colonisation est une spécificité supplémentaire du Maroc : c’est l’inverse de la dynamique fortement centripète souvent observée en Afrique subsaharienne durant la colonisation10. Ce point n’est pas mineur : si le Sahara occidental avait eu le même colonisateur que les régions situées plus au nord, aurait-on, une seconde, envisagé pour lui un futur séparé du Maroc ? Ajoutons à cela la multiplicité des statuts parmi les territoires relevant de la colonisation espagnole. Sacraliser, par principe, les frontières héritées de la colonisation est un postulat peu acceptable pour les Marocains.
En 1912, les capacités militaires du Maroc obligèrent la France au compromis, dans le cadre d’un protectorat défini comme temporaire et laissant subsister la monarchie. La préservation d’une institution nationale (comme en Tunisie avec le Bey) représentait une grande différence avec le statut juridique de l’Algérie, considérée comme une partie intégrante du territoire français11. Le Général Hubert Lyautey, militaire romantique, épris de traditions et amoureux du Maghreb, fut l’homme de la situation. Le premier résident général se voyait comme au service du Sultan. Guerroyant en son nom contre les tribus rebelles, il unifia ou « pacifia » le pays.
De son vivant, il contint autant qu’il put les abus dont la colonisation est porteuse, abus qu’il avait observés lors d’un séjour antérieur en Algérie. Comme Paul Cambon12, qui l’avait devancé en Tunisie, son obsession était de « ne pas refaire l’Algérie française ». Il n’en mit pas moins en place un appareil d’État colonial, à finalité développementaliste, certes, mais d’esprit jacobin car la France ne se refait pas.
Après l’indépendance du Maroc, cet appareil sera repris et complété, puis rapproché du modèle de l’État moderne « wébérien »13. Ce modèle ne cadrait pas avec la gouvernance chérifienne traditionnelle, extrêmement souple. C’est l’une des raisons pour lesquelles Hassan II, souverain à trempe arrivé sur le trône en 1961, fut qualifié de « tyran » par certains adversaires, une des raisons des convulsions marocaines des décennies 1960 et 1970, celles où, précisément, le drame du Sahara occidental s’est noué.
Ces convulsions reflétaient aussi l’irruption de forces nouvelles avec l’engagement citoyen des classes moyennes et bourgeoises. La lutte indépendantiste en avait été le creuset avec le « mouvement national » des années 1930, qui fonda en 1943 le premier parti politique marocain, l’Istiqlal (« indépendance » en arabe).
Cette action citoyenne a été cruciale, non seulement pour l’indépendance, mais aussi pour l’émergence d’un espace politique et d’une conscience nationale articulée au Maroc. L’Istiqlal se sépara en deux en 1959 (Istiqlal « maintenue » au centre droit, et l’Union nationale des forces populaires – UNFP, parti de gauche qui deviendra en 1975, l’Union socialiste des forces populaires – USFP). Ceci était plutôt sain : avec l’indépendance, une diversité d’options s’offrait. D’autres partis virent le jour.
La monarchie eut donc à se frotter à des forces politiques modernes. Ces dernières disposaient au départ d’unités militaires créées durant la lutte d’indépendance. Le Sultan Mohammed V, lui, était désarmé : au sein d’un Protectorat, la défense relève des puissances coloniales. L’une de ses priorités fut de créer les Forces armées royales, avec l’aide de la France. Il en confia le commandement à son fils aîné, le Prince Hassan.
Lorsque celui-ci devint roi à la mort de son père en 1961, la lutte pour le pouvoir se fit féroce. Ceci explique (sans les excuser) les graves atteintes ensuite perpétrées contre les droits de l’homme, dans un pays plutôt soucieux de tolérance et de conciliation.
En 1961, le nouveau roi choisit de conserver, marocaniser et développer l’État centralisé et développementaliste ébauché par les Français. Mais il eut l’intelligence – alors rare – de laisser s’installer le pluralisme des partis. À la fin de son règne, il restitua de la souplesse à la gouvernance par un compromis avec le mouvement national et ses exigences démocratiques. La crise politique fut surmontée en laissant progressivement un rôle aux élus pour gérer la vie quotidienne des Marocains.
D’où, à la fin du XXe siècle, l’apparition d’un jeu d’alternances à l’occasion des élections législatives : victoire des socialistes en 1998, des islamistes modérés en 2011, renvoi de ces derniers par les urnes en 2021.
De là le nouveau profil de souverain incarné par Mohammed VI, arrivé sur le trône en 1999 : un roi resté clé de voûte du système, ne le cachons pas, mais prenant part le moins possible aux querelles, à la différence de son père, souverain projeté dans la mêlée. Le roi actuel s’attache à promouvoir une « vision » de l’avenir du pays. Ce terme de « vision » (officiellement employé) vise à ajouter à la légitimité traditionnelle de la monarchie une autre qualité : le souci qu’elle montre de l’intérêt du pays à long terme.
Là est le secret de la « surprise » éprouvée par beaucoup devant l’évolution contemporaine du Maroc : le ressenti négatif devant les débuts répressifs d’Hassan II ne valait absolument pas augure pour la suite. Pays différent des autres, et déjà incompris (un peu moins en France et en Espagne).
Les frontières, question non tranchée à l’indépendance
Une Convention relative au tracé de la frontière et mettant fin aux revendications marocaines a été signée le 15 juin 1972. L’Algérie a ratifié cette convention le 17 mai 1973 et l’a publiée à son journal officiel du 15 juin de la même année. Selon l’ONU, « l’échange des instruments de ratification » est intervenu le 14 mai 1989. Le Parlement marocain ne semble pas s’être prononcé, tout au moins à cette date. Selon le Bulletin officiel du Royaume du Maroc du 1er juillet 1992, la Convention a été « rendue publique » le 22 juin de cette année-là.
Selon certains observateurs, l’Algérie aurait initialement cherché à obtenir pour elle-même, au sein du territoire, un corridor d’accès à l’Atlantique, ambition à laquelle elle aurait ensuite renoncé.
L’empire chérifien avait des confins mais point de frontières précisément tracées, une notion d’ailleurs acclimatée en Europe plus tardivement que l’on croit. Bien d’autres empires ou États avaient été dans le même cas. Que l’on songe au flou du Limes des Romains (peuple pourtant maniaque de l’organisation).
La souveraineté du Sultan était traditionnellement fondée sur l’allégeance des tribus, dont certaines étaient nomades et d’autres turbulentes. À l’indépendance, l’absence de frontières tracées allait devenir un casse-tête. Car, entretemps, cette notion s’était mondialement généralisée.
Du fait de sa prédominance au Maghreb, la colonisation française avait eu peu de raisons de pousser à la fixation de frontières entre pays : des deux côtés, le colonisateur était souvent identique. Toutefois, un tracé d’environ 120 km, partant de la Méditerranée et allant vers le sud, avait été arrêté par la France en 1845 pour distinguer l’Algérie française d’un Maroc resté alors indépendant. Ce tracé correspondait grosso modo aux anciennes lignes de séparation entre influences marocaines et turques (régence d’Alger). Il n’a guère été remis en question ensuite. Plus au sud, c’étaient en revanche les « confins algéro-marocains ».
Cette définition floue permit à la France, sous pression de son armée d’Algérie, d’agrandir le territoire contrôlé par cette dernière au détriment du Maroc. L’étendue de cet agrandissement est controversée mais son existence est indéniable. Les archives françaises sont remplies de protestations émanant de responsables politiques français devant les empiètements exigés par les militaires, empiètements contraires à l’obligation de protectorat.
En 1961, l’indépendance algérienne se profilant, Charles de Gaulle proposa à Mohammed V de résoudre les problèmes identifiés pendant que ce pays était encore sous souveraineté française. Le Maroc, solidaire de la lutte algérienne, consulta le Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) de Ferhat Abbas. En juillet 1961, un accord fut signé. La partie algérienne s’engagea à ne pas se prévaloir du tracé colonial. Mohammed V ne donna pas suite à l’offre gaullienne. Las ! Après l’indépendance et sa prise du pouvoir (1962), le FLN s’estima non lié par les engagements du GPRA (les divers engagements du GPRA, pas seulement ceux envers le Maroc).
En 1963, une brève « guerre des Sables » s’ensuivit entre les deux pays. Malgré la supériorité marocaine sur le terrain, Hassan II accepta le retour au statu quo dans les arpents de désert disputés. C’est que l’Algérie avait remporté une éclatante victoire politique. Sa diplomatie était parvenue à accréditer la thèse d’une agression contre sa jeune indépendance et, mieux encore, à gendarmer contre le Maroc le reste du monde, en particulier une Afrique subsaharienne inquiète à l’idée de rectification des frontières.
Le venin de la méfiance était instillé. Côté Maroc, sentiment d’injustice. Côté Algérie, sentiment d’insécurité, procédant d’un doute sur l’acceptation de ses frontières. Loin d’être provisoire comme le croient les Marocains, ce doute sera récurrent14. C’est l’un des ressorts du conflit. L’engagement ultérieur d’Alger dans l’affaire du Sahara occidental, territoire qu’officiellement elle ne revendique nullement15, vient en partie de cette inquiétude. Fondée ou non, elle rendait tout moyen de pression sur le Maroc désirable pour Alger.
Le patchwork des possessions espagnoles
Traité de Tordesillas, à la suite de la bulle papale Inter cætera.
Historien français né à Constantine, spécialiste du Maghreb et de la guerre d’Algérie.
« 66e anniversaire de la Révolution nationale : message du président de la République », Ambassade d’Algérie en France, 31 octobre 2020 [en ligne]. Voir, par exemple, la déclaration prononcée par le président Tebboune lors du 66e anniversaire de l’indépendance. Il évoque une « Algérie où la moindre parcelle s’est abreuvée du sang » des martyrs ».
Du côté des possessions espagnoles, la situation historique était pleine de paradoxes. Après la découverte de l’Amérique, l’Espagne n’a guère nourri d’ambitions coloniales en Afrique. Elle était absorbée par le Nouveau Monde. Un partage était intervenu avec le Portugal : à Madrid, l’ouest de l’Amérique, du cône sud au Mexique ; au Portugal, l’est, c’est-à-dire le Brésil et… l’Afrique16.
Toutefois, ce n’était là qu’une satisfaction partielle pour le Maroc car du fait de la proximité (14 km au détroit de Gibraltar), les quelques incursions espagnoles en Afrique se concentrèrent sur lui. Mais, deuxième paradoxe, sans beaucoup de plans. Pas moins de quatre situations différentes :
– les minuscules enclaves espagnoles de la côte méditerranéenne (Ceuta, Melilla et quelques îlots). Apparues dès le XVe siècle, elles subsistent encore, en plein XXIe siècle, au nom du souhait des habitants de rester espagnols ;
– une part minoritaire du « protectorat ». En 1912, la France a concédé à l’Espagne la gestion d’une partie du protectorat imposé au Maroc par le traité de Fès : Tétouan, une partie de la péninsule de Tanger, de la côte méditerranéenne et du Rif. D’où le terme de « protectorat franco‑espagnol »). En 1956, cette partie espagnole est revenue à la souveraineté marocaine dans la foulée du retrait français ;
– des possessions espagnoles vers le sud, en partie incluses dans le protectorat, en partie non incluses mais enclavées en son sein et dont l’Espagne ne consentira à se dessaisir qu’après 1956 : Bande de Tarfaya (1958), Ville d’Ifni (1969) ;
– encore plus au sud, le vaste « Sahara espagnol », conservé par Francisco Franco jusqu’en 1975.
Au sud du Sahara espagnol, se situe la Mauritanie, État créé par la France et marqué, aujourd’hui encore, par une forte empreinte culturelle marocaine. À l’ouest de cette dernière, le Mali comporte quelques régions ayant été, à certaines périodes (reculées), incluses dans l’empire chérifien.
Pour achever le tableau postcolonial, il faut signaler que l’immense Sahara central a été, pour l’essentiel, exploré par les Français. L’Algérie étant alors perçue par Paris comme destinée à rester éternellement française, c’est à ce pays qu’il a été rattaché (plutôt qu’aux colonies françaises d’Afrique de l’Ouest, par exemple). De là, l’énorme accroissement du territoire algérien, devenu sous la colonisation le plus étendu d’Afrique. Malgré le poids de son histoire, le Maroc se retrouvait avec un voisin cinq fois plus étendu que lui. Son sentiment d’injustice territoriale ne pouvait qu’être avivé, voire doublé d’une inquiétude en termes d’équilibre géopolitique.
On pourrait en déduire à l’inverse que l’Algérie était « saturée », expression employée naguère, à propos de l’Autriche, par le Chancelier Metternich (1821-1848). Mais, en 1962, elle s’est mise à voir sa situation différemment. Vers la fin de la guerre, jugeant que le FLN faisait traîner les pourparlers de paix, Charles de Gaulle avait menacé de conserver le Sahara central pour faire pression. Du coup, les dirigeants algériens ont fait du territoire un symbole, la composante d’une indépendance « chèrement payée », selon l’expression de Benjamin Stora17.
Pour saisir les orientations et la vision des dirigeants algériens, il faut décrypter le langage utilisé pour sacraliser le territoire : il invoque le sang des martyrs de la lutte d’indépendance18. Autrement dit, l’ampleur des sacrifices consentis interdit, à leurs yeux, de remettre en cause le territoire, vu comme leur fruit. Rappelons, sans vouloir être insistants, un élément qui peut nous faire saisir le point de vue algérien : si la France a étendu comme elle l’a fait le territoire de l’Algérie française, c’est qu’elle le considérait comme français « pour toujours ». Or c’est justement ce postulat quil ’a amenée à refuser si longtemps l’indépendance, privant les Algériens de droits citoyens et conduisant au bain de sang. En suivant ce fil, on discerne un lien entre l’étendue des sacrifices et celle du territoire : cette croyance initiale en une Algérie « française pour toujours ».
Replaçons-nous en 1956, année d’abolition du protectorat. À cette date, le Maroc ne dispose que d’un territoire amoindri. Ni l’Espagne, ni la France, ni le GPRA algérien de 1961 n’en sont sérieusement disconvenus. Ils ne souscrivent pas à tous les « droits » invoqués par le Maroc mais rares sont ceux qui ne lui en reconnaissent aucun.
L’indépendance par étapes
Nizar Baraka, secrétaire général de l’Istiqlal et ministre de l’Équipement et de l’Eau, m’a fait connaître ce concept. Larabi Jaïdi, Senior Fellow au PCNS, insiste sur l’importance de la problématique des frontières aux yeux des historiens marocains.
Il aurait fallu tout mettre à plat. La communauté internationale aurait pu reconnaître le problème des frontières marocaines et chercher une solution équitable. Comme l’écrit l’historien marocain Abdallah Laroui, une procédure logique eût été une conférence internationale afin de les fixer dans le cadre d’une vision géopolitique équilibrée. Mais cette méthode, pratiquée naguère, n’était plus dans l’esprit du temps.
Sur le continent africain, elle aurait fleuré les conférences coloniales d’antan, Congrès de Berlin ou autres. Pour corser le tout, la ville de Tanger était sous statut international, avec des puissances pouvant y trouver l’occasion de prolonger leurs titres. Le Maroc ne le souhaitait pas. Pas de mise à plat, donc. Voilà Rabat obligé d’improviser. Ce serait l’indépendance par étapes19. La route allait se révéler semée d’embûches.
Le Sultan pris la précaution d’énoncer les droits qu’il estimait les siens. Allal El-Fassi, leader de l’Istiqlal, publia en mars 1956 une Carte du Grand Maroc qui fit sensation. Elle englobait non seulement le Sahara espagnol mais aussi, pour faire bonne mesure, la totalité de la Mauritanie, une bonne part de d’Algérie et une partie du Mali.
Destinée à éviter le fait accompli d’un Maroc rabougri, la carte ne pouvait qu’inquiéter les pays concernés. D’où un premier écueil. Cette inquiétude viendra avant tout polluer les rapports avec l’Algérie. Mais ceux avec la Mauritanie, officiellement revendiquée par le Maroc jusqu’en 1969, n’en sortiront pas indemnes. Rabat saura établir avec elle des rapports amicaux mais sans dissiper totalement l’inquiétude de Nouakchott, l’Algérie y étant parfois vue comme un élément d’équilibre.
Le terme d’expansionnisme marocain fit florès. La carte voyait large. Même au sein de l’Istiqlal, beaucoup estiment a posteriori qu’elle a été trop extensive. Pour être juste, il y avait un dilemme : si elle l’avait été insuffisamment, cela aurait signé la renonciation aux territoires non englobés. Bref, pas de bonne solution, un choix entre des écueils. Le Maroc resta serein, convaincu de son bon droit. Or le droit, en ces temps-là, était mouvant.
Chapitre II. Les « trois âges » du droit international
Pour éviter de nombreuses répétitions, ce rapport emploie l’expression « droit international » pour désigner le droit international public. Le droit international privé obéit, quant à lui, à une logique différente. De même, il nous arrive de dire Sahara pour désigner le Sahara occidental lorsque le contexte est clair.
Raymond Aron avait laissé paraître un certain scepticisme à propos du droit international. La nuance que nous exprimons en sens inverse est inspirée d’une conversation avec Gilles Andréani, ancien chef du Centre d’analyse et de prévision du Quai d’Orsay et lui-même grand connaisseur de la pensée d’Aron.
Le droit international public20 n’est pas un droit comme les autres : il dépend de l’accord des États, ces sujets que, précisément, il est censé contraindre. De là sa faiblesse et son application inégale.
Elle conduit certains auteurs à douter de sa réalité. Ceci est excessif : il existe bel et bien des obligations internationales, avec un effet stabilisateur et une réciprocité incitant les acteurs à s’y conformer21. Simplement, il faut rester lucide sur la nature de ces obligations et revenir inlassablement à l’essentiel : l’intention à la base de chaque disposition. Ce sera notre fil d’Ariane.
Pour aider à cerner l’évolution du droit international à travers les siècles, nous en proposons une lecture stylisée. Elle schématise volontairement sa teneur en se focalisant sur le trait principal de chaque époque.
Le sacre de la souveraineté (1648-1945)
Les traités de Westphalie, conclus en 1648, mirent fin à la guerre de Trente Ans et consacrèrent l’affirmation de la souveraineté étatique. Ils constituent ainsi une étape fondatrice dans l’évolution du droit international public et du principe de non-ingérence.
Comme l’écrit Pierre Manent, philosophe et président de l’association des amis de Raymond Aron, la notion de « forme politique » est un apport essentiel de la science politique. Elle permet un classement des différents types d’organisation politique (Cours familier de philosophie politique, Collection Tel, Éditions Gallimard, Paris, 2001).
Le principe uti possidetis juris impose aux nouveaux États de conserver les frontières héritées de la puissance coloniale au moment de leur indépendance, afin d’éviter les contestations territoriales. Traduction en français : «Vous posséderez ce que vous possédiez déjà».
À partir des traités de Westphalie (1648)22, le droit international a pris forme, avec comme priorité : conforter la souveraineté des États. Ces derniers sont devenus progressivement la forme politique principale, au détriment des cités, des tribus et des empires23. La souveraineté étatique moderne a besoin de périmètres précis. Ceci a favorisé la notion de frontières.
Dans la plupart des pays, la séquence était, d’abord l’affirmation d’une souveraineté de facto au moyen de la puissance politique et militaire, et, ensuite seulement, une éventuelle consécration par traité. Autrement dit, la majorité des frontières, de la plupart des pays du monde a été le fruit de rapports de force, avec une importante composante militaire.
Ce point mérite d’être rappelé à ceux qui, supposant que le Maroc n’avait pas de droits au Sahara espagnol, en déduisent qu’il aurait donc scandaleusement abusé de la force.
Partons, un instant de raison, de leur présupposé (que nous ne partageons pas) sur l’absence de droits. Dans cette hypothèse, ce qu’aurait alors fait le Maroc est ce qu’ont fait beaucoup de pays dans le monde, c’est-à-dire se tailler un territoire au moyen de rapports de forces. La critique au regard du droit actuel se plaide mais, de là à l’exprimer en termes grandiloquents, il existe un pas.
De plus, le Maroc a opéré dans un territoire quasiment vide d’hommes. Le présenter comme ayant, en quelque sorte, tué père et mère est un discours pouvant être tenu hors sol, dans telle ou telle enceinte échauffée par l’idéologie. Auprès de la France et de l’Espagne, pays familiers du Maroc, ce type d’outrance passe mal.
Pour en revenir au droit international, dès ce premier âge de son histoire, il commence à privilégier le titre du dernier possédant (Uti possidetis juris 24). De ce fait, les droits dits « historiques », c’est-à-dire fondés sur l’invocation d’une souveraineté passée, sont relativisés. Ils ne sont pas pour autant complètement écartés : parfois, les États momentanément obligés de céder à la force revendiquaient de tels droits (« c’était à nous avant »). Ils se réservaient la possibilité de revenir à la charge, au besoin par la force. Politiquement, les droits historiques restaient souvent acceptés.
La priorité à la stabilité et interdiction des annexions (1945 à nos jours)
Après les catastrophes des deux guerres mondiales, l’impératif de stabilisation des frontières a primé. C’était le mot d’ordre (naturel) des vainqueurs. Cela deviendra la loi internationale, d’autant plus que les deux camps rivaux de la guerre froide, l’Alliance atlantique et le bloc soviétique, partageaient ce but.
D’où, en 1945, la Charte de l’ONU, qui établit des dispositions de maintien et de rétablissement de la paix. Le recours à la force a été interdit, sauf légitime défense, de même que les annexions. De fait, ces dernières se sont raréfiées (sans complètement disparaître). La conséquence était, cette fois, de tourner vraiment le dos à la notion de droits historiques, vus comme une source d’activation des conflits. La priorité irait à la reconnaissance des situations acquises et stables dans le présent.
C’était épineux pour le Maroc. Toutefois, il pouvait plaider l’exception : ses frontières n’avaient pas été stabilisées (ce qui était reconnu). Par conséquent, ses droits historiques conservaient du sens. De plus la colonisation en avait entravé l’exercice. Il pouvait escompter le secours d’un troisième droit en train de naître, celui de la décolonisation. Hélas, son contenu cadrera peu avec les spécificités marocaines.
L’autodétermination comme levier de décolonisation
Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, Résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies adoptée le 14 décembre 1960, Nations unies [en ligne].
Annuaire français de Droit international, cité en bibliographie.
Accessoirement, elle permettait de traiter les cas où ce consentement était vérifié (exemple : les DOM français).
Nations unies, Résolution 2625 (XXV) de l’Assemblée générale des Nations unies, intitulée Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations unies ; 24 octobre 1970 [en ligne].
Ces termes sont les suivants : « mettre fin rapidement au colonialisme en tenant dûment compte de la volonté librement exprimée des peuples intéressés. ».
Policy Paper, L’intangibilité des frontières africaines à l’épreuve des réalités contemporaines, PCNS, 2018, op. cit.
Un autre souci était d’éviter tout démembrement initié par le colonisateur.
Des doutes existent sur la validité de l’intangibilité comme concept juridique. En Afrique, beaucoup de frontières étaient imprécises. Peut-on figer ce que l’on ignore ? Et interdire aux générations suivantes d’y toucher ?
C’est ainsi que la sécession de l’Érythrée par rapport à l’Éthiopie (1993), puis celle du Soudan du Sud par rapport au Soudan (2011) ont été acceptées.
Même en Algérie, la Régence d’Alger a été unifiée par les Turcs plusieurs siècles avant la colonisation.
Loulichki, op. cit.
Après l’entrée de pays en développement à l’ONU dans les années 1950, l’appel à l’indépendance des colonies est devenu irrésistible. Un droit propre à la décolonisation a pris forme.
Ce droit devait compter avec le principe du dernier possédant (Uti possidetis juris). Ce principe pouvait servir à perpétuer la domination coloniale. Mais revenir sur ce principe « facteur de paix » était impossible. Pas question de réformer en ce sens le droit international « général ». C’est pourquoi le droit de la décolonisation allait créer un cadre ad hoc.
Dilemmes de la décolonisation et autodétermination
Quel contenu pour ce cadre spécial ? On aurait pu imaginer une mise en avant des droits historiques, avec le cas des États préexistants à la colonisation : Inde, Égypte, Éthiopie, Tunisie, Maroc, etc. Mais, en 1960, ces pays étaient déjà indépendants. Les esprits étaient tournés vers les pays restant à décoloniser.
Dans leur cas, reconnaître des droits passés semblait peu pertinent. Quid de la forme étatique généralement absente avant la colonisation, comme souvent en Afrique subsaharienne ? De nouveaux coups furent donc portés à la notion de droits historiques, au profit d’une idée progressiste : l’autodétermination.
En soi, cette notion n’était pas nouvelle. Elle est apparue dans la philosophie politique dès le XVIIIe siècle, avec Emmanuel Kant. Sa signification originelle : le droit de tout sujet, individuel ou collectif, à se déterminer de manière autonome et libre. Elle a commencé à poindre sur le plan international au XIXe siècle avec l’apparition, heureuse, de la notion de « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ».
Toutefois, il s’agissait d’un principe très général. Il allait être concilié avec d’autres notions, notamment l’intégrité territoriale, indispensable à la stabilité des États. Autrement dit, le droit international général n’a pas consacré le droit de toute population à se séparer d’un État. Un débat préalable est requis : quelle est la densité de sa revendication nationale et quel est le niveau pertinent pour l’exercice de la souveraineté ? Sans cette maîtrise, le principe aurait été déstabilisateur, contraire à la finalité du droit international.
Tout l’enjeu est là : concilier droit à l’autodétermination des populations et besoin d’intégrité territoriale des États. Ce dernier s’inscrit dans une nécessité géopolitique : disposer d’États viables, capables de s’épanouir au plan international, idéalement avec un équilibre entre eux.
Il serait hypocrite de gommer cette nécessité au nom de la démocratie : l’intérêt des populations n’est pas de favoriser systématiquement les petites unités par rapport aux grandes. Il existe des avantages substantiels à appartenir à un État d’une certaine taille : sa viabilité, les opportunités offertes par un espace plus vaste, le poids à l’extérieur, etc. Pour justifier la sécession, les vœux ne suffisent pas, il faut un débat contradictoire.
Offrir matière à débat n’affaiblit pas un principe, loin de là. Dès le XIXe siècle, des nations dotées d’une identité manifeste se sont affranchies des empires multinationaux (Grèce face à la Turquie, Italie face à l’Autriche). Avec l’entrée en scène des opinions publiques et des intellectuels (comme Lord Byron), droit des peuples et principe des nationalités ont pu peser de façon irrésistible. Seulement, cette revendication était très étayée. À partir de 1960, une évolution s’est manifestée : à l’égard du colonisateur, une telle exigence n’apparaissait plus indispensable.
L’autodétermination, entre principe et automatismes
Le 14 décembre 1960, l’Assemblée générale de l’ONU adoptait une résolution qui devait servir de socle au droit de la décolonisation : la fameuse « 1514 » sur l’ « indépendance des peuples colonisés »25.
En principe, l’AG n’a pas le pouvoir d’édicter des normes obligatoires. Certains juristes estiment qu’elle avait outrepassé sa compétence. La portée juridique de la « 1514 » pourrait donc être contestée. Toutefois, nous ne préconisons pas cette lecture. L’autodétermination représente un progrès et la décolonisation a été reconnue comme une compétence de l’AG. Pour ces raisons, la communauté internationale a validé la résolution, progressivement mais clairement. Telle est la démonstration apportée par Michel Virally26. En revanche, ce processus signifie qu’elle doit être perçue comme un principe (essentiel) et non comme une règle à suivre aveuglément : son champ d’application et ses modalités peuvent légitimement être débattus.
En simplifiant à l’extrême, la résolution allait accoucher d’un mécanisme en deux temps : tout d’abord, les territoires coloniaux sont identifiés en tant que tels et inscrits sur la liste des territoires non autonomes prévue par la Charte ; ensuite, ces territoires sortent de la liste lorsque l’AG, sur proposition du comité de la décolonisation, constate qu’ils ont exercé leur droit à l’autodétermination.
La consécration du principe permettait de traiter deux problèmes.
Le premier était le risque de voir le « droit du dernier possédant » invoqué par le colonisateur. L’autodétermination déminait cet obstacle. Autre souci : les colonisateurs se prévalaient d’un consentement des populations, affirmation invérifiable. L’autodétermination réglait élégamment ce problème en prenant les puissances coloniales au mot27.
Le lendemain même du vote de la résolution 1514, l’AG adoptait une autre résolution, la 1541, en date du 15 décembre. Elle précise que la décolonisation d’un territoire pouvait revêtir différentes formes, pas seulement l’indépendance. L’intégration à un État indépendant en fait partie. Ceci autorise à voir dans la réunion du Sahara occidental au Maroc une décolonisation et offre un espace aux droits historiques. De plus, l’AG a ultérieurement éprouvé le besoin de revenir sur les thèmes évoqués en 1960. La résolution 2625 du 24 octobre 197028 a mis l’accent sur l’intégrité territoriale. Elle a souligné la valeur de l’autodétermination mais l’a défendue en termes nuancés, éloignés de tout automatisme29.
Néanmoins, la procédure spéciale a vécu sa propre vie. Le comité de la décolonisation a fait de l’autodétermination une règle, dont la vérification dépendait de lui-même. Il est à noter qu’une question aurait dû être posée, qui ne l’a guère été : le droit à l’autodétermination prévu contre le colonisateur pour les motifs que l’on a vus pourrait-il être invoqué exactement de la même façon à l’encontre d’un pays « victime » de la colonisation ? Était-ce vraiment là l’intention initiale des auteurs de la norme ? Question cruciale.
L’intangibilité des frontières, tabou utile et règle discutable
Un « ovni » juridique a atterri, en 1963, sur le continent africain : la notion d’intangibilité des frontières héritées de la colonisation. L’intangibilité signifie interdiction de toucher, donc de modifier, même par la négociation et l’accord. Autrement dit, elle va jusqu’à interdire de discuter d’éventuelles rectifications. Alors que négocier est l’essence même du droit international, la possibilité en est exclue.
Cette étrange notion n’a été introduite que sur le continent africain. Comme l’a montré Mohammed Loulichki, la stabilité n’exige pas un tel corset. Elle requiert seulement l’inviolabilité, interdiction de modifier les frontières par la force, une notion de droit international éprouvée30.
Lorsque l’Amérique latine a accompli sa décolonisation début XIXe siècle, souligne Loulichki, c’est l’inviolabilité des frontières qu’elle a proclamée. En 1945, la même notion a été consacrée par la Charte de l’ONU31. Pourquoi, l’OUA a-t-elle opté pour une notion drastique, fermant la porte à toute négociation ?
Un impératif se présentait : consolider les jeunes États d’Afrique subsaharienne. Les leaders de l’indépendance avaient choisi comme socles les États coloniaux. Ces derniers étaient parfois des créations artificielles, surplombant des réalités tribales encore très prégnantes. Une déstabilisation des jeunes États aurait aggravé les difficultés déjà grandes de l’Afrique.
Figer les frontières était un moyen de sertir les États dans un périmètre intouchable. L’intangibilité a été introduite en 1964, par amendement à la Charte de l’OUA. Elle n’est pas indispensable à la protection juridique des États contre les atteintes extérieures. L’inviolabilité suffit. L’intangibilité permet de combattre les pulsions centrifuges32. Au nom de cette nécessité politique, elle a sévèrement encadré l’expression des populations. C’est pour cette raison que nous employons le mot « tabou », plutôt que « principe », terme supposant une justification intrinsèque : l’intangibilité n’est pas une notion juste. C’est un interdit jugé nécessaire33.
Son adoption avait suscité d’âpres débats. Un groupe de pays milita en sa faveur, le groupe de Monrovia. Un autre milita en sens inverse : le groupe de Casablanca. Ce dernier comprenait au départ le Maroc, le lecteur s’en doute, et la Tunisie, il peut le deviner car elle avait subi aussi quelques grignotages. Mais il incluait un autre pays : c’était l’Algérie. Néanmoins, l’intangibilité s’est rapidement imposée après la création de l’OUA. Sur la durée, elle remplira son office : une solidarité constante s’est exercée en faveur des États subsahariens menacés de scission ou d’annexion. Ensuite, le tabou finira par être relâché34.
En l’absence de justification par la « justice », l’intangibilité ne peut être acceptée que si elle répond à une nécessité impérieuse. Cette nécessité n’existe absolument pas en Afrique du Nord. L’existence de grandes entités y était bien établie (Égypte : plusieurs millénaires, Maroc et Tunisie : de l’ordre du millénaire, Algérie : plusieurs siècles grâce à la régence d’Alger)35. Ce n’est pas un hasard si le Maroc, la Tunisie et l’Algérie se sont initialement retrouvés ensemble parmi les pays défavorables à l’intangibilité.
Le Maroc aspirait évidemment à des regroupements par rapport aux frontières du protectorat. À ses yeux, l’intangibilité revenait à « acquiescer aux conséquences des injustices coloniales »36. Il a exprimé une réserve lorsque cette notion a été ajoutée à la Charte de l’OUA. Cette dernière n’ayant pas de pouvoir normatif sur ses membres, elle ne peut être juridiquement opposée à Rabat. Si l’on admet ce point, un pan des critiques juridiques contre le Maroc s’effondre. C’est le pan le moins sérieux, convenons-en. Néanmoins, son inanité (dans le cas précis du Sahara occidental) ne l’a pas empêché de peser (sur ce même dossier). Beaucoup ont longtemps cru à un manquement marocain sur ce chapitre. Leur jugement sur les autres points de droit a été affecté.
L’intangibilité a eu un énorme impact politique en Afrique : nombre d’États subsahariens la ressentaient comme vitale. L’Algérie, bénéficiaire d’acquisitions territoriales sous la colonisation, s’est ralliée à cette notion et l’a brandie auprès des Subsahariens. Ceci ne fut pas étranger à son triomphe politique dans la « guerre des Sables ». Dans le conflit du Sahara occidental, l’intangibilité a été invoquée pour charger la barque des manquements reprochés au Maroc. Elle a contribué à l’admission de la RASD au sein de l’OUA, organisation pourtant censée n’admettre que des États. Ailleurs (ONU, CIJ, autres continents), la notion d’intangibilité n’a guère été reprise.
Philosophiquement, intangibilité et autodétermination sont antinomiques. La première cantonne la seconde : elle interdit aux populations séparées en deux ou coupées de leurs racines, de réclamer. Ceci invite à la sobriété dans les postures. Brandir l’autodétermination de manière aveugle est discutable, le faire tout en glorifiant l’intangibilité l’est encore plus.
Au pied de la lettre, l’intangibilité limite l’autodétermination à une seule possibilité : réclamer le départ du colonisateur dans le cadre territorial fixé par ce dernier. C’est pourquoi le référendum a semblé adéquat, malgré ses limites. On a fini par oublier une autre voie : les élections pluralistes et la délibération d’instances électives. Elles sont plus fécondes pour la démocratie, prouvées par l’Inde et l’Afrique du Sud.
Les élections supposent le pluralisme, la mise en place d’institutions, la protection des libertés, une culture civique, bref, jeter les bases de la démocratie. Le référendum dispense de cela. Il est adapté à une problématique simple telle que la cessation de la dépendance coloniale. Il est source de mécomptes pour trancher des questions complexes qu’il oblige l’électeur à trancher sans maîtriser toutes les cartes. Comme l’écrivait l’historien britannique Lord Acton, le référendum « sépare la décision de la délibération ». Il est moins fidèle qu’on ne croit à la promesse démocratique.
Sur le plan géopolitique, la coexistence des notions d’autodétermination et d’intangibilité est riche d’enseignements. D’un côté, le droit à l’autodétermination est proclamé. De l’autre, l’intangibilité introduit un garde-fou. Ce n’est pas un hasard. Cela confirme que l’autodétermination est rarement un droit absolu, même dans le cas des décolonisations subsahariennes. Elle doit s’inscrire dans un raisonnement équilibré.
Le fait qu’elle soit invoquée à l’encontre du Maroc sans bémols ni nuances, constitue une sorte d’exception. Tout se passe comme si, du fait de son caractère atypique, le dossier du Sahara occidental se trouvait dans un angle mort du droit international.
Chapitre III. Évaluer la marche verte
L’affirmation de souveraineté au Sahara est souvent présentée comme ayant débuté avec la « Marche verte ». C’est un raccourci. D’abord elle s’inscrit dans la problématique générale des frontières du Maroc (enclaves espagnoles, contentieux frontalier avec l’Algérie, etc.). Ensuite, elle a ses propres antécédents.
La « préhistoire » de la Marche verte
Fait relaté par la Revue des Deux-Monde en 1960 et corroboré par Gilbert Meynier dans l’ouvrage Histoire intérieure du FLN (ce dernier a, en effet, dû affronter des mesures de rétorsions de Madrid). Le contexte (solidarité marocaine envers l’Algérie et liens étroits entre armées de libération) rendait la participation du FLN assez naturelle.
Abdallah Laroui cite à ce propos la République de Chine et le Vietnam du Nord.
Je dois remercier Fathallah Oulalou, économiste et ancien ministre USFP des Finances, pour le partage inestimable de son expérience. Il avait été, entre autres, le professeur d’El Ouali à la faculté de Rabat.
Driss Benhima m’a, entre autres, initié à cette littérature.
Op. cit. L’auteure est Sophie Caratini. L’ouvrage m’a été signalé par Mohamed Brick.
Problématique étudiée dans l’ouvrage de Pascal Ory déjà cité : Qu’est-ce qu’une nation ?
Georges Pompidou les rétablira après son élection en 1969.
Le Sahara occidental se situe dans une vaste région d’imprégnation marocaine qui va du nord du Maroc à la Mauritanie (incluse). Cette imprégnation s’observe à travers les objets de la vie quotidienne, les pratiques de déplacement et la prière accomplie en tout lieu, au nom du Sultan, seul souverain musulman d’une région où le Califat ottoman n’a pas pénétré.
Le Sultan recueillait auprès des tribus des serments d’allégeance. Selon l’historien marocain Abdallah Laroui, c’est à cela qu’il mesurait sa souveraineté, tout en sachant qu’elle était inégalement effective. L’affaiblissement du Maroc au XIXe et l’interposition de l’Espagne, au XXe siècle, dans la relation avec les tribus sahraouies sont des facteurs ayant distendu les liens.
À l’indépendance, Mohammed V a réaffirmé « ses droits ». En même temps, il se refusait à faire la guerre à l’Espagne (comme à la France). Sur le moment, l’Istiqlal n’avait pas la même ligne. Or ce parti disposait d’une armée, l’armée de libération. En 1957 et 1958, celle-ci est parvenue à bousculer les Espagnols et à prendre le contrôle d’une grande partie du Sahara occidental. Détail piquant : des unités du FLN algérien ont pris part à ces opérations militaires visant la réunion au Maroc37.
Emportée par son élan (et peut-être grisée par son succès), l’armée de libération a commis l’erreur de s’attaquer à la Mauritanie, alors colonie française. Paris disposait de sa puissante armée d’Algérie et décida de réagir. Ce fut l’opération Écouvillon, alliance ponctuelle et couronnée de succès avec Madrid. L’armée régulière marocaine, quant à elle, resta neutre, sur ordre du Sultan.
La tentative a au moins permis d’obtenir, plus au nord, la restitution de la bande de Tarfaya, l’Espagne se montrant sensible à l’élégance de Mohammed V. Après son décès, en février 1961, le dossier sera dominé par la prudence du jeune roi Hassan II, aux prises avec des dissensions, à l’intérieur, et des incertitudes juridiques, à l’extérieur. Comparé au mouvement national, formé de militants enclins à prendre des risques, il était plus circonspect : son trône et sa dynastie étaient en jeu.
Entretemps, la « guerre des Sables » (1963) a écarté l’espoir de rectifications avec l’Algérie. Parallèlement, revendiquer la Mauritanie s’est avéré irréaliste sous plusieurs facteurs : écran formé par le Sahara espagnol entre ce pays et le Maroc, opiniâtreté du premier président mauritanien, Ould Dada, attaché à un État indépendant, soutien de la France à ce projet. Ce n’est qu’en 1969 que le Maroc renoncera officiellement à la revendiquer. Toutefois, il n’attendit pas cette date pour comprendre qu’il ne lui resterait guère que le Sahara occidental pour corriger les injustices territoriales dont il s’estimait victime.
En 1963, Hassan II décida de saisir l’ONU sur la base de la résolution 1514 pour réclamer l’inscription du Sahara occidental (et de l’enclave espagnole d’Ifni) sur la liste des fameux TNA, où il figure encore aujourd’hui. Cette saisine donnait la main à l’ONU, ce que d’autres pays confrontés à des contentieux territoriaux se sont gardés de faire38. Certains Marocains se demandent aujourd’hui si cette décision fut judicieuse. Malgré tout, cela permit une seconde récupération de territoire : la ville d’Ifni en 1969. Telles sont les servitudes de « l’indépendance par étapes » : elle exige des compromis que l’on peut vous opposer après. L’intransigeance n’a pas cet inconvénient.
Au Sahara, le Général Franco fit de la résistance. Son occupation était pour l’Espagne un moyen de sécuriser les îles Canaries, qu’elle possédait juste en face. Plus grave (pour le Maroc), Madrid caressait, pour le territoire, l’espoir d’une indépendance séparée du Maroc, au profit d’un État qu’elle conserverait sous son influence. Avec l’Algérie, les relations traversaient des hauts et des bas : des déclarations algériennes favorables à la cause marocaine au Sahara occidental, mais aussi des pressions de ce pays sur l’Espagne pour qu’elle organise un référendum avant son départ (ce à quoi Franco semble s’être engagé).
Toute cela favorisa une effervescence locale. Au début des années 1970, un Sahraoui effectuant ses études à Rabat, un certain El Ouali demanda aux partis nationalistes marocains des armes pour « libérer » le Sahara occidental (le réunir au Maroc). Il fut éconduit par ses interlocuteurs pour qui, désormais, cela relevait de l’État. Le Maroc venait de connaître un premier et sanglant coup d’État (Skhirat, 1970). El Ouali ne put accéder à des contacts officiels. Il organisa en 1972 une manifestation à Tan-Tan, ville marocaine proche de la ligne de démarcation espagnole. Elle fut réprimée par le général Oufkir, encore ministre de l’Intérieur, et c’est alors que l’histoire bifurqua39.
Les Sahraouis
Le leader qui se voyait comme un Marocain mais que Rabat venait de s’aliéner appartenait à l’un des groupes de tribus les plus guerriers de tout le Sahara, les Reguibets. De nombreux écrivains français ont évoqué ces valeureux nomades40. Parmi eux, Le Clézio marié à une Sahraouie et prix Nobel de littérature.
Ce groupe nomadise dans une vaste zone incluant l’est du Sahara occidental, le sud du Maroc dans ses frontières de 1956, l’Algérie, la Mauritanie et le Mali, souvent à distance relative de la mer. Il s’agit de tribus chamelières (mieux équipées pour le combat que les tribus dont les troupeaux comprennent une majorité de chèvres et moutons). Elles accomplissent des déplacements et razzias permettant de se rapprocher du littoral quand les pluies font surgir d’éphémères pâturages pour les bêtes. On prête à ce groupe de tribus une positions fréquente de domination sur les autres groupes tribaux de la région. Il allait être le fer de lance du Polisario.
Au nord-ouest du Sahara occidental, plus près de la mer, se trouve un autre groupe de tribus, les Teknas, de tempérament souvent présenté comme plus paisible, vivant et nomadisant à cheval sur l’ancienne ligne de démarcation Sahara espagnol-Maroc. Plus au sud, mais également près de la mer, un troisième groupe : les Ouled Delim.
Le conflit a précipité ces trois groupes de tribus dans un drame : la sédentarisation brutale d’êtres humains vivant dans la mobilité. Celle-ci est un univers d’existence : on vit au rythme des éléments, on suit les bêtes autant qu’on les précède. C’est un imaginaire : les ancêtres, la culture orale, le prochain départ. Le groupe est tout, avec ses chants, ses chefs. La propriété privée n’existe pas.
Tout cela a été interrompu avec la guérilla opposant le Polisario aux Forces armées royales. Le premier a conduit une partie des populations vers des camps, ceux de Tindouf en Algérie. Les autorités marocaines ont regroupé une autre partie dans les villes sous leur contrôle.
Cette sédentarisation brutale est un drame incontestable. Il en est rarement question. Ce drame humain bien réel est occulté, dans l’esprit d’une partie de l’opinion internationale, par le drame que serait l’absence d’État indépendant, drame plus abstrait. Cet État aurait uni les différents groupes de tribus qui se croisaient dans ce vaste espace. Mais ces groupes se sont-ils vraiment agrégés, fondus dans une nation ?
Une anthropologue française sympathisante du Polisario a relaté les débuts de cette organisation dans un livre poétiquement intitulé « La République des Sables »41. À le lire, on découvre l’appel d’air exercé par la résolution de l’ONU sur l’autodétermination. Une assemblée de tribus a été convoquée. Selon son récit, les participants se sont vu exposer les perspectives qui s’ouvriraient à eux s’ils renonçaient à être des tribus pour se proclamer peuple : un État, un siège à l’ONU, des richesses. Ils furent invités à oublier du jour au lendemain leurs origines (appartenances tribales en particulier) afin de se qualifier pour l’autodétermination.
À chacun de méditer sur l’épisode. On peut y voir, soit un saut dans la modernité politique légitimant un État, soit un acte artificiel, masquant la réalité tribale. Les historiens ayant travaillé sur les nations dans le monde ont généralement décrit leur façonnement comme un processus et non une rupture soudaine42.
Le rendez-vous des histoires
Peu après sa création, le Front Polisario obtint des soutiens extérieurs, d’abord la lointaine et turbulente Libye de Mouammar Kadhafi, ensuite l’Algérie. C’est là que les deux histoires, celle des rapports entre grands du Maghreb et celle du conflit, ont rendez-vous. L’Algérie, on l’a compris, n’a pas créé le conflit de toutes pièces, ce serait une méprise de le croire. Mais son soutien au Polisario a été massif, au point de devenir déterminant.
Le Polisario en est devenu dépendant, notamment financièrement. Elle a acquis un fort ascendant sur lui.
Ceci autorise à lire ensuite le conflit comme une affaire maroco-algérienne, tributaire des rapports entre les deux pays. Alger récuse parfois cette lecture mais insiste sur son rôle de « tierce partie intéressée au conflit » et fait de son « règlement » un préalable au rapprochement entre les deux pays.
À ce conflit entre pays voisins, il faut ajouter l’effet initial de querelles internes au Maroc. Quelques éléments de la gauche marocaine se sont installés à Alger après l’avènement d’Hassan II. Lors de la « guerre des Sables », certains d’entre eux n’ont pas hésité à prendre le parti de l’Algérie, auréolée d’une image révolutionnaire. L’affaire Ben Barka, opposant marocain, enlevé à Paris, puis mort sous la torture par les œuvres d’Oufkir et ses séides en octobre 1965 a attisé les haines. Il semble que des éléments de la « gauche » marocaine aient présenté le Polisario aux Libyens, puis aux Algériens, pour affaiblir Hassan II.
Ceci nous signale une clé majeure : le rôle des dissensions maroco‑marocaines dans le déclenchement du conflit. C’est une clé méconnue : aucun pays n’aime évoquer ses tensions internes. Toutefois, en glissant sur cet aspect, le narratif marocain se prive d’un éclairage plutôt favorable à ses thèses. Il donne au conflit une cause nationale, à base idéologique. Cela ne va pas dans le sens d’une affaire « internationale », opposant « Marocains » et « Sahraouis », mais plutôt d’un conflit interne instrumentalisé de l’extérieur.
Le Pont d’Arcole d’Hassan II
Au début des années 1970, le dossier du Sahara occidental commence à prendre, pour Rabat, une tournure préoccupante. La communauté internationale montre de l’indifférence aux méthodes pacifiques privilégiées jusque-là par le Maroc. La guerre du Vietnam s’achève par la victoire complète du Nord et du FNL sud-vietnamien, en 1975, justement. Après le succès politique du FLN algérien face à la France, ce succès militaire face aux États‑Unis et à leurs alliés marque un triomphe des fronts de libération face aux puissances occidentales. Et, en Occident, une partie de l’opinion a pour ces mouvements armés les yeux de Chimène.
Les options pacifiques du Maroc étaient regardées avec dédain par cette fraction de l’opinion, comme si elles confirmaient l’archaïsme du régime. Belle erreur d’appréciation. Toutefois, l’Espagne et la France ne pouvaient y succomber complètement. Dans leur tréfonds, elles savaient ce qu’elles devaient à ces options : la valeur irremplaçable des vies sauvées et celle, inestimable, des amitiés sauvegardées.
C’est là qu’était pour le Maroc un espoir de recours face au mur d’incompréhension qu’il allait rencontrer. Contrairement à une idée répandue, la France et l’Espagne n’ont pas écouté le Maroc simplement par amitié. Sur un sujet majeur, une puissance n’obéit pas aux sentiments. En revanche, quand un ami est victime de ce que vous admettez vous‑même être une injustice, votre sens de l’honneur est touché.
Hassan II a cultivé avec une extrême détermination l’amitié des deux ex-puissances coloniales du Maroc. Avec l’Espagne, le jeu fut longtemps parasité par les calculs locaux de ce pays contre le Maroc et les liens du Polisario avec une partie de la société civile espagnole. Avec la France, initialement, c’était pire : le roi avait sa part dans les difficultés.
L’affaire Ben Barka avait été un meurtre, un affront à la souveraineté française et, comme si cela ne suffisait pas, un scandale politique déclenché en octobre 1965, en pleine campagne présidentielle. Outragé au dernier degré, le général de Gaulle alla jusqu’à rompre les relations diplomatiques avec le Maroc. Il ne les rétablira pas de son vivant à l’Élysée43.
L’affaire Ben Barka eut des effets comparables à ceux de la déposition du Sultan, mais à l’envers. Après son énorme bévue de 1953, la France s’était évertuée à réparer ses relations avec la monarchie marocaine. De même, Hassan II en fit beaucoup, entre 1965 et 1975, pour revenir dans l’entente avec les autorités françaises. Étrange particularité de la relation entre les deux pays que ce rôle des crises. Il est vrai que la rupture officielle n’avait pas effacé l’exceptionnelle densité des relations humaines entre les deux pays.
À l’approche de 1975, année de la Marche verte, l’amitié franco-marocaine est au zénith. Ce n’est pas la seule amitié occidentale du Maroc, heureusement pour lui, mais la plus solide. L’horizon est chargé de nuages. Après les deux tentatives de coups d’État (1970 et 1972), l’opposition démocratique intérieure se refuse à négocier avec Hassan II. L’Espagne et l’Algérie, chacune à son rêve mais se croyant les mêmes intérêts, songent à un Sahara occidental indépendant et proche d’elles. Un redoutable groupe de tribus prend le chemin de la Siba, cette rébellion contre le Sultan qui scande l’histoire du Maroc.
Quant aux instances internationales, elles s’ébaudissent d’elles-mêmes après avoir découvert la pierre philosophale de l’autodétermination. Pas question que la grand-messe tiers-mondiste soit perturbée par les singularités marocaines. De nombreuses conditions sont donc réunies pour forger, au Sahara occidental, un destin d’État indépendant, condamnant le Maroc à un territoire rabougri ad vitam.
Il restait le recours à la force, en l’occurrence contre l’Espagne, puissance occupante du Sahara occidental. Mais avec trois inconvénients pour le Maroc. Le premier était de perdre une partie du mérite moral de ses choix pacifistes. Mais, après tout, comme on ne l’en créditait guère… Le second était plus ennuyeux : un coup sérieux à l’amitié espagnole. Mais avec la puissance coloniale, difficile à éviter, décolonisation oblige. Le troisième inconvénient était autrement redoutable : c’étaient les prérogatives de l’ONU et du Conseil de sécurité en matière de maintien et de rétablissement de la paix. Elles permettaient à ce dernier de mandater une force militaire pour faire évacuer les Forces armées royales.
Divisé, incompris, coupé de l’Afrique, ciblé par les adeptes de la révolution internationale, le Maroc pouvait-il se payer un tel luxe ? Peut-être pouvait-il jouer sur ses amitiés mais jusqu’où tirer sur la corde ? Les lointains États‑Unis indiquèrent leur opposition à une action unilatérale du Maroc dans un courrier officiel adressé au roi en septembre 1975 par le secrétaire d’État Henry Kissinger.
La corde française se révéla plus solide. Toutefois, Paris ne pouvait ruiner sa crédibilité en apparaissant comme un corsaire du droit international. Le Maroc possède cette vertu méditerranéenne : ne pas mettre ses alliés en difficulté. Il allait intégrer les contraintes françaises à son raisonnement.
Pour le reste, le roi se trouvait, politiquement et juridiquement, dans une situation que l’on pourrait comparer à celle, militaire, de Napoléon à Arcole : avoir à franchir un pont étroit, sur lequel les armes ennemies sont braquées.
La portée de la Marche verte
Expression de Yahia Zoubir. 25.000 soldats marocains avaient pénétré le territoire fin octobre.
Daniel Calleja-Crespo, directeur du service juridique de la Commission européenne, a vécu les évènements comme étudiant espagnol. Ce bref récit lui doit beaucoup.
Entretien avec l’auteur.
Comme à Arcole, il fallait pour passer réunir trois conditions : calculer les risques, accepter un certain niveau de dommages et, une fois la décision arrêtée, passer quoi qu’il en coûte.
Au vu de l’intimité des relations bilatérales, les réflexions se firent ensemble, Marocains et Français. Alexandre de Marenches, chef romanesque et disert de l’espionnage français, se vanta d’avoir soufflé l’idée de la « Marche verte ». Gardons-nous d’une telle conjecture. Après un brainstorming, chacun croit avoir eu l’idée le premier. Si la Marche avait été un fiasco, nul n’en aurait disputé la paternité au roi. C’était bien lui le cerveau principal, même s’il savait consulter.
L’extraordinaire spectacle d’une foule désarmée et décidée est l’évènement phare de l’affirmation marocaine de souveraineté au Sahara. Comment être insensible à un tel symbole ? Faisons néanmoins l’effort de garder la tête froide et d’écouter les critiques algériennes. La Marche verte n’aurait pas été « si verte que cela ». De fait, les forces armées royales avaient pénétré le territoire44. En droit, cela reste une action unilatérale. Sur ce point, il est impossible de balayer le point de vue algérien. Autrement dit, le dommage accepté, c’était bien l’image du Maroc au regard du droit et l’exploitation qui en découlerait. C’est à ce moment précis que la faille juridique s’est ouverte, qui n’a pas été refermée.
Mais, pour le Roi, c’était un mal inévitable. Imaginer qu’en restant bien sage, le Maroc aurait vu ensuite la communauté internationale descendre de l’Olympe pour lui octroyer la souveraineté au Sahara occidental ne lui paraissait pas réaliste. L’histoire des relations internationales enseigne le contraire.
Il y a fort à parier que ce raisonnement n’arrangeait pas Paris, eu égard à l’aventure diplomatique qui s’annonçait. Pourtant il fut accepté, sous l’effet de l’intimité plus encore que de l’amitié : impossible de dire aux Marocains qu’ils avaient tort quand, dans leur for intérieur, les Français leur donnaient raison. Une alliance fut scellée. Elle reposait sur une conviction forte mais politiquement incorrecte, liant les deux pays mais difficile à proclamer publiquement.
Quant à la Marche verte, le symbole qu’elle représente n’est pas annulé par le rôle de l’armée dans la prise de contrôle du territoire. À ceux qui qualifient le Maroc d’agresseur, la Marche permet de rétorquer : sont-ils si nombreux les agresseurs opposant aux fusils leur poitrine désarmée ? Imagine-t-on l’Irak de Saddam Hussein ou la Russie de Vladimir Poutine accomplissant un tel geste au Koweït ou en Ukraine ?
La méthode est un appel à la justice dont il est difficile de contester la sincérité. La noblesse des risques physiques assumés a rempli les Marocains de fierté. Elle a évidemment aidé la France à apporter son soutien, en essuyant les critiques, mais en maîtrisant les risques.
Le 6 novembre 1975, la foule rassemblée à Tarfaya au bout d’une route construite par le groupe Bouygues se met en branle. Le Maroc avait ménagél ’effet de surprise. Peu pensaient qu’il oserait. Pour éviter les soupçons, les énormes besoins logistiques furent en partie couverts par des commandes effectuées via une entreprise domiciliée en Savoie. Cet effet de surprise avait un revers : il interdisait de préparer l’opinion internationale. Mais, le jeu en valait la chandelle. Madrid n’osa pas faire tirer. C’était le pari d’Hassan II.
Francisco Franco était dans le coma, Juan Carlos faisait ses premiers pas comme chef d’État par intérim, le peuple espagnol avait le cœur empli d’espoirs démocratiques. Salir le moment par un bain de sang les aurait entachés. Sous le choc, Madrid accepta de négocier. Le roi savait calculer45.
La négociation déboucha sur les accords de Madrid du 14 novembre 1975. Ils prévoient un partage du Sahara occidental entre le Maroc et la Mauritanie (environ deux tiers-un tiers : partie nord dite Saqia El Hamra pour le premier, partie sud dite Rio de Oro pour la seconde). Pour Rabat, c’est un acte de décolonisation et une base juridique à sa souveraineté. Pour d’autres, une puissance coloniale ne peut disposer de son ancienne possession et la signature espagnole était sans valeur.
Dans les faits, la souveraineté marocaine allait s’exercer, d’abord sur les deux tiers du territoire. En 1979, la Mauritanie, désireuse de sortir du conflit, se retirera du Rio de Oro. Elle reconnaîtra la République arabe sahraouie démocratique (RASD), sans doute pour ne pas avoir d’ennuis avec le Polisario et l’Algérie. Mais, cette dernière étant éloignée de la zone en question, le Maroc s’y installera sans difficulté. Sa souveraineté de facto s’étend alors à l’essentiel du Sahara occidental.
Manœuvre de politique intérieure ou compromis historique ?
Les répercussions intérieures de la Marche verte ont été, comme d’autres aspects du conflit, citées davantage qu’étudiées. Commençons par un fait manifeste, confirmé par tous les visiteurs : le soutien profond, viscéral, des Marocains. En déduire que l’unité nationale autour du roi était un objectif central n’est pas absurde. De cette prémisse assez juste, certains déduisent que celui-ci aurait agi pour accroître son pouvoir en paralysant l’opposition. La prémisse est plausible mais la conclusion est fausse.
L’histoire retiendra que la Marche verte s’est inscrite dans un processus de consolidation de la monarchie. Mais ce fut au prix d’un compromis historique et d’une limitation progressive de ses pouvoirs.
La situation intérieure était la suivante : le mouvement national, historiquement porteur de la cause territoriale, exigeait la réduction des prérogatives royales. Il n’avait condamné les tentatives d’attentat (1971, 1972) que du bout des lèvres. L’Istiqlal, l’Union nationale des forces populaires et le PPS (ex-parti communiste) avaient contracté une alliance pour arracher une réforme constitutionnelle. C’était la « Kutla », accord ressuscitant l’unité du mouvement national. Ces partis boycottaient les élections, révélées comme truquées.
Ali Bouabid, Directeur de la Fondation Bouabid et fils d’Abderrahim Bouabid, leader de l’UNFP, puis de l’Union socialiste des Forces populaires (USFP), interprète la séquence de la manière suivante : « avec la Marche verte, le roi a touché la fibre patriotique du mouvement national. Ce faisant, il les a forcés à revenir dans la négociation avec lui »46. Cette négociation a conduit, avec le temps, à l’ouverture démocratique, forme de compromis historique à la marocaine.
Ce point d’histoire intérieure a son importance. À l’international, la Marche verte a parfois été décrite comme l’instrument du despotisme. Cette lecture, encouragée par certains exilés marocains, a été martelée par le Polisario. Elle a influencé l’opinion mais elle est inexacte : un lien plausible peut au contraire être établi entre la Marche et l’ouverture démocratique. Relevons ici qu’après le biais intellectuel causé par l’intangibilité, un deuxième malentendu a faussé l’analyse. À nos yeux, les biais ayant influencé les résolutions internationales suffisent à légitimer, à leur propos, l’esprit critique.
Cela dit, l’ouverture démocratique a demandé du temps. À court terme, un durcissement du régime a bien eu lieu. L’une des raisons : la guerre.
Partie 2
Le dénouement du noeud juridique
Chapitre IV. La guerre et la diversification des sources juridiques
L’AG ONU a elle-même précisé en 1960 qu’un TNA au sens de la Charte devait s’interpréter comme « un territoire géographiquement séparé et ethniquement ou culturellement distinct du pays qui l’administre ».
Ce comité comporte 40 membres. Usuellement, les présidences et vice-présidences d’instances multilatérales sont pourvues par rotation. Cuba a détenu une vice-présidence de façon quasi continue depuis 1983.
En 1974, à un an de la Marche verte, le débat sur le Sahara est déjà marqué par deux éléments émanant d’instances internationales indépendantes entre elles : l’ajout de l’intangibilité des frontières à la Charte de l’OUA et l’inscription du territoire sur la liste des « territoires non autonomes » (TNA) tenue par l’AG de l’ONU. Nous avons longuement évoqué la première. Voici quelques observations sur la seconde.
Le Sahara occidental reste un « TNA » malgré le départ de l’Espagne (qui notifie à l’ONU en février 1976, la fin de ses responsabilités). Le motif est l’absence d’exercice du droit à l’autodétermination. Subrepticement, une métropole est substituée à une autre, désignant le Maroc comme puissance coloniale. Jusque-là, cette qualification avait toujours été réservée aux pays lointains. C’est la théorie dite de « l’eau salée », eau des mers censées séparer colonisateurs et colonisés47. En vertu de cette théorie, la domination russe sur des pays contigus d’Asie centrale ne suscita jamais, quant à elle, l’inscription de ces pays sur la liste des TNA.
Aujourd’hui encore, le Sahara occidental est le seul territoire de cette liste attenant au pays dont il est présenté comme dépendant. Est-ce là une manifestation du droit à l’état pur ? Comment ne pas redouter un « deux poids-deux mesures » ? Les décisions de l’AG sur la liste des TNA sont préparées par le comité de la décolonisation. C’est un comité restreint, souvent décrit comme une place forte du tiers-mondisme. Cuba y joue un grand rôle48.
À partir de 1974, en seulement un an, deux autres sources juridiques viennent s’ajouter à celles que l’on vient d’évoquer : la Cour internationale de Justice et le Conseil de sécurité de l’ONU.
L’entrée en scène de la Cour internationale de Justice
Comme pour l’inscription initiale sur la liste des TNA, c’est le Maroc lui‑même qui est à l’origine de la saisine de la Cour internationale de Justice (CIJ) en 1974 (dans ce dernier cas : conjointement avec la Mauritanie). La base juridique de cette saisine mérite d’être signalée. La Charte autorise l’Assemblée générale des Nations unies à solliciter un avis consultatif de la CIJ. Ceci emporte deux conséquences : la cour a l’obligation de se prononcer et son avis est non contraignant.
Le fait qu’il s’agisse d’un avis, et non d’un arrêt n’est pas neutre (alors que ces mots sont couramment employés l’un pour l’autre). En termes de degré de certitude, les juges n’ont pas tout à fait les mêmes impératifs dans les deux cas. Ceci ne retire rien à l’ampleur du travail accompli par la CIJ et les parties à la procédure, qui en fait une véritable somme. Les juristes marocains et français en ont produit une part notable. Une contribution particulièrement érudite est venue d’un juriste algérien, Mohamed Bedjaoui. Cet homme allait devenir président de la CIJ et son rôle est significatif de l’implication algérienne dans le droit international « nouveau » des années 1960 et 1970. Ce droit était vu comme un levier du tiers-mondisme.
La question posée par le Maroc et la Mauritanie réservait une grande place à leurs droits historiques. Rabat produisit des serments d’allégeance émanant de tribus sahraouies. La Cour reconnut l’existence de ces liens, mais avec deux nuances : ils n’étaient pas constitutifs à ses yeux de liens de souveraineté de type moderne et, aux liens du Sahara occidental avec le Royaume, s’en ajoutaient d’autres, avec la Mauritanie (cosignataire de la demande de saisine). La Cour préconisait l’autodétermination pour trancher.
Au lendemain de l’avis, le Maroc ne chercha pas à poursuivre le débat juridique, ce qu’il aurait parfaitement pu faire eu égard à son caractère facultatif. Deux éléments auraient pu nourrir la critique. D’abord, en cherchant une souveraineté de type moderne et en omettant l’impact colonial, l’avis participait d’une forme d’occidentalocentrisme, point soulevé par le juge Ammoun49. Ensuite, la symétrie avec le jeune État mauritanien était discutable. Sans nier la prouesse de ceux qui ont fait de ce pays un État indépendant, il n’avait ni la profondeur historique, ni le rayonnement de l’État marocain. À preuve : quatre ans après, Nouakchott renoncerait à ses « droits ».
Néanmoins, les chances de faire valoir ces nuances dans le débat étaient ténues. Hassan II préféra « proclamer la victoire », une technique osée mais fréquente en matière judiciaire. Le Maroc s’était vu reconnaître « des » droits. Le chef d’État fit comme si la Cour avait reconnu « ses » droits. Il lança immédiatement les préparatifs de la Marche verte qui démarra trois semaines plus tard. On se dirigea vers l’affrontement politique, militaire et diplomatique.
L’entrée en scène du Conseil de sécurité
Parmi les critiques des thèses marocaines ayant vu juste sur ce point, Yahia Zoubir évoque dès 1990, dans le Middle East Council Report, la volonté marocaine de conquérir « les esprits et les cœurs ».
Toute menace sur la paix justifie, selon la Charte des Nations unies, la compétence du Conseil de sécurité de l’ONU. Après l’OUA, l’Assemblée générale de l’ONU et la CIJ, voilà une quatrième institution dans la danse. Non des moindres : le Conseil détient tout pouvoir pour maintenir ou rétablir la paix, y compris celui de recourir à la force. Il avait notamment le pouvoir d’enjoindre au Maroc de se retirer du Sahara occidental et de mandater une force internationale pour l’y contraindre.
Les pays hostiles étaient légion, bloc communiste et révolutionnaristes du sud en tête. Une partie des Africains et non-alignés modérés suivaient ce groupe. Les Occidentaux redoutaient de les « laisser seuls » face aux assiduités communistes. Le tout ressemblait à une meute aux trousses du Maroc.
Pour faire équilibre, un seul atout : le droit de veto français au Conseil de sécurité. Pour Paris, hurler avec les loups contre le Maroc était impensable. Mais user du veto était extrêmement délicat. La France a toujours redouté de voir contestée sa position de membre permanent du Conseil de sécurité car sa place parmi les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale a été obtenue à l’arraché, en 1945. Pour la légitimer, elle se pose en défenseur du droit international. En outre, pour montrer qu’elle n’abuse pas de son veto, elle ne le déclenche que lorsque ses intérêts territoriaux directs sont menacés.
Pourtant, le droit de veto français allait bel et bien servir, plusieurs décennies durant, à protéger le Maroc. Ayant évoqué les « biais » défavorables au Maroc, il convient ici de mentionner cet obstacle persistant qui entravait ses adversaires. Néanmoins, du fait de son caractère solitaire, le veto exposait fortement Paris. Il y avait là une grande différence avec les adversaires des thèses marocaines qui, soit oeuvraient groupés, soit invoquaient les grands principes.
Paris reçut son lot d’injures de la part des adversaires des thèses marocaines mais elle parvint à limiter les dégâts. Le savoir-faire de sa diplomatie ne suffit pas à expliquer cette performance : elle reposa aussi sur une étroite coordination avec Rabat. C’est ainsi que la France se retrouva « mariée » avec la cause nationale marocaine, au point d’être accusée de soutien inconditionnel. Ce terme n’est pas exact. Le soutien français s’est avéré indéfectible, décennie après décennie. Il ne pouvait être inconditionnel.
Le Maroc ne le demandait pas. Il s’est montré à la hauteur du soutien reçu, c’est-à-dire exigeant envers lui-même. Hormis transiger avec sa souveraineté, affaire à ses yeux de justice élémentaire, tout ce qu’il pourrait faire pour aller dans le sens du droit et de son esprit, il le ferait, ou finirait par le faire : approbation de conventions internationales sur les droits de l’homme et la protection des peuples autochtones, esprit de méthode dans leur mise en œuvre, actions en faveur des populations locales, etc.
Ces actions ont conforté la confiance française. Mais elles procédaient avant tout du sens que le Maroc entendait donner à sa souveraineté, surtout à partir de l’avènement de Mohammed VI : l’intégration dans un pays attaché à sa diversité et s’efforçant de garantir les droits des populations. La tolérance ethnique fait d’ailleurs partie de son ADN historique. L’historien français Charles-André Julien voyait par exemple dans l’équilibre entre composantes arabe et berbère « l’âme » même du Maroc.
Les mesures en faveur des populations sont l’une des « faces cachées » du dossier. Certains adversaires des thèses marocaines ont su le reconnaître, d’autres ont refusé d’y croire50. Ce faisant, ils s’enfermèrent dans une nouvelle erreur d’appréciation. Dépeindre un Maroc « prenant le maquis » par rapport au droit international, c’est ignorer les actions allant dans l’autre sens. C’est également ignorer l’un des ressorts du retournement de la situation : ceux qui se limitaient à accuser le Maroc de faire preuve de « mépris du droit » n’avaient pas saisi que le terrain se dérobait progressivement sous leurs pieds.
Côté français, le soutien au Maroc fit grincer quelques dents : tout le monde ne communie pas dans l’amitié des deux pays. Néanmoins, les diplomates ayant pris part à ce soutien ont eu peu d’états d’âme en raison de l’injustice territoriale subie par ce pays. Même les sceptiques reconnaissaient qu’il ne correspondait pas aux caricatures. Certains trouvaient que la France en faisait trop. Aucun n’eut de drame de conscience, y compris parmi les nombreux spécialistes du droit international.
Les résolutions du Conseil de sécurité
Certaines ONG insistent sur les limites qui subsistent à la liberté d’expression au Maroc.
Au Conseil de sécurité, la partie était subtile. Paris, prête à user de son veto, préférait ne pas avoir à le déclencher officiellement. Ceci aurait signifié le blocage très visible d’un texte approuvé par une majorité de membres, avec les dégâts politiques que l’on devine. Mieux valait se concilier les pays hésitants. Ne nous le cachons pas : cela revenait à louvoyer. Concrètement : laisser passer des formulations désagréables pour le Maroc, du moment qu’il pouvait « vivre avec », en menaçant de veto celles qui le gênaient vraiment.
Pendant des décennies, Rabat s’y résigna : il fallait prioritairement réduire l’isolement. D’où l’ambivalence des résolutions : elles mettent en avant l’autodétermination et non la création d’un État sahraoui indépendant, laquelle se fût heurtée au veto français (et aux réticences de nombreux autres membres). Ceci n’empêche pas certains commentateurs de voir dans cette création un droit reconnu par l’ONU. Ils oublient que la référence à l’autodétermination, notion que nul n’ose critiquer, est pour beaucoup une manière de ne pas se prononcer. L’autodétermination servait de « joker ».
Le dessous des cartes juridiques est souvent constitué par ce type d’équation diplomatique. Les habiletés ne sont pas automatiquement synonymes de cynisme : il arrive que les accommodements aient des effets vertueux. Le Maroc a accepté de les entendre. Il s’en est servi pour remédier à des aspects contestés de son action. On revient à l’essence du droit international : dialoguer, consulter, négocier.
Parmi ceux avec lesquels il fallait dialoguer, il y avait évidemment les États‑Unis d’Amérique. Ceux-ci ont été pour le Maroc un partenaire bienveillant mais longtemps difficile. Obtenir leur accord, à chaque fois que possible, était hautement recherché par la France et par le Maroc. Ce sont généralement les Américains qui tiennent la plume au Conseil de Sécurité sur le Sahara, signe de leur rôle pivot. Le plus souvent, ils ont fait pencher la balance vers le Maroc, mais parfois après lui avoir d’abord donné du fil à retordre. Ainsi, en 1975, après avoir écrit à Hassan II pour le dissuader d’entrer au Sahara occidental, Henry Kissinger poussa discrètement l’Espagne à lui donner satisfaction à travers les Accords de Madrid.
Face à la menace communiste dans le tiers-monde, Washington s’est posé en défenseur du principe d’autodétermination. De plus, les États‑Unis entretiennent des relations correctes avec Alger qui a toujours su, discrètement, y veiller. Entre 1977 et 1980, le Président Jimmy Carter exaltera « l’autodétermination, valeur américaine ». En 2003, sous la présidence (républicaine) de George W. Bush, le Plan Baker II préconisera la tenue, sous cinq ans, d’un référendum posant la question de l’indépendance. La France batailla longuement au Conseil de Sécurité contre cette exigence, menace de veto à la main. Elle emporta le morceau, sans grands dommages diplomatiques car, en ces temps de guerre en Irak, les États‑Unis redoutaient vivement son veto. En 2013, le Président Barack Obama insistera pour inscrire les droits de l’homme dans le mandat de la Minurso, thème que le Maroc estime relever de sa souveraineté51. C’est en cette occasion précise que le veto français s’avérera le plus ingrat à manier et sera le plus sévèrement fustigé par la presse.
Le Conseil de sécurité n’approuva pas la Marche verte, comme on peut l’imaginer. Il demanda le retrait « immédiat » des marcheurs et des soldats. Par la suite, il adopta une série de résolutions au fil des années, rappelant le principe d’autodétermination des populations et recommandant un référendum. Cette mention découlait de la position prise par le Comité spécial de la décolonisation et l’Assemblée générale.
Les phases du conflit
On pense, par exemple, au cas d’Abraham Serfaty, enfermé dix-sept ans au bagne de Tazmamart.
La guerre d’embuscade
Les Forces armées royales (FAR) prirent pied au Sahara occidental à partir du 31 octobre 1975 en évitant tout heurt avec les Espagnols. Elles connurent alors de premiers accrochages avec le Polisario. À partir de 1976, elles furent systématiquement attaquées par le Polisario, fort de sa base arrière en territoire algérien et de l’aide reçue à la fois de ce pays et d’autres classés dans le camp communiste.
Dans les premiers temps, la participation de soldats de l’Armée nationale populaire (ANP) algérienne déguisés en Sahraouis, fut signalée puis on assista à la montée en puissance de la guérilla menée par des Sahraouis eux-mêmes, principalement Reguibets, avec une forte aide extérieure.
La France soutint le Maroc, ne manqua pas de mettre en garde l’Algérie contre une intervention mais, eu égard à la non-persistance des incursions algériennes, n’envoya pas de troupes au Sahara occidental lui-même.
Le Polisario décida d’attaquer la Mauritanie, à laquelle lui et l’Algérie tenaient rigueur d’avoir signé les Accords de Madrid avec le Maroc. La capitale Nouakchott fut menacée.
Paris décida alors d’intervenir militairement, sur la base des accords de défense avec ce pays. Ce fut l’opération Lamantin (1976-1977), par laquelle l’Armée de l’air française, notamment, infligea des coups sévères au Polisario.
Les opérations continuèrent au Sahara occidental avec un soutien des camps révolutionnariste et communiste au Polisario. La guerre d’embuscade fut cruelle pour les Forces armées royales. Cela n’en fut pas moins l’un des rares cas de guérilla bénéficiant de forts soutiens extérieurs, battue par une armée régulière. Certains diront que le terrain n’offrait que peu d’abris. D’autres y verront un signe de la valeur et, également, de la motivation des soldats marocains.
Le mur et les camps
À partir de 1981, le Maroc édifia un mur pour empêcher le Polisario de pénétrer au Sahara occidental. Environ 80% du territoire était concerné, Rabat ayant fait la part du feu en laissant un no man’s land.
Le problème de terrain ne se limitait pas aux opérations militaires. En 1976, sur invitation du président Boumediene, le Polisario amena une partie importante des Sahraouis (dont assurément la majorité des Reguibets) dans des camps situés à Tindouf en Algérie. Il leur fit valoir que les Marocains allaient les massacrer. Ces camps devenaient un abcès de fixation, le Polisario contrôlant cette population. Le Maroc est présenté comme à l’origine de cette situation. Mais est-on sûr qu’il soit responsable de la fuite de population en 1975-1976 ? Est-on sûr que les Forces armées royales aient transgressé les « règles d’engagement » et eu l’intention de s’en prendre aux civils ? À force d’être tenues pour évidentes, ces assertions n’ont jamais été démontrées.
S’agissant des populations sous leur contrôle, les autorités marocaines les ont regroupées dans les villes, seul moyen de les sécuriser face à la guerre d’embuscade qui faisait rage dans le désert.
État de guerre et libertés
Il est rare qu’un conflit militaire ne s’accompagne de restrictions des libertés. Ceci n’excuse pas les graves atteintes aux droits de l’homme perpétrées au début du règne d’Hassan II, qui avaient commencé bien avant la Marche verte. La situation s’est d’abord aggravée au début du conflit. La répression s’est abattue sur les personnalités de la gauche marocaine ayant rejeté la marocanité du Sahara52 et sur les Sahraouis partisans du Polisario, qualifiés de « séparatistes ». Elle s’est ensuite relâchée avec l’affermissement de la position marocaine.
La particularité du Maroc est d’avoir, plus tard, officiellement reconnu les violations commises. Ce processus a été conduit par l’Instance Equité et réconciliation (IER) dirigée en grande partie par des militants des droits de l’homme. Inspiré de la procédure mise en place par Nelson Mandela en Afrique du Sud (« Vérité et réconciliation »), ce processus a été mis en place par Mohammed VI en 2004. Il est unique dans le monde arabe. Environ 3.000 victimes d’atteintes graves aux droits de l’hommes ous le règne d’Hassan ont été recensées et indemnisées (arrestations arbitraires, détentions illégales, tortures, assassinats, disparitions). Sur ces 3.000, environ 900 auraient été liées au conflit du Sahara occidental. La reconnaissance de la vérité a eu lieu alors que ce conflit était encore en cours.
Les inflexions marocaines
Entretien avec l’auteur.
Il est une circonstance où le soutien français faillit fléchir : en mai 1981, avec l’arrivée de la gauche à l’Elysée, après 23 ans d’opposition. Nombre de ses responsables s’étaient naguère engagés pour l’indépendance de l’Algérie, ou bien contre la répression envers les forces de gauche au Maroc. Le parti socialiste penchait alors du côté du Polisario. Hassan II, lié d’amitié avec le président Giscard d’Estaing (1974-1981), n’avait pas anticipé sa défaite.
Son successeur, François Mitterrand était sous forte pression. Cependant, il était pénétré de conscience historique. Sous la IVème république, il avait quitté le gouvernement peu après la déposition de Mohammed V. Il encouragea l’un de ses jeunes conseillers, Hubert Védrine, à maintenir les étroites relations de sa famille avec celles de trois personnalités marocaines engagées en politique : Abderrahim Bouabid, Mohamed Boucetta et Majoubi Aherdane.
Le 21 juin 1981, le deuxième tour des élections législatives confirma la victoire sans appel des socialistes, qui obtinrent à eux seuls, pour cinq ans, la majorité absolue à l’Assemblée nationale. Le 25 juin suivant, après en avoir informé François Mitterrand, Hassan II accepta l’idée d’un référendum dans un discours prononcé devant l’OUA, à Nairobi. Il s’agissait, précisa-t-il, d’un référendum « contrôlé ».
Selon Hubert Védrine, cette acceptation aida grandement à sauvegarder le soutien français au Maroc sur le moment53. Ensuite, ce soutien ne fut plus jamais remis en cause, lors d’aucune alternance.
De 1981 à 1987, le Maroc fit construire le Berm, un mur de pierre et de sable permettant d’empêcher les incursions. En 1988, Hassan II proposa le « pardon » aux responsables du Polisario et à ceux les ayant suivis. Selon Rabat, 8.000 à 10.000 personnes auraient alors rejoint le Maroc. Certains deviendront élus, hauts fonctionnaires ou ministres.
Cessez-le-feu et préparatifs de référendum
L’Ambassade de France à Rabat suit de près l’activité de la Minurso. Elle m’a éclairé sur ce point, comme sur beaucoup d’autres.
Le 6 septembre 1991, un accord de cessez-le-feu intervient sous l’égide de l’ONU. À partir de cette date des cycles de négociations auront lieu. Surtout des travaux conjoints sont entrepris pour établir les listes électorales nécessaires au référendum. D’où l’intitulé de la force onusienne : Mission des Nations unies pour l’organisation du référendum au Sahara occidental (Minurso).
Le sujet est complexe. Le Polisario refuse que les Marocains arrivés sur le territoire après la Marche verte (portant la population totale à plus de 600.000 habitants) participent au scrutin. Rabat rétorque que certains d’entre eux (pour un nombre plus faible) étaient originaires du territoire qu’ils avaient quitté après l’opération Écouvillon de 1958. Il faut aussi s’assurer que les Sahraouis recensés au titre de leur présence en 1974 étaient bien sur le territoire à cette date. La tâche s’est révélée impossible. En 1999, ces travaux ont pris fin. Mais la Minurso, elle, a été prorogée54.
Mohammed VI, le développement et le plan d’autonomie
L’avènement de Mohammed VI en 1999 fait entrer le dossier du Sahara occidental dans une nouvelle ère. Le nouveau roi accomplit un sans-faute. À force de méthode, il va surmonter la plupart des écueils.
D’abord, il n’a jamais affronté le Mouvement national. Celui-ci est présent au sein de tous ses gouvernements et le règne se traduit par des avancées majeures en faveur des droits de l’homme, de la modernité et de la transformation du pays en matière économique et sociale.
Ensuite, il va retourner progressivement la situation dans les rapports avec l’Afrique, y accomplissant de nombreux voyages et montrant une grande disponibilité. Dans un premier temps, c’est l’essor de relations bilatérales compensant l’absence marocaine de l’enceinte multilatérale que constitue l’Union africaine (ex-OUA). Puis ce sera le retour dans cette enceinte, soutenu par la majorité des États du continent (2017).
En 2006, il lance le projet d’autonomie du Sahara occidental qui est immédiatement appuyé par Paris. La position marocaine s’ordonne alors autour de ce plan. Le roi met en place un Conseil royal consultatif pour les affaires sahariennes (CORCAS) regroupant les notables sahraouis favorables à la souveraineté marocaine. Après consultation de cette instance, le plan est transmis au Conseil de sécurité, qui en prend note et salue « les efforts sérieux et crédibles du Maroc pour aller de l’avant vers un règlement » (Résolution du 30 avril 2007)55.
En 2011, un processus de régionalisation du Maroc incluant l’élection directe des conseils régionaux a été lancé. C’est ainsi que des élections pluralistes ont lieu à tous les niveaux : communes, régions, Parlement national. Elles se tiennent aussi dans les régions sahraouies, où le parti parfois présenté comme celui du roi les perd régulièrement au profit du parti de l’Istiqlal. Les élections sont une forme d’autodétermination même si, étant réfugiée en Algérie, la population des camps n’y participe pas.
Sous le règne de Mohammed VI, la « cause nationale » change de dimension : l’effort de développement local et la vision d’un Maroc trait d’union avec l’Afrique subsaharienne lui donnent un sens nouveau. Le regard sur le Maroc ne sera plus le même. Les résolutions internationales initiales paraîtront décalées.
Du polycentrisme juridique aux tokens56
Un token est un actif numérique créé, détenu et échangé sur une blockchain (ou chaîne de blocs en français, technologie de stockage et de transmission d’informations qui fonctionne sans autorité centrale).
Je remercie Hélène Le Gal, directrice générale en charge de la région Afrique du Nord et Moyen-Orient au service d’action extérieure de l’Union européenne, d’avoir attiré mon attention sur ce point.
Étant l’une des institutions des Nations unies, le Conseil de sécurité doit se référer aux résolutions de l’AG. De là, les mentions de la présence du Sahara occidental sur la liste des TNA. De même, elle fait partie du système des Nations unies. Bien que consultatif, son avis de 1975 est souvent cité. Enfin, l’OUA est une organisation régionale reconnue par l’ONU. Toutes ces institutions doivent respecter les finalités de la Charte, comme le montre la thèse de Sâ Benjamin Traoré.
Néanmoins, à l’autre bout de la chaîne de raisonnement, le droit suppose une appréciation des faits : ce groupe précis de populations constitue‑t‑il un « peuple » ? Cette modalité concrète de consultation constitue‑t‑elle une forme d’autodétermination ? Questions parmi d’autres. Cette appréciation consiste à « qualifier » ces faits pour qu’ils puissent devenir un maillon du raisonnement juridique mais elle est peu encadrée.
On suppose parfois qu’avant de se référer aux qualifications émanant d’une autre instance, une institution les vérifie et n’ajoute son autorité à ces qualifications qu’après s’être forgée sa propre opinion. Ce n’est pas ainsi que les choses se passent. Tout responsable ayant œuvré dans le champ multilatéral en a fait l’expérience : au nom de la répartition des rôles, une instance doit souvent tenir pour acquises les positions des autres. Le consensus international est à ce prix.
De là un risque de consolidation collective des approximations. Certaines appréciations formulées sous la pression des circonstances se mettent à circuler dans l’espace onusien, telles des tokens, ces actifs dématérialisés échangeables dans l’espace numérique.
L’assimilation Sahara occidental-Palestine, un glissement révélateur
Cherchant des repères, le droit international est avide d’analogies57. Après le départ des Espagnols, le Maroc a pu être qualifié de « puissance occupante ». Certaines parties prenantes ont alors extrapolé. C’est ainsi qu’est née l’équivalence Sahara occidental-Palestine. Elle part d’un présupposé : le droit à l’autodétermination aurait été bafoué dans les deux cas. Le Polisario joue de ce parallèle.
Outre que les textes diffèrent profondément, les faits démentent ce rapprochement. Nous sommes à mille lieux de l’opposition ethnique entre Israéliens et Palestiniens : des deux côtés de l’ancienne ligne de démarcation espagnole, la religion et les langues sont les mêmes. Hormis la sédentarisation sans doute plus précoce au nord, la société et l’histoire sont identiques. Ensuite, le terme de « colon » est parfois employé pour fustiger les Marocains venus du nord de l’ancienne ligne. Cette dénomination n’a de réalité que verbale : dans cet immense espace, la concurrence pour la terre est inexistante. On serait bien en peine de trouver au Sahara l’équivalent des Palestiniens de Cisjordanie chassés de leurs champs. Autre différence : Israël écarte le droit au retour des Palestiniens partis en 1948 (la densité de population n’y est d’ailleurs pas étrangère). Le Maroc appelle de ses vœux un retour.
La comparaison ne résiste pas à l’examen. Mais elle ne s’impose pas moins dans les têtes, alimentant articles et prises de position. Le Maroc est identifié aux colons de Cisjordanie. On cherche à recopier les sanctions. C’est, dans toute sa splendeur, le droit appréhendé comme une « boîte noire ».
Chapitre V. Guérilla judiciaire au Luxembourg
Après les élections européennes de 2019, la Commission a été élue en se présentant comme une « Commission géopolitique ». C’est elle qui a été confrontée, avec le Conseil de l’UE, au recours du Polisario.
Le droit international est en grande partie politique dans son mode d’élaboration et dans son application. Il en va tout autrement du droit européen : il repose sur une architecture de règles serrée et une armature judiciaire complète. Elles garantissent son effectivité.
Le Polisario a entrepris une guérilla juridique pour défendre son point de vue. Avec peu de résultats dans les instances judiciaires internationales. Tout naturellement, il a tenté sa chance auprès de l’UE. La Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE), siégeant à Luxembourg, a été saisie. En 2024, notamment, elle a rendu deux arrêts annulant des accords de l’Union avec le Maroc, l’un sur la pêche, l’autre sur les échanges agricoles. Le motif est en rapport avec le Sahara occidental. En présence de tels arrêts, deux possibilités : se réjouir de voir le juge européen prêter son filet à un droit international aux mailles espacées, ou bien dénoncer le mélange contestable de normes d’essences différentes.
La nature de l’UE fait partie des questions posées. Plus que toute autre entité dans le monde, elle s’est construite par le droit. Parallèlement, elle doit intégrer les réalités géopolitiques d’un monde devenu plus dangereux. Telle est évidemment la leçon de la guerre en Ukraine. Mais c’est un choix plus général de l’Union et de ses États membres. Les accords avec le Maroc n’y échappent pas.
Ces accords visent un intérêt économique mutuel tout en s’inscrivant dans une démarche politique58. L’Union voit dans le Maroc un pays stratégique : position géographique, trait d’union avec l’Afrique, stabilité, engagement dans la coopération internationale, etc. Le consensus des États membres autour de cette appréciation se mesure à plusieurs signes : l’approbation unanime des accords mais aussi la qualité de leurs propres relations bilatérales avec lui. Sur le continent européen, pas un pays ne reconnaît la RASD.
Autant dire que les arrêts s’inscrivent à contre-courant.
Une irruption judiciaire dans la politique extérieure
Entretien avec Sâ Benjamin Traoré.
La Cour de Luxembourg est parfois comparée à une « Cour suprême » européenne. En démocratie, la juridiction faîtière doit s’appuyer sur des principes incontestables lorsqu’elle se confronte aux autorités élues.
C’est particulièrement net pour un accord international, qui suppose des compromis avec l’autre partie. Dans maints pays, sans vice de forme, l’annulation judiciaire d’un traité est impensable. En France, le Conseil d’État classe la signature des traités parmi les « actes de gouvernement », non susceptibles d’annulation : il refuse de s’ingérer dans la conduite de la politique étrangère. Aux États‑Unis, c’est la notion de Political Question qui aboutit à ce résultat59.
La CJUE s’abstrait de ces prudences alors même que le centre de gravité de ses compétences est à composante plutôt économique. Après des arrêts, le Conseil européen a solennellement rappelé ses prérogatives en politique étrangère et l’importance des relations avec Rabat.
Contrôle judiciaire et intérêts de l’Union européenne
L’Union européenne n’est pas seule à souhaiter des partenariats avec le Maroc, avec les avantages économiques que cela inclut. Elle est en compétition avec d’autres entités. Européens et Russes sont, par exemple, en concurrence pour l’obtention de droits de pêche au large du Maroc. À Moscou, aucun juge ne s’interpose dans les négociations avec Rabat. On rétorquera que le droit doit savoir primer sur les intérêts. Soit. S’il est incontestable.
Les arrêts de la Cour au regard du droit européen
Journal officiel de l’Union européenne, Traité sur l’Union européenne (version consolidée), publié le 26 octobre 2012 [en ligne]. L’article 21 du traité de Rome (devenu traité sur le fonctionnement de l’UE) commence ainsi : « L’action de l’Union sur la scène internationale repose sur les principes qui ont présidé à sa création, à son développement et à son élargissement et qu’elle vise à promouvoir dans le reste du monde : la démocratie, l’État de droit, l’universalité et l’indivisibilité des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d’égalité et de solidarité et le respect des principes de la Charte des Nations unies et du droit international ».
Le 31 août 2024, en marge d’une rencontre avec le secrétaire général de l’ONU, le secrétaire général du Polisario, Brahim Ghali, aurait déclaré que « le peuple sahraoui attendait toujours de pouvoir connaître la démocratie ».
Selon la Cour, ses arrêts ont leur base juridique dans l’article 21 du traité de Rome. Il dispose que l’action extérieure de l’Union repose sur le droit international et un ensemble de principes et valeurs60. Il s’agit de principes très généraux. Ils sont soutenus par l’opinion, si bien que leur prise en compte est réelle, même sans intervention des juges.
Par ailleurs, une politique étrangère répond à une logique globale, dont l’appréciation revient aux autorités politiques. Les contraindre par une interprétation judiciaire rigide est antinomique de la notion même de politique étrangère. Enfermer l’action extérieure de l’UE dans un corset va à l’encontre de l’émergence d’une politique étrangère commune, que les traités appellent de leurs vœux. Est-ce le rôle de la CJUE ?
Aux objectifs initiaux de l’Union, s’ajoute dorénavant l’idée de « souveraineté européenne ». Elle implique des décisions indépendantes dans le domaine extérieur. Or, les arrêts se réfèrent à certaines décisions de l’ONU en exigeant que l’Union s’y conforme sans même un droit de regard. N’est-ce pas là une forme de limitation de sa souveraineté ?
Sur le fond, l’article 21 se réfère à la « démocratie ». À cet égard, reconnaître au Polisario le pouvoir d’intervenir devant la Cour n’est pas évident. Il ne détient pas la personnalité morale. Il s’agit d’un mouvement armé sans légitimité élective61. La Cour estime l’Union tenue par l’inscription du Sahara occidental sur la liste des territoires non autonomes de l’ONU. Cependant, cette liste dépend grandement du Comité spécial de la décolonisation, qui se caractérise notamment par l’influence qu’y détient Cuba, autre système de parti unique. C’est à ce type d’acteurs que les arrêts obligent l’Union européenne à rendre des comptes.
Un contrôle judicaire portant sur les erreurs manifestes pourrait se concevoir. Si la Commission ou le Conseil avait délibérément ignoré les droits des populations sahraouies ou les contestations sur la souveraineté marocaine, une annulation se concevrait. Tel n’est absolument pas le cas. La Commission européenne est une institution profondément imprégnée de droit. Contrairement à un raccourci fréquent, la cohérence juridique de la construction européenne ne repose pas seulement sur la Cour, mais aussi sur la Commission, « gardienne des traités ». À travers elle, le droit est pris en compte à l’orée de tout processus de décision.
Dans la négociation des accords, la Commission et le Conseil s’étaient soigneusement préoccupés des populations sahraouies. Ils étaient d’ailleurs allés jusqu’à proposer de consulter le Front Polisario qui a refusé cette consultation. La Cour a jugé les diligences non satisfaisantes. C’est un contrôle de détail, effectué loin du terrain, avec les risques qui en découlent.
Les arrêts de la Cour au regard du droit international
Voir notamment les arrêts suivants : Van Gend en Loos (1963) [en ligne] et Costa contre ENEL (1964) [en ligne].
La distinction entre ces deux formes de droit est solidement établie. Voir David Ruzié, Gérard Teboul, Droit international public, Dalloz, 2019, ouvrage cité en bibliographie.
Selon la Cour, le Maroc aurait rejeté « catégoriquement » la qualification de « puissance administrante ». Ce pays refuse de mettre en avant une qualification niant sa souveraineté. Mais rien n’empêche les tiers de prendre acte d’une souveraineté effective. Le terme « catégoriquement » est inexact : l’OCP a, par exemple, publié des audits montrant que son activité au Sahara occidental est compatible avec les standards d’une « puissance administrante ».
La CJUE est chargée d’interpréter le droit européen. Ce droit est spécifique : il organise un système juridique intégré, différent dans sa nature du droit international général. Il est infiniment plus « judiciarisé » car il doit garantir l’égale application des normes européennes.
C’est la Cour elle-même qui a souligné, dans des arrêts historiques, la spécificité du droit européen62. Il peut imposer directement des obligations aux particuliers, ce qui est normalement exclu en droit international, droit ne concernant que les États. Il est effectif et sa transgression sanctionnée, ce qui est rarement le cas du droit international.
Doit-on féliciter la Cour de s’être portée au secours du droit international ? Le droit international étant perçu comme un combat juste, certains voient en chaque circonstance une occasion de s’y engager. Les milieux académiques ne sont pas insensibles à ce raisonnement. Il nous paraît contestable. S’il est un domaine où la fin ne peut pas justifier les moyens, c’est bien le droit.
À y regarder de près, le raisonnement de la Cour aboutit à se saisir d’une norme conçue dans le cadre souple du droit international public et à lui conférer la rigueur du droit européen. Était-ce l’intention des auteurs de la norme. Conçue pour interpréter le droit européen, la Cour de Luxembourg est peu outillée pour interpréter les décisions de l’ONU, tâche incombant normalement aux États membres de l’ONU (dont l’UE ne fait pas partie) et, éventuellement, aux institutions onusiennes elles-mêmes. Eux seuls savent comment délibère l’Assemblée générale de l’ONU. Ses votes sont politiques. Les motifs idéologiques jouent un rôle central. Au Conseil de sécurité, les compromis et les exigences du maintien de la paix à court terme pèsent d’un grand poids.
Ignorer ce contexte conduit à des faux sens. La Cour tient pour définitivement acquise l’existence d’une nation au regard de résolutions de l’ONU mentionnant le « peuple » du Sahara occidental. En anglais, les mots « peuple » et « population » sont un seul mot (people). Dans le contexte de la décolonisation, il a été employé spontanément, à la fois pour les habitants de la ville d’Ifni (intégrée au Maroc en 1969 à la demande même de l’ONU) et pour ceux du Sahara occidental. Dans ce dernier cas, certes, un mouvement de libération a vu le jour (Polisario). Mais ce n’est pas lui qui a fait partir le colonisateur. C’est le Maroc.
Autre question échappant aux référentiels de la CJUE : comment apprécier la solidité d’une revendication nationale ? Il faut pour cela étudier son histoire : y a-t-il eu émergence d’une idée nationale sur la durée ? Y a-t-il eu une vie commune, constitutive d’une identité nationale unissant les tribus nomades du Sahara occidental. En fait, c’est une question de science politique et non de droit.
Gommer ces interrogations dans des débats politiques est une chose, graver dans le marbre du droit européen les réponses sans avoir même identifié les questions en est une autre. Les arrêts de Luxembourg rendent éclatant le sophisme consistant à noyer dans le droit une question de science politique.
De même, la Cour prend pour argent comptant l’idée selon laquelle le Polisario, organisation non élue, serait le « représentant du peuple sahraoui ». Cette formule a certes été employée par l’Assemblée générale, en 1979 et en 1980, c’est-à-dire à deux reprises en cinquante ans.
Rappelons le contexte : certains pays africains étaient affectés par des rivalités entre mouvements de libération, au point de provoquer des guerres civiles (comme en Angola). L’ONU s’était assignée la mission de déterminer quel mouvement devait être considéré comme légitime. Mentionner le Polisario comme « représentant du peuple sahraoui » était un moyen de décourager localement toute rivalité de ce type. Cela attestait-il l’existence d’une nation sahraouie ?
En fétichisant des formules onusiennes sorties de leur contexte, la Cour efface la distinction entre droit international politique et droit international judiciaire. Le premier est produit par des institutions politiques, avec des risques de distorsions qui invitent à le manier avec prudence. Le second émane de la Cour internationale de Justice et des sentences arbitrales, fruit d’un raisonnement purement juridique qui justifie leur caractère obligatoire. En l’occurrence, la Cour européenne s’est référée à du droit politique comme s’il s’agissait de droit judiciaire.
Certes, il ne s’agit pas d’une distinction formelle et l’on peut feindre de l’ignorer. Le droit politique ne se qualifie pas lui-même comme tel (il s’efforce d’atteindre à la plus grande autorité possible). Mais c’est une distinction essentielle et parfaitement étayée dans la doctrine63.
La pratique va dans le même sens : elle imprègne le fonctionnement de l’ONU. À preuve : ni les résolutions de l’AG, ni celles du Conseil de Sécurité ne sont susceptibles de recours devant la CIJ. Ceci prouve bien qu’elles relèvent d’un autre registre que le droit judiciaire. Cela n’implique pas que le droit politique soit sans valeur : il formalise un équilibre à un moment donné. Les États et les opinions publiques s’y montrent attachés, ce qui lui confère de l’autorité. Les diplomates élaborent des processus de coopération à partir des bases qu’ils ont établies.
Mais sa mise en œuvre est modulée par la politique, c’est à dire les débats, les jeux de force, les négociations, etc. Non sanctionné par un juge, le droit politique est souple dans son application. Sa formulation solennelle, voire tonitruante, ne doit pas tromper : elle est compensée par cette application nuancée. Pour le dire brutalement : le droit international peut se montrer d’autant plus dur dans ses formulations qu’il est incertain dans son exécution.
La Cour de Luxembourg a splendidement ignoré ce décodage : le manque de nuance est frappant dans les arrêts. Il y est question de « prétendue souveraineté » marocaine au Sahara occidental. Or cette souveraineté est pleinement effective sur l’essentiel du territoire, depuis des décennies. Elle est contestée, certes. Mais, justement, le droit international a forgé un concept pour ce type de situation : la notion de « puissance administrante64 ». Cette notion est balayée par la Cour. Cependant, elle est protectrice pour les populations. Elle prévoit que les ressources naturelles du territoire concerné peuvent être exploitées mais de façon durable et dans l’intérêt des populations.
Le terme de « prétendue souveraineté » est en décalage avec les décisions du Conseil de sécurité, qui fait preuve d’un grand pragmatisme à propos du Sahara occidental. Sur l’essentiel du territoire, la souveraineté marocaine y est dans les faits, protégée par la force qu’il a mandatée et qui a cessé depuis 1999 de travailler sur un projet de référendum.
En 2007, le Conseil a décidé de prendre en considération la proposition marocaine de plan d’autonomie, qualifié de « base sérieuse de négociation », avec un soutien croissant. La Cour est donc en décalage avec le Conseil lui-même dans l’interprétation de ses propres résolutions.
Il est vrai que, ni les milieux académiques, ni la France et l’Espagne n’ont réfuté ouvertement la thèse de l’infraction marocaine. Dans ce contexte, la réaction de la CJUE se comprend mieux.
Chapitre VI. Vers une sortie du conflit
Le doute sur l’infraction marocaine a toujours été présent. Il explique le soutien français depuis le premier jour. Il a motivé la prudence du Conseil de sécurité, qui a atténué, puis modifié ses affirmations. Mais ce doute est resté implicite car la cause marocaine a été confrontée à une grande adversité : hostilité communiste, tentations révolutionnaires au sud, hantise américaine de voir ce dernier basculer vers l’est. Le caractère atypique du dossier du Sahara occidental aurait exigé une approche circonstanciée, éloignée de l’idéologie.
Sur le moment, la stratégie du dos rond est apparue comme la seule option. Le Maroc et la France se sont accordés là-dessus pendant plus de quatre décennies. Mais cela recouvrait deux logiques distinctes.
L’argument des “droits historiques” : atouts et contraintes pour le Maroc
Selon le philosophe Philippe Raynaud, « les droits historiques sont l’argument qui fait le plus facilement l’unité à l’intérieur du pays qui les revendique et convaincre moins à l’extérieur »65. Cette équation correspondait exactement aux données de 1975. À l’extérieur, de toute façon, les chances d’être entendues étaient limitées à court terme, quelle que soit l’argumentation avancée. À l’intérieur, en revanche, l’unité était vitale. Le pays avait payé assez cher ses divisions. Privilégier l’argument favorisant le plus l’unité nationale était un choix rationnel et, sous ce rapport, la réussite a été complète. Conjugués avec le droit de veto français à l’extérieur, les droits historiques ont représenté une « ligne Maginot qui a réussi ». Impossible de retirer au Maroc ce qu’il estimait être « son » Sahara. Le dos rond a permis à la conjoncture politique de se retourner. L’opinion internationale est aujourd’hui ouverte à l’idée de légitimité du Maroc au Sahara. Ceci place la fin du conflit à portée de main.
Toutefois, l’équation argumentaire s’en trouve modifiée : il faut achever de convaincre. Sinon, le succès sera porté par certains au compte du fait accompli.
Dans cette perspective, l’argument des droits historiques devient, pour Rabat, moins topique. Il se heurte toujours aux mêmes préventions de la communauté internationale, qui voit dans cette notion une source d’attisement des conflits en général. De plus, cet argument valorise peu les mérites que le Maroc s’est acquis avec le temps : son évolution interne, son action pour le développement du territoire, son souci de dialoguer avec la communauté internationale. Autant d’éléments que d’autres pays tenants des droits historiques seraient bien en peine d’invoquer. Le Maroc est dans la situation, rare, d’un pays dont le comportement passe mieux que son discours.
Les droits historiques peuvent difficilement clore un contentieux. Comme le souligne le chercheur Brahim Oumansour, le passé auquel ils renvoient est imprécis : jusqu’où remonter dans le temps ? Certaines régions de Mauritanie et du Sahara central algérien (le Touat) avaient fait allégeance au Sultan. Bien sûr, le Maroc ne les revendique pas. Sa sincérité n’est pas en cause mais ses voisins voient les choses différemment : si la communauté internationale endossait le critère de l’allégeance, ne pourrait-il pas être invoqué ailleurs ?
Le Maroc doit déployer de nouveaux arguments pour obtenir gain de cause. Mais il bute sur deux risques. Le premier : lâcher la proie pour l’ombre. Il ne peut réduire sa dépendance aux droits historiques qu’au bénéfice d’arguments sûrs. Second risque : apparaître comme hostile au droit international s’il critiquait certaines résolutions onusiennes66. Il vit depuis 1975 le dilemme de la victime d’erreur judiciaire : admettre un verdict, c’est accepter la faute ; s’en prendre à lui, c’est aggraver son cas.
Les anciennes puissances coloniales ne s’exposent pas à ce risque mais elles doivent faire face à d’autres préoccupations.
Avantages et inconvénients de l’évitement juridique pour la France
Point de vue encore exprimé au printemps 2025 par le président Teboune : Crise Algérie – France : nouvelles déclarations de Tebboune, TSA – Tout sur l’Algérie, 23 mars 2025 [en ligne].
Qu’il s’agisse de la France ou de l’Espagne, s’abstenir de réfuter les arguments juridiques avancés contre le Maroc a longtemps présenté de grands avantages : esquiver les critiques, rassurer les hésitants et ne pas avoir à se prononcer sur les « droits historiques ».
De plus, s’agissant de la France, elle est prisonnière de son approche du droit international, l’approche positiviste. Selon cette approche, le droit n’a pas à respecter idéalement une rigueur intellectuelle absolue. Il est pris comme une donnée quasiment factuelle : le point d’équilibre de la communauté internationale à un moment donné, nécessairement imparfait mais stabilisateur. Accessoirement, ce droit positif rassemble facilement en Europe. L’Espagne est dans une situation voisine, sans être membre permanent du Conseil de sécurité, position qui incite la France à se poser en « bon élève » du droit international. Malgré la qualité reconnue de ses juristes, l’administration française est réticente à produire officiellement une lecture alternative à ce droit positif. La solution aurait pu venir de travaux académiques dont les autorités auraient pu faire état. Hélas, l’État n’a pas toujours le réflexe de susciter de tels travaux.
La France a préféré faire évoluer ce fameux droit positif et le Maroc s’est volontiers rangé à cet avis. Pari ô combien gagnant sur la longue période : les résultats se voient aujourd’hui au Conseil de sécurité. Néanmoins, l’observation émise à propos des droits historiques vaut également pour le droit positif : cette ligne argumentaire s’est faite moins avantageuse avec le temps. Le besoin de clarification s’accroît quand l’issue approche.
Le respect formel du droit positif allait de pair avec la discrétion, laquelle était perçue comme une forme de modération française par l’Algérie.
Rapidement prévenu par Paris de son soutien à Rabat, l’Algérie avait répondu : « c’est compatible avec des relations correctes avec nous si vous restez discrets67 ». Cette discrétion convenait parfaitement au Maroc.
Récemment, cet équilibre a volé en éclats :
– le Maroc a voulu se sentir mieux reconnu, ce que Paris a mis du temps à comprendre ;
– la contrainte américaine a semblé se volatiliser. Peu encombré de droit international, Donald Trump a brusquement reconnu en 2020 la « marocanité » du Sahara (en contrepartie des relations diplomatiques Maroc-Israël). La position américaine à l’ONU n’a guère changé avant 2025. Mais les précautions françaises sont soudain apparues excessives aux Marocains ;
– se sentant en meilleure position, Rabat a mis Paris sous pression.
Une crise bilatérale a surgi, plaçant la France face à une alternative : céder, ou risquer d’obtenir, après près d’un demi-siècle de soutien, comme seul résultat, un partenaire mécontent. La séquence diplomatique a de quoi surprendre : avoir assumé des risques en soutenant le Maroc lorsqu’il était isolé, et paraître hésitante au moment où la communauté internationale évoluait en sa faveur.
L’idéal aurait été de pouvoir élever le débat en déployant une nouvelle argumentation juridique, justifiant la souveraineté marocaine sans effets collatéraux inutiles sur l’Algérie. Cela aurait supposé que les autorités s’appuient sur des travaux académiques, qui faisaient alors défaut.
Par conséquent, la France s’est trouvée intellectuellement dépourvue. En effet, elle a dû affronter sa hantise de toujours au Maghreb : un choix de type « lui ou moi » entre les deux voisins. En juillet 2024, le président Emmanuel Macron a écrit au roi Mohammed VI qu’il « considér[ait] que le présent et l’avenir du Sahara occidental s’inscriv[aient] dans le cadre de la souveraineté marocaine68 ». Ce geste majeur en direction du Maroc a été facilité par des tensions avec l’Algérie. Mais, de ce fait même, il a été ressenti comme encore plus hostile par cette dernière, tétanisée par les droits historiques et le soutien occidental au Maroc.
C’est là qu’une argumentation alternative pourrait aider, fût-ce modestement. Le pouvoir algérien comporte peut-être des responsables cyniques, cherchant à gêner le Maroc à tout prix. On ne saurait céder à cela.
Mais il compte aussi des diplomates sincères. C’est tout particulièrement vrai sur le chapitre du droit international, domaine dans lequel l’Algérie a énormément investi, ce serait les priver de porte de sortie. En effet, cela revient à laisser sans réponse l’affirmation selon laquelle la souveraineté marocaine serait incompatible avec le droit international.
Le Sahara occidental est devenu pour Alger un enjeu d’amour-propre. L’intérêt du Maroc n’est pas que cette plaie soit avivée. In fine, la solution du conflit exigera la coopération des deux pays, notamment pour traiter la question des populations des camps, sujet crucial s’il en est.
L’enrichissement du référentiel marocain
Tout en musclant sa diplomatie, le Maroc a enrichi sa réflexion et son action. Deux institutions, parmi d’autres, ont été motrices.
L’une d’entre elle est l’Office chérifien des Phosphates (OCP), entreprise publique et leader mondial de sa spécialité. Sous l’impulsion du président nommé par le roi Mohammed VI, Mostafa Terrab, l’Office a déployé à l’échelle du Maroc une stratégie de responsabilité sociale et environnementale (RSE). Ceci a notamment pris la forme d’actions de développement structurantes au Sahara occidental. Les bénéfices des phosphates exploités dans cette région y sont entièrement réinvestis, avec vérification par audit. Le recrutement de personnels locaux est privilégié et la population associée à la mise en œuvre des actions développement. L’Agence française de développement juge cette méthode exemplaire et son directeur général, Rémy Rioux voit dans le développement du territoire une source majeure de légitimité pour le Maroc.
L’OCP a également permis la création, à Rabat, d’un think tank permettant au Maroc d’élargir sa participation au débat international, le Policy Center for the New South69. Dirigé par Karim El Aynaoui, personnalité issue de la Banque centrale, le Policy Center produit des travaux riches et respectés. Ses collaborateurs contribuent à renouveler la lecture des relation internationales, parmi d’autres sujets. Grâce à des chercheurs comme Mohammed Loulichki et Jamal Machrouh, les débats sur l’autodétermination et l’intangibilité des frontières ont acquis une profondeur inédite.
Moins connue à l’étranger, l’Agence de développement des provinces du Sud70 a été créée en 2002 pour accélérer les investissements publics au Sahara occidental. Son premier directeur général, Ahmed Hajji, a été nommé par le roi Mohammed VI au titre de sa réputation professionnelle dans la conduite des projets d’infrastructures. Il fait aussi partie des hauts fonctionnaires du ministère marocain de l’intérieur qui se sont engagés en faveur des politiques culturelles, un aspect peu connu de l’action de cette administration.
Cette agence interministérielle fait de la promotion de la culture sahraouie une priorité, année après année. Elle commande des travaux de sciences humaines qui nourrissent une lecture plus concrète et moins idéologique de la situation (la présente étude doit beaucoup à ces travaux).
Au rôle structurant des institutions, s’ajoute l’apport des nouvelles générations d’historiens marocains. Parmi eux, Jillali El-Adnani, qui a enrichi la connaissance des liens entre le Sahara occidental et les régions plus au nord. Ses travaux (cités en bibliographie) tranchent avec la littérature relevant du récit national car ils ne passent pas sous silence les faits allant en sens inverse de la thèse qu’il retient. Il reconnaît honnêtement l’affaiblissement du pouvoir sultanien, au XIXe siècle dans les régions du Sahara occidental. Il établit que, du temps de la colonisation, la France et l’Espagne ont cherché à distendre les liens nord-sud le reliant au Maroc, au profit, soit d’un isolement (Espagne) soit de lien est-ouest avec l’Algérie (France). Par ailleurs, ces liens ne se limitaient pas à l’allégeance : les échanges économiques, les mouvements humains et les pratiques pastorales leur donnaient une densité que cet historien met en lumière.
Cette recherche va au-delà de la notion classique de droits historiques. Elle souligne les injustices d’origine coloniale. Elle montre combien le Sahara occidental est géographiquement partie prenante du Maroc. Par ailleurs, l’historien Rahal Boubrik (également cité en bibliographie) martèle une observation : à ses yeux, la France et l’Espagne reconnaissent qu’elles ont naguère nui aux liens entre le Sahara occidental et le Maroc. Il est difficile de lui donner tort.
Équité et légalité
Le talon d’Achille du droit positif dans le dossier est sa relation approximative aux faits. On a postulé l’existence d’une nation sahraouie, affirmation de science politique jamais démontrée. L’autoproclamation suivie d’une reconnaissance du bout des lèvres par certaines instances de l’ONU a été transformée en preuve. Cette transformation était un sophisme.
Il est souhaitable que les travaux académiques s’emparent du sujet. La solution à rechercher en dépend. Si les populations saharaouies sont considérées comme des peuples autochtones ainsi qu’il en existe des centaines, voire des milliers, alors la procédure référendaire n’a guère de sens.
La solution réside dans la protection de leur culture et la restauration de leur mode de vie quand elles le souhaitent. Le droit international offre des instruments : les notions de droits humains, de non-discrimination, de peuples autochtones, de statut d’autonomie à finalité culturelle.
Dès lors que l’existence d’une nation n’est pas prouvée, l’idée d’indépendance est affaiblie. A l’inverse, il existe des pistes pour mieux asseoir la cause marocaine au regard du droit. Les chercheurs peuvent travailler sur les indices de souveraineté dans trois directions :
– L’histoire et la géographie du territoire. Celui-ci est dans le prolongement du nord du Maroc, qui détenait des droits.
– Le rapport de l’État marocain à la diversité. L’empire chérifien n’a pas recherché l’effacement des différences culturelles. L’hypothèse d’une tension essentialiste avec l’identité sahraouie peut probablement être réfutée. L’action de développement économique et culturel de l’État marocain en faveur du territoire va dans le même sens.
– La géopolitique. La stabilité du Maroc en fait un pays stratégique et un maillon nord-sud. Sa souveraineté au Sahara occidental est compatible avec un cadre régional équilibré, incluant l’inviolabilité des actuelles frontières algériennes et mauritaniennes.
Conclusion
La thèse de l’infraction marocaine s’est imposée en 1975 sur des bases qui se révèlent approximatives et biaisées.
Il est donc légitime et nécessaire de reprendre et approfondir la réflexion juridique. Celle-ci devra mieux intégrer les apports de l’histoire, de la science politique et des autres sciences sociales. Il faudra questionner l’existence d’une nation saharaouie.
Il conviendra également de prendre en compte, au-delà des droits historiques qu’il invoque, les autres éléments de légitimité dont le Maroc pourrait se prévaloir.
Ceci exige un débat apaisé, nourri par une relance des travaux académiques. La discussion a été confisquée par les caricatures et les polémiques. Pour dégeler le conflit, il faut d’abord dégeler le débat.
Bibliographie sélective
Droit international et interprétation des résolutions ONU et OUA
Sâ Benjamin Traoré, L’interprétation des résolutions du Conseil de sécurité, Contribution à la théorie de l’interprétation dans la société internationale, Éditions Hebling Lichtenhahn, Bâle, 2020. Thèse de doctorat de la Faculté de droit de Neuchâtel soutenue en 2018.
« La formation du droit international dans le cadre des Nations unies », Alain Pellet, European Journal of International Law, Volume 6, Issue 3, 1995, p. 401-425 [en ligne].
Michel Virally, « Droit international et décolonisation devant les Nations unies », Annuaire français de droit international, vol. IX, 1963, Éditions du CNRS, Paris.
Mohammed Loulichki, L’intangibilité des frontières africaines à l’épreuve des réalités contemporaines, PCNS, 2018.
« La Minurso, 25 ans au service de la paix au Sahara occidental », Michel Liégeois (Professeur à l’Université de Louvain) et Salomé Ponsin, Recherches internationales, 2015, N° 103, p. 123-137.
Mathias Forteau, Alina Miron et Alain Pellet, Droit international public, LGDJ, 9e édition.
Sources favorables au point de vue marocain
Robert Rézette, Le Sahara occidental et les frontières marocaines, Nouvelles éditions latines, Paris, 1975.
Charles Henneghien, Sahara. Tunisie, Maroc, Mauritanie, Algérie, Niger, Mali, Libye, Éditions La Renaissance du Livre, Collection L’esprit des lieux, Tournai, 2000.
Jillali El Adnani, Le Sahara à l’épreuve de la colonisation, Un nouveau regard sur les questions territoriales, Faculté des Lettres et Sciences humaines, Rabat, 2021.
Rahal Boubrik, La question du Sahara. Aux origines d’une invention coloniale, La croisée des chemins, Casablanca, 2022.
Jamal Machrouh et Florent Parmentier, Vers une Communauté de l’Atlantique oriental, PCNS, 2025.
Mohammed Loulichki, Cap sur l’autonomie au Sahara ; une dynamique en marche, PCNS, avril 2025.
Sources défavorables ou réservées à l’égard du point de vue marocain
Sophie Caratini, La République des Sables. Anthropologie d’une Révolution, L’Harmattan, Paris, 2003.
Yahia Zoubir, Stalemate in Western Sahara: Ending international Legallity, Yahia H. Zoubir, Middle East Policy, Volume XIV, N°4, Winter 2007.
Yahia Zoubir, « Le conflit du Sahara occidental : enjeux régionaux et internationaux », CERI, Sciences Po, 2010 [en ligne].
Tribune de Khadija Mohsen-Finan , « Au Sahara occidental, Paris appuie une initiative marocaine destinée à contourner le droit international », Le Monde, 8 août 2024 [en ligne].
Brahim Oumansour, « Tensions entre l’Algérie et la France : une crise à enjeux multiples » – Le Rubicon, 2025 [en ligne].



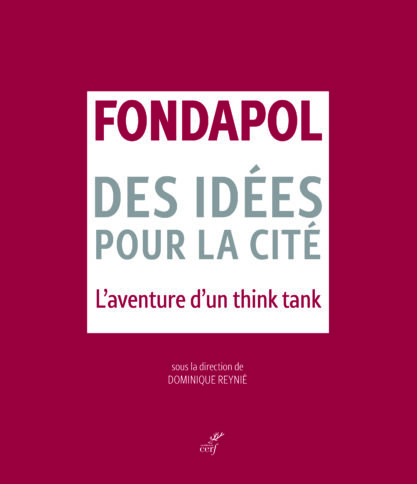
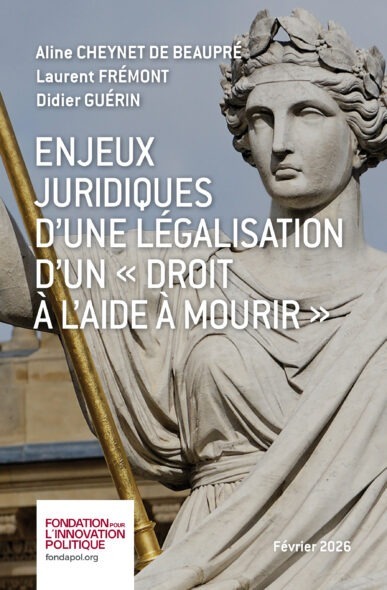
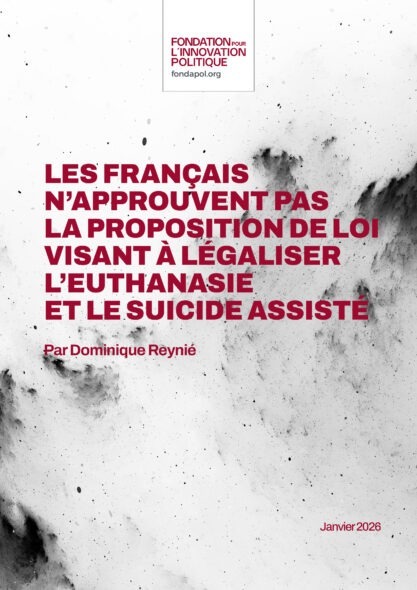








Aucun commentaire.