Va-t-on légaliser la mort provoquée ? La psychiatrie face au risque de l'euthanasie et du suicide assisté
État des lieux de la psychiatrie en France: enjeux et perspectives
La prévention du suicide en France
Les chiffres du suicide
Les stratégies actuelles de la prévention du suicide
Un peu d’histoire
Une proposition de loi face au enjeux de la psychiatrie
La proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir
Une proposition de loi mettant en difficulté la psychiatrie
Une proposition de loi aux lourdes conséquences
Conclusion
Résumé
L’adoption d’une loi autorisant le recours à l’euthanasie ou au suicide assisté pour les personnes souffrant de troubles psychiques entrerait en contradiction absolue avec la politique publique de prévention du suicide que les psychiatres assurent au quotidien. Comment ne pas voir qu’une légalisation de la mort provoquée pourrait donner à penser que le suicide est une solution souhaitable à la souffrance psychique ?
En outre, la proposition de loi semble vouloir ignorer l’état de faiblesse dans lequel se trouvent les personnes souffrant de troubles psychiques. Il ne suffit pas de préciser, comme croit pouvoir le faire cette proposition en son article 6, qu’une « personne dont le discernement est gravement altéré […] ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée » puisqu’il reste à savoir comment une personne confrontée à des souffrances psychiques et aspirant à s’en libérer pourrait ne pas subir une altération de son discernement.
Les députés français ne semblent pas considérer la prudence du législateur canadien qui a décidé à plusieurs reprises de reporter l’application de la loi sur l’euthanasie et le suicide assisté aux personnes souffrant de troubles psychiques, par crainte de dérives catastrophiques.
Dans le contexte français d’une détérioration de l’offre de soins psychiatriques que les députés ne peuvent pas méconnaître, autoriser la mort provoquée fragilisera plus encore un secteur médical en crise, au détriment des professionnels de santé et au risque d’inciter les patients les plus fragiles à demander la mort.
Aujourd’hui, ce sont 13 millions de Français qui souffrent de troubles psychiatriques ; la dépression affecte 15 à 20% de la population ; 9.200 personnes se sont donné la mort en 2022 et le suicide est responsable de 13,5% des décès chez les jeunes de 15 à 24 ans.
Dr Françoise Chastang,
Psychiatre en unité d’urgences psychiatriques – Service universitaire de psychiatrie adulte CHU Caen Normandie
Dr Cécile Omnès,
Psychiatre au dispositif VigilanS 78-95 – Centre hospitalier de Plaisir

Va-t-on légaliser la mort provoquée ? Le handicap face au risque de l'euthanasie et du suicide assisté

Va-t-on légaliser la mort provoquée ? La gériatrie face au risque de l'euthanasie et du suicide assisté

Les non-dits économiques et sociaux du débat sur la fin de vie
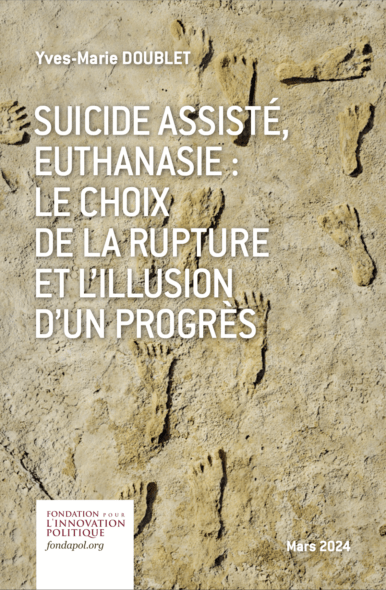
Suicide assisté, euthanasie : le choix de la rupture et l'illusion d'un progrès
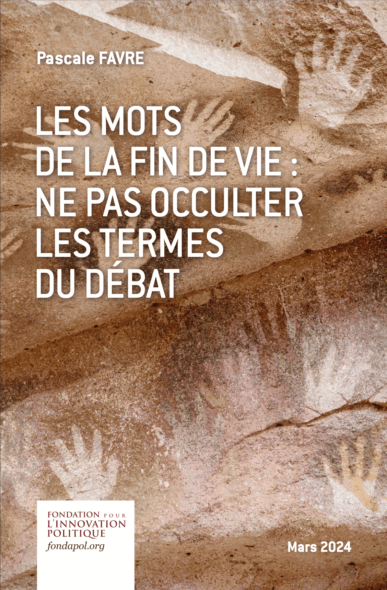
Les mots de la fin de vie : ne pas occulter les termes du débat
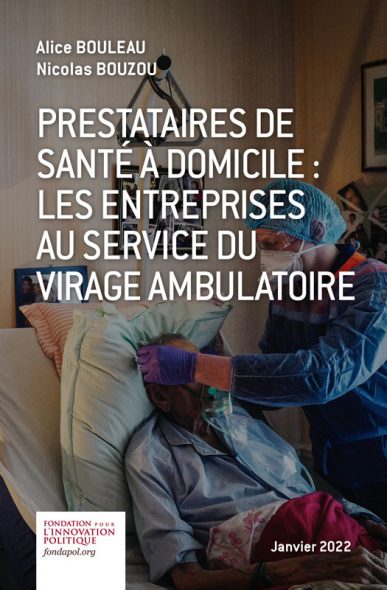
Prestataires de santé à domicile : les entreprises au service du virage ambulatoire
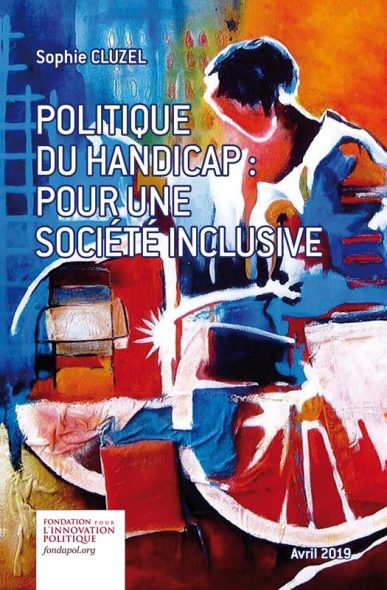
Politique du handicap : pour une société inclusive
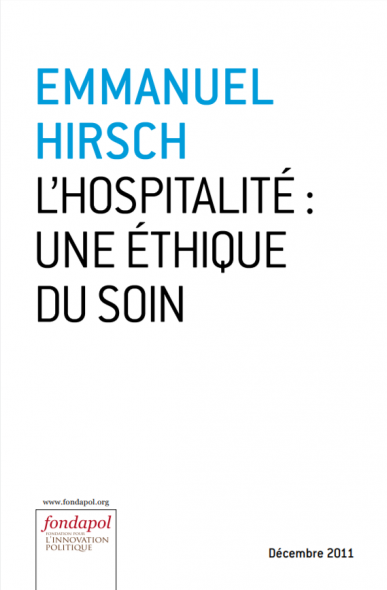
L’hospitalité : une éthique du soin
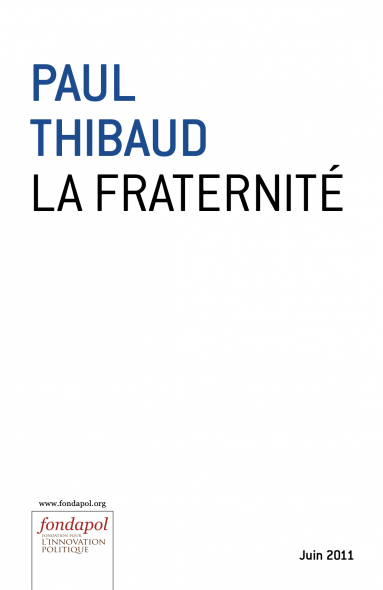
La fraternité
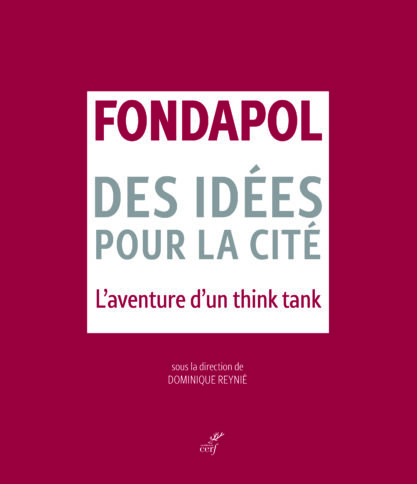
Fondapol - Des idées pour la Cité - L'aventure d'un think tank
La coordination des trois notes Va-t-on légaliser la mort provoquée ?
a été assurée par Dr Pascale Favre et Yves-Marie Doublet.
Cette étude reprend certains éléments de la thèse suivante : La mort choisie pour raison psychique ou existentielle : de l’autodétermination à la rencontre éthique. Dirigée par Emmanuel Hirsch et Jean-Marc Baleyte, cette thèse a été soutenue par Madame Françoise Chastang, coautrice de la présente contribution, le 19 décembre 2023 à l’université Paris-Saclay [en ligne].
Albert Camus, L’Homme révolté, Paris, Gallimard, 1951, Introduction.
Puisque toute action aujourd’hui débouche sur le meurtre,
direct ou indirect, nous ne pouvons pas agir avant de savoir si,
et pourquoi, nous devons donner la mort. L’important n’est donc
pas encore de remonter à la racine des choses, mais, le monde étant
ce qu’il est, de savoir comment s’y conduire.
Albert Camus, L’Homme révolté2
État des lieux de la psychiatrie en France: enjeux et perspectives
Proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir adoptée par l’Assemblée nationale le 27 mai 2025, T.A. n° 122 [en ligne].
Sénat, Michel Amiel, Situation de la psychiatrie des mineurs en France, Rapport d’information n° 494 (2016-2017), 2017 [en ligne] ; Sénat, Céline Brulin, Daniel Chasseing, Jean Sol, Santé mentale et psychiatrie : pas de « grande cause » sans grands moyens d’information, Rapport d’information n°787 (2024-2025), 2025 [en ligne] ; Assemblée nationale, Nicole Dubré-Chirat et Sandrine Rousseau, Rapport d’information déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des affaires sociales, en conclusion des travaux d’une mission d’information sur la prise en charge des urgences psychiatriques n°714, 2024 [en ligne] ; Cour des comptes, « La pédopsychiatrie. Un accès et une offre de soins à réorganiser », Rapport de communication à la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, mars 2023 [en ligne].
Drees, « L’offre de soins de psychiatrie dans les établissements de santé », Les établissements de santé en 2023, Édition 2025, p. 90-98 [en ligne].
Ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, Santé mentale et psychiatrie. Synthèse du bilan de la feuille de route. État d’avancement au 3 mars 2023 [en ligne].
Romain David, « Près de deux ans après les assises de la psychiatrie, le secteur de la santé mentale toujours en état d’urgence », Public Sénat, 23 mai 2023 [en ligne].
Ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, « Santé mentale et psychiatrie : Agnès Buzyn présente sa feuille de route pour changer le regard sur la santé mentale et les personnes atteintes de troubles psychiques », Communiqué de presse, 28 juin 2018 [en ligne].
Ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, Santé mentale et psychiatrie. Synthèse du bilan de la feuille de route. État d’avancement au 1er mai 2025, Dossier de presse, p.5 [en ligne].
Cour des comptes, « Les parcours dans l’organisation des soins de psychiatrie », Rapport public thématique, février 2021 [en ligne].
Christine Chan Chee, Claire Gourier-Fréry, Romain Guignard, François Beck : « État des lieux de la surveillance de la santé mentale en France », Santé publique, volume 23, supplément n° 6, novembre-décembre 2011, p. 13-29 [en ligne].
Fédération hospitalière de France, Communiqué de presse : « Répondre à l’urgence et bâtir l’avenir de la psychiatrie : présentation des propositions de la FHF », avril 2024 [en ligne].
Ibid. ; Conseil national de l’Ordre des médecins, Docteur François Arnault, Atlas de la démographie médicale en France. Situation au 1er janvier 2025 [en ligne].
Cese, Améliorer le parcours de soin en psychiatrie, Avis du Conseil économique, social et environnemental présenté par Alain Dru et Anne Gautier au nom de la section des affaires sociales et de la santé, 24 mars 2021 [en ligne].
Ifop, « L’impact du reste à charge sur le renoncement aux soins médicaux », 21 septembre 2023 [en ligne].
Comité consultatif national d’éthique.
CCNE, Avis 147. Enjeux éthiques relatifs à la crise de la psychiatrie : une alerte du C.C.N.E., janvier 2025 [en ligne].
Aude Caria, Simon Vasseur-Bacle, Sophie Arfeuillère, Céline Loubières, « Lutter contre la stigmatisation dans le champ de la santé mentale : quelques recommandations », Actualité et Dossier en Santé Publique n° 84, septembre 2013, p. 40-42 [en ligne].
La proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir3 n°1100 arrive à un moment où la psychiatrie publique française, exsangue, est confrontée à une augmentation sans précédent des troubles psychiques et des crises suicidaires, particulièrement chez les jeunes. À la suite de nombreux rapports4 produits ces dernières années, le diagnostic de la situation est maintenant bien connu de tous. Les professionnels et les usagers sont profondément inquiets de l’absence de perspective d’une réelle réforme du système de santé, notamment pour la psychiatrie, alors même que les groupes privés se sont mis sur ce marché particulièrement rentable5 avec le risque de négliger les plus vulnérables.
Cette crise arrive dans le contexte d’une forte augmentation des troubles psychiatriques. Ces derniers touchent près de 20% de la population, soit 13 millions de Français, par ailleurs considérés comme les plus gros consommateurs de psychotropes du monde. La dépression frappe 15 à 20% de la population, et trois millions de Français souffrent de dépression sévère6. Les troubles psychiatriques représentent le premier poste de dépenses de santé, devant le cancer et les risques cardio-vasculaires, soit 14,5% de la facture annuelle avec 23,4 milliards d’euros pour l’Assurance maladie, auxquels s’ajoutent 30 milliards d’euros d’aides indirectes7. Malgré une politique gouvernementale favorable dès 2018 avec la feuille de route éditée par Agnès Buzyn « pour changer le regard sur la santé mentale et les personnes atteintes de troubles psychiques »8, la pandémie de COVID-19 n’a fait qu’accélérer un phénomène annoncé il y a 20 ans par l’OMS. L’explosion des troubles psychiques en période post-pandémique a conduit à considérer en 2025 la « santé mentale », champ bien plus vaste que la psychiatrie, comme grande cause nationale, avec pour ce faire un effort gouvernemental annoncé de trois milliards d’euros9, dans le contexte d’une enveloppe budgétaire fermée et l’annonce d’un plan d’économies sans précédent, y compris sur la santé.
Comment en arrive-t-on à cette situation ?
La psychiatrie française souffre cruellement :
– d’une stigmatisation ancienne systémique, délétère tant pour les patients que pour la profession ;
– d’une absence de volonté politique dans la durée malgré les alertes, dans une vision sécuritaire des troubles psychiques, sans réelle politique de santé publique et de prévention, au nom d’une spécialité jugée trop complexe et non médicale du fait de ses interfaces avec le social, l’éducation, la culture, la philosophie et l’éthique ;
– d’une inégalité d’accès aux soins10 à la suite d’un développement des pratiques sur les territoires sans vision des besoins de cette spécialité ni indicateur jusqu’aux années 201011 ;
– d’une pénurie médicale et professionnelle majeure, prenant sa source dans la stigmatisation, l’absence d’anticipation des changements sociétaux et de l’augmentation des besoins, l’absence d’adaptation du système à ces mêmes changements. Les psychiatres désertent le service public devenu peu attractif, et souffrent d’une perte de sens dans un contexte de contraintes multiples. En effet, plus d’un quart des postes vacants dans 40% des établissements et 25% des établissements sont en grande difficulté pour répondre aux besoins de la population sur l’année 202312. Le vieillissement des médecins généralistes et des psychiatres pour les dix prochaines années ne peut qu’aggraver la situation actuelle13.
Comme conséquence de cette situation s’est instauré un cercle vicieux très coûteux humainement et financièrement.
Les difficultés d’accès aux soins14, le renoncement aux soins par suite de problèmes financiers15, le repérage tardif des troubles émergents et des crises suicidaires génèrent un indubitable retard dans la mise en place et dans l’accès aux soins. C’est ainsi que l’on déplore l’aggravation des pathologies et du handicap psychique, l’accroissement des tentatives de suicide – particulièrement chez les jeunes femmes de 10 à 25 ans et les femmes en post-partum, une augmentation des appels au SAMU et des passages par les urgences avec saturation de ce système devenu parfois la seule porte d’entrée pour recevoir les soins psychiatriques.
Se rajoute depuis plusieurs années la pénurie durable et actuellement cruciale de psychotropes qui engendre des ruptures de soins et des décompensations, conduisant à des hospitalisations pourtant évitables et marginalisant encore plus les patients souffrant de pathologies psychiatriques.
Pour enrayer cette situation alarmante, une volonté politique forte et durable s’impose, avec des moyens dédiés suffisants assortis d’orientations claires et indispensables construites sur un continuum de la prévention aux soins. Déclarer la santé mentale grande cause nationale 2025 sans moyens spécifiques ni réforme profonde du système de santé et des soins psychiatriques ne suffit pas.
Face à l’ampleur de cette crise, le CCNE16, comme d’autres instances, insiste dans son avis 147 sur l’urgence d’investir dans un plan de psychiatrie ambitieux à la hauteur des défis actuels. Ainsi est-il précisé : « Il s’agit non seulement d’une exigence sanitaire, mais aussi d’un enjeu d’éthique, visant à préserver la cohésion sociale et à construire une société plus solidaire et résiliente17 ».
Les pistes à construire sont connues, en France comme à l’étranger. Doivent être associés :
– la lutte à tous les niveaux contre la stigmatisation de cette spécialité et des patients qui en relèvent18 ;
– un choc d’attractivité pour le service public indispensable au maintien d’un accès aux soins pour tous sans distinction ;
– une formation professionnelle intégrant la déstigmatisation, dès les premières années d’études en santé, un code de bonnes pratiques et pour les internes un exercice hors CHU territorial ;
– un décloisonnement des parcours de soins et de vie pour les patients ;
– un modèle financier cohérent et non pénalisant pour les établissements et les professionnels engagés ainsi que les patients et leur famille, n’aggravant pas la fracture sociale qui est souvent à l’origine des troubles psychiques puis psychiatriques.
« L’investissement dans la santé mentale est un investissement dans une vie et un avenir meilleur pour tous19 », générant des économies sur deux générations.
La prévention du suicide en France
Les chiffres du suicide
Observatoire national du suicide, Suicide, mal-être croissant des jeunes femmes et fin de vie. Penser les conduites suicidaires au prisme de l’âge et du genre, 6ème Rapport, février 2025 [en ligne].
Dans le champ de la psychiatrie, et particulièrement de la prévention du suicide, les initiatives politiques sont d’autant plus nécessaires que les chiffres du suicide restent importants en France.
Selon l’Observatoire national du suicide20, après une diminution de la mortalité par suicide de 32% en France entre 2000 et 2020, les chiffres accusent une légère remontée depuis 2020, restant supérieurs à la moyenne européenne de 10,2/100.000. On estime qu’il y a environ 9.200 décès par suicide en 2022, soit un taux de 13,4/100.000 habitants, avec une forte progression chez les personnes âgées, plus particulièrement les hommes de plus de 85 ans, ainsi que chez les jeunes femmes de moins de 25 ans, dont le taux a été multiplié par deux entre 2015 et 2022. Cette évolution n’est que partiellement expliquée par la crise sanitaire, qui n’a fait qu’amplifier une tendance antérieure. Le suicide est trois fois plus fréquent chez les hommes que chez les femmes, les personnes les plus touchées étant les hommes entre 45 et 54 ans et les personnes âgées de plus de 74 ans. Il reste la deuxième cause de mortalité chez les jeunes. Lors d’un suicide, 90% des jeunes sont atteints d’un trouble psychique, principalement la dépression et l’anxiété, souvent associé à un mésusage de l’alcool.
Par ailleurs, près de 5% de la population adulte déclarent avoir eu des idées suicidaires dans l’année écoulée et plus de 7% avouent avoir entrepris un geste suicidaire au cours de sa vie. On estime à plus de 200.000 le nombre annuel des gestes suicidaires en France, avec une majorité de situations dans lesquelles est retrouvée une pathologie psychiatrique sous-jacente, en particulier une dépression. Le coût annuel des suicides et tentatives de suicides en France pour l’année 2019 a été évalué à respectivement 18,5 milliards d’euros et 5,4 milliards d’euros, dont 566 millions et 75 millions d’euros en coût direct21.
Considéré comme une cause de mort hautement évitable, le principal écueil de la prévention du suicide réside en sa dimension multifactorielle. Malgré ces difficultés, il est possible d’infléchir le nombre de suicides, à condition de mettre en place des actions combinées.
Les stratégies actuelles de la prévention du suicide
Ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, Le dispositif de recontact VigilanS, [en ligne].
Santé Publique France, 5 septembre 2023 Communiqué de presse, « Prévention du suicide : VigilanS, un dispositif efficace face au risque de récidives des tentatives de suicide », 5 septembre 2023 [en ligne].
C’est-à-dire d’accompagnement des personnes exposées à un décès par suicide.
Réaffirmée comme priorité de santé publique en 2018, la prévention du suicide s’appuie sur une stratégie nationale multimodale portée par le ministère de la Santé et mettant en œuvre de façon coordonnée un ensemble d’actions intégrées dans les territoires.
Le premier point est le maintien du lien avec les personnes ayant fait une tentative de suicide par le biais du dispositif Vigilans22 qui permet le recontact des personnes ayant fait une tentative de suicide. Ce dispositif national a permis une diminution de 38% du risque de réitération suicidaire dans les 12 mois suivant leur tentative de suicide chez les patients suivis23, avec une évaluation médico-économique montrant qu’un euro investi dans ce dispositif permet d’économiser deux euros de coûts de santé.
Le deuxième point consiste à déployer des formations graduées sur la crise, permettant repérage, évaluation et intervention auprès des personnes à risque suicidaire afin de créer dans les territoires de santé des réseaux de personnes relais, capables de repérer les personnes en souffrance et d’agir en lien avec les professionnels de santé pour leur prise en charge.
Le troisième point promeut le développement d’actions ciblées pour lutter contre le risque de contagion suicidaire, par le biais d’actions de postvention24, par la promotion d’un traitement médiatique approprié du suicide en lien avec le programme Papageno25, par le repérage et la sécurisation des lieux à risque suicidaire. Ce dispositif ambitieux est complété par la mise en place d’un numéro national de prévention du suicide, le 3114, accessible sept jours sur sept et 24 heures sur 24 sur l’ensemble du territoire, permettant une prise en charge immédiate des personnes suicidaires par des professionnels du soin.
Enfin, la prévention du suicide s’inscrit dans une stratégie plus large de promotion de la santé mentale et de prévention de la souffrance psychologique.
Comme d’autres pays où le taux de suicide est assez élevé, avec des systèmes de soins complexes et coûteux ainsi que des actions de prévention du suicide déclinées depuis de longues années, la France se caractérise par un double mouvement paradoxal, à savoir la coexistence d’une stratégie de prévention du suicide nationale forte, dynamique et structurée, avec un projet de loi sur l’aide à mourir proposant le suicide assisté et l’euthanasie, projet contenant les germes d’une potentielle dérive vers une extension des souffrances psychiques, de la même manière que d’autres pays ayant légiféré avant nous.
Un peu d’histoire
L’Antiquité gréco-latine fournit de multiples exemples de suicides de personnes célèbres, comme celui de Sénèque sous la Rome antique. Le christianisme a ensuite assimilé le suicide à un péché, tandis que l’interdit royal en a fait un acte criminel devant être puni, ce qui fut notamment conforté par l’ordonnance criminelle de 1670. L’absence de sépulture, le châtiment des cadavres et la confiscation des biens a durablement imprégné les esprits.
Puis, au XVIIIe siècle, on assiste peu à peu à la « suppression de l’incrimination pour suicide », suppression notamment confirmée dans le Code pénal de 1791. C’est également l’époque d’une vague de suicides sans précédent chez les jeunes en Europe à la suite de la parution en 1774 de l’ouvrage de Goethe, Les souffrances du jeune Werther. C’est par analogie avec cette vague de suicides que l’effet « contagion » du suicide est actuellement nommé « effet Werther ». Les philosophes des Lumières ont eux-mêmes des positions contrastées. Emmanuel Kant, au nom de la loi morale et du devoir, considère que porter atteinte à soi-même revient à considérer l’être humain comme un moyen et non comme une fin, et s’oppose donc au suicide, alors que David Hume et John Stuart Mill soutiennent le principe de la liberté individuelle sans limites dans les différents aspects de la vie, y compris face à la mort.
Aux XIXe et au XXe siècles, le suicide devient objet d’étude, tant dans le domaine sociologique avec les travaux de Durkheim26 et de Halbwachs27, que dans le domaine psychiatrique où il est lié à la folie selon les aliénistes de l’époque, et donc objet d’exclusion dans le silence des asiles, refoulé dans les interdits implicites, dans des conditions presque idéales de renforcement d’un tabou historiquement et socialement constitué.
Aux XXe et XXIe siècles, le suicide, reconnu au terme d’un long parcoursc omme priorité de santé publique, entre définitivement dans le domaine des soins et de la prévention. Cette priorité débute par les vecteurs de sociabilité, avec en Angleterre le révérend Chad Varah et ses Samaritains en 1953, prélude en France des centres d’écoute comme SOS Amitié dès les années 1960. L’OMS prend position dès 1969, considérant que la problématique suicidaire est devenue un enjeu majeur et urgent de santé publique dans les pays industrialisés. À cette même époque est publié le livre Suicide, mode d’emploi : Histoire, technique, actualité de Guillon et Le Bonniec, suscitant de violentes polémiques. Cet ouvrage libertaire, qui prône une attitude favorable au suicide, est une véritable bombe médiatique signant pour les personnes engagées dans la prévention du suicide la banalisation la plus extrême d’un comportement de désespoir et la facilitation de l’accès aux moyens. Devant une intense mobilisation et malgré les positions des tenants de la liberté individuelle, l’ouvrage est interdit en 1987, et l’incitation au suicide est réprouvée. Parallèlement se crée en France en 1969 le Groupement d’études et de prévention du suicide (GEPS), affilié à l’Association internationale de prévention du suicide, et qui deviendra avec la future Union nationale de prévention du suicide (UNPS), l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics dans le domaine de la prévention du suicide.
Cette présentation succincte revient sur les représentations collectives résultant de l’idée de suicide, représentations traversées par des valeurs morales issues de la religion et de la philosophie, formant désormais le terreau de notre culture. Ces valeurs contiennent en outre tous les éléments susceptibles de promouvoir une large définition de la mort provoquée dont la véritable pierre d’achoppement demeure la souffrance. C’est cette souffrance humaine insupportable qui est à prendre en considération et contre laquelle il est nécessaire de lutter.
Une proposition de loi face au enjeux de la psychiatrie
La proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir
L’avant-projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie déposé en 2024 comprenait initialement deux parties qui ont par la suite été séparées en sujets autonomes. La première vise à « garantir les soins palliatifs et renforcer les soins d’accompagnement et les droits des personnes malades partout sur le territoire », et la seconde concerne « l’aide à mourir28 ». L’Assemblée nationale a adopté en première lecture, le 16 mai 2025, la proposition de loi relative aux soins palliatifs, et le 27 mai celle relative à l’aide à mourir. Ces textes seront soumis au Sénat en octobre 2025.
Il importe de souligner que la psychiatrie, tout comme l’Observatoire national du suicide, fut curieusement absente des auditions parlementaires, au nom du fait que les troubles psychiatriques en étaient apparemment exclus. Néanmoins, l’idée des psychiatres intéressés par le champ de la mort provoquée était d’y participer et, en s’appuyant sur l’expérience des pays voisins, d’alerter sur leurs inquiétudes quant aux critères élargis et subjectifs de la « souffrance psychologique », et défendre le champ de la prévention du suicide.
Sous l’expression « aide à mourir », le projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie introduit, pour « une personne qui en a exprimé la demande », « apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée », la possibilité de « recourir à une substance létale […] afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ». Par ailleurs, ces personnes doivent être « atteintes d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale », et « présenter une souffrance physique ou psychologique constante liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement. […]. Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir29 ».
La décision médicale est transmise à la personne dans les deux semaines suivant la consultation, et le demandeur bénéficie d’un délai minimal de 48 heures pour confirmer sa décision, la procédure ayant une validité de 3 mois. Ce délai de réflexion réduit fait fi aussi bien de l’ambivalence de la personne concernée que de la complexité du fait psychique, prélude de la demande.
Sans les citer explicitement, cette proposition de loi décrit parfaitement les modalités du suicide assisté et celles de l’euthanasie d’exception, comme si ne pas les nommer en atténuait l’importance, la violence, la gravité et les implications morales tant pour les personnes que pour la société. En y inscrivant l’expression « souffrance physique ou psychologique liée à cette affection » sans pour autant y introduire la nécessité d’un avis psychiatrique ou psychologique, qui serait particulièrement utile pour évaluer le discernement, elle laisse la porte ouverte à l’application d’une loi future aux souffrances psychiques.
Cette future loi tente de restreindre initialement les indications aux personnes au seuil de la mort sans pour autant exclure explicitement les personnes souffrant de troubles psychiatriques avérés. Cependant, les expériences des pays voisins, comme la Belgique ou les Pays-Bas, montrent que le suicide assisté est progressivement ouvert aux personnes en « phase avancée » de leur maladie sans même que le pronostic vital soit mis en jeu, ou aux « polypathologies » souvent mal définies. Les législations étrangères montrent également qu’exclure totalement les souffrances psychiques ou existentielles est illusoire. La mise en place législative est tellement complexe que le Canada en a reculé l’échéance, et que la Belgique et les Pays-Bas alertent sur les risques de l’extension des limites et sur la forte sensibilisation des enjeux éthiques.
La grande majorité de ces demandes est en lien avec une souffrance intolérable dont la part psychique est loin d’être négligeable. Puisqu’il est question de donner la mort, il serait licite d’être tout aussi exigeant que lorsqu’il s’agit d’une intervention pour greffe d’organe ou de chirurgie bariatrique, et de solliciter un regard spécialisé sur les mécanismes psychologiques afin de permettre une évaluation correcte des capacités de discernement. Sous-estimer la complexité et l’ambivalence de telles demandes conduit à confondre élimination de la souffrance et élimination du souffrant, aide à mourir et aide au suicide.
Une proposition de loi mettant en difficulté la psychiatrie
Émilie Olié et Raphaël Gourevitch, « La souffrance psychologique, jamais absente dans une demande d’aide à mourir », in Emmanuel Hirsch (dir.), Fins de la vie : les devoirs d’une démocratie, Cerf, 2025, p.351-361.
Joyce Travelbee, Aspects interpersonnels des soins infirmiers (2e éd.), FA Davis Company, 1971.
Marianne Dees, Myrra Vernooij-Dassen, Wim Dekkers, Chris van Weel “Unbearable suffering of patients with a request for euthanasia or physician-assisted suicide: an integrative review”, Psycho-oncology, 19(4), 2010, p. 339–352, [en ligne, par abonnement].
Ilana Levene, Michael Parker, “Prevalence of depression in granted and refused requests for euthanasia and assisted suicide: a systematic review”, Journal of medical ethics, 37(4), 2011 p.205–211, [en ligne].
Monica Verhofstadt, Kurt Audenaert, Kris Van den Broeck, Luc Deliens, Freddy Mortier, Koen Titeca, Dirk De Bacquer and Kenneth Chambaere, “Euthanasia in adults with psychiatric conditions: A descriptive study of the experiences of Belgian psychiatrists”, Science progress, 104(3), 2021 [en ligne].
Ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, Projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie, texte soumis à la délibération du Conseil des ministres [en ligne].
Institut Européen de Bioéthique, « + 16,6% : Pourquoi le nombre d’euthanasies continue-t-il d’augmenter en Belgique ? », 21 mars 2025 [en ligne].
Françoise Chastang, La mort choisie pour raison psychique ou existentielle : de l’autodétermination à la rencontre éthique, Université Paris-Saclay, 2023 [en ligne].
Ministère de la Justice du Canada, « Report de l’admissibilité à l’aide médicale à mourir pour les personnes dont le seul problème médical est une maladie mentale, proposé par les ministres de la Justice et de la Santé », Communiqué de presse, 2 février 2023 (en ligne).
François-Xavier Putallaz, « Suicide assisté : le contre-exemple suisse », in Emmanuel Hirsch (dir.), Fins de la vie : les devoirs d’une démocratie, Cerf, 2025, p.351-361.
Institut Européen de Bioéthique, « Canada : l’ONU recommande d’interdire l’euthanasie des personnes dont le décès n’est pas “raisonnablement prévisible” », 15 avril 2025 [en ligne].
Soizic Bonvarlet, « Aide à mourir : le projet de loi qui ouvrira cette possibilité assortie de “conditions strictes” examiné à l’Assemblée à partir du 27 mai », LCP, 11 mars 2024 [en ligne].
Pablo Chignard, « Fin de vie, le choix de Joseph », Le Nouvel Observateur, 13 mai 2021 [en ligne] ; Éric Favereau, Anne Bert : « Mourir sans souffrir, le droit de choisir », Libération, 13 septembre 2017 [en ligne] ; « La dernière lettre d’Anne Bert, euthanasiée lundi en Belgique », Le Journal du Dimanche, 2 octobre 2017 [en ligne].
Cédric Terzi, « Comment je suis devenu un fils indigne », Libération, 20 janvier 2024 [en ligne, par abonnement].
Violaine des Courières, Entretien de Matthias Savignac (MGEN) : « Sur la fin de vie, le rôle d’une mutuelle est de permettre à chacun d’avoir le choix », Marianne, 21 avril 2024 [en ligne, par abonnement].
Sylvine Plantier, « Fin de vie : “Elle est sortie de la résidence avec sa canne et un tabouret” », Le Nouvel Observateur, 29 mars 2023 [en ligne] ; Élodie Armand, « Son agonie a été insupportable, épouvantable : Sandrine Rousseau témoigne sur la fin de vie de sa mère à l’Assemblée nationale », La Voix du Nord, 23 mai 2025 [en ligne].
Charles-Édouard Notredame, Nathalie Pauwels, Michel Walter, Thierry Danel, Guillaume Vaiva, « Le traitement médiatique du suicide : du constat épidémiologique aux pistes de prévention », in La Presse Médicale, volume 44, numéro 12, partie 1, décembre 2015, p. 1243-1250, [en ligne].
Pascale Favre, « Derrière les demandes d’euthanasie, une liberté, vraiment ? », in E. Hirsch (Dir.), Fins de la vie : les devoirs d’une démocratie, Cerf, 2025, p. 381-395.
Jérôme Lefilliâtre et Pascale Robert-Diard, « Des membres d’Ultime Liberté bientôt jugés pour avoir importé des médicaments d’aide au suicide », Le Monde, 4 octobre 2024 [en ligne, par abonnement].
Chapitre VI – Dispositions pénales, Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, relative au droit à l’aide à mourir le 27 mai 2025, T.A. n° 122 [en ligne].
Ibid.
Plus précisément, de l’ « assistance » et du « secours » portés à « une personne en péril ».
Code pénal, article 223-13 : « Le fait de provoquer au suicide d’autrui est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d’une tentative de suicide » [en ligne].
Plus précisément, de « propagande » ou de « publicité » dans le texte.
Code pénal, article 223-14 : « La propagande ou la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de produits, d’objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende » [en ligne].
Code de la santé publique, article L333, [en ligne] ; Loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge [en ligne].
« La souffrance psychologique n’est jamais absente dans une demande d’aide à mourir30 ».
On considère la souffrance insupportable comme le facteur le plus fréquemment évoqué lorsqu’il s’agit d’accepter le suicide, et que d’autres souhaitent éviter par une demande d’aide à mourir. Chacun d’entre nous est d’accord, cette souffrance insupportable doit être soulagée.
La souffrance est un concept holistique complexe avec un aspect physique, psychologique, existentiel et social, en lien avec une dimension subjective et individuelle de l’expérience vécue. Elle peut être définie comme « une expérience qui varie en intensité, en durée et en profondeur. Elle est un sentiment de déplaisir qui va du simple inconfort transitoire mental, physique ou spirituel, à l’angoisse extrême et, au-delà de l’angoisse, qui peut atteindre la phase maligne de désespoir et la phase terminale de l’abandon de vie31 ».
Cette souffrance difficilement supportable est le résultat d’une interaction complexe entre les troubles de santé et les symptômes de la maladie, la personnalité, les expériences de vie personnelle et la situation sociale actuelle. La dimension subjective domine, comme en témoignent les réelles différences entre les motivations des personnes et les motivations perçues par les tiers et les soignants. Les motivations des patients demandeurs d’une aide médicale à mourir sont beaucoup plus souvent d’ordre psychologique et existentiel que ne le supposent soignants et entourage. Elle est donc avant tout une expérience intense, un profond ressenti personnel et subjectif unique en soi et par conséquent peu, voire non comparable aux expériences d’autrui, et surtout, qui ne laisse plus de choix, et encore moins de liberté. En d’autres termes, « une souffrance intolérable dans un contexte de demande d’aide médicale à la mort est l’expérience profondément personnelle d’une menace imminente réelle ou perçue pour l’intégrité ou la vie d’une personne, de durée significative et occupant une place centrale dans l’esprit de la personne32 ».
Cette subjectivité a pour conséquence l’absence de définition consensuelle de la souffrance insupportable. On prendrait donc des décisions de mort provoquée sans pouvoir préciser exactement ce qu’est une « souffrance insupportable » ? Et jusqu’où pourrait aller cette définition de « souffrance insupportable » ? Jusqu’à la souffrance existentielle ou la « fatigue de vivre » ? Jusqu’à la possibilité de demander une euthanasie pour « sentiment de vie accomplie » comme il en est régulièrement question aux Pays-Bas33 ?
La dernière Commission d’évaluation belge34 reconnaît que la souffrance psychique est présente chez 82% des personnes recourant à l’euthanasie, quelles que soient les pathologies en cause, et que cette souffrance tend à perdurer dans le temps y compris lorsque les douleurs sont apaisées, ce qui tendrait à en faire l’un des principaux facteurs, voire le principal, d’une telle demande de mort provoquée.
Prenons deux exemples, celui de la dépression dans le cadre de maladies graves, et celui de la personne âgée confrontée à sa finitude. La dépression, fréquente en cas de maladie grave ou chronique, touche 40% à 75% des patients cancéreux. Source de douleur psychologique, elle contribue à aggraver le pronostic de la maladie somatique. On constate parmi la moitié environ des personnes qui sollicitent une aide à mourir la prévalence de symptômes dépressifs, soit une proportion quasiment similaire à celle de la dépression dans les maladies somatiques chroniques35. Les conséquences en sont identiques, à savoir une vision pessimiste du monde, de soi, de ses relations, ainsi qu’un intense sentiment de perte d’espoir qui domine et envahit toutes les sphères de la vie36. Ce serait donc les mêmes motifs qui engendrent des pensées suicidaires ou qui peuvent conduire les personnes à une demande d’aide à mourir.
Chez la personne âgée, l’idée de la mort peut devenir un rempart contre un vécu de plus grande déchéance et la demande de mort peut traduire l’impossibilité de « vivre ainsi », pour reprendre l’expression des patients. La demande de « mourir avant » la déchéance leur permet d’espérer ne pas vieillir, ne pas peser, ne pas se considérer comme un fardeau pour l’entourage ou la société.
Une demande d’aide à mourir est davantage une libération de la souffrance, quand le choix de surmonter cette même souffrance semble hors de portée. Il serait donc possible, au nom de cette souffrance intolérable impossible à définir précisément, de prendre le risque d’éliminer le souffrant sous couvert d’éliminer la souffrance, alors même que le processus décisionnel est soumis à une temporalité différente en fonction des situations.
Lorsque la personne est en fin de vie, la confrontation à l’échéance de la mort est directe, et la question est celle du moment et des conditions de la mort. Lorsque le pronostic vital n’est pas engagé, la situation est différente, car la décision de mourir renvoie toujours à la complexité du fait psychique, à la relation ambivalente que tisse la personne avec la mort, à l’ambivalence du médecin et de la société. Cette même société délègue d’une certaine façon au médecin le pouvoir de faire mourir par exception d’euthanasie ou sur ordonnance, la différence morale entre les deux restant somme toute relativement ténue puisque dans les deux cas, c’est l’acte médical qui déclenche la mort. Et l’on peut sincèrement se demander si cette « aide à mourir » que permettra un jour la loi est une construction théorique, sociopolitique, ou une réelle nécessité médicale.
La question des troubles psychiatriques avérés mérite d’être posée.
Dans l’avant-projet de loi portant sur l’aide à mourir soumis en avril 2024, il était clairement noté : « Les personnes dont une maladie psychiatrique altère gravement le discernement lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peuvent pas être regardées comme manifestant une volonté libre et éclairée37», ce qui pouvait laisser penser que les troubles psychiatriques les plus graves étaient considérés comme exclus du champ d’une future loi. Ils ne le sont pourtant pas dans le projet de loi, seule la souffrance psychologique isolée y figure.
Or les troubles psychiques majeurs, comme par exemple les troubles sévères du comportement alimentaire, les troubles schizophréniques graves, certains troubles de l’humeur particulièrement résistants, représentent un nombre non négligeable de personnes atteintes de maladies chroniques, avec une morbidité et une mortalité de ces patients supérieures à la moyenne de la population générale et une espérance de vie réduite de 10 à 15 ans. Le parcours de vie est souvent chaotique, marqué par des violences précoces qui font le lit des futurs troubles psychiatriques.
Ces pathologies sont source de souffrances psychiques majeures, altèrent gravement la qualité de vie, sont dans certains cas sans solution thérapeutique satisfaisante, et peuvent engager le pronostic vital. Elles posent par conséquent la question du développement d’une psychiatrie palliative. Par ailleurs, nombre de patients souffrant de ces pathologies cessent d’eux-mêmes leurs traitements. Une future loi donnant la possibilité au patient de refuser le traitement proposé et de déposer une demande de mort provoquée ne peut que complexifier les prises en charge.
Il est tout à fait légitime de considérer qu’il n’est guère possible d’exclure les troubles psychiatriques d’une future loi portant sur la mort provoquée, au nom des souffrances intenses des patients et d’une non-discrimination, ce que démontrent parfaitement les expériences étrangères. Le 11ème rapport de la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie belge faisant état des chiffres 2022-2023 dénombre 3 423 euthanasies en 2023, avec une augmentation de 12% par an. En 202438, ce sont près de 4.000 euthanasies qui ont été enregistrées, soit une augmentation de 16,6% par rapport à 2023, l’euthanasie représentant dorénavant 3,6% des décès. Depuis 2004, 427 euthanasies pour raisons psychiatriques hors démences ont été comptabilisées, dont 48 en 2023. Ce chiffre est le plus haut depuis l’entrée en vigueur de la loi. Plus de la moitié sont en relation avec un trouble dépressif, environ 15% avec un trouble de la personnalité, 9% avec trouble psychotique et 9% avec un syndrome post-traumatique ; 40% des personnes avaient réalisé des gestes suicidaires et 22% avaient été victimes d’abus sexuels ou de violences. Les différents rapports donnent des exemples d’euthanasies pratiquées chez des personnes jeunes ayant de telles caractéristiques et relevant authentiquement de soins psychiatriques.
La Commission ajoute, dans l’un de ses rapports, que « les tentatives de suicide ratées ont fait prendre conscience aux personnes concernées qu’il existait aussi une autre façon, plus digne, de mettre fin à ses jours39 ». Cette formulation particulièrement ambiguë permet d’entrevoir toute l’ambivalence de la Commission, et laisse entendre que le geste suicidaire en tant que tel est connoté comme comportement peu digne par rapport à l’euthanasie qui serait en revanche « une autre façon, plus digne, de mettre fin à ses jours ». De tels propos sont contraires aux messages de prévention du suicide et sont susceptibles de heurter le monde de la psychiatrie40.
Le sujet est tellement délicat que le Canada, qui s’était engagé à ouvrir l’aide active à mourir aux personnes atteintes de troubles psychiques, a pris la décision de reculer cette échéance à 2027, considérant ce sujet comme sensible, avec dans certains cas des difficultés à différencier clairement les demandes d’aide à mourir des idées suicidaires41. L’expérience suisse montre quant à elle qu’il est impossible de fixer des critères objectifs42.
Par ailleurs, le Comité des droits des personnes handicapées de l’Organisation des Nations unies, face à l’augmentation des euthanasies des personnes handicapées au Canada, a recommandé d’abroger l’ouverture de l’aide médicale à mourir pour les personnes dont « la seule condition médicale sous-jacente est une maladie mentale43 ».
Tout se passe comme si l’inclusion des troubles psychiatriques, en intensifiant les tensions éthiques, constituait le réel point de non-retour du débat sur la mort provoquée, et entrait en conflit direct avec les efforts de prévention du suicide. Mais les exclure est un leurre tant juridique que social.
Vers une remise en question de la prévention du suicide ?
Cette future loi relative au droit à l’aide à mourir, présentée comme une « loi de fraternité », un texte humaniste, qui place la « dignité » humaine au cœur de son projet pour « disposer de sa mort44 », est susceptible de mettre à mal la prévention du suicide sur au moins trois aspects : la médiatisation de situations singulières, la mise à disposition d’un moyen létal et le délit d’entrave.
Les situations singulières de personnes ayant demandé une mort provoquée à l’étranger font l’objet de reportages, d’articles de journaux aux témoignages émouvants45. Ces médias en parlent comme autant de victoires, d’avancées démocratiques, au nom de la dignité, de la liberté de choisir, pour éliminer la souffrance. C’est une valorisation, une revendication, parfois même une célébration de la mort provoquée, choisie au détriment de l’intime. Beaucoup plus rares sont les témoignages des personnes confrontées à la mort provoquée de l’un des leurs, et qui expriment tout autant leur désarroi, leur incompréhension et leur douleur face à ce qu’ils considèrent – et qui est – un suicide46.
Certains, dans leurs propos, osent un lien entre le taux de suicide élevé des personnes âgées et une demande préexistante de mort provoquée47, lien non démontré aujourd’hui. Des témoignages douloureux, y compris émanant de personnes politiques, semblent soutenir ces déclarations48, et montrent toute la portée de tels gestes sur ceux qui restent. Mais généraliser à partir de situations singulières et dramatiques reviendrait à assimiler le suicide des personnes âgées à des demandes de mort provoquée en faisant fi de la souffrance, de la dépression, de l’isolement et de la vulnérabilité, et ignorer ainsi l’aide qu’il est possible de leur apporter.
Il existe une réelle responsabilité des médias. De tels propos décomplexés autour d’une « mort plus digne » semblent résonner comme une véritable promotion de la mort provoquée, sans être pour autant accompagnés de messages de prévention du suicide. Ce sont autant de messages auxquels les personnes les plus vulnérables sont exposées, avec des risques de contagion par « effet Werther49 », via une identification verticale (décès de personnes connues) ou horizontale (conditions similaires à des situations émotionnelles intenses)50.
La façon dont on parle de la mort provoquée dans les médias peut progressivement influer sur l’opinion publique en donnant à penser que l’aide à mourir est un « bon mourir », un « bon pour mourir », une mort « plus digne et plus acceptable » que de faire face à la souffrance devenue intolérable. Notre société actuelle, dans sa quête incessante d’autonomie, conduit dès lors à la revendication à un « droit à mourir ».
La mise à disposition du produit létal
Le projet de loi décrit parfaitement – sans les nommer – les deux principales modalités de « l’aide à mourir », à savoir le « suicide assisté » et « l’euthanasie ». Le « suicide assisté », formule privilégiée dans le projet de loi, est défini par le fait de prendre soi-même le produit létal prescrit par un médecin. Or la stratégie nationale de prévention du suicide insiste sur cette même prévention d’un suicide qui ne peut être « assisté », ainsi que sur la nécessité de réduire l’accès aux moyens létaux. Dans cet ordre d’idées, le journal Le Monde51 rappelle que doit se tenir en 2025 un procès incriminant des militants d’Ultime Liberté, appartenant à la frange la plus radicale des tenants de la mort provoquée, qui permettrait à leurs adhérents souhaitant mettre fin à leurs jours de se procurer du pentobarbital, substance interdite en France.
Y aurait-il délit d’entrave ?
Tout en reconnaissant une clause de conscience s’appliquant uniquement aux médecins, et non aux pharmaciens chargés de la préparation létale, cette proposition de loi prévoit des peines pour quiconque serait en situation « d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen […] en exerçant des pression morales ou psychologiques […] à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur l’aide à mourir […]52 ». Pire, « toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits53 » peut alors se constituer partie civile.
Cet article n’existe dans aucune autre loi sur le sujet dans les pays étrangers. Il est redoutable sous tous ses aspects. L’expression « par tout moyen » s’avère extrêmement large et peut englober toute situation dans laquelle les soignants écoutent pour mieux comprendre la personne et cherchent potentiellement des solutions alternatives. Elle s’oppose au principe humain intangible de l’aide à autrui54 inscrit dans le Code pénal en son article 223-655, s’oppose au délit de provocation au suicide56, consacré à l’article 223-13, et encore plus clairement au délit d’incitation57 au suicide défini par l’article 223-1458. Il est enfin en contradiction avec la loi du 27 septembre 2013 permettant l’hospitalisation sans consentement d’une personne souffrant de « troubles mentaux » et ayant des projets suicidaires59.
Ce processus de normalisation voire de promotion de la mort choisie heurte profondément les concepts et les actions concrètes de la prévention du suicide.
Comme le souligne fort justement l’avis n°1 du Collectif Démocratie, Éthique et Solidarités, « [ce délit] est le premier pilier d’un projet de société tout autre, dont la préoccupation est non pas la lutte contre les douleurs réfractaires en fin de vie mais la volonté de prôner une autodétermination quasi absolue dans une approche ultralibérale60 ».
Une proposition de loi aux lourdes conséquences
Collectif Démocratie, Éthique et Solidarités, Fin de vie : les enjeux d’une loi en faveur d’une mort programmée, Avis n°1, 3 avril 2025 [en ligne].
Arnaud Larrouture, Les orthèses d’autonomie, Thèse de doctorat, Philosophie pratique, Université Gustave Eiffel, 2022, [en ligne].
Didier Sicard, « Point de vue du vivant sur la fin de vie », in Emmanuel Hirsch (Dir.), Fins de la vie : les devoirs d’une démocratie, Cerf, 2025, p. 25-30.
Théo Boer, « L’euthanasie légalisée va toujours plus loin », in Emmanuel Hirsch (Dir.), Fins de la vie : les devoirs d’une démocratie, Cerf, 2025, p. 517-523.
C’est une véritable ambivalence sociétale et politique qui sous-tend la demande d’une loi sur le droit à l’aide à mourir. Les pays ayant légiféré sur le sujet sont caractérisés par un niveau de vie élevé, avec les principes d’autonomie et d’individualisme érigés comme piliers de l’organisation sociétale. Or, perdre son autonomie signifie dépendance aux autres, et la maintenir nécessite le plus souvent des orthèses médicales et soignantes61.
L’intégration d’un « droit à mourir » dans la loi façonnera de nouvelles normes juridiques qui évolueront avec des élargissements – déjà annoncés par certains – ou les jurisprudences. C’est ainsi que l’accès au suicide assisté ou à l’euthanasie sera bientôt possible pour atténuer la souffrance psychique. Soutenue par un discours sociétal décomplexé, hyperbolique, émotionnel et valorisant, une nouvelle norme sociale apparaît, prônant une « culture de la mort programmée » qui « intégrera cette loi dans l’imaginaire et la morale d’une époque62 » avec une évolution progressive de la manière de penser la maladie et la mort, la mise en place d’une nouvelle pratique sociale où l’on aura, du moins dans le discours, la liberté de choisir.
Cette banalisation permettra de repousser les limites toujours plus loin, aux malades mentaux, aux mineurs, aux handicapés, etc.
Émergera également une nouvelle perception de la souffrance, qui sera par nature « intolérable », et donc soumise à l’autodétermination de la personne, conduisant au risque suivant : « plus la mort est invoquée comme un remède efficace à une souffrance insupportable, plus nous en sommes venus à croire que nous ne pouvons pas faire face à cette souffrance63 ».
Conclusion
Yves Gallien, Sandrine Broussouloux, Alice Demesmaeker, Anne Fouillet, Clément Mertens, Francis Chin, Guillaume Cassourret, Céline Caserio-Schonemann, Enguerrand du Roscoät, Yann Le Strat, VigilanS Collaborators, “Outcomes and Cost-Benefit of a National Suicide Reattempt Prevention Program” (Résultat et rapport coût-bénéfice d’un programme national de prévention du suicide), Réseau JAMA, août 2025, vol. 8, n° 8 [en ligne].
Gouvernement du Canada, Bureau du directeur parlementaire du budget, Estimation des coûts du projet de loi C-7 (Aide médicale à mourir), 20 octobre 2020 [en ligne].
Yves-Marie Doublet et Pascale Favre, Les non-dits économiques et sociaux du débat sur la fin de vie, Fondapol, janvier 2025 [en ligne].
Yves-Marie Doublet, Suicide assisté, euthanasie : le choix de la rupture et l’illusion d’un progrès, Fondapol, mars 2024 [en ligne].
Emmanuel Hirsch, Fins de la vie : les devoirs d’une démocratie, Cerf, 2025.
Dans le domaine des soins, malgré une prévention active du suicide déployant des actions dynamiques reconnues, c’est un réel marasme qui envahit le monde de la santé et plus particulièrement la psychiatrie, alors même que cette dernière traverse une crise structurelle et identitaire sans précédent comme nous avons pu le voir. Le système sanitaire français dessine un avenir peu radieux présentant des soins à plusieurs vitesses selon le lieu d’habitation, les ressources financières et sociales, menaçant de laisser de côté les plus vulnérables (personnes seules, âgées, précaires, vulnérabilités associées). Dans un tel contexte, une loi sur l’aide à mourir peut laisser penser que le suicide assisté et l’euthanasie seraient un soin voire un traitement, une solution comme une autre à des souffrances profondes, voire une solution aux souffrances existentielles, sur fond d’autodétermination érigée comme un droit, une porte de sortie face à la pression sociale.
Ce qui pose la question des limites de ce que l’on fait, des limites que met une société dans l’application d’une telle loi, des limites que s’impose un corps professionnel dans ce qu’il accepte de faire, des limites morales personnelles. Ce qui pose la question du soin, de la prise en charge des plus vulnérables, nombreux dans le domaine de la santé mentale, et de la solidarité, ainsi que la question de la qualité du système de santé que l’on souhaite dans une société où l’accès aux soins, et plus particulièrement aux soins palliatifs, n’est plus garantie pour tous. Ce qui pose la question d’une société dans laquelle les analyses coût-économies montrent certes les avantages d’un programme de recontact des suicidants tel VigilanS64, mais également dans certains pays les avantages financiers de l’aide à mourir en période de restrictions budgétaires et d’économies forcées65.
Il nous faut oser nous demander si derrière une apparente ambivalence ne se cache pas une volonté délibérée mais déguisée d’un changement de modèle sociétal et du soin qui ne peuvent s’énoncer officiellement, et savoir si le choix sociétal « de plus grande humanité » proposé n’est pas en réalité motivé par des intérêts financiers non énoncés mais bien présents66.
Cette future loi confrontera nécessairement notre société à une quadruple rupture67 : sémantique, éthique, juridique et médicale. Malgré toutes les précautions et les garde-fous instaurés, son champ d’application sera entaché de dérives, bien identifiées dans les pays étrangers, sera soumis à des tensions d’ordre éthique maximales dès lors que les frontières entre l’aide à mourir et le suicide sont floues. Non seulement une telle loi entre en conflit, de manière subtile mais évidente, avec l’idée généreuse et bienveillante de la prévention du suicide, mais également, en abordant le thème plus large des « fins de la vie », renvoie à la façon dont chacun d’entre nous, notre société, aborde et abordera « les devoirs d’une démocratie68 ».


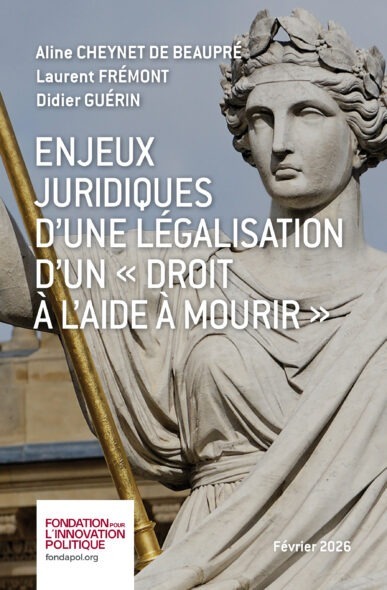
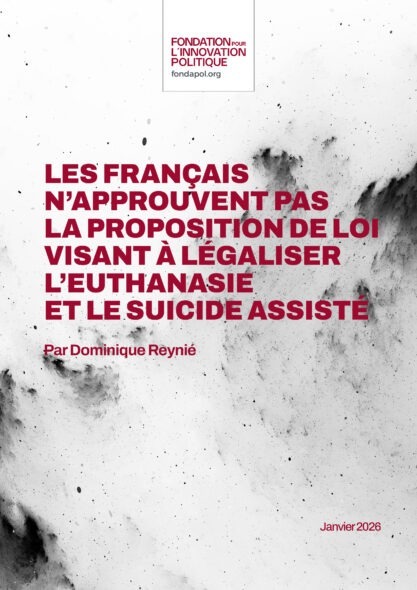






Aucun commentaire.