
Immigration : quarante ans de lois pour rien ?
Charles Sapin | 06 novembre 2023
Le projet de loi Darmanin, discuté ce 6 novembre au Sénat, pourrait être le 30e texte sur l’immigration adopté depuis 1980. Radiographie d’un échec politique.
Il est visiblement des Sisyphe heureux. D’ici à la fin de l’année, la France s’apprête à discuter puis vraisemblablement adopter un nouveau texte législatif ayant trait à l’immigration. Encore un. Depuis la Seconde Guerre mondiale, le pays a connu une réforme migratoire en moyenne tous les deux ans. Le « Projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration », est examiné au Sénat ce 6 novembre après moult reports et atterrira à l’Assemblée au plus tard à la mi-décembre. Il sera très exactement… le trentième du genre depuis 1980. La multiplication des flux migratoires par trois en Méditerranée l’an passé comme le récent attentat terroriste d’Arras ne laissent d’autre choix à l’exécutif que de légiférer, une fois de plus, cinq ans seulement après la précédente réforme, celle de Gérard Collomb.
Mais pour quels résultats ? Jamais ouvrage n’aura autant été remis sur l’établi parlementaire. Sans qu’il parvienne, jamais, à obtenir de résultats tangibles – comme tarir l’accélération des arrivées ou reléguer la thématique de l’immigration en queue des préoccupations des Français. Nicolas Sarkozy appelait à une « immigration choisie » lors de sa campagne présidentielle de 2007. François Hollande à une « immigration intelligente » en 2012. François Mitterrand, lui-même, ambitionnait de « réduire le nombre » d’immigrés en France lors de sa campagne pour un second mandat en 1988. En vain.
« Stop and go » successifs
Quelles que soient les promesses de maîtrise des flux, les chiffres ont continué leur course indifférente à la parole politique. Jusqu’à ce que le stock de permis de séjour atteigne, en 2022, le seuil inédit de 3,7 millions de personnes. Soit 25 % de plus qu’en 2017 et 47 % de plus qu’en 2012. Les demandes d’asile, quant à elles, ont bondi de 227 % par rapport à 2009. Comment expliquer un tel échec des politiques publiques, devenu l’illustration reine de l’impuissance de l’État et, du même coup, le terreau fertile du Front devenu Rassemblement national ? « Ce sont des sujets très compliqués », botte en touche un préfet, pourtant ancien directeur d’administration centrale spécialisé dans lesdits sujets. L’examen attentif des différents textes sur l’immigration soumis à la représentation nationale ces quarante dernières années, sans compter les innombrables ordonnances, décrets, arrêtés ou circulaires, apporte pourtant des premiers éléments de réponse.
Point de clivage primordial entre droite et gauche, le sujet de l’immigration aura sans cesse vu s’affronter les majorités successives, l’une effaçant bien souvent l’œuvre de sa prédécesseure, peu de temps avant de voir, à son tour, son travail rayé d’un trait de plume, l’heure de l’alternance venue. Première loi véritable contre l’immigration clandestine, la loi Bonnet de janvier 1980 simplifie la procédure d’expulsion et crée la possibilité d’une rétention administrative des étrangers sommés de quitter le territoire. Vingt-deux mois et une élection présidentielle plus tard – celle du socialiste François Mitterrand –, la loi Questiaux réduit pour ainsi dire à néant la loi précédente, en durcissant drastiquement les conditions d’expulsion d’un étranger du sol français. Du moins jusqu’à 1986. La cohabitation, avec le retour de la droite au gouvernement, permettra au nouveau ministre de l’Intérieur de faire adopter la loi Pasqua, rétablissant les dispositions de la loi Bonnet et confiant au seul préfet le pouvoir d’éloigner un étranger. Des mesures sur lesquelles s’empressera de revenir son successeur, Pierre Joxe, en 1989, un an après la réélection de François Mitterrand à l’Élysée. En profitant pour multiplier les voies de recours possibles pour un étranger sous le coup d’une procédure d’éloignement, désormais sous le contrôle du juge judiciaire.
Les conditions du regroupement familial, les modalités d’obtention d’un titre de séjour ou le droit du sol n’ont ainsi cessé, quarante ans durant, à jouer à l’essuie-glace, parfois même entre deux gouvernements d’une même famille politique. Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’Intérieur et adepte de triangulation politique, exaucera ainsi, en 2003, les vœux de la gauche en restreignant à la portion congrue une mesure phare de son camp : la double peine, c’est-à-dire l’expulsion du territoire d’un délinquant étranger à l’issue de sa peine de prison. Une possibilité que l’actuel ministre de l’Intérieur, pourtant sarkozyste assumé, ambitionne de rétablir dans son intégralité cet hiver. « On a beaucoup de mal dans notre pays à dégager sur ce sujet de l’immigration un consensus transpartisan. Du coup, les majorités successives font du stop and go, voire un pas en avant et deux pas en arrière, témoigne Patrick Stefanini, ancien secrétaire général du ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Développement solidaire. Cela ne favorise pas la stabilité et donc l’efficacité de la législation puisqu’il faut, chaque fois, que l’administration s’y adapte. » Le préfet Michel Aubouin, ancien directeur de l’accueil, de l’intégration et de la citoyenneté au ministère de l’Intérieur, abonde : « Aujourd’hui, plus personne, ni au sommet de l’État ni au guichet d’une préfecture, n’est capable de retenir les mille subtilités d’un droit devenu inapplicable, d’autant qu’aux décisions jurisprudentielles, aux lois et aux décrets s’ajoutent des circulaires, publiées ou non, dont l’effet s’ajoute au reste… »
Un méandre juridique
Là réside la seconde explication de l’échec des politiques migratoires en France. Au gré de ces allers-retours parlementaires, la logique voudrait que la législation propre au droit des étrangers parvienne à une forme d’équilibre entre les réformes allant dans le sens d’une plus grande ouverture et celles instituant au contraire un cadre plus restrictif. C’est omettre que les premières ne rencontrent jamais aucun problème d’exécution et ont plutôt tendance à surperformer, quand les secondes peinent systématiquement à être mise en œuvre et butent sur une multitude d’obstacles juridiques et jurisprudentiels. « En termes d’effectivité, il y a clairement une asymétrie », abonde Patrick Stefanini. « Aucun pouvoir politique n’a jamais été véritablement capable de faire exécuter les lois qu’il a fait passer, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Il y a un problème administratif », reconnaît Philippe Brun, ancien juge spécialisé en droit des étrangers, aujourd’hui député PS de l’Eure. Année après année, la législation est devenue broussailleuse, pour ne pas dire labyrinthique. Au point de porter à plus de 1 500 pages le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda), créé en 2006. Un méandre juridique dont profitent avocats spécialisés et associations pro-immigration, à l’image de la Cimade ou du Groupe d’information et de soutien des immigrés (Gisti). « Nous sommes dans un système kafkaïen où la politique de l’asile, par exemple, a été totalement externalisée à ces acteurs », livre au Point un juge de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), devenue la première juridiction de France avec 45 000 dossiers par an.
« Les réseaux de passeurs fournissent aux candidats à l’asile des kits comprenant faux papiers, traversée et surtout le narratif à dérouler devant la CNDA ou l’Office français de protection des réfugiés et apatrides [Ofpra]. Les associations telles que la Cimade ou France terre d’asile prennent ensuite le relais pour s’assurer que les demandeurs bénéficient de toutes les failles ou largesses de notre droit afin que leur demande soit certaine d’aboutir ou, à défaut, qu’ils ne soient jamais expulsés », relate le magistrat, citant volontiers pour exemple le cas de la famille du terroriste d’Arras, Mohammed Mogouchkov. Après six années de recours infructueux pour obtenir l’asile devant l’Ofpra, la CNDA, le tribunal administratif et la cour administrative d’appel, cette famille s’est vu opposer plusieurs obligations de quitter le territoire (OQTF). Avant de voir finalement son expulsion stoppée par le cabinet du ministre de l’Intérieur de l’époque, Manuel Valls, sous la pression d’associations et de collectifs pro-immigration… Dans le cas d’une résistance du pouvoir politique, il reste à ces associations les recours aux différentes juridictions nationales et européennes qui développent une jurisprudence chaque année plus protectrice du droit des étrangers.
L’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (Anafé) s’est ainsi félicitée, non sans raison, qu’à la suite de sa saisine la Cour de justice de l’Union européenne ait « vidé de sa substance les effets des refus d’entrée » sur le territoire. Dans son arrêt du 21 septembre dernier, la juridiction européenne a en effet statué, malgré le rétablissement des frontières nationales depuis 2015, que les forces de l’ordre françaises ne pouvaient refouler à la frontière un étranger entré irrégulièrement sans lui laisser un « certain délai » pour quitter le territoire… volontairement. « Autrement dit, la France peut “inviter” les migrants franchissant irrégulièrement la frontière franco-italienne à quitter le territoire de la République, mais elle ne peut leur interdire ce franchissement », déplore l’ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel Jean-Éric Schoettl. L’histoire n’est pas nouvelle. Lorsqu’en 1977 le gouvernement entend restreindre le regroupement familial devant l’ampleur des flux qu’il suscite, le Conseil d’État, saisi par le Gisti, casse le décret, allant jusqu’à reconnaître le « droit de mener une vie familiale normale » comme un principe général du droit, résultant du préambule de la Constitution de 1946. Interdisant, depuis lors, à la représentation nationale et aux gouvernements successifs d’en restreindre la portée.
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) ne tardera pas à emboîter le pas au Conseil d’État, déjà imité par le Conseil constitutionnel. En étendant notamment l’interprétation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme – consacrant un droit à la vie privée et familiale essentiellement utilisé, jusque-là, pour garantir le secret des correspondances – pour en déduire une sanctuarisation du regroupement familial qui vise à limiter nombre de décisions de renvoi et d’expulsion nationales. Les sages de la Rue de Montpensier ne sont pas en reste. Poursuivi pour « aide à l’entrée et à la circulation d’étrangers en situation irrégulière », le militant Cédric Herrou les saisit d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) en 2018. Le Conseil constitutionnel consacre alors un principe à valeur constitutionnelle de fraternité, dépénalisant le fait d’aider les migrants à traverser illégalement la frontière, dès lors qu’« un motif humanitaire » est invoqué. Les pouvoirs publics n’ont d’autre choix que de s’y soumettre. « En réalité, sur l’immigration, le législateur ne fait que déplacer les curseurs en espérant que cela passera la barrière du Conseil constitutionnel, note Patrick Stefanini. Mais nous sommes confrontés à un nouveau défi, celui d’un terrorisme diffus dont les acteurs sont des personnes résidant régulièrement en France et capable de frapper partout et à tout moment sans préavis. J’espère que le Conseil constitutionnel saura, dans sa sagesse, prendre en compte ce risque terroriste en établissant dans sa jurisprudence un nouvel équilibre entre les droits individuels et l’impératif de protection de nos concitoyens. »
Reste à savoir quelle sera, ces prochaines semaines, l’ambition du gouvernement et de la représentation nationale. « L’ensemble de la réforme à venir est inutile », juge le socialiste Philippe Brun. « Les délais de recours sur lesquels se concentre l’exécutif ne sont pas le problème. Quant à l’article 3 [qui prévoit la régularisation de clandestins travaillant dans les métiers en tension, NDLR], cela devrait relever, au mieux, d’une directive administrative, pas de la loi », souligne l’élu alors que le débat politique se concentre sur ce seul point.
« Danemark, Suède, Finlande, Italie, et même désormais Allemagne, la plupart des pays européens font beaucoup d’efforts pour réduire l’intérêt qu’il y a à venir chez eux, avec un véritable effet dissuasif pour tous ceux qui n’ont pas les meilleures chances d’obtenir l’asile et de s’intégrer. Le problème est que les flux ne se tarissent pas mais se redirigent. Or nous avons aujourd’hui, en France, le système le plus attractif en Europe », livre Dominique Reynié, directeur général de la Fondation pour l’innovation politique. Dans une note publiée en mars intitulée « Immigration : comment font les autres pays européens », le think tank ancré à droite souligne que les États membres ayant réussi à la fois à juguler l’immigration à laquelle ils sont confrontés et à intégrer les personnes sur leur sol ont tous considérablement réduit leur attractivité vis-à-vis des ressortissants extra-européens. Que ce soit en restreignant les prestations sociales à destination des étrangers en situation légale ou illégale ; en réduisant l’effet des diasporas par la dénonciation, notamment, des accords bilatéraux avec les pays de départ facilitant les conditions d’entrée et de séjour ; ou en resserrant drastiquement les conditions d’accès à la nationalité. Aucun de ces points n’est, pour l’heure, abordé par le projet de loi immigration et intégration porté par le gouvernement.
Retrouvez l’article sur lepoint.fr
Dominique Reynié (Dir), Immigration : comment font les États européens, Fondation pour l’innovation politique, mars 2023.





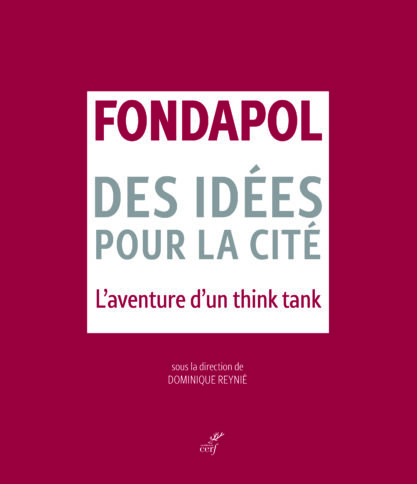



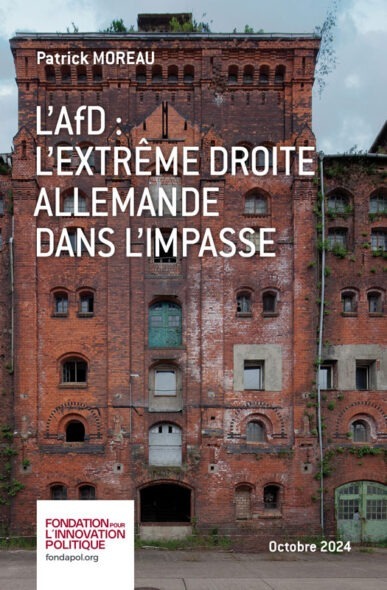



Aucun commentaire.