
« Penser différemment les écosystèmes »
12 mars 2021
La Fondation pour l’innovation politique (Fondapol) a publié le septième volet de sa série consacrée aux agritechnologies et aux biotechnologies. Cette étude, réalisée par Christian Lévêque, tente de répondre à la question : « Reconquérir la biodiversité, mais laquelle ? ».
Adoptée en 2016, la loi sur la biodiversité ne manque pas d’interroger. Au mois de septembre dernier, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) dressait un bilan plutôt décevant de cette loi expliquant qu’elle était mal appliquée.
Deux mois plus tard, l’Assemblée permanente des Chambres d’agriculture (APCA) se demandait si la biodiversité et l’alimentation avaient un avenir en commun, concluant sur la nécessité de répondre aux attentes de la société et de redonner une ambition aux agriculteurs. Dans sa longue note d’une trentaine de pages, Christian Lévêque, directeur de recherches émérite de l’Institut de recherches pour le développement (IRD) et président honoraire de l’Académie d’agriculture de France, se pose la question de la définition de cette biodiversité à défendre.
« Le futur ne sera jamais le passé »
Pour lui, cette biodiversité est protéiforme et fluctue au gré du temps. Elle est « le produit d’une co-construction entre processus spontanés et aménagements qui se sont succédés au cours des siècles. Elle a changé en permanence sous l’effet des changements climatiques, de l’anthropisation des territoires et des nombreuses espèces introduites volontairement ou accidentellement », explique-t-il.
Avec beaucoup de pédagogie, il explique cette « anthropisation très ancienne », citant l’exemple des agriculteurs venus du Croissant fertile apportant avec eux des espèces qu’ils cultivaient« mais aussi les espèces commensales ou les plantes messicoles ». L’agriculture elle-même a apporté sa pierre à l’édification de la biodiversité en valorisant des systèmes écologiques que l’on ne remet pas en cause : la Camargue, les Dombes, la Sologne, etc. « Le passé explique l’état présent mais le futur ne sera jamais le passé », avertit Christian Lévêque.
« Regarder la réalité en face »
Poussant plus loin sa réflexion, il explique que l’équilibre de la nature est un « concept écologique équivoque ». Il reprend ainsi l’intervention de Michel Serres devant le Forum pour une agriculture raisonnée et respectueuse de l’environnement (FARRE) en 2006 qui affirmait : « (…) la nature est toujours en évolution, donc toujours en déséquilibre. Sauver un équilibre est un concept politique, ce n’est pas un concept savant (…) ». Ce qui aboutit à l’affrontement de deux conceptions de l’organisation et du fonctionnement des écosystèmes : d’une part, une conception déterministe de la nature, qui privilégie un « ordre de la nature » et dont les tenants « appuient leurs discours sur une vision romantique de la nature » ; et d’autre part, une conception opportuniste dans laquelle la nature s’adapte, sans projet précis. Puis le président honoraire demande de « regarder la réalité en face », notamment sur la question des espèces « nuisibles » qui ont été rebaptisées dans la loi de 2016 « animaux susceptibles d’occasionner des dégâts » et sur celle des espèces devenues invasives et qui, une fois installées ont du mal à être éradiquées.
« Droit flexible et réactif »
Pour l’ancien directeur de recherches, la question de la protection de la biodiversité se pose différemment selon les régions du monde, lesquelles n’ont pas la même histoire climatique et évolutive et qui en sont à des degrés d’anthropisation très différents.
Ainsi « que vont devenir nos bocages si nous mangeons moins de viande et si l’élevage périclite ? », s’inquiète-t-il. Militant pour un droit de l’environnement « flexible et réactif », il ne s’agit pas, pour lui, de privilégier la nature au détriment de l’homme, « mais de travailler de façon à rendre compatibles usages et préservation des écosystèmes ». Une démarche adaptative et pragmatique en somme !
| Ne pas encourager le bio « haut de gamme »
La Fondation pour l’innovation politique estime dans une synthèse publiée le 2 mars que « l’État n’a pas à encourager financièrement des productions de produits alimentaires qui se positionnent dans le haut de gamme comme le sont les produits bio ». L’objectif fixé par la loi Égalim de 20 % de produits biologiques dans la restauration scolaire risque ainsi selon le think tank de créer « un marché captif », et de fausser la concurrence. De même, des éventuels allègements de TVA sur la bio reviendraient, selon Gil Kressmann, auteur de la note Quel avenir pour l’agriculture et l’alimentation bio ? (Fondation pour l’innovation politique, mars 2021), à « un sur-subventionnement du bio sur fonds publics ». Ces aides seraient d’autant plus risquées, selon la Fondation pour l’innovation politique, que la croissance actuelle du bio pourrait se retourner contre le label lui-même, avec un risque « d’éclatement d’une bulle de marché ». En Autriche, illustre l’auteur du rapport, le prix des céréales bio aurait notamment chuté de près de 30 % entre 2017 et 2019, et se vendrait parfois sur le marché international au prix du conventionnel face à l’augmentation des surfaces. La Fondation pour l’innovation politique suggère en conclusion de limiter l’action publique dans le secteur à « la transformation nécessaire de nos filières bio pour qu’elles deviennent leaders européens ». |
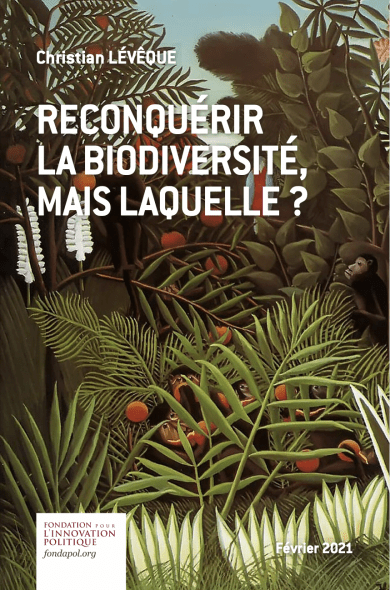
Christian Lévêque, Reconquérir la biodiversité, mais laquelle ? (Fondation pour l’innovation politique, février 2021).
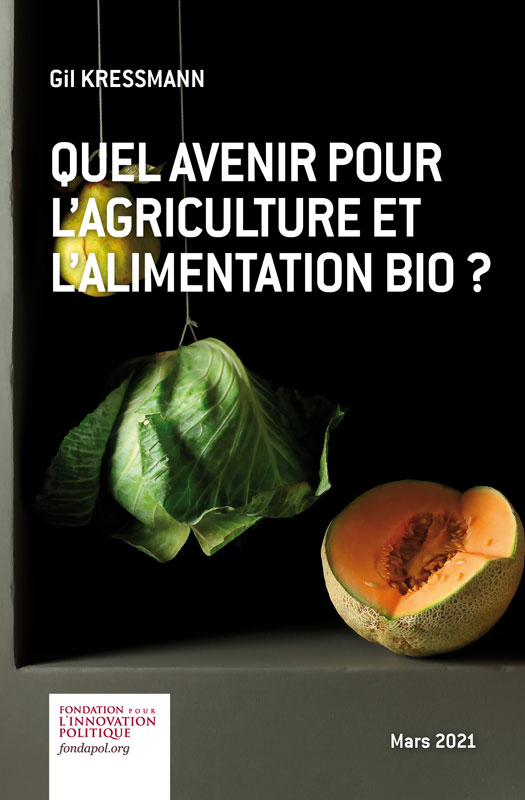
Gil Kressmann, Quel avenir pour l’agriculture et l’alimentation bio ? (Fondation pour l’innovation politique, mars 2021).












Aucun commentaire.