Ce que notre rapport à la concurrence dit de la démocratie
02 février 2019
Réfléchissant à l’effondrement de la démocratie hongroise à l’approche de la Seconde guerre mondiale, Sandor Marai décrivait une bourgeoisie apathique qui cohabitait en l’ignorant avec une colère sociale sourde. Il soulignait que, dans cette société cloisonnée, l’élite était devenue une caste qui « récusait (…) la libre concurrence, qui ne connaît d’autres lois que celles, naturelles, du talent, du savoir, de l’offre et de la demande » (1).
Ce que Marai décrit à propos du politique se retrouve dans le domaine économique : les acteurs en place se défient de l’opérateur qui perturbe l’équilibre existant. Dans Le Bonheur des Dames, Zola rapporte les réflexions de l’épouse de Robineau, dont l’activité est menacée par le grand magasin : « sans doute, le client était satisfait, puisque, en fin de compte, c’était le client qui bénéficiait de la baisse des prix. Seulement, il fallait bien que chacun vécût ». La question de la défense des producteurs anciens face aux entrants n’est pas nouvelle.
Ces deux réactions hostiles traduisent une revendication récurrente face à la dynamique mouvementée de la concurrence : la demande de préservation de stabilité. Cette attente est légitime : personne n’aime voir sa situation remise en cause. Le chauffeur de taxi qui s’est endetté pour acquérir sa licence a raison de s’inquiéter pour son avenir si elle perd sa valeur. Le fonctionnaire parvenu à se hisser au sommet de l’administration n’est pas le mieux placé pour remettre en cause le budget dont il a la charge et qui justifie sa carrière comme son salaire. Le chef d’entreprise qui préside à la destinée d’un groupe ne se réjouit pas spontanément de l’entrée sur le marché d’un concurrent plus agile et performant.
Deux stratégies politiques sont schématiquement envisageables pour répondre aux revendications de ces potentielles victimes des transformations économiques et sociales.
La première mise sur la flexibilité et la mobilité pour faciliter le cycle continu des destructions créatrices. Le politique s’y fait modeste, acceptant son incapacité de prédiction ; le rôle de l’Etat y est limité et son intervention réparatrice. Cette société de marché est instable : l’équilibre social est reconfiguré à chaque instant par la confrontation de nouvelles solutions individuelles.
La seconde cherche à préserver la stabilité sociale pour protéger les citoyens de heurts économiques brutaux. Le politique y est devin ; l’Etat, qui prétend y anticiper les mutations, intervient de façon préventive, régulant les choix individuels dont il se défie. Il se fait nécessairement contraignant : toute déviation est une atteinte à l’intérêt collectif qu’il a défini de façon immanente.
Ces deux modèles sont évidemment caricaturaux, mais ils sont des guides éclairants : leur différence réside dans la propension de chaque société à accepter une part d’aléa. Plus celle-ci est restreinte, plus la concurrence est encadrée, plus les choix individuels sont contraints, plus la liberté régresse.
La concurrence est synonyme d’imprévisibilité. En cela, elle est angoissante et épuisante pour les individus. Le défi de nos sociétés démocratiques est d’inventer le compromis social qui rend cette incertitude acceptable, sans asphyxier la liberté. L’enjeu est là, car historiquement, la défiance vis-à-vis de la concurrence et de la liberté a conduit aux pires extrêmes.
(1) Ce que j’ai voulu taire




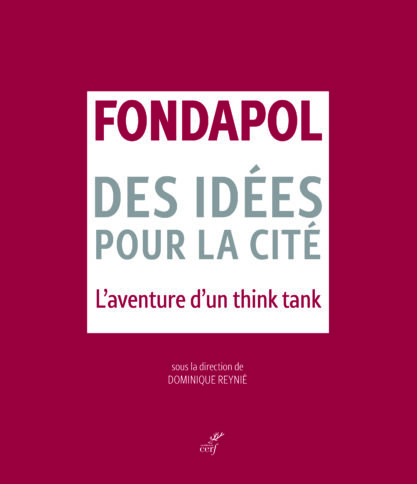



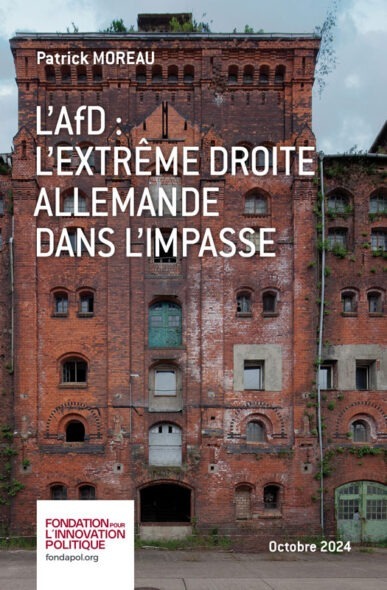



Aucun commentaire.